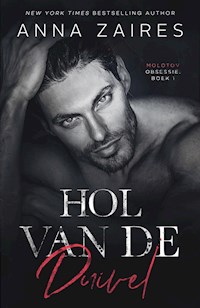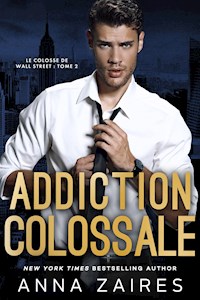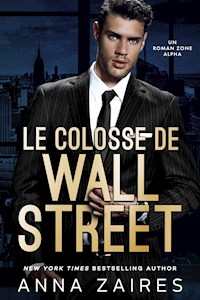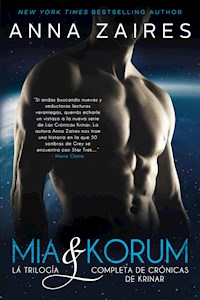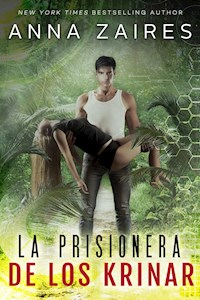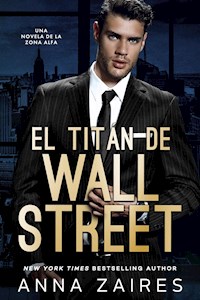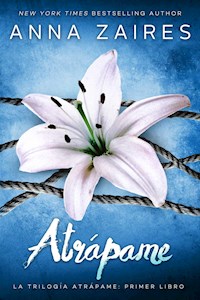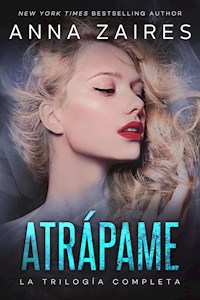6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Mozaika Publications
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une nouvelle dark romance de l’auteure Anna Zaires meilleures ventes du New York Times
Il est venu à moi dans la nuit, un sombre et cruel étranger des coins les plus dangereux de la Russie. Il m'a tourmentée et m'a détruite, mettant en pièces mon monde dans sa quête de vengeance.
Maintenant, il est de retour, mais ce n’est plus après mes secrets.
L’homme qui joue dans mes cauchemars me veut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mon tourmenteur
Anna Zaires
♠ Mozaika Publications ♠
Table des matières
Partie 1
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Partie 2
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Chapitre 37
Chapitre 38
Chapitre 39
Chapitre 40
Partie 3
Chapitre 41
Chapitre 42
Chapitre 43
Chapitre 44
Chapitre 45
Extrait de L’Enlèvement
Extrait de Capture-Moi
Extrait de La captive des Krinars
À propos de l’auteur
Ceci est une œuvre de fiction. Les noms, personnages, lieux et incidents sont soit le produit de l’imagination de l’auteur, soit utilisés de façon fictive et toute ressemblance avec des personnes, vivantes ou décédées, des établissements commerciaux, des événements ou des lieux existants est purement une coïncidence.
Copyright © 2017 Anna Zaires
http://annazaires.com/series/francais/
Tous droits réservés.
À l’exception d’un usage pour une critique, aucune partie de ce livre ne peut être reproduite, numérisée ou distribuée de façon imprimée ou électronique sans permission.
Publié par Mozaika Publications, une mention légale de Mozaika LLC.
www.mozaikallc.com
Couverture: Najla Qamber Designs
najlaqamberdesigns.com
Sous la direction de Valérie Dubar
Traduction : Sarah Morel
e-ISBN: 978-1-63142-252-2
Print ISBN: 978-1-63142-253-9
Partie I
1
5 ans plus tôt, monts du Caucase du Nord
Peter
— Papa !
Le cri aigu est suivi par l’écho de petits pieds alors que mon fils se propulse dans l’encadrement de la porte, ses boucles foncées bondissant autour de son visage illuminé.
En riant, j’attrape son petit corps robuste comme il se jette sur moi.
— Je t’ai manqué, pupsik ?
— Oh oui !
Ses petits bras entourent mon cou et j’inspire profondément, sa douce odeur d’enfant emplissant mon nez. Bien que Pasha ait presque trois ans, il sent encore le lait, le bébé en bonne santé et l’innocence.
Je le serre fort et la froideur qui m’habite est chassée par une chaleur lumineuse qui emplit ma poitrine. La sensation est douloureuse, comme si j’étais submergé dans de l’eau chaude après avoir été gelé, mais c’est une bonne douleur. Elle me fait sentir vivant, remplit toutes les fissures vides en moi, jusqu’à ce que j’aie presque l’impression d’être complet et de mériter l’amour de mon fils.
— Tu lui as manqué, dit Tamila, en entrant dans le hall.
Comme toujours, elle se déplace discrètement, presque sans bruit, les yeux baissés. Elle ne me regarde pas directement. Depuis son enfance, on lui a appris à éviter le regard des hommes. Je ne vois donc que ses longs cils noirs, alors qu’elle fixe le plancher. Elle porte un foulard traditionnel qui dissimule sa longue chevelure foncée, et sa robe grise est longue et informe. Pourtant, elle me semble toujours belle, aussi belle que lorsqu’elle s’est glissée dans mon lit, trois ans et demi plus tôt, pour échapper à un mariage avec un ancien du village.
— Et vous m’avez tous deux manqué, dis-je, alors que mon fils pousse sur mes épaules, voulant être reposé.
En souriant, je le dépose au sol et il attrape immédiatement ma main, la tirant vers lui.
— Papa, veux-tu voir mon camion ? Veux-tu, papa ?
— Bien sûr, dis-je, en souriant de plus belle, alors qu’il me tire à sa suite vers la salle de séjour.
— Quel genre de camion ?
— Un gros camion !
— Oh, montre-le-moi.
Tamila nous suit, et je réalise que je ne lui ai pas encore adressé la parole. En m’arrêtant, je me retourne et regarde ma femme.
— Comment vas-tu ?
Elle me jette un œil à travers ses cils.
— Je vais bien. Je suis heureuse de te voir.
— Et je suis heureux de te voir.
Je veux l’embrasser, mais je la rendrais mal à l’aise si je le fais devant Pasha, alors je me retiens. Je lui caresse plutôt la joue, doucement, puis je laisse mon fils me tirer vers son camion, celui que je lui ai envoyé de Moscou, il y a trois semaines.
Il me montre avec fierté toutes les particularités de son jouet alors que je m’accroupis à ses côtés, en observant son visage animé. Il possède la beauté sombre et exotique de Tamila, jusqu’aux cils, mais il a un peu de moi aussi en lui, même si je ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus.
— Il possède ta témérité, dit Tamila doucement, en s’agenouillant près de moi. Et je crois qu’il sera aussi grand que toi, même s’il est probablement trop tôt pour le savoir.
Je la regarde. Elle me surprend souvent ainsi, m’observant avec tant d’attention que j’ai l’impression qu’elle lit dans mes pensées. Bien qu’il ne soit pas difficile de deviner mes pensées ; j’ai tout de même demandé un test de paternité avant la naissance de Pasha.
— Papa, papa.
Mon fils tire sur ma main à nouveau.
— Joue avec moi.
Je ris et reporte mon attention sur lui. Pendant l’heure qui suit, nous jouons avec le camion et une dizaine d’autres jouets, chacun d’entre eux, un type de véhicule. Pasha est obnubilé par les véhicules-jouets, des ambulances aux voitures de course. Peu importe le nombre de jouets que je lui offre, il joue uniquement avec ceux qui possèdent des roues.
Après le jeu, nous dînons, et Tamila donne le bain à Pasha avant l’heure du coucher. Je remarque que la baignoire est craquée et je prends note d’en commander une nouvelle. Le petit village de Daryevo est haut dans les monts Caucase et difficile d’accès. Je ne peux donc pas demander une livraison normale d’un magasin, mais j’ai les moyens de faire monter des choses ici.
Lorsque je mentionne l’idée à Tamila, elle relève les yeux et me lance l’un de ses rares regards directs, accompagné d’un sourire lumineux.
— Ce serait vraiment bien, merci. Je dois essuyer le plancher pratiquement tous les soirs.
Je lui retourne son sourire et elle termine le bain de Pasha. Une fois qu’il est sec et vêtu de son pyjama, je le porte jusqu’à son lit et lui lis une histoire de son livre préféré. Il s’endort presque immédiatement et j’embrasse son front lisse, mon cœur se serrant sous l’effet d’une émotion puissante.
De l’amour. Je le reconnais, même si je ne l’ai jamais ressenti avant, même si un homme comme moi n’a aucun droit de le ressentir. Aucun de mes actes passés n’a d’importance ici, au cœur de ce petit village du Daguestan.
Lorsque je suis auprès de mon fils, le sang sur mes mains ne brûle pas mon âme.
Soucieux de ne pas réveiller Pasha, je me lève et sors silencieusement de la petite pièce qui lui sert de chambre. Tamila m’attend déjà dans notre chambre, alors j’enlève mes vêtements et la rejoins dans le lit, lui faisant l’amour aussi tendrement que je le peux.
Demain, je devrai faire face à la laideur de mon monde, mais ce soir, je suis heureux.
Ce soir, je peux aimer et être aimé.
— Ne pars pas, papa.
Le menton de Pasha tremble alors qu’il retient avec peine ses larmes. Tamila lui a dit quelques semaines plus tôt que les grands garçons ne pleurent pas, et il fait de son mieux pour être un grand garçon.
— Je t’en prie, papa. Reste un peu plus longtemps.
— Je serai de retour dans deux semaines, lui dis-je, en m’accroupissant à la hauteur de ses yeux. Je dois aller travailler, vois-tu.
— Tu dois toujours travailler.
Son menton tremble un peu plus et ses grands yeux bruns débordent de larmes.
— Pourquoi je ne peux pas y aller avec toi ?
Des images du terroriste que j’ai torturé la semaine dernière emplissent mon esprit, et il me faut toute ma force pour garder une voix égale, alors que je lui réponds :
— Je suis désolé, Pashen’ka. Mon travail n’est pas un endroit pour les enfants.
Ou même pour les adultes, mais je me tais. Tamila sait un peu ce que je fais au sein d’une unité spéciale de la Spetsnaz, les forces spéciales russes, mais elle ignore tout des réalités sombres de mon monde.
— Mais je serai tranquille.
Il pleure maintenant à chaudes larmes.
— Je te le promets, papa. Je serai tranquille.
— Je sais.
Je l’attire contre moi et le serre étroitement, son petit corps tremblant sous les sanglots.
— Tu es mon bon garçon, et tu dois être bon pour maman pendant mon absence, oui ? Tu dois prendre soin d’elle, comme un grand garçon.
Ces mots semblent magiques, car il renifle et se recule.
— Oui.
Son nez coule et ses joues sont humides, mais son petit menton est résolu lorsqu’il croise mon regard.
— Je vais prendre soin de maman, je le promets.
— Il est si intelligent, dit Tamila, en s’agenouillant à mes côtés pour prendre Pasha dans ses bras. Il semble plus près des cinq ans que des trois ans.
— Je sais.
Ma poitrine se gonfle de fierté.
— Il est incroyable.
Elle sourit et croise mon regard à nouveau, ses grands yeux bruns si semblables à ceux de Pasha.
— Sois prudent et reviens-nous vite, d’accord ?
— D’accord.
Je me penche pour lui embrasser le front, avant d’ébouriffer la tignasse soyeuse de Pasha.
— Je serai de retour en un clin d’œil.
Je me trouve à Grozny, en Tchétchénie, vérifiant une piste concernant un nouveau groupe radical d’insurgés, lorsque j’apprends la nouvelle. C’est Ivan Polonsky, mon supérieur à Moscou, qui m’appelle.
— Peter.
Sa voix est d’une rare gravité, lorsque je prends l’appel.
— Il y a eu un incident à Daryevo.
Mes entrailles se glacent.
— Quel genre d’incident ?
— Une opération qui ne nous a pas été communiquée. L’OTAN était impliquée. Il y a eu des… victimes.
La glace en moi se répand me déchirant de ses rebords tranchants et j’ai toutes les peines du monde à prononcer les mots, ma gorge serrée.
— Tamila et Pasha ?
— Je suis désolé, Peter. Certains villageois ont été tués pendant l’opération et...
Je l’entends déglutir.
— … les rapports préliminaires démontrent que Tamila était dans les victimes.
Mes doigts serrent le téléphone à le briser.
— Et Pasha ?
— Nous ne le savons pas encore. Il y a eu plusieurs explosions et…
— Je suis en route.
— Peter, attends…
Je raccroche et sors à la course.
Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, faites qu’il soit vivant.
Je n’ai jamais été religieux, mais alors que l’hélicoptère militaire passe au-dessus des montagnes, je prie, je supplie et je marchande avec ce qu’il y a là-haut, peu importe ce dont il s’agit, pour un petit miracle, pour sa clémence. La vie d’un enfant est insignifiante à l’échelle de l’univers, mais elle m’est essentielle.
Mon fils est ma vie, ma raison d’être.
Le grondement des hélices est assourdissant, mais ce n’est rien par rapport aux hurlements dans ma tête. J’ai peine à respirer, je ne peux pas penser à travers la rage et la peur qui m’étouffent de l’intérieur. J’ignore comment Tamila est morte, mais j’ai vu assez de cadavres pour imaginer son corps, pour imaginer avec une précision acérée comment ses yeux magnifiques sembleront vides et aveugles, sa bouche molle et tâchée de sang sec. Et Pasha…
Non, je ne peux pas y penser. Pas avant d’être sûr.
Ce n’était pas censé arriver. Daryevo est à des lieues de tout point chaud du Daguestan. C’est un petit village pacifique, sans aucun lien avec des groupes d’insurgés. Ils devaient y être en sécurité, loin de la violence de mon univers.
Faites qu’il soit vivant. Faites qu’il soit vivant.
Le trajet semble éternel, mais enfin, nous passons le couvert nuageux et j’aperçois le village. Ma gorge se resserre, me coupant le souffle.
De la fumée monte de différents bâtiments dans le centre et des soldats armés parcourent le village.
Je saute de l’hélicoptère au moment même où il touche le sol.
— Peter, attends. Tu as besoin d’une autorisation, lance le pilote, mais je cours déjà, écartant les gens sur mon passage.
Un jeune soldat tente de m’arrêter, mais je lui arrache son M16 et le mets en joue.
— Montre-moi les corps. Tout de suite.
Je ne sais pas si c’est l’arme ou la note meurtrière dans ma voix, mais le soldat obéit, se déplaçant en hâte vers une cabane au bout de la rue. Je le suis, l’adrénaline comme une vase toxique dans mes veines.
Faites qu’il soit vivant. Faites qu’il soit vivant.
J’aperçois les corps derrière la cabane, certains soigneusement disposés, d’autres empilés sur l’herbe parsemée de neige. Il n’y a personne autour ; les soldats doivent tenir les villageois éloignés pour l’instant. Je reconnais certains des morts immédiatement ; l’ancien du village fiancé à Tamila, la femme du boulanger, l’homme qui m’a déjà vendu du lait de chèvre, mais il y en a d’autres que je ne reconnais pas, en partie en raison de l’ampleur de leurs blessures, mais aussi parce que je n’ai pas passé beaucoup de temps au village.
Je n’ai pratiquement pas passé de temps ici, et maintenant ma femme est morte.
Me ressaisissant, je m’agenouille près d’un corps féminin élancé, dépose le M16, et déplace le foulard couvrant son visage. Une partie de son visage a été pulvérisée par une balle, mais je peux suffisamment distinguer ses traits pour savoir qu’il ne s’agit pas de Tamila.
Je passe au prochain corps de femme, celui-ci est troué de plusieurs balles dans la poitrine. Il s’agit de la tante de Tamila, une femme timide dans la cinquantaine qui m’avait adressé moins de cinq mots au cours des trois dernières années. Pour elle et le reste de la famille de Tamila, j’étais un étranger, un étranger effrayant venant d’un monde différent. Ils n’avaient pas compris la décision de Tamila de m’épouser, ils l’avaient même condamnée, mais Tamila n’en avait cure.
Elle avait toujours été indépendante comme ça.
Un autre corps féminin attire mon attention. La femme est étendue sur le côté, mais la douce courbe de son épaule est douloureusement familière. Ma main tremble alors que je la retourne, et une douleur cuisante me transperce lorsque j’aperçois son visage.
La bouche de Tamila est aussi molle que je l’imaginais, mais ses yeux ne sont pas vides. Ils sont fermés, ses longs cils roussis, et ses paupières sont collées par le sang. Sa poitrine et ses bras sont couverts de sang, rendant sa robe grise presque noire.
Ma femme, la belle jeune femme qui avait eu le courage de choisir sa propre destinée, est morte. Elle est morte sans jamais avoir quitté son village, sans avoir vu Moscou comme elle en rêvait. Sa vie s’est éteinte avant qu’elle n’ait la chance de vivre, et tout est de ma faute. J’aurais dû être là, j’aurais dû les protéger, Pasha et elle. Bordel, j’aurais dû être au fait de cette putain d’opération ; personne n’aurait dû se trouver ici sans en avoir informé mon équipe.
Je sens la rage m’envahir, combinée à une douleur et à une culpabilité atroces, mais je l’écarte et m’efforce de continuer mes recherches. Il n’y a que des adultes dans les rangées, mais il y a encore cette pile.
Faites qu’il soit vivant. Je suis prêt à tout du moment qu’il est vivant.
J’ai les jambes en coton alors que je m’approche de la pile. Le sol est jonché de membres arrachés et les corps sont mutilés au point d’empêcher toute identification. Il doit s’agir des victimes des explosions. J’écarte chaque corps, fourrageant à travers les membres. L’odeur viciée de sang et de chair calcinée pèse dans l’air. Un homme normal aurait vomi depuis longtemps, mais je n’ai jamais été normal.
Faites qu’il soit vivant.
— Peter, attends. Une équipe spéciale est en route et elle ne veut pas que nous touchions aux corps.
Il s’agit du pilote, Anton Rezov, qui s’approche de l’arrière de la cabane. Nous travaillons ensemble depuis des années et je le considère comme un ami proche, mais s’il tente de m’arrêter, je le tuerai.
Sans répondre, je poursuis ma tâche macabre, observant chaque membre et buste brûlé avant de l’écarter. La plupart des restes semblent appartenir à des adultes, bien que je tombe aussi sur quelques membres appartenant à des enfants. Ils sont toutefois trop gros pour être ceux de Pasha et je suis assez égoïste pour m’en réjouir.
Puis, je l’aperçois.
— Peter, tu m’as compris ? Tu ne peux rien faire pour l’instant.
Anton fait mine d’agripper mon bras, mais avant qu’il puisse m’atteindre, je me retourne, ma main se resserrant automatiquement. Mon poing s’écrase contre sa mâchoire et il chancelle sous le coup, ses yeux roulant dans leurs orbites. Je ne le regarde pas tomber ; je suis déjà en mouvement, fourrageant dans la pile de corps, jusqu’à atteindre la petite main que j’ai aperçue plus tôt.
Une petite main serrant une petite voiture brisée.
Je vous en prie, je vous en prie. Faites que ce soit une erreur. Faites qu’il soit vivant. Faites qu’il soit vivant.
Je me mets à la tâche comme un homme possédé, toute mon attention fixée sur un seul but : atteindre cette main. Certains des corps sur le dessus sont pratiquement entiers, mais je ne sens pas leur poids alors que je les écarte violemment. Je ne sens pas la douleur de mes muscles éreintés ni la puanteur révoltante de la mort violente. Je me contente de me baisser, de soulever et de jeter les corps, jusqu’à me retrouver entouré de corps et ensanglanté.
Je ne m’arrête qu’au moment où le petit corps est entièrement exposé, et qu’il ne reste plus aucun doute.
En tremblant, je tombe à genoux, mes jambes incapables de me soutenir.
Par un quelconque miracle, la moitié droite du visage de Pasha est intacte, sa douce peau de bébé n’arbore pas même une égratignure. L’un de ses yeux est fermé, sa petite bouche entrouverte, et s’il avait été étendu sur le côté comme Tamila, on aurait pu croire qu’il dormait. Mais il n’est pas étendu sur le côté et je vois le trou béant où l’explosion a pulvérisé la moitié de son crâne. Il lui manque son bras gauche et la moitié de sa jambe en dessous du genou. Son bras droit, toutefois, est indemne, ses doigts serrant convulsivement la petite voiture.
Au loin, j’entends un hurlement, un son brisé et fou empli de rage inhumaine. Ce n’est que lorsque je me retrouve à serrer le petit corps contre moi que je réalise que le cri vient de moi. Je me tais alors, mais je ne peux m’empêcher de me balancer d’avant en arrière.
Je ne peux arrêter de le serrer contre moi.
Je ne sais pas combien de temps je reste ainsi, serrant les restes de mon fils, mais il fait noir lorsque les soldats de l’équipe spéciale arrivent enfin. Je ne les repousse pas. Ça ne sert à rien. Mon fils n’est plus, sa lumière éclatante s’étant éteinte avant même d’avoir eu la chance de briller.
— Je suis désolé, dis-je dans un murmure, alors qu’ils me traînent au loin.
Avec chaque mètre de distance entre nous, je sens le froid en moi croître, les vestiges de mon humanité s’écoulant de mon âme. Il n’y a plus de supplication, plus de marchandage avec quiconque ou quoi que ce soit. Je suis sans espoir, dépourvu de chaleur et d’amour. Je ne peux plus revenir en arrière et serrer mon fils plus longtemps, je ne peux plus rester avec lui comme il me l’a demandé. Je ne peux pas amener Tamila à Moscou l’an prochain comme je le lui ai promis.
Je n’ai plus qu’une seule chose à faire pour ma femme et mon fils, une chose qui me forcera à vivre.
Je les ferai payer.
Chacun de leurs tueurs.
Ils répondront de ce massacre de leurs vies.
2
États-Unis, aujourd’hui
Sara
— Tu es sûre de ne pas vouloir aller prendre un verre avec les filles et moi ? demande Marsha, en s’approchant de mon casier.
Elle s’est déjà débarrassée de son uniforme d’infirmière pour enfiler une robe sexy. Avec son rouge à lèvres éclatant et ses boucles blondes flamboyantes, elle ressemble à une version plus vieille de Marilyn Monroe et elle aime faire la fête autant qu’elle.
— Non, merci. Je ne peux pas.
Je tempère mon refus d’un sourire.
— La journée a été longue et je suis éreintée.
Elle lève les yeux au ciel.
— Évidemment. Tu es perpétuellement éreintée ces jours-ci.
— Le résultat de travailler.
— Oui, si tu travailles quatre-vingt-dix heures par semaine. Si je ne te connaissais pas, je croirais que tu veux te tuer à la tâche. Tu n’es plus une interne, tu sais ? Tu n’as pas à supporter tout ça.
Je soupire et attrape mon sac.
— Quelqu’un doit rester de garde.
— Oui, mais pas toujours toi. C’est vendredi soir, et tu as travaillé tous les week-ends depuis un mois, en plus de tous les quarts de nuit. Je sais que tu es le plus récent ajout, mais…
— Je n’ai rien contre les quarts de nuit, l’interromps-je, en me dirigeant vers le miroir. Le mascara que j’ai appliqué ce matin a laissé des taches foncées sous mes yeux, et j’utilise une serviette en papier humide pour les effacer. Ça n’améliore pas vraiment mon apparence hagarde, mais je suppose que ça n’a pas d’importance, puisque je m’en vais directement à la maison.
— Parce que tu ne dors pas, dit Marsha, en se plaçant derrière moi.
Je me prépare, sachant qu’elle est sur le point d’aborder son sujet préféré. Bien qu’elle soit mon aînée de quinze ans, Marsha est ma meilleure amie à l’hôpital et elle exprime de plus en plus ses inquiétudes.
— Marsha, je t’en prie. Je suis trop fatiguée pour ça, dis-je, en rassemblant mes boucles indisciplinées en une queue de cheval.
Je n’ai pas besoin d’un sermon pour savoir que je m’épuise à la tâche. Mes yeux noisette sont rougis et larmoyants dans le miroir et j’ai l’impression d’avoir soixante ans, et non vingt-huit.
— Oui, parce que tu travailles trop et que tu ne dors pas assez.
Elle se croise les bras.
— Je sais que tu as besoin d’une distraction après toute cette histoire avec George, mais…
— Mais rien.
En me retournant, je la fixe du regard.
— Je ne veux pas parler de George.
— Sara…
Elle fronce les sourcils.
— Tu dois arrêter de te punir. Ce n’était pas de ta faute. Il a choisi de prendre le volant ; c’était sa décision.
Ma gorge se serre et mes yeux me piquent. Avec horreur, je réalise que je suis sur le point d’éclater en sanglots, et je me détourne dans un effort pour me contrôler. Seulement, je ne peux pas m’enfuir ; le miroir me fait face et il reflète tout ce que je ressens.
— Je suis désolée, chérie. Je suis complètement insensible. Je n’aurais pas dû dire ça.
Marsha semble réellement pleine de regrets alors qu’elle s’approche et me serre doucement le bras.
Je prends une profonde inspiration et me retourne vers elle à nouveau. Je suis éreintée, ce qui n’aide pas aux émotions qui menacent de me submerger.
— Ça va.
Je me force à sourire.
— Ce n’est rien. Tu devrais y aller ; les filles t’attendent probablement.
Et je dois retourner chez moi avant de m’écrouler et de pleurer en public, ce qui serait le summum de l’humiliation.
— D’accord, chérie.
Marsha me sourit, mais je vois la pitié dans son regard.
— Repose-toi ce week-end, d’accord ? Promets-moi de le faire.
— C’est d'accord… maman.
Elle lève les yeux au ciel.
— Oui, oui, j’ai compris. Je te vois lundi.
Elle sort du vestiaire, et j’attends une minute avant de la suivre, évitant ainsi de croiser son groupe d’amies près des ascenseurs.
J’ai eu plus de pitié que je ne peux en supporter.
En mettant le pied dans le parc de stationnement de l’hôpital, je vérifie mon téléphone par habitude, et mon cœur s’emballe lorsque je vois un texto d’un numéro bloqué.
Je m’arrête et glisse un doigt incertain sur l’écran.
Tout va bien, mais je dois remettre la visite de ce week-end, dit le message. Problème d’horaire.
Je soupire de soulagement et, du coup, je sens la culpabilité familière m’envahir. Je ne devrais pas me sentir soulagée. Je devrais espérer ces visites, plutôt que de les voir comme une obligation désagréable. Je ne peux pourtant pas changer la façon dont je me sens. Chaque fois que je rends visite à George, je me remémore cette nuit-là, et je perds le sommeil pendant plusieurs nuits.
Si Marsha croit qu’il me manque du sommeil maintenant, elle devrait me voir après l’une de ces visites.
Après avoir remis mon téléphone dans mon sac, je m’approche de ma voiture, une Toyota Camry, la même que j’ai depuis cinq ans. Maintenant que j’ai remboursé mes prêts d’études en médecine et que j’ai quelques économies, je pourrais me permettre mieux, mais je n’en vois pas l’utilité.
George était le fanatique de voitures, pas moi.
La douleur me transperce, familière et tranchante, et je sais que le texto en est la cause. Ça, et ma conversation avec Marsha. Dernièrement, je peux passer des jours sans penser à l’accident, suivre ma routine sans l’incroyable culpabilité qui me pèse, mais ce n’est pas l’un de ces jours.
C’était un adulte, dois-je me rappeler, répétant ce que tout le monde me dit toujours. C’était son choix de prendre le volant ce jour-là.
Rationnellement, je sais que ces mots disent vrai, mais même si je les entends souvent, ils ne s’imprègnent pas. Mon esprit est pris dans une boucle, rejouant sans fin cette soirée, et aussi fort que je le veuille, je ne peux pas empêcher l’affreuse bobine de tourner.
Ça suffit, Sara. Concentre-toi sur la route.
En prenant une inspiration pour me calmer, je sors du parc de stationnement et me dirige vers ma demeure. Le trajet dure quarante minutes, soit quarante minutes de trop en ce moment. Mon estomac se serre et je réalise qu’une des raisons de mon émotivité actuelle est que je suis sur le point de commencer mes règles. En tant qu’obstétricienne-gynécologue, je connais mieux que quiconque l’effet puissant des hormones, et lorsque le syndrome post menstruel est combiné à de longues heures et à des souvenirs de George… Disons que c’est un miracle que je ne sois pas déjà une fontaine de sanglots.
Oui, c’est ça. Ce ne sont que mes hormones et la fatigue. Je dois retourner chez moi et tout ira bien. Déterminée à reprendre le contrôle, j’allume la radio à une station pop de la fin des années quatre-vingt-dix, et commence à chanter en chœur avec Britney Spears. Ce n’est peut-être pas la musique la plus sérieuse, mais elle est joyeuse et c’est exactement ce qu’il me faut.
Je ne me laisserai pas m’écrouler. Ce soir, je vais dormir, même si je dois prendre un somnifère pour y arriver.
Ma maison se trouve dans un cul-de-sac bordé d’arbres, juste après une route à deux voies traversant des champs. Comme bien d’autres dans le beau quartier d’Homer Glen, en Illinois, elle est énorme : cinq chambres et quatre salles de bain, en plus d’un sous-sol totalement aménagé. Avec son énorme cour arrière et tous les chênes qui l’entourent, elle donne l’impression d’être située au milieu d’une forêt.
Elle est parfaite pour cette grande famille que George voulait et horriblement solitaire pour moi.
Après l’accident, j’avais pensé vendre la maison et me rapprocher de l’hôpital, mais je ne pouvais pas m’y résoudre. C’est toujours le cas. George et moi avions rénové la maison ensemble, modernisant la cuisine et les salles de bain, décorant méticuleusement chaque pièce pour y donner une ambiance accueillante et chaleureuse. Une ambiance familiale. Je sais que les chances d’avoir cette famille sont maintenant inexistantes, mais une partie de moi s’accroche à ce vieux rêve, à la vie parfaite que nous étions censés avoir.
— Trois enfants, au moins, m’avait dit George lors de notre cinquième rendez-vous. Deux garçons et une fille.
— Pourquoi pas deux filles et un garçon ? Avais-je demandé, en souriant. Qu’en est-il de l’égalité des sexes et tout ça ?
— En quoi deux contre un est-il égal ? Tout le monde sait que les filles font n’importe quoi de nous, et lorsqu’il y en a deux…
Il frissonna dramatiquement.
— Non, il nous faut deux garçons pour équilibrer la famille. Sinon, papa sera dans de beaux draps.
J’avais éclaté de rire et lui avais frappé l’épaule, mais secrètement, j’aimais l’idée de deux garçons se chahutant et protégeant leur petite sœur. Je suis enfant unique, mais j’avais toujours voulu un grand frère, et il m’était facile d’adopter les rêves de George.
Non. N’y pense pas. Difficilement, je repousse les souvenirs, parce que bons ou mauvais, ils mènent tous à cette soirée, et je ne peux pas l’affronter maintenant. Les crampes sont de plus en plus douloureuses et c’est à peine si je peux garder les mains sur le volant alors que j’entre dans mon garage pour trois voitures. J’ai besoin d’un Advil, d’un coussin chauffant et de mon lit, dans cet ordre, et si j’ai de la chance, je vais m’endormir tout de suite, sans l’aide d’un somnifère.
En retenant un grognement, je ferme la porte du garage, entre le code de l’alarme et me traîne dans la maison. Les crampes sont si horribles que je suis incapable de marcher sans me plier en deux. Je me rends donc directement à l’armoire à pharmacie dans la cuisine. Je ne prends même pas la peine d’allumer les lumières ; l’interrupteur se trouvant loin de l’entrée du garage. Et puis, je connais suffisamment la cuisine pour m’y déplacer dans le noir.
J’ouvre l’armoire et je trouve au toucher le flacon d’Advil. Je prends deux comprimés, puis je me rends à l’évier, emplis ma main d’eau et avale les comprimés. En haletant, j’agrippe le comptoir de cuisine et j’attends que le médicament fasse effet avant de tenter quelque chose d’aussi ambitieux que de me rendre à la chambre principale à l’étage.
Je le sens une seconde avant qu’il ne frappe. C’est subtil, le simple déplacement de l’air derrière moi, un soupçon de quelque chose d’étranger… le sentiment d’un danger soudain.
Un frisson me passe dans le cou, mais il est trop tard. Une seconde, je suis debout devant l’évier, et la suivante, une grande main recouvre ma bouche, alors qu’un corps solide et grand me coince contre le comptoir par l’arrière.
— Ne crie pas, murmure une profonde voix masculine à mon oreille.
Quelque chose de froid et de tranchant se presse contre ma gorge.
— Tu ne veux pas que ma lame glisse.
3
Sara
Je ne crie pas. Pas parce que c’est la bonne chose à faire, mais parce que je ne peux pas prononcer un mot. Je suis figée de terreur, absolument et totalement paralysée. Tous mes muscles sont de marbre, y compris mes cordes vocales, et mes poumons ont cessé de fonctionner.
— Je vais retirer ma main, murmure-t-il à mon oreille, son souffle chaud sur ma peau moite. Et tu vas rester silencieuse. Compris ?
Je ne peux pas même gémir, mais je réussis tout de même à hocher faiblement la tête.
Il baisse la main, son bras s’enroulant maintenant autour de ma cage thoracique, et mes poumons choisissent ce moment pour recommencer à fonctionner. Sans le vouloir, je prends une inspiration sifflante. Immédiatement, la lame presse davantage contre ma peau, et je me fige à nouveau en sentant du sang chaud couler le long de mon cou.
Je vais mourir. Oh, mon Dieu, je vais mourir ici, dans ma propre cuisine.
La terreur est une créature monstrueuse en moi, me transperçant de ses serres glacées. Je ne me suis jamais trouvée aussi près de la mort. Quelques centimètres à droite et…
— Tu dois m’écouter, Sara.
La voix de l’intrus est douce, en contraste avec le couteau s’enfonçant dans ma gorge.
— Si tu coopères, tu pourras t’en sortir vivante. Sinon, tu finiras dans un sac mortuaire. C’est ton choix.
Vivante ? Un éclat d’espoir transperce le brouillard de panique qui emplit mon cerveau, et je réalise qu’il a un léger accent. Une touche exotique. Du Moyen-Orient, peut-être, ou de l’Europe de l’Est.
Étrangement, ce détail me recentre un peu, m’offrant quelque chose de concret sur lequel mon esprit peut s’accrocher.
— Q-que voulez-vous ?
Les mots ne sont qu’un murmure tremblant, mais je suis stupéfaite de pouvoir parler. Je me sens comme un cerf devant les phares d’une voiture, paralysée et dépassée, mon raisonnement étrangement lent.
— Seulement quelques réponses, dit-il, en relâchant quelque peu le couteau.
Sans l’acier glacial se pressant contre ma peau, une partie de ma panique se résorbe, et je remarque d’autres détails, comme le fait que mon agresseur me dépasse d’au moins une tête et qu’il est bourré de muscles. Le bras autour de ma cage thoracique me fait l’effet d’une tige d’acier et il n’y a aucune flexibilité dans le corps massif qui se presse contre mon dos, aucune trace de douceur palpable. Je suis une femme de taille moyenne, mais je suis mince avec une ossature délicate. S’il est aussi musclé que je le crois, il doit faire pratiquement le double de mon poids.
Même sans le couteau, je serais incapable de m’en sortir.
— Quel genre de réponses ?
Ma voix est un peu plus ferme cette fois. Il a peut-être seulement l’intention de me voler et il veut la combinaison du coffre. Il sent bon, comme le détergent à lessive et la peau d’un homme en bonne santé, alors il n’est probablement pas un consommateur de meth ou un voyou de bas quartier. Un cambrioleur professionnel, alors ? Si c’est le cas, je lui laisserai avec plaisir mes bijoux et l’argent pour les cas d’urgence que George a caché dans la maison.
— Je veux que tu me parles de ton mari. Plus particulièrement, je veux savoir où il se trouve.
— George ?
Mon esprit s’embrouille alors qu’un nouvel effroi me submerge.
— Q-quoi… pourquoi ?
La lame se presse davantage contre ma peau.
— Je pose les questions.
— J-je vous en prie, dis-je d’une voix étranglée.
Je ne peux pas penser ni me concentrer sur autre chose que le couteau. Des larmes brûlantes coulent sur mes joues et je tremble de tous mes membres.
— Je vous en prie, je ne…
— Répond à ma question. Où se trouve ton mari ?
— Je…
Oh, mon Dieu, que dire ? Il doit être l’un d’entre eux, la raison de toutes ces précautions. Mon cœur bat si fort que je me sens près de l’hyperventilation.
— Je vous en prie, je ne… Je n’ai pas…
— Ne me mens pas, Sara. Je dois savoir où il se trouve. Maintenant.
— Je ne sais pas, je le jure. Je vous en prie, nous sommes…
Ma voix se fêle.
— Nous sommes séparés.
Le bras qui retient ma cage thoracique se resserre et le couteau s’enfonce un peu plus.
— Tu souhaites mourir ?
— Non. Non, je ne veux pas. Je vous en prie…
Je tremble encore plus fort, les larmes inondant mon visage sans relâche. Après l’accident, il y a eu des jours où je pensais vouloir mourir, lorsque la culpabilité et la douleur des regrets m’écrasaient, mais maintenant, avec la lame contre ma gorge, je veux vivre. Je le veux tant.
— Alors, dis-moi où il se trouve.
— Je ne sais pas !
Mes genoux sont sur le point de céder, mais je ne peux pas trahir George ainsi. Je ne peux pas l’exposer à ce monstre.
— Tu mens.
La voix de mon agresseur est glaciale.
— J’ai lu tes messages. Tu sais exactement où il est.
— Non, je…
J’essaie de trouver un mensonge plausible, mais je n’y arrive pas. La panique laisse un goût âcre sur ma langue alors que des questions affolées se pressent dans mon esprit. Comment a-t-il pu lire mes messages ? Quand ? Depuis combien de temps me traque-t-il ? Est-il l’un d’entre eux ?
— Je… je ne sais pas de quoi vous parlez.
Le couteau s’enfonce davantage et je ferme les yeux avec force, mon souffle s’échappant en sanglots étouffés. La mort est si près que je peux la goûter, la sentir… je la ressens dans toutes les fibres de mon corps. C’est l’odeur métallique de mon sang et la sueur froide qui coule dans mon dos, le fracas de mon pouls à mes tempes, et la tension de mes muscles frémissants. Dans une seconde, il entaillera ma jugulaire et je me viderai de mon sang, ici sur le plancher de ma cuisine.
Est-ce ce que je mérite ? Est-ce ainsi que j’expie mes péchés ?
Je serre les dents pour m’empêcher de parler.
Pardonne-moi, George. Si c’est ce dont tu as besoin…
J’entends le soupir de mon agresseur et, l’instant d’après, le couteau disparaît et je me retrouve basculée sur le comptoir. Mon dos cogne contre le marbre et ma tête tombe vers l’arrière dans l’évier, les muscles de mon cou se tendant sous la pression. En haletant, je donne des coups de pieds et tente de le frapper, mais il est trop fort et trop rapide. En un instant, il saute sur le comptoir et me chevauche, me retenant en place sous son poids. Il attache mes poignets avec quelque chose de solide et d’incassable avant de les attraper d’une main. Malgré tous mes efforts, je suis incapable de me libérer. Mes talons glissent inutilement sur le comptoir lisse et les muscles de mon cou brûlent sous l’effort de retenir ma tête. Je suis impuissante, immobilisée et je sens monter en moi un autre type de panique.
Je vous en prie, mon Dieu, non. Tout, sauf un viol.
— Nous allons essayer autre chose, dit-il, en laissant tomber un bout de tissu sur mon visage. Voyons voir si tu es vraiment prête à mourir pour ce salaud.
Haletante, je bouge la tête de tous les côtés, en tentant de repousser le tissu, mais il est trop long et j’ai de la peine à respirer sous lui. Veut-il m’étouffer ? Est-ce son plan ?
Puis, la poignée du robinet grince, et tout prend son sens.
— Non !
Je me débats avec plus de force, mais il agrippe mes cheveux de sa main libre, me retenant sous le robinet, la tête vers l’arrière.
Le choc initial de l’eau n’est pas si mal, mais en quelques secondes, l’eau coule dans mon nez. Ma gorge se contracte, mes poumons se convulsent et tout mon corps se soulève alors que je m’étouffe et suffoque. La panique est instinctive et incontrôlable. Le tissu est comme une patte mouillée appuyée contre mon nez et ma bouche, les bloquant. Je suffoque, je me noie. Je ne peux plus respirer, plus respirer…
Le robinet se referme, et le tissu est retiré de mon visage. En toussant, j’inspire avec peine, en sanglotant, la respiration sifflante. Mon corps tremble et je combats un haut-le-cœur, et des points blancs dansent devant mes yeux. Avant que je puisse me reprendre, le tissu claque à nouveau sur mon visage et le robinet s’ouvre une seconde fois.
Cette fois, c’est encore pire. Mes voies nasales brûlent sous l’effet de l’eau, et mes poumons s’affaiblissent à chercher de l’air. J’ai des nausées et je suffoque, m’étouffant et pleurant. Je ne peux pas respirer.
Oh, mon Dieu, je suis en train de mourir ; je ne peux pas respirer…
L’instant d’après, le tissu disparaît, et j’inspire convulsivement.
— Dis-moi où il est, et j’arrêterai.
Sa voix est un murmure sinistre au-dessus de moi.
— Je ne sais pas ! Je vous en prie !
Je peux goûter le vomi dans ma gorge, et savoir qu’il recommencera me glace le sang. Il était facile d’être courageuse avec le couteau, mais pas avec ça. Je ne peux pas supporter de mourir ainsi.
— Dernière chance, dit doucement mon bourreau, en laissant tomber le tissu mouillé sur mon visage.
Le robinet commence à grincer.
— Arrêtez ! Je vous en prie !
Le cri vient de mes entrailles.
— Je vais vous le dire ! Je vais vous le dire.
L’eau se referme et le tissu est retiré de mon visage.
— Parle.
Je sanglote et je tousse trop fort pour former une phrase cohérente, alors il me descend du comptoir jusqu’au plancher, puis s’accroupit pour m’encercler de ses bras. Pour un spectateur, cela a tout d’une étreinte consolatrice ou de l’étreinte protectrice d’un homme amoureux. Pour ajouter à l’illusion, la voix de mon tortionnaire est douce et tendre alors qu’il murmure à mon oreille :
— Dis-moi, Sara. Dis-moi ce que je veux savoir, et je partirai.
— Il est…
Je m’arrête une seconde avant de dévoiler la vérité. L’animal paniqué en moi veut survivre à tout prix, mais je ne peux pas. Je ne peux pas mener ce monstre vers George.
— Il est à l’hôpital Advocate Christ, dis-je d’une voix étranglée. L’unité de soins de longue durée.
C’est un mensonge, et apparemment pas un très bon, car les bras qui m’entourent se resserrent jusqu’au point de me broyer les os.
— Ne me raconte pas de putains de conneries.
La note tendre de sa voix est remplacée par une rage mordante.
— Il n’y est plus… depuis des mois. Où se cache-t-il ?
Je sanglote davantage.
— Je… je ne…
Mon agresseur se relève, m’entraînant avec lui, je crie et je me débats alors qu’il me tire vers l’évier.
— Non ! Je vous en prie, non !
Je suis hystérique alors qu’il me dépose sur le comptoir, mes mains liées se balançant alors que j’essaie de lui griffer le visage. Mes talons frappent le marbre comme il me chevauche, me coinçant sous lui à nouveau, et ma gorge s’emplit de bile comme il agrippe mes cheveux, arquant ma tête vers l’arrière dans l’évier.
— Arrêtez !
— Dis-moi la vérité, et j’arrête.
— Je… je ne peux pas. Je vous en prie, je ne peux pas !
Je ne peux pas faire ça à George, pas après tout ce qui s’est passé.
— Arrêtez, je vous en prie !
Le tissu mouillé claque contre mon visage, et ma gorge se convulse sous la panique. L’eau est fermée, mais je me noie déjà ; je ne peux pas respirer, pas respirer…
— Bordel !
Je suis brusquement tirée du comptoir et jetée au sol, où je m’écrase en un tas tremblant et sanglotant. Seulement, cette fois-ci, aucun bras ne me retient et je réalise vaguement qu’il s’éloigne.
Je devrais me relever et fuir, mais mes mains sont liées et mes jambes refusent de bouger. Je réussis avec peine à rouler sur le côté et je tente de me traîner sur le sol. La peur m’aveugle, me désoriente, et je ne vois rien dans l’obscurité.
Je ne le vois pas.
Cours, ordonné-je à mes muscles tremblants et sans force. Lève-toi et cours.
Inspirant profondément, j’attrape quelque chose, un coin du comptoir, et je me remets sur mes pieds. Il est pourtant trop tard ; il est déjà de retour, son bras de fer entourant ma cage thoracique de l’arrière.
— Voyons voir si nous avons plus de chance ainsi, murmure-t-il, lorsqu'une chose froide et pointue me pique le cou.
Une aiguille, réalisé-je avec horreur, avant de sombrer dans le néant.
Un visage flotte devant mes yeux. C’est un visage séduisant, beau, malgré la cicatrice qui traverse son sourcil gauche. Des pommettes hautes et saillantes, des yeux d’un gris acier bordés de cils noirs, une forte mâchoire assombrie par une barbe naissante ; un visage masculin décide finalement mon esprit. Ses cheveux sont épais et foncés, plus longs sur le dessus que sur les côtés. Pas un vieil homme alors, mais pas non plus un adolescent. Un homme dans la force de l’âge.
Les traits froncés sont figés en un masque hostile et sinistre.
— George Cobakis, dit la bouche sculptée et dure.
C’est une bouche séduisante, bien dessinée, mais j’entends les mots comme s’ils sortaient d’un mégaphone au loin.
— Sais-tu où il se trouve ?
Je hoche la tête, du moins j’essaie. Ma tête semble lourde, mon cou étrangement douloureux.
— Oui, je sais où il se trouve. Je croyais que je le connaissais aussi, mais ce n’était pas le cas, pas vraiment. Peut-on vraiment connaître quelqu’un ? Je ne crois pas, du moins, je ne le connaissais pas vraiment. Je croyais que oui, mais non. Toutes ces années ensemble et tout le monde croyant que nous étions si parfaits. Le couple parfait, disaient-ils. Peux-tu le croire ? Le couple parfait. Nous étions la crème de la crème, la jeune médecin et le journaliste prometteur. Ils disaient qu’il finirait par remporter un Pulitzer.
J’ai vaguement conscience de babiller, mais je ne peux pas m’arrêter. Les mots déboulent, toute l’amertume et la douleur accumulées.
— Mes parents étaient si heureux, si fiers le jour de notre mariage. Ils n’avaient aucune idée, ignoraient ce qui suivrait, ce qui nous attendait…
— Sara. Concentre-toi sur moi, dit la voix dans le mégaphone.
Je détecte une trace d’accent étranger. Il me plaît, cet accent, me donne envie de tendre la main et de la presser contre ces lèvres sculptées, puis de laisser courir mes doigts sur cette mâchoire solide pour découvrir si elle est rugueuse. J’aime lorsque c’est rugueux. George revenait souvent de ses voyages à l’étranger, la mâchoire rugueuse, et j’aimais ça. Même si je lui disais de se raser. Il était plus beau fraîchement rasé, pourtant j’aimais sentir la rugosité de son chaume parfois, j’aimais la sentir contre mes cuisses lorsqu’il…
— Sara, ça suffit, m’interrompt la voix, et les traits séduisants et exotiques se renfrognent davantage.
Je parlais à voix haute, réalisé-je, mais je ne suis pas embarrassée, pas du tout. Les mots ne m’appartiennent pas ; ils sortent de leur propre chef. Mes mains bougent aussi d’elles-mêmes, tentant d’atteindre ce visage, mais quelque chose les arrête. Lorsque je baisse ma tête lourde pour voir ce qui se passe, je vois une attache en plastique autour de mes poignets, une grande main masculine recouvrant mes paumes. Elle est chaude, cette main, et elle retient mes mains sur mes genoux. Pourquoi ? D’où vient-elle, cette main ? Lorsque je relève les yeux avec confusion, le visage est plus près, les yeux gris fixant les miens.
— J’ai besoin que tu me dises où se trouve ton mari, articule la bouche, et le mégaphone s’approche. Il semble être tout à côté de mon oreille. Je grimace, mais en même temps, cette bouche m’intrigue. Ces lèvres me donnent envie de les toucher, de les lécher, de les sentir sur… attends. Elles me demandent quelque chose.
— Où se trouve mon mari ?
Ma voix semble ricocher contre les murs.
— Oui, George Cobakis, ton mari.
Les lèvres m’attirent pendant qu’elles forment les mots et l’accent caresse mes entrailles, malgré l’effet persistant de mégaphone.
— Dis-moi où il est.
— Il est en sécurité. Il est dans une résidence protégée, dis-je. Ils peuvent le trouver. Ils ne voulaient pas qu’il publie cette histoire, mais il l’a fait. Il était brave comme ça, ou stupide… probablement stupide, non ? Et puis, il y a eu l’accident, mais ils peuvent encore s’en prendre à lui, parce que c’est ce qu’ils font. La mafia se fout qu’il soit un légume maintenant, un concombre, une tomate, une courgette. Bon, la tomate est un fruit, mais il est un légume. Un brocoli, alors ? Je ne sais pas. Ce n’est pas important de toute façon. Ils veulent en faire un exemple, menacer les autres journalistes qui leur tiennent tête. C’est ce qu’ils font, la manière dont ils fonctionnent. Tout est question de corruption et de petites enveloppes, et lorsqu’on le dévoile…
— Où se trouve cette maison ?
Les yeux d’acier brillent d’un éclat sombre.
— Donne-moi l’adresse de la maison.
— Je ne connais pas l’adresse, mais elle est sur un coin de rue près de la buanderie chez Ricky, à Evanston, réponds-je à ces yeux. Ils m’y conduisent toujours, alors je ne connais pas l’adresse exacte, mais j’ai aperçu cet immeuble d’une fenêtre. Il y a au moins deux hommes dans cette voiture et ils conduisent pendant des heures, changeant parfois de voiture aussi. C’est à cause de la mafia, parce qu’ils pourraient les surveiller. Ils m’envoient toujours une voiture, mais pas ce week-end. Un problème d’horaire. Ça arrive parfois ; les quarts des gardes ne le permettent pas toujours et…
— Combien de gardes y a-t-il ?
— Trois, parfois quatre. Ce sont d’imposants militaires ou ex-militaires, je ne sais pas. Ils ont simplement cet air. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tous cet air. C’est comme la protection des témoins, mais pas vraiment, parce qu’il a besoin de soins spéciaux et je ne peux pas quitter mon emploi. Je ne veux pas quitter mon emploi. Ils m’ont dit qu’ils pouvaient me faire changer d’endroit, disparaître, mais je ne veux pas disparaître. Mes patients ont besoin de moi, et mes parents aussi. Que ferais-je avec mes parents ? Ne plus jamais les voir ou les appeler ? Non, c’est fou. Alors, ils ont fait disparaître le légume, le concombre, le brocoli…
— Sara, chut.
Des doigts se pressent contre ma bouche, interrompant le torrent de paroles, et le visage s’approche encore davantage.
— Tu peux arrêter maintenant. C’est fini, murmure la bouche sensuelle, et j’ouvre mes lèvres, aspirant ces doigts.
Je peux goûter le sel et la peau, et je veux plus, alors je passe ma langue sur les doigts, suivant le contour rugueux des callosités et le contour émoussé des ongles courts. Ça fait si longtemps que je n’ai pas touché quelqu’un, et mon corps s’échauffe de cet avant-goût, de l’éclat de ces yeux d’argent.
— Sara…
La voix à l’accent est plus basse maintenant, plus profonde et plus douce. Elle me fait moins l’effet d’un mégaphone, et plus d’un écho sensuel, comme la musique d’un synthétiseur.
— Tu ne veux pas de ça, ptichka.
Oh, mais je le veux. Je le veux tant. Je continue de passer ma langue sur ces doigts et je regarde les yeux gris s’assombrir, les pupilles se dilatant visiblement. C’est un signe d’excitation, je sais, et j’ai envie de plus. J’ai envie d’embrasser ces lèvres sculptées, de frotter ma joue contre cette mâchoire rugueuse. Et ces cheveux, ces cheveux épais et foncés. Seraient-ils souples ou moelleux au toucher ? Je veux le savoir, mais je ne peux pas bouger mes mains, alors je me contente de plonger ces doigts plus profondément dans ma bouche, les prenant de mes lèvres et de ma langue, les suçotant comme s’il s’agissait d’un bonbon.
— Sara.
La voix est rauque et voilée, le visage froncé sous l’effet d’une faim difficilement contenue.
— Tu dois arrêter, ptichka. Tu le regretteras demain.
Le regretter ? Oui, probablement. Je regrette tout, tant de choses, et je relâche les doigts pour le lui dire. Mais avant de pouvoir prononcer un mot, les doigts s’éloignent de mes lèvres, et le visage se recule.
— Ne me laisse pas.
C’est une plainte pathétique, comme celle d’un enfant accaparant. Je veux davantage de ce contact humain, de cette connexion. Ma tête me fait l’effet d’un sac de roches et j’ai mal partout, surtout près de mon cou et de mes épaules. J’ai aussi des crampes au ventre. Je veux que quelqu’un me brosse les cheveux et me masse le cou, qu’on m’étreigne et qu’on me berce comme un bébé.
— Je t’en prie, ne me laisse pas.
Quelque chose qui ressemble à de la douleur traverse le visage de l’homme, et je sens à nouveau la piqûre froide de l’aiguille sur mon cou.
— Au revoir, Sara, murmure la voix, et je suis partie, mon esprit flottant comme une feuille dans le vent.
4
Sara
Le mal de tête. C’est la première chose qui me frappe. Mon crâne semble se morceler, les vagues de douleur pulsant dans mon cerveau.
— Dr Cobakis… Sara, m’entendez-vous ?
La voix féminine est douce et tendre, mais elle m’emplit d’appréhension. Il y a de l’inquiétude dans cette voix, accompagnée d’une insistance contenue. J’entends perpétuellement ce ton à l’hôpital et ce n’est jamais bon signe.
En tentant de ne pas bouger ma tête qui cogne, je me force à soulever mes paupières et je bats spasmodiquement des cils dans la lumière éclatante.
— Que… où…
Ma langue est épaisse et lourde, ma bouche est douloureusement sèche.