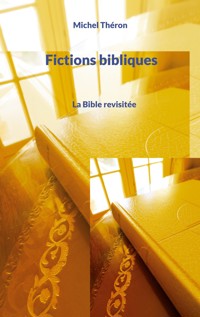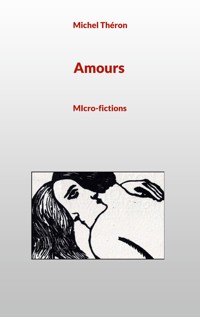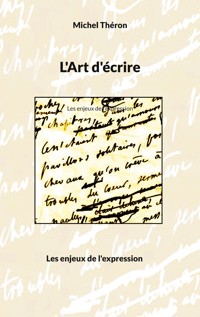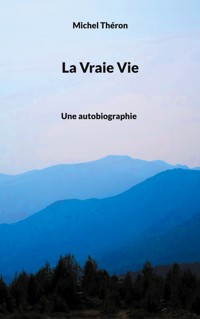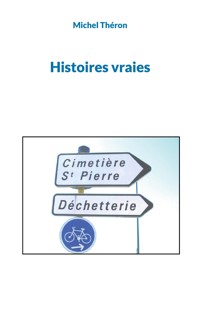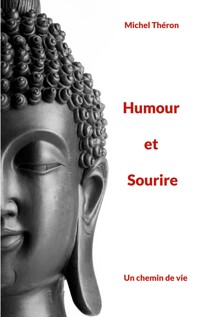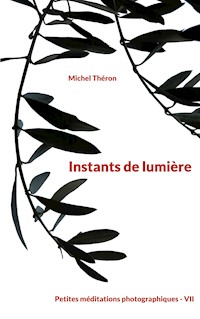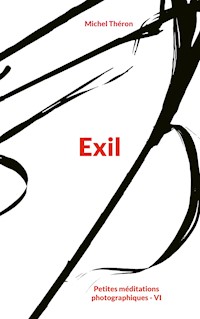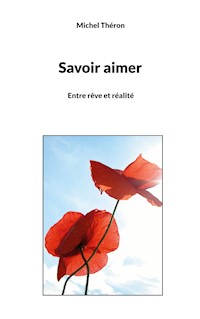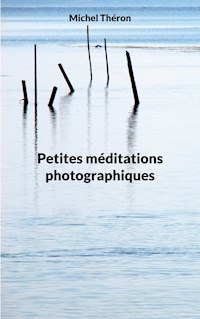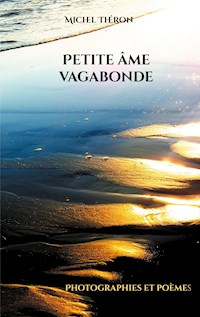11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Philosophie
- Sprache: Französisch
Les textes composant cet ouvrage sont tous parus, sous leur forme initiale, dans un journal hebdomadaire. Souvent inspirés par l'actualité, ce qui les rend plus vivants, ils ont cependant un contenu intemporel, et se prêtent toujours à une réflexion philosophique. Ils peuvent servir de points de départ pour la réflexion individuelle du lecteur, mais aussi ils peuvent alimenter des débats thématiques collectifs (cours scolaires, cafés-philo, réunions de réflexion...).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sommaire
Avant-propos
Absurdité
Accomplissement
Addiction
Amoureux
Anticléricalisme
Anxiété
Apocalypse
Appauvrissement
Attention
Aveuglement
Bêtise
Biographie
Bonheur
Brutalité
Caporalisation
Censure
Châtiment
Civisme
Commémoration
Compromission
Confiance
Conformisme
Considération
Copulation
Cruauté
Culture
Cupidité
Cynisme
Démagogie
Démission
Dépression
Déshérence
Dilemme
Divertissement
Dogme
École
Émotion
Empathie
Enchère
Endoctrinement
Engagement
Eschatologie
Espérance
Évaluation
Évangélisation
Évasion
Finalité
Gazouillis
Génie
Genre
Grammaire
Harcèlement
Heure
Historicité
Honnêteté
Honte
Iconoclasme
Idéologie
Image
Impudeur
Inculture
Infantilisation
Inquiétude
Insignifiance
Instant
Intégrisme
Jeu
Jupe
Laïcité
Légende
Lenteur
Lobbying
Lobotomie
Malus
Marie
Martyr
Masque
Miracle
Mot
Mythe
Narcissisme
Nationalisme
Néant
Négationnisme
Négativité
Obligation
Obsolescence
Oligarchie
Prime
Promotion
Proverbe
Racines
Rire
Scrupule
Souillure
Stupidité
Transhumance
Transparence
Uniforme
Virilité
Vocabulaire
Vote
Avant-propos
Les textes qu’on va lire, comme ceux du tome 1 auquel ce livre fait suite, sont tous parus, sous leur forme initiale, dans le journal Golias Hebdo, entre janvier 2011 et décembre 2012. Leur contenu est fort divers : politique, sociétal, religieux ou spirituel, parfois poétique et sensible, mais se prêtant toujours à une réflexion philosophique. Ils ont chacun pour titre un mot. Par commodité ils ont été rangés par ordre alphabétique, mais évidemment on peut les lire dans l’ordre qu’on veut.
Souvent c’est l’actualité qui les a inspirés. On pourra s’amuser à le vérifier, en voyant la date de parution qui figure à la fin de chaque texte. Mais les problèmes soulevés ici sont intemporels.
Si ces petits textes peuvent nourrir la réflexion personnelle du lecteur, ils peuvent aussi servir de points de départ utiles pour alimenter des débats thématiques menés en commun (cours scolaires, cafés-philo, réunions de réflexion, etc.).
Chaque texte est assorti à la fin d’un petit encart en grisé indiquant de quel thème il relève plus particulièrement, mais sans être exclusif des autres. Il se trouve en bas à droite de la page de droite, ce qui permet de feuilleter rapidement le livre et d’en améliorer l’exploration en suivant les thèmes indiqués.
Les renvois à d’autres entrées de l’ouvrage sont signalés en gras et entre crochets : []. Lorsque le renvoi est fait au tome 1 de l’ouvrage, cela est indiqué (par l’abréviation : t.).
Absurdité
Un employé d’une grande distribution risque d’être licencié pour avoir pris six melons et deux salades qu’il a récupérés dans une poubelle du supermarché où il travail-lait. Il vient d’être convoqué pour un entretien de licenciement. La direction prétend qu’il aurait dû faire une demande officielle pouvant autoriser ce qu’il a fait. Faute de quoi cet acte est considéré comme un vol.
Nous voici donc en pleine absurdité. Mieux vaut laisser les légumes pourrir que d’en faire profiter quelqu’un. C’est à la fois comique et tragique. On pense à du Courteline, et à du Kafka. Mais l’enjeu, qui est le chômage possible de cet homme, fait assurément se figer le sourire sur nos lèvres.
Je vois là aussi un signe de la brutalité extrême de notre monde. Ce que la littérature a déjà évoqué, par exemple avec le cas de Jean Valjean envoyé au bagne pour le vol d’un pain, dans Les Misérables de Victor Hugo, se réalise effectivement. Et à côté de cela, combien s’emplissent les poches « légalement », sans être inquiétés le moins du monde !
On se demande, comme le disait déjà Montaigne en faisant parler ses Cannibales, pourquoi dans notre Occident qui se prétend encore chrétien en affirmant la fraternité nécessaire entre tous les hommes, les pauvres ne prennent pas les riches à la gorge, et ne mettent pas le feu à leurs maisons !
Ce qui est intéressant aussi est l’argument évoqué : tout doit se faire légalement, en respectant les formes prévues, ici le dépôt d’une demande d’autorisation pour prélever quelques miettes d’un surplus condamné de toute façon à la destruction. Le légalisme administratif peut être la pire des choses. On sait bien pourtant que la lettre tue, et que l’esprit vivifie. Et l’adage latin aussi le dit : summum jus, summa injuria (plus grand est le droit, plus grande est l’injustice).
Et n’oublions pas non plus que le légal n’est pas toujours le légitime. On le sait depuis l’affrontement entre Antigone et Créon dans la pièce de Sophocle. Pour respecter légalisme et formes, on a même ranimé des condamnés à mort avant de les mener au supplice ! Voyez le film de Kubrick Les Sentiers de la gloire, où on soigne un mutin blessé avant de le fusiller : il faut qu’il soit debout en cette occasion.
Notre exemple de départ est dans son ordre aussi abject, et on se demande qui peut bien oser encore se prêter à cette sinistre comédie.
21 juillet 2011
> Société
Accomplissement
Il est le deuil du projet qui l’a précédé, et donc peut provoquer une grande mélancolie, voire une dépression.
Je pense à ce qui est arrivé à Neil Amstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. Il s’est retiré de la vie publique dans son Ohio natal. Il ne donne aucune entrevue. On prétend qu’il ne s’est jamais remis de son « pas de géant » accompli au nom de l’humanité, et que, depuis qu’il est revenu de la Lune, il n’est plus tout à fait le même. Il souffre, dit-on, d’une maladie curieuse : le « syndrome de l’accomplissement total ». Ayant concrétisé le plus suprême de ses rêves, il aurait perdu le goût de tout. (Source Internet : Nox oculis – La cartographie lunaire et l’exploration spatiale).
Rien de curieux pourtant là-dedans. « Toute œuvre, disait Walter Benjamin, est le masque mortuaire de son intention. » C’est sans doute pourquoi, dans la Bible juive, Dieu dit « bon » ce qu’il a fait au jour Un ou jour de l’Unité (en hébreu : Yom Erad – il ne s’agit pas comme on le traduit souvent du « premier » jour). Mais il ne répète pas au deuxième jour son auto-félicitation (Genèse 1/6-8). Celle-ci ne reprend qu’au troisième jour.
Tout se passe comme s’il y avait un principe de malédiction, une sorte de moins-être, dans tout accomplissement, qui est la rupture de l’infini des possibles présent au départ, l’éclatement catastrophique d’une unité première, comme les Gnostiques l’ont toujours souligné.
On peut en effet menacer quelqu’un de l’accomplissement de ce qu’il souhaite le plus ardemment. Car s’il l’obtient, il n’aura plus rien à désirer, ce qui est sans doute le pire des états. Les dieux nous punissent en nous exauçant. Changeons donc nos cartes de vœux : « Je vous souhaite de ne pas obtenir cette année tout ce que vous désirez ! » Je ne sais quelle tête ferait le destinataire, mais cela vaut le coup toujours d’essayer.
Le désir fleurit, la possession flétrit toute chose. La vraie fête, c’est la veille de la fête. Le vrai dimanche, c’est le samedi soir. Les vraies vacances, c’est le jour où on les prend.
Loin des yeux, près du cœur. « Comme vous étiez jolie, hier soir au téléphone ! » : beau mot de Sacha Guitry. Le meilleur moment en amour, c’est quand on monte l’escalier. Il est meilleur dans les rêves que dans les draps. L’homme descend du Songe : il meurt de le réaliser…
Sachons méditer tout cela, ne nous laissons pas prendre à ceux qui nous disent que tout accomplissement est positif, comme ceux qui ne voient pas dans le texte de la Genèse l’importante faille que j’ai signalée. Écoutons plutôt ici ce que dit l’Apôtre : « L’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? » (Romains 8/24)
17 novembre 2011
> Psychologie / Philosophie
Addiction
Lors de la panne générale du 6 juillet dernier qui a affecté le réseau téléphonique d’un des plus grands opérateurs français, ses utilisateurs ont été privés de la faculté d’utiliser leur portable : un grand nombre d’entre eux se sont sentis perdus, désemparés et paniqués, à un point tel qu’on peut se demander de quelle angoisse cette prothèse les protège. L’émoi a été énorme, relayé immédiatement par les medias, de façon significative.
Pour dire cette peur de la séparation d’avec l’instrument, on a forgé un néologisme, la nomophobie, francisation de no mobile phobia, notion apparue dans une étude britannique de 2008. En France aujourd’hui, plus de 50% des utilisateurs pensent ne pas pouvoir se passer plus d’une journée de leur mobile, et même ils seraient 20% à avoir besoin d’emporter leur smartphone dans leur chambre à coucher (source : L’Ordinateur individuel, juillet-août 2012, p.36). Bref, l’instrument sert d’objet transitionnel ou de doudou, transformant en enfant celui qui s’en sert.
De cette dépendance nous sommes des victimes consentantes, et on pourrait parler ici, en changeant le contexte, de cette « servitude volontaire » décrite par La Boétie. Un peu de réflexion tout de même nous montre qu’un téléphone ne rend pas libre : est-ce l’être en effet, que d’accourir immédiatement à une sonnerie, comme le chien au sifflet de son maître ?
En outre, par le mobile, tout appel est aussitôt localisé : on peut aisément savoir où nous nous trouvons quand nous téléphonons. Mais qui s’en soucie ?
Enfin, mis à part les usages professionnels ou d’urgence, la plupart des contenus échangés sont d’une rare insignifiance. La vérité est qu’on a peur du silence, qu’on meuble par du bavardage, cette « parlerie » dont parle Heidegger dans L’Être et le Temps. Combien de Téou ? sont ainsi échangés !
On redoute la solitude et l’ennui, dont pourtant il faut faire l’éloge, comme moyen salutaire de se faire face à soi-même et de développer sa richesse intérieure, sa créativité. [v. t. 1 : Dimanche et Silence]
Enfin, les relations par le mobile, comme celles par Internet, sont totalement virtuelles. On n’a jamais autant « communiqué », et on n’a jamais autant été coupé physiquement des autres. La solution ? Comme Quentin qui casse symboliquement sa montre dans Le Bruit et la Fureur de Faulkner, il faut savoir se déconnecter d’un instrument potentiellement aliénant.
26 juillet 2012
> Société
Amoureux
D’après une étude américaine récemment publiée et dont je viens de prendre connaissance, s’il arrive qu’on ait mal quelque part dans son corps, le meilleur remède est de tomber amoureux. Cela sécrèterait dans l’organisme de bénéfiques « substances psycho-actives », qui comme leur nom l’indique seraient susceptibles de nous redonner du tonus, de l’élan et de l’allant.
Je ne sais quel humoriste a dit que passé un certain âge, que je ne préciserai pas par précaution, si on n’a mal nulle part lorsqu’on se réveille, c’est qu’on est mort. Eh bien, voici maintenant le remède : tomber amoureux.
Certes il y a là une solution pour lutter contre la dépression du désenchantement, l’acédie ou le « À quoi bon ? » où nous mène inexorablement le poids des ans. Comme dit l’Évangile, « Si le sel perd sa saveur, comment le lui redonnera-ton ? » (Matthieu 5/13 ; Marc 9/50 ; Luc 14/34) Évidemment les rédacteurs de ces textes n’avaient pas pensé, comme palliatif, à la voie sus-évoquée. Mais nous vivons une époque moderne, et nous serions bien sots d’en éluder les progrès.
Les Anciens disaient que l’amour dans la vieillesse est une chose honteuse : Turpe senilis amor. Démentons-les donc, et ouvrons à nouveau notre cœur, laissons-le battre selon tous ces merveilleux horizons que nous ouvre, quand nous sommes amoureux, notre imagination. Y trouverons-nous des ennuis ? Qu’à cela ne tienne ! Les ennuis chassent l’ennui. Ceux de l’amour ont ceci de bon qu’ils n’ennuient jamais. De toute façon, il vaut mieux se perdre dans sa passion que de perdre sa passion.
Ne risquons-nous pas, si nous aimons, de ne pas être payés de retour ? Tant pis. Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ! À nous donc les voyages organisés, les clubs de rencontre, les liaisons sur Internet, les cours de danse où s’épanouira à nouveau notre vie au contact d’un nouveau partenaire ! N’hésitons pas. Écoutons les médecins, ces gourous modernes. Sans aucun doute notre corps s’en trouvera mieux, si nous passons des rhumatismes au romantisme.
5 mai 2011
> Société
Anticléricalisme
On peut être anticlérical, et aimer fréquenter les prêtres, rechercher sinon leur amitié, au moins leur conversation. C’est précisément mon cas, et en chaque ville que j’ai habitée j’ai toujours essayé de rencontrer le chargé de paroisse de mon quartier.
Aussi me suis-je reconnu en lisant le récent article de Télérama consacré au trentième anniversaire de la mort de Georges Brassens. On y lit que ce « légendaire bouffeur de curés » en comptait plusieurs dans son entourage. Et cela ne m’a pas du tout étonné.
Comment expliquer ce paradoxe ? Cela est aisé. Qui pourrions-nous vouloir rencontrer, lorsque nous sommes jusqu’à la nausée écœurés par le matérialisme de notre société ? Face à ce « règne inexpiable de l’argent » dont parlait Péguy, et dont il n’y a aucun précédent dans l’histoire de notre monde, qui voir, avec qui parler, qui n’en soit pas a priori prisonnier, et qui soit une occasion de nous ouvrir à ce à quoi notre âme altérée aspire : quelque chose d’autre au moins que tout cela, et qu’il faut bien appeler Transcendance ? Qui nous change des vedettes du show-biz, du foot, de la finance, de l’arrivisme de nos professionnels de la politique ?
En principe, à part peut-être certains penseurs ou artistes (dont le nombre n’est pas bien grand, car beaucoup sont pris par le culte de leur ego, quand ce n’est pas par le maelstrom de l’argent), seuls les hommes de Dieu peuvent nous faire entrevoir d’autres horizons que ce royaume de la Mort.
Mais seulement quand nous les sentons habités par la même recherche que la nôtre : bref, nos frères en humanité. Mais viennent-ils à nous débiter tel catéchisme ou tel credo, telle injonction institutionnelle, qu’aussitôt le rapprochement se rompt, et qu’apparaît inévitablement l’anticléri-calisme. C’est que nous n’avons plus devant nous un homme, mais comme disait Drewermann un « fonctionnaire de Dieu ».
C’est pourquoi, contre ce type de fossilisation, le « mécréant » Brassens a toujours défendu l’humain. Mais déjà Hugo, ce grand croyant, disait que Dieu sortait de l’église dès lors qu’un prêtre y pénétrait. Quant à moi, j’en pourrais certes dire autant à l’occasion. Mais tout de même, je me contenterai d’espérer rencontrer un homme partageant la même soif que moi, même si c’est pour un Dieu auquel personnellement je ne crois pas.
31 mars 2011
> Religion / Spiritualité
Anxiété
Le tribunal administratif de Melun a reconnu jeudi 19 juillet un « préjudice d’anxiété » à des enseignants du lycée Adolphe-Chérioux, à Vitry-sur-Seine, au motif que l’État ne leur a pas assuré une protection suffisante.
L’établissement ne possédant pas de barrière, des éléments étrangers pouvaient s’y introduire, et y répandre la peur. D’où un climat d’insécurité permanente pesant sur les élèves et les professeurs, contraints de s’enfermer dans leurs salles de cours pour se mettre à l’abri de la violence environnante.
Cette décision judiciaire est une première en France, et pourrait faire jurisprudence. On connaissait déjà le « droit de retrait » qui permet à chaque agent confronté à un danger « imminent » d’arrêter son travail sans s’exposer à des pénalités. Mais ici l’affaire a été jusqu’à l’épreuve de force devant un tribunal, et chaque professeur a obtenu 500 euros chacun, pour son « préjudice d’anxiété ». Pourront donc désormais exciper de ce jugement tous les personnels en contact direct avec le public, guichetiers d’accueil, agents de Pôle emploi, chauffeurs de bus, etc., susceptibles d’être en situation d’insécurité.
Personnellement je pense qu’il y a bien longtemps que pareille nouvelle aurait pu nous parvenir, tant les paroles et actes qu’on dit pudiquement d’« incivilité », mais qui sont en réalité de violence, se produisent dans l’enceinte des établissements.
En tant qu’ancien professeur je l’atteste : dans une classe ordinaire du second degré, aucun cours ne peut se faire calmement, c’est-à-dire sans qu’il y ait bavardage constant (je ne parle pas de chahut organisé), plus de cinq minutes. Ce n’est pas pour rien qu’en période de chômage généralisé la totalité des postes mis au concours de recrutement des professeurs du secondaire ne peut pas être pourvue. Mieux vaut en collège ou lycée être professeur d’arts martiaux que professeur traditionnel.
La vérité est que chacun a peur. Les élèves des mauvais sujets, le professeur des élèves, le directeur des scandales et des parents, le ministre de l’impopularité, etc. Finalement, anxiété et peur, cela revient au même. Comme le dit le cinéaste Fassbinder, La Peur dévore l’âme (éd. L’Arche, 1997). Il faudrait assurément un sursaut. Mais vu l’état général des esprits, la paralysie et la veulerie générales, la délivrance me paraît bien problématique.
2 août 2012
> Société
Apocalypse
Je n’ai aucun goût pour l’eschatologie [v. Eschatologie]. Pourtant je viens de voir le dernier film apocalyptique de Lars Von Trier, Melancholia, et je l’ai bien aimé.
Je laisse bien sûr de côté les déclarations de l’auteur au dernier festival de Cannes, qui lui ont valu d’en être exclu, pour ne m’intéresser qu’au film. Il montre la vanité profonde des occupations et institutions humaines, via la critique qu’il fait, dans sa première partie, du mariage de l’héroïne. Celle-ci, comme les Gnostiques ou les Cathares, est persuadée du côté profondément mauvais ou diabolique de la vie telle qu’elle va : c’est simplement la tribulation (la thlîpsis) propre au monde, telle qu’on la voit dans l’évangile selon Jean.
La seconde partie est consacrée à la collision possible d’une autre planète, appelée Melancholia, avec la terre. La fin montre la destruction finale de celle-ci, simplement « compensée » par les mains jointes des trois personnages centraux, réunis en un « triangle magique », en un admirable symbole. Qu’opposer en effet au néant qui vient, sinon un simple blottissement quasi animal ?
Bien sûr il se trouvera des personnes pour trouver ce film excessivement pessimiste. Je ne suis pas de leur avis. La mélancolie, comme dit Nerval, est un « soleil noir ». Elle nous brûle par la lucidité qu’elle nous donne. Au reste, comme disait Artaud, celui qui n’est pas malade ne va pas bien.
J’ai aimé ce film parce qu’il montre dans une Apocalypse une signification symbolique : la vanité de toutes les affirmations optimistes qu’on nous assène pour nous rassurer sur l’existence. Sans symbole de ce type, on n’a affaire qu’à du Grand Guignol, qui ne fait pas réfléchir et joue sur la crédulité des gens, tels tous ceux, millénaristes, adventistes, etc ., qui tout au long des siècles ont pris littéralement le dernier livre de la Bible chrétienne.
Comment ne pas être mélancolique ? Qu’atten-dre d’un monde, comme disait Schopenhauer, où en naissant on est à peu près sûr de voir mourir son père et sa mère ? Où de deux êtres qui s’aiment, l’un est sûr de voir mourir l’autre ?
Certains disent que Lars Von Trier est un dépressif, et qu’il urge qu’il sorte de sa dépression. Je pense le contraire, qu’il est tout à fait lucide, et que face à l’absurdité du monde la seule chose qui nous reste à espérer est, comme on le voit à la fin du film, de pouvoir serrer fortement la main de quelqu’un.
13 octobre 2011
> Psychologie / Philosophie
Appauvrissement
Il ne concerne pas que les biens matériels, mais aussi le langage, dont l’étendue reflète les capacités de notre pensée.
Ainsi il paraît que le mot Mademoiselle va être banni des documents administratifs. Certes, comme aujourd’hui ce mot désigne une jeune fille ou une femme célibataire, on n’a pas voulu voir le sexe féminin comme essentiellement promis au mariage, dont le seul but est la maternité. On a donc préféré n’y pas enfermer la femme. Madame suffirait donc pour la nommer dans tous les cas, et les féministes peuvent s’en féliciter.
Cependant le mieux est l’ennemi du bien et, comme disaient les Latins, la pire corruption est celle du meilleur – corruptio optimi pessima. En effet, perdre le mot Mademoiselle est oublier tout un pan de notre culture passée, où il désignait une femme de haute condition. Voyez « La grande Mademoiselle », titre de la fille aînée des frères ou des oncles du roi sous l’Ancien Régime. C’était aussi une promotion que de l’utiliser pour une bourgeoise. Ainsi, remarque Le Robert, « Racine appelait sa sœur Madame avant son mariage avec Louis Rivière et Mademoiselle lorsqu’elle fut son épouse. » On trouverait chez Molière des sens analogues. Qu’en restera-t-il maintenant ?
Et faudra-t-il rebaptiser nos œuvres ? Changer Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier en Madame de Maupin ? Notre héritage en sera fortement appauvri. En outre, il était d’usage qu’un professeur appelât, jusqu’à une date relativement récente, ses élèves féminines en disant : « Mademoiselle une telle… » Devra-t-il dire : « Madame… » ?
Bref, cette simplification sera aussi catastrophique pour les mœurs que la généralisation immédiate du prénom et du tutoiement pour s’adresser à une personne, selon cet usage néfaste qui nous vient des États-Unis. Gardons donc les filtres divers qui permettent l’apprivoisement progressif d’un être, ainsi que les changements d’état.
Ainsi, quand la langue le permet, le passage du vous au tu, et l’usage pour la première fois du prénom, ont la magie d’un premier commencement, comme dans le premier baiser. Ne donnons pas la proximité d’emblée, et n’embrassons pas à tout bout de champ, comme on le voit aujourd’hui.
Gardons aussi les titres, et quand ils existent sous trois formes (Monsieur, Mademoiselle, Madame), leur usage ainsi que leur éventuel changement donneront plus de sel à la vie. Méfions-nous d’un méliorisme irréfléchi. Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. [v. t. 1 : Espaces]
8 mars 2012
> Société
Attention
C’est, selon Malebranche, la piété maximale de l’esprit. On n’en fera jamais assez l’éloge, car elle est aujourd’hui en grand déclin.
Dans le système scolaire, par exemple, combien d’élèves doivent leurs mauvais résultats simplement à des difficultés d’attention ! Ainsi il est effarant de constater le nombre d’appels qu’ils reçoivent le soir sur leur téléphone portable : peuvent-ils faire correctement leurs devoirs dans ce temps-là ? D’ailleurs, accourir à la sonnerie comme le chien quand on le siffle, est-ce être libre ? [v. Addiction]
On essaie de remédier à ces difficultés de concentration par des drogues chimiques, à base d’amphétamines. Mais est-ce une solution ? Je pense aussi à ces personnes qu’on voit dans les transports en commun, en train de lire avec un walkman sur les oreilles. Que peuvent-ils bien comprendre à ce qu’ils lisent, car l’esprit, tous les neurologues nous le disent, ne peut faire deux choses à la fois ? Il n’est pas multitâche, et on n’y peut ouvrir, à la différence de tel logiciel informatique, plusieurs fenêtres (Windows) à la fois.
Les Anciens disaient bien : Age quod agis – c’est-à-dire : « Fais ce que tu fais ». Autrement dit : fais effectivement ce que tu es en train de faire, en ne faisant que cela.
Il faudrait apprendre la concentration, et toutes les sagesses du monde insistent sur le salut procuré, à cet égard, par la méditation visant l’état de pleine conscience (mindfulness). Elle consiste à poser seulement l’esprit sur l’instant présent, le hic et nunc, l’ici et maintenant. S’il s’évade ailleurs, il faut le ramener à cet instant, s’y absorber. Les effets somatiques en sont très bénéfiques, par exemple sur l’obésité et l’hypertension.
On objectera peut-être que ce moment présent n’a rien d’attirant en soi. Mais quand bien même cela serait, il faudrait faire l’éloge de ce vide même, de cette disponibilité, je dirais même celui de l’ennui. Laissons nos enfants, bien souvent rendus hyperactifs par la suroccupation dont les accablent leurs parents, s’ennuyer. L’ennui est formateur, car il développe l’imagination et la créativité. C’est dans la lenteur même de l’écoulement du temps qu’elles peuvent s’épanouir. Là encore un ancien proverbe est d’actualité : Festina lente – « Hâte-toi lentement ».
Nous valorisons l’aigle, à cause de sa vue perçante. Ou le lion, à cause de sa force (il dort pourtant la plupart du temps !). Mais qui fera l’éloge de la tortue ? À son allure, tout peut prendre vie, devenir objet d’une attention et d’un éveil salvateurs.
→ Pour des développements supplémentaires sur ces questions, on peut lire mon ouvrage Sur les chemins de la sagesse – Des clés pour mieux vivre, éd. BoD, 2019.
6 octobre 2011
> Psychologie / Philosophie
Aveuglement
Notre société n’a jamais été dans les faits aussi dure, et aussi aveuglée dans ses représentations et dans son langage.
Je prendrai le seul exemple de l’enseignement, que je connais bien pour lui avoir consacré ma vie professionnelle. Les agressions des élèves ou des parents contre les professeurs se multiplient, et on se contente de les appeler, par un doux euphémisme, des actes d’« incivilité ».
Le jargon pédagogiste laisse aussi rêveur. Ainsi la notation est-elle dite « stigmatisante », et pour cette raison doit être rendue « positive » (ce qui ne veut rien dire), ou même totalement supprimée, avec les redoublements. On ne réfléchit pas que l’évaluation fait toujours partie de la vie professionnelle, sinon de la vie tout court, et qu’elle peut être, si elle est juste, une gratification très prisée des élèves, qui ont droit qu’on la leur offre.
Mais ces derniers sont maintenant des « apprenants », même quand ils n’apprennent rien parce qu’ils ne veulent pas apprendre. Gageons que Prévert, l’auteur du Cancre, se retournerait dans sa tombe si on lui disait qu’il n’y a plus de cancres, mais simplement des « apprenants en réussite différée » !