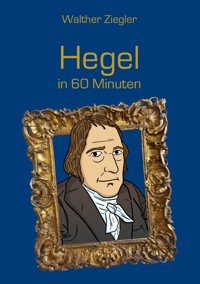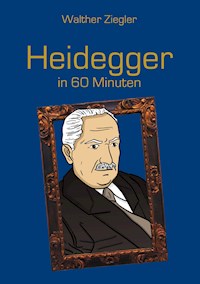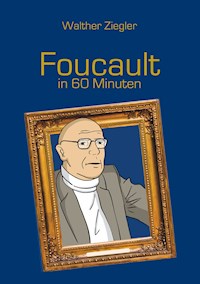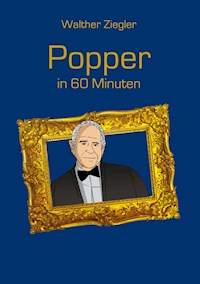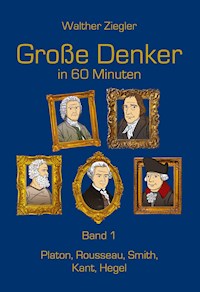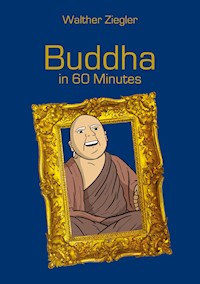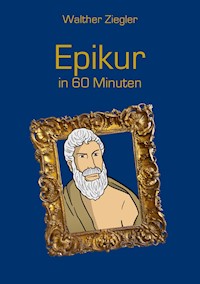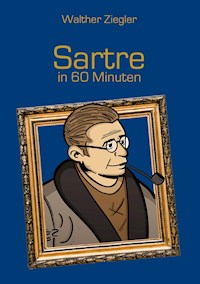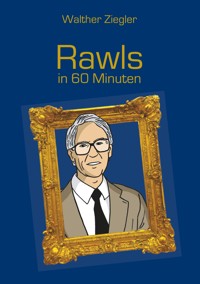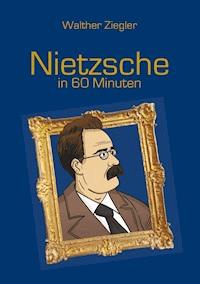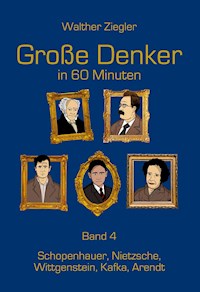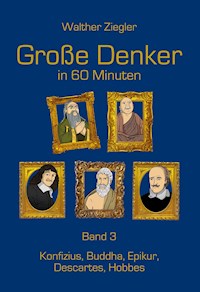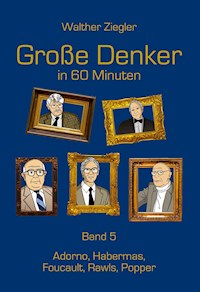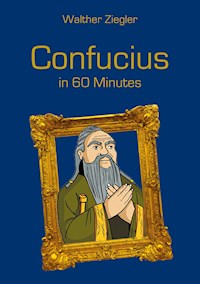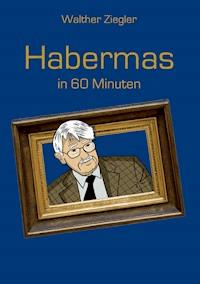Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La grande découverte de Platon fut un événement fondateur. Sa théorie des Idées a marqué toute la culture occidentale. Il y a plus de 2000 ans, Platon exprima son incroyable doute dans l'allégorie de la caverne : les hommes voient des ombres sur la paroi d'une caverne et les prennent pour des réalités. Avec cette allégorie, Platon voulait réveiller ses contemporains, incapables de reconnaitre le monde réel, et les amener à cesser de vivre dans le monde manipulé des illusions. Les Athéniens se laisseraient aveugler par les plaisirs matériels, la richesse et des politiciens démagogues. Son intuition est aujourd'hui plus que jamais d'actualité dans l'ère du numérique. Ne courons-nous pas le risque de nous laisser éblouir par un monde illusoire, avec notre usage d'internet, du téléphone portable et de la télévision ? Pour connaître la vérité, l'homme doit réapprendre à voir de son oeil intérieur. Nous serons capables de ressentir la vérité si nous parvenons à regarder au-delà des simples apparences. Car derrière les objets du quotidien et le monde visible qui nous entourent se trouve un deuxième monde invisible, une dimension supérieure de l'être qui peut nous faire accéder à la vérité. Cette deuxième réalité, c'est le royaume des Idées, en particulier des Idées du Bien, du Vrai et du Beau, vers lesquelles nous devons nous orienter. Mais que sont ces Idées ? D'où viennent-elles ? Que veut nous dire Platon lorsqu'il parle du Bien ? Et surtout, comment pouvons-nous reconnaitre le Bien et vivre en accord avec lui ? À l'aide du mythe de l'attelage, de l'image du soleil et de l'allégorie de la caverne, le livre « Platon en 60 minutes » explique le monde fascinant des Idées. Mais il fournit également un éclairage sur sa vision de l'État idéal dirigé par les philosophes-rois, en s'appuyant sur les plus importantes citations. Le dernier chapitre révèlera l'étonnante actualité de sa philosophie. Le livre est paru dans la collection à succès « Grands penseurs en 60 minutes ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 63
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je remercie Rudolf Aichner pour sa direction éditoriale infatigable, Silke Ruthenberg pour la
délicate réalisation graphique, Angela Schumitz, Lydia Pointvogl, Eva Amberger, Christiane
Hüttner, Martin Engler pour la relecture, et Eleonore Presler, docteur en philosophie, qui a
effectué une dernière relecture linguistique et scientifique du texte français. Je remercie aussi
monsieur le Professeur Guntram Knapp à qui je dois ma passion pour la philosophie.
Je tiens à remercier tout particulièrement mon traducteur
Neïl Belakhdar
Lui-même philosophe, il a traduit en français, avec soin et précision, mon texte allemand, le
complétant, là où nécessaire, de passages adaptés spécifiquement aux besoins du lecteur
francophone.
Table des matières
La grande découverte de Platon
La pensée centrale de Platon
Le mythe de l’attelage et la voie vers le bonheur
L’amour platonicien
La doctrine des Idées
Le savoir comme réminiscence
L’immortalité de l’âme
L’allégorie du soleil
L’allégorie de la caverne
L’État idéal
À quoi nous sert aujourd’hui la découverte platonicienne ?
L’État idéal – vision ou cauchemar ?
Platon – ancêtre intellectuel de l’Occident
Nous sommes tous prisonniers – l’ascension de l’âme vers le Bien, le Vrai et le Beau
La connaissance, hors du confort et de l’oubli
Index des citations
La grande découverte de Platon
La grande découverte de Platon (428-348 av. J-C) a été un moment marquant et fondateur dans l’histoire de la pensée. Sa « doctrine des Idées » a marqué toute la culture occidentale et son nom est aujourd’hui connu du monde entier. Pourtant, Platon a au fond découvert quelque chose de très simple. Il s’agissait pour lui de trouver un critère fiable de la vérité, un repère ultime pour nous guider dans la conduite de notre vie. Et il ne cessa de poser la question : Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui est faux ? Comment distinguer la vérité de la non-vérité ?
Lors de son vivant déjà, environ quatre-cents ans avant Jésus Christ, philosophes et citoyens se disputaient sur les places publiques au sujet de la vérité. Chacun défendait alors un avis différent et accusait son interlocuteur d’ignorance ou de naïveté. Ces différends incessants leur paraissaient tout à fait naturels. Car les philosophes les plus influents à l’époque, les sophistes, Protagoras à leur tête, prétendaient que l’homme est la mesure de toute chose. Selon cette thèse, cinq individus différents auraient tout logiquement et légitimement cinq conceptions différentes de la vérité. Chacun d’eux disposerait de ses critères propres et pourrait donc en tirer ses propres conséquences et il n’existerait ainsi, par principe, pas de vérité reconnue par tous.
Or, c’est justement l’existence d’une telle vérité universelle et absolue que visait à établir Platon. L’absence d’une telle vérité, rétorquait-il aux sophistes, mènerait inévitablement à un déclin moral, car chacun pourrait alors se comporter comme bon lui semble, selon ses propres critères. Platon se mit alors à la recherche d’un point intangible pouvant servir de critère à toute théorie, toute pensée et toute action. Au fond, toute la pensée platonicienne tourne autour de ces deux questions : Qu’est-ce qui est réellement vrai et comment peut-on vivre une vie véridique ?
Il fut ainsi le premier à poser la question centrale de la philosophie. Car la combinaison des mots grecs « philo » et « sophia » ne signifie rien d’autre que l’amour de la sagesse, ou, si l’on va plus loin, l’amour de la vérité. Bien évidemment, la recherche d’une telle vérité ultime n’est pas chose facile et représente un immense défi. Il n’est donc pas étonnant qu’étant jeune, Platon ne parvint pas à trouver de réponse définitive à ses questions. Mais il décida de poursuivre son questionnement en quête d’une réponse satisfaisante. Pour cela, il développa sa propre méthode, le dialogue, et trente-six de ses quarante-et-une œuvres sont écrites dans ce style surprenant, alternant questions et réponses. Dans la plupart des dialogues, il met en scène son philosophe préféré Socrate, discutant avec des interlocuteurs variés autour de questions philosophiques.
Au début, chacun a une opinion différente, voire contraire à celle des autres. Chaque interlocuteur doit ensuite faire face aux questions épineuses du philosophe Socrate, jusqu’à pouvoir justifier sa thèse ou avouer son erreur. C’est ainsi que Platon a pu, à l’aide de ces dialogues écrits dans un style brillant, critiquer les opinions contradictoires de son époque, sans devoir lui-même prendre parti pour telle ou telle thèse. Dans ses premiers dialogues, il avoue même, en toute honnêteté, ne pas encore savoir en quoi pourrait consister une telle vérité définitive.
C’est dans ce contexte-là que Platon fait dire à l’interlocuteur principal de ses dialogues, Socrate, la fameuse phrase : « Je sais que je ne sais rien. » Ou littéralement :
Les dialogues du jeune Platon ont toujours une fin ouverte. Il lui suffisait de montrer que les autres philosophes, notamment les sophistes, s’embourbaient dans leurs contradictions. Ainsi, par exemple, dans un dialogue qui porte son nom, le sophiste et professeur de rhétorique Gorgias prétend que la rhétorique est un art noble et supérieur. Or, les questions de Socrate le poussent petit à petit à avouer que la rhétorique, comme art de la persuasion, peut être employée pareillement pour des causes justes comme pour des causes injustes. Finalement, Gorgias est forcé d’avouer que la rhétorique est moins un art qu’une technique, dont on peut faire bon ou mauvais usage.
Le dialogue Lachès traite du courage. À la question de savoir ce qu’est l’essence du courage, les interlocuteurs de Socrate répondent en citant des exemples d’hommes courageux, admirables pour leur talent à la guerre, leur endurance, leur vigueur, réponses nullement satisfaisantes pour Socrate. Car suivant cette logique, le courage serait à chaque fois quelque chose de différent, selon l’homme courageux que l’on a devant soi. Finalement, tous les interlocuteurs doivent avouer qu’il leur manque un critère précis pour juger de ce qu’est réellement le courage.
C’est de cette manière-là que Platon permet à la figure de Socrate de mener les entretiens dans la direction souhaitée. Notons que Socrate n’est pas un personnage littéraire inventé par Platon, mais qu’il a réellement vécu et qu’il a même longtemps été son professeur. Parce que Socrate n’enseignait qu’oralement et qu’il n’a légué aucune œuvre écrite, Platon a pu, après coup, faire dire à Socrate ce qui était en fait ses propres pensées. En effet, jusqu’aujourd’hui, il est très difficile voire impossible pour les spécialistes de distinguer la pensée de Socrate de celle de Platon, car presque tout ce que nous savons de Socrate nous provient des dialogues platoniciens.
Dans tous les cas, il est certain que Platon a consciemment utilisé le personnage de Socrate pour véhiculer les thèses centrales de sa propre philosophie. La méthode pratiquée par Socrate, consistant à mettre en évidence les contradictions de ses interlocuteurs afin qu’ils avouent s’être trompés, cette méthode, Platon l’appelle aussi la « dialectique » ou encore la « maïeutique », c’est-à-dire la méthode de sage-femme, car avec ses questions, Socrate fait naître la vérité à la manière d’une sage-femme, en répétant ses questions jusqu’à dissolution de toute contradiction, pour que la vérité puisse éclore de la bouche de ses interlocuteurs eux-mêmes.
Dans son dialogue le plus connu, la République, Platon décrit sa manière de mener des entretiens comme une méthode dialectique de dévoilement de la vérité. Seule la méthode dialectique, dit-il, est capable de mettre fin aux préjugés barbares et aux fausses suppositions, de mener l’homme à la source même de la vérité et de libérer l’œil de l’âme du bourbier des préjugés :
L’œil intérieur ne pourra apercevoir la vérité que lorsque la méthode dialectique aura guidé l’âme vers le haut. Mais qu’est donc la vérité ? Comment distinguer le vrai du faux ? C’est dans la République, ainsi que dans le Phédon et dans le Banquet