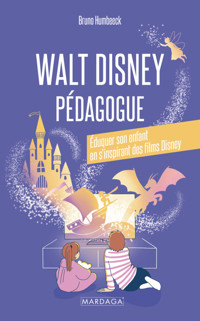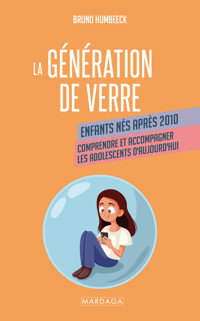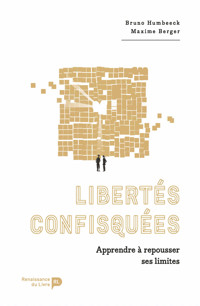Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Et si on repensait vraiment l’éducation ?
La pédagogie a une histoire… et même plusieurs !
Entre traditions et innovations, théories anciennes et réinventions modernes, il est parfois difficile de s’y retrouver. Ce livre propose un voyage passionnant à travers les grandes figures, les courants majeurs et les enjeux brûlants de l’éducation.
Découvrez :
Les fondements des pédagogies traditionnelle, active, libertaire et spiritualiste
Les grands noms de l’histoire éducative : La Salle, Montessori, Freinet, Alvarez…
Les mythes, limites et apports des différents modèles pédagogiques
Un éclairage inédit sur les défis contemporains :
Comment accompagner une génération ultra-connectée dès la petite enfance ?
Comment redonner du sens à l’école dans un monde en mutation ?
Quelles pédagogies actives, collaboratives et critiques pour former des citoyens libres et conscients ?
Un guide vivant, clair et stimulant, qui interroge, bouscule et inspire !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Titulaire d’un Master Européen de Recherche en Sciences de l’Education et d'un doctorat en Sciences de l’Éducation de l’Université de Rouen, Bruno Humbeeck est actif à la fois sur le terrain en tant que psychopédagogue et en tant que directeur de recherche au sein du service des Sciences de la famille de l'Université de Mons. Son immersion continue dans les pratiques de soutien à la parentalité des familles défaillantes l’amène à interroger en permanence la validité opérationnelle des perspectives théoriques à travers lesquelles la réalité psychosociale des personnes et des familles en difficulté peut être envisagée. Spécialiste de la résilience, il est aussi formateur et auteur de plusieurs publications dans le domaine de l’éducation familiale, des relations école-famille, de la maltraitance, de la toxicomanie et de la prise en charge des personnes en rupture psychosociale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
EN GUISE D’INTRODUCTION : FAIRE DE LA PÉDAGOGIE TOUTE UNE HISTOIRE
La pédagogie a une drôle d’histoire. Ou plutôt, elle a plusieurs histoires. C’est pour cela qu’il est parfois difficile d’en suivre le cours. C’est aussi pour cette raison qu’il est aisé de s’y égarer – ou d’y perdre les parents et les enseignants –, confondant le neuf et l’ancien, le convenu et le révolutionnaire, l’innovant et le déjà éprouvé…
Il suffit parfois, pour précipiter cet égarement, de faire passer des vessies surannées pour des lanternes innovantes ou de donner une nouvelle jeunesse à de vieilles intuitions délavées en les couvrant superficiellement d’un vernis scientifique… Le parent berné, l’enseignant dupé, n’y verront généralement que du feu et les pseudo-révolutionnaires s’en tireront à bon compte en n’ayant rien changé du tout, mais en s’étant assurés, sous couvert d’une marchandise pédagogique frelatée, d’avoir utilisé le flou historique pour vendre des théories creuses débouchant sur des pratiques vides.
Peu importe si les résultats s’avèrent, à l’examen, décevants. Peu importe si, confrontées aux réalités d’une classe ou d’une famille, les méthodes éducatives s’écrasent contre un réel qui leur résiste. Peu importe si, appliquées dans la vraie vie, les idées pédagogiques se fracassent face à une réalité subversive. Plutôt que de remettre en cause les idées creuses porteuses de pratiques vides, les promoteurs de ces fausses innovations pédagogiques préféreront généralement s’interroger sur la pertinence du réel ou sur le bien-fondé de la réalité. En matière d’éducation, il sera de toute façon toujours possible, quand cela ne marche pas, de trouver un coupable : le parent qui n’y entend rien, l’enseignant qui applique mal ou l’enfant qui ne fait pas preuve de bonne volonté.
Le « marché » des idées pédagogiques est en pleine expansion. Profitant de parents déboussolés, d’enseignants mis sous pression et d’éducateurs sommés d’être performants, beaucoup y vont de leur « méthode », prétendant avoir inventé l’eau qui bout, suggérant l’idée qu’ils auraient révolutionné l’éducation, affirmant détenir enfin le modèle qui vient à bout de tout, l’enfant récalcitrant, l’élève résistant ou l’adolescent opposant. Ils « vendent leur soupe » puis, une fois enrichis, se taisent sans avoir fait avancer d’un iota l’histoire de la pédagogie parce qu’ils n’ont, la plupart du temps, pas pris le temps de la lire.
Les véritables pédagogues – et il y en a – n’agissent pas de cette façon. Ils ne vendent généralement rien. En tout cas, pas des méthodes qui prétendent tout expliquer et avoir réponse à tout. Parfois juste des techniques qui essayent d’enrichir ce que d’autres ont déjà mis en place. Ambitieux dans leur désir de voir l’institution scolaire et familiale évoluer, ils n’en demeurent pas moins modestes dans la vitesse et la radicalité des changements qu’ils proposent d’introduire. C’est pour toutes ces raisons que les véritables pédagogues refusent généralement de faire école.
L’école, ils ont généralement pris le temps de l’interroger avec suffisamment de rigueur pour savoir à quel point celui qui prétend enseigner s’engage dans une tâche compliquée. Mesurant l’ampleur et la difficulté du mandat qui leur est donné, ils ne peuvent, s’ils sont honnêtes, que renoncer aux propos réducteurs, aux schémas simplistes qui transformeraient, à coups de formules magiques, n’importe quel être humain en super-enseignant.
Il en va de même quand ils se penchent sur l’éducation familiale. Là aussi, le véritable pédagogue se refuse à faire monter les enchères en prétendant vendre ses conseils avisés aux parents perdus parce qu’il saurait, lui, comment il faut se comporter à tous les coups pour éduquer sans faille, sans faiblesse et sans faute. Tout juste peut-il, s’il n’est pas présomptueux, leur faire profiter un peu de ses lectures et de ce qu’il a appris à connaître au fil de ses rencontres, et cela non pas pour leur donner des réponses mais pour les aider à s’interroger autrement en réfléchissant avec eux aux expériences dont ils le prennent à témoin. Là non plus, pas de méthode. De la modestie éclairée, de la patience réfléchie et de la conscience lucide introduites à petites doses feront sans doute beaucoup mieux l’affaire pour connaître, comprendre et analyser ce qui se passe quand l’éducation ne trouve plus son chemin dans une famille et que des parents se sentent perdus.
C’est la raison pour laquelle les pédagogues, avant d’oser écrire un peu, doivent avoir pris le temps de lire beaucoup. Ce temps pris pour lire ce qui a été pensé avant eux et autour d’eux leur permet de se donner les moyens de connaître, de comprendre et d’analyser ce sur quoi ils s’interrogent avant d’en proposer une synthèse et, sur base de cette synthèse, d’oser le début du commencement de l’embryon d’une innovation. C’est ce cheminement qui fait généralement la différence entre la démarche intelligente et celle de celui qui prétend synthétiser ce qu’il n’a pris le temps ni de connaître, ni de comprendre, ni d’analyser.
Quand un pédagogue se met à réfléchir à propos de l’éducation, il doit pourtant savoir qu’il n’inscrit jamais ses pas que dans les traces de ceux qui ont réfléchi avant lui aux manières de transmettre, aux façons d’éduquer qui ont existé avant lui et continuent à exister ailleurs, autour de lui… En pédagogie, il n’y a pas d’innovations sorties du néant, il n’y a que des réaménagements plus ou moins innovants.
C’est en cela que tout véritable pédagogue contient généralement l’embryon d’un historien de la pédagogie. Lire, lire et relire… Ce sont les premiers pas en pédagogie. Ceux qui comptent le plus, parce que sans eux, le chemin, mal éclairé, pourrait bien conduire n’importe où celui qui l’emprunte sans qu’il prenne conscience qu’il est perdu. C’est le danger d’un faible éclairage. Dans l’obscurité, chacun peut vite se retrouver sur une voie sans issue et inviter malgré tout les autres à le suivre dans le cul-de-sac qu’il leur a ouvert. Un pédagogue mal avisé s’expose également au risque, en s’imaginant défricher un chemin de traverse, de s’engager sur une route à trois bandes hyper-encombrée que d’autres ont tant et tant de fois arpentée avant nous.
Les véritables pédagogues tâtonnent ensuite pour s’avancer prudemment et prendre leurs marques lentement sur les voies que leurs devanciers ont tracées avant eux. Ces chemins éclairés par l’histoire de la pédagogie leur permettent alors de prendre une direction en connaissance de cause, en sachant d’où ils partent et en se situant par rapport aux différents courants qui portent et animent leur réflexion. Faute de cet éclairage qui reflète ce que nous pensons à la lumière de la réflexion construite par d’autres que nous, la pensée s’imagine originale et, aveugle à tous les points de vue qui s’en écartent, s’expose au triple risque de la radicalité, de l’exclusivité et du simplisme réducteur.
Ainsi, chaque fois qu’une réflexion pédagogique tend à s’inscrire dans une conviction, le bon réflexe n’est pas de se documenter en rassemblant tout ce qui la conforte mais, au contraire, de se mettre en quête de tout ce qui la conteste, la contredit ou la bouscule. C’est comme cela qu’une réflexion pédagogique demeure ce qu’elle doit être, une manière de penser qui fait avancer les choses sans s’exposer au risque de se scléroser dans une « méthode » présentée comme complète, définitive et aboutie.
C’est en cela qu’il est important de pouvoir situer ce que l’on pense dans le courant porteur de notre pensée. Cela nous conduit en effet à aller chercher dans les autres courants ce qui permet de contester la toute-puissance de notre propre opinion. La pédagogie s’assimile à une lutte constante pour faire avancer les choses le mieux possible au bénéfice de tous. Elle n’a rien à gagner à se constituer comme un combat vis-à-vis de tous ceux qui pensent autrement que soi. La tentation de se laisser porter par le courant semble évidemment confortable quand on ne veut pas faire trop d’effort pour avancer. La démarche la plus porteuse en pédagogie impose pourtant au contraire de prêter une attention positive à tout ce qui se dit, se fait ou se démontre dans les autres courants.
Deux dangers guettent alors le pédagogue qui remonte ces courants. Le premier, c’est celui de se laisser emporter par un seul d’entre eux, celui qu’il trouve le plus puissant, le plus navigable ou le plus excitant, peu importe, en tout cas celui qui convient le mieux à sa façon de penser et incite à négliger tous les autres. Il risque alors de devenir le promoteur exclusif de ce seul courant et d’envisager les autres comme autant de fausses pistes inutiles à explorer. Le pédagogue emporté par le courant se fait de cette façon défenseur d’une cause et se met à penser « contre » tout ce qui ne s’y rattache pas explicitement. Ce faisant, il mutile sa réflexion des apports de chacun des autres courants. Nous tenterons précisément dans cet ouvrage d’éviter ces formes de tyrannie d’un courant au détriment des autres pour nous donner les moyens de les suivre dans ce qu’ils proposent ensemble quand ils portent l’Histoire, la contestent ou en élargissent la perspective.
Le second piège, c’est de se laisser duper par une méthode qui prétendrait répondre à tout et, en conséquence, de céder à la tentation d’édifier des statues dédicacées aux personnes qui s’en seraient déclarées dépositaires. Ces statues naturellement immobiles deviennent dès lors parfois tellement imposantes qu’elles ne permettent plus de voir, derrière elles, le courant qui est, lui, nécessairement mouvant. Le pédagogue, se nourrissant d’hagiographies plus que de biographies, risque alors de figer sa pensée en la coulant dans l’édifice de marbre et, par fidélité au modèle, d’accepter qu’elle s’y rigidifie pour en grossir le volume. Ce faisant, il laisse filer le courant et ne participe plus à son développement, mutilant ainsi sa réflexion du mouvement nécessaire qui doit sans fin l’animer. C’est pour cette raison que nous nous attacherons particulièrement dans ce livre à résister sans cesse à cette tentation de dresser des statues. Nous envisagerons chaque courant comme un mouvement de pensée toujours réalisé par un collectif d’individus et nous nous efforcerons de ne jamais le figer en rattachant par exemple le courant à une méthode unique associée à un seul d’entre eux.
Voilà donc comment, nourris de ce double principe de précaution, nous avancerons au gré des courants pédagogiques sans limiter notre exploration à un seul d’entre eux, et en passant notre temps à déboulonner les statues qui risquent de nous empêcher d’observer son inévitable évolution.
Nous distinguerons globalement trois voies fluviales majeures dans lesquelles s’engouffrent, dans nos pays occidentaux, les courants les plus importants de la pédagogie. Une quatrième voie, plus récente, est venue s’y ajouter en rassemblant un ensemble de cours d’eau plus marginaux issus notamment des apports de la mondialisation.
La première voie, traditionnelle, avance comme un long fleuve tranquille drainant dans ses effluves les alluvions héritées de cette philosophie platonicienne revisitée par Kant et un grand nombre de ses éminents confrères. Ce courant, au débit régulier, peu impétueux, est précisément celui qui fait le lit de notre civilisation judéo-chrétienne à dominante rationnelle. Pour mieux comprendre dans quel sens il nous transporte, il importe d’en remonter le cours. C’est ce que nous ferons en allant à la rencontre de deux de ses illustres représentants historiques. L’un, pédagogue religieux, sert de clé de voûte à son socle chrétien ; l’autre, sociologue, exerce la même fonction de pilier mais du côté laïc. Jean-Baptiste de La Salle et Durkheim seront nos principaux guides dans ce retour aux sources.
Examinant sans concession leur héritage, nous verrons ce qu’il faut en retenir, ce que l’on doit discuter et ce qu’il vaut mieux oublier pour ne pas encombrer notre investigation d’idées datées ou nous égarer en suivant des pistes qui ne mènent nulle part.
Nous verrons ensuite comment ce courant s’est dépoussiéré pour donner lieu, de nos jours, à des innovations essentielles, tant dans le champ de la pédagogie scolaire que dans celui de la pédagogie familiale. La pédagogie différenciée, la pédagogie de compensation, la pédagogie par objectifs, la remédiation ciblée ou la pédagogie inversée en constituent des déclinaisons contemporaines. Elles offrent aux enseignants et aux parents d’aujourd’hui des sources fécondes d’inspiration et permettent aux idées neuves de poursuivre leur route en se laissant éventuellement porter, en tout ou en partie, par ce courant qui, tout en demeurant traditionnel dans ses fondements, peut néanmoins se révéler novateur dans ses formes.
Un second courant, qui se présente comme alternatif, suit en réalité placidement le même cours paisible bien à l’abri des soubresauts de l’Histoire à laquelle il évite par tous les moyens possibles de se heurter. Ce courant pseudo-alternatif est celui des pédagogies dites nouvelles, autrement appelées pédagogies actives et plus récemment assimilées aux pédagogies dites « positives ». Avec ses faux airs torrentueux, cette rivière secondaire fait parfois mine de s’opposer à la pensée conventionnelle, mais elle évite en réalité avec beaucoup de force de faire des vagues… Puisant sa source dans les philosophies aristotéliciennes, elle s’écoule au contraire le plus souvent paisiblement et avance dans le même sens du courant que le fleuve central en empruntant juste une voie parallèle.
Les pensées fécondes de J.-J. Rousseau et J. Locke alimentent le débit de ce courant de pensée. Plus souvent cités qu’ils ne sont réellement lus, l’Émile de l’un et les Pensées sur l’éducation de l’autre sont parfois considérés comme de véritables « bibles ». Inévitablement datés, ils véhiculent pas mal de conceptions surannées dont certaines feraient littéralement frémir plus d’un parent ou d’un enseignant contemporains.
Le courant de la pédagogie active n’est par ailleurs pas avare de statues. Elles jalonnent littéralement son parcours. Montessori en est incontestablement la plus grande. Démesurée, elle bouche parfois totalement la vue d’ensemble que l’on peut avoir sur le courant. Elle gagne donc particulièrement à être déboulonnée et nous y consacrerons pas mal d’énergie. Celles de Freinet, Steiner et Decroly, plus modestes dans leur taille, gagneront également à être un peu déplacées, voire partiellement démontées. Cela nous permettra de laisser une place aux illustres pédagogues de l’ombre que sont notamment Dewey, Claparède, Ferrière et Cousinet, dont l’œuvre, pillée par les pédagogues statufiés, s’est souvent trouvée diluée dans le courant. Ils en ont pourtant été, au même titre que les premiers cités et souvent même avec davantage de sérieux, moins d’ambitions mercantiles et plus de modestie que la dottoressa italienne, les véritables porteurs.
Souvent mélangées au sein d’un salmigondis au milieu duquel il apparaît de plus en plus difficile de faire la part des uns et des autres, les inflexions pédagogiques de ce qu’il faut nécessairement envisager comme un collectif de pédagogues sont susceptibles de faire l’objet de techniques à diffuser ou de méthodes à imposer. Les techniques, nous le verrons, peuvent être consommées sans modération. Elles sont compatibles avec d’autres styles pédagogiques – en ce compris ceux qui se revendiquent d’un autre courant. Il faudra par contre davantage se méfier des méthodes qui apparaissent souvent radicales, exclusives et inconciliables avec toutes les autres présentées comme inexorablement éloignées d’elles.
Le courant des pédagogies nouvelles est généralement considéré comme un courant alternatif… Pour notre part, nous l’envisagerons comme un courant pseudo-alternatif, une sorte de courant parallèle. Nous constaterons en effet qu’au-delà des effets de manche et de l’apparence révolutionnaire qu’elles se donnent, ces postures apparaissent le plus souvent pédagogicocompatibles avec l’ensemble des courants qui définissent les différentes histoires de la pédagogie. Les allures rebelles qu’elles prennent ne sont souvent que des « airs qu’elles se donnent » pour donner l’illusion de faire la révolution là où elles participent parfois simplement à une évolution, voire à un simple balbutiement de l’Histoire.
Pour illustrer la force de ce courant, nous analyserons plus précisément, sans bien sûr négliger les autres, deux de ses canaux les mieux identifiables. Le premier, porté par un souffle divin, semble parfois, nous l’avons dit, entraîner dans son seul cours toute l’histoire de la pédagogie active : la pédagogie Montessori. Ce canal s’écoule avec force en partant du pied de la statue de son illustre dépositaire. Associé à une méthode, il prétend chasser, sans équivoque, tous les autres. Le second, animé de revendications communistes, fait aussi assez bien parler de lui. Il part également du socle de la statue, de taille bien plus modeste, bâtie en l’honneur de Célestin Freinet par ses admirateurs. Présenté comme un ensemble de techniques et non comme une méthode, il couvre parfois les canaux creusés par les autres acteurs du même champ pédagogique, mais sans jamais chercher à en évacuer aucun.
En observant d’ailleurs ce que l’ensemble de ce courant des pédagogies actives est devenu dans le champ contemporain de la pédagogie, nous constaterons qu’un grand nombre de ces techniques actives sont venues tout simplement grossir le courant traditionnel en exerçant en quelque sorte par rapport à lui le rôle d’un affluent. D’autres, jouant sur un vernis de modernité, ont cherché à créer davantage de vagues en faisant mine de ramer à contre-courant, alors qu’ils se contentaient pourtant de suivre une voie parallèle. Quelques-uns, enfin, ont tenu à demeurer purs dans leurs inflexions en affirmant une orthodoxie sans faille par rapport à leur origine. Ceux-là, bien loin de leur aspiration initiale à se poser en voie navigable exclusivement composée d’une eau pure, sont parfois devenus, il faut bien en convenir, des petits ruisseaux plus ou moins marécageux dont le cours ne s’étend généralement que sur quelques mètres.
C’est là le sort de certaines pédagogies « actives » qui, par souci de fidélité radicale et d’exclusive envers leur membre fondateur, ne sont notamment jamais parvenues à s’étendre au-delà de l’enseignement maternel.
Reste un troisième fleuve. Celui-là, par contre, est animé de courants plus sauvages. Il apparaît nettement moins navigable. C’est pour cette raison sans doute qu’il est logiquement moins souvent emprunté et qu’il ne bénéficie pas du même éclairage que ses deux puissantes consœurs fluviales. Ce courant ne s’inscrit d’ailleurs généralement dans l’histoire « officielle » de la pédagogie qu’en filigrane.
Prenant sa source philosophique à l’ombre de Démosthène et des philosophies cyniques, et dans les méandres nietzschéens qui leur ont succédé, ce courant ne répond sans doute qu’aux conditions d’écriture de ce que Michel Onfray appelle une contre-histoire. Drainant l’ensemble des « pédagogies libertaires », la ravine que ce courant constitue est, on ne s’en étonnera pas, celle qui provoque le plus de remous à chaque confluent.
Tortueux, il avance en cherchant sans fin à rompre le ruissellement trop paisible du courant traditionnel, en provoquant des tourbillons, des débordements, des érosions ou des sorties de lit, bref, en troublant le cours trop tranquille des choses. Raison pour laquelle on l’oublie si souvent dans les histoires de la pédagogie et que beaucoup aimeraient le voir se perdre dans les terres et terminer en marigot, ou se fondre dans le désert et finir en oued asséché. Redoutant qu’il ne devienne un affluent influent susceptible de perturber l’eau claire des deux canaux principaux, ou d’y provoquer l’une ou l’autre cascatelle qui rendrait le cabotage un peu moins tranquille et le moutonnage un peu moins facile, les politiques de l’école soucieuses de préserver le cours normal des choses ont souvent fait mine de les oublier.
À la source de ce courant tempétueux, on ne s’étonnera pas de trouver, derrière Proudhon et Bakounine, Kropotkine et Robin, un lot de révolutionnaires et de contestataires revendiquant la suppression de l’école (Illitch), sa conversion en modèle nomade (Deligny), son alignement sur un modèle ultra-révolutionnaire (Makarenko) ou sa transformation radicale en instrument de contestation institutionnelle (Oury et Vasquez) ou idéologique (Neill).
Les ravines creusées par de tels courants n’ont généralement pas pour vocation de prendre tout le terrain, mais d’animer le débat en provoquant des remous de façon à ce que le courant traditionnel s’en trouve perturbé. Les expériences d’apparence parfois « marginale » qui font état de leur évolution dans le champ de la pédagogie contemporaine n’en demeurent pas moins d’une importance capitale. Ce sont elles qui créent le mouvement et font avancer les choses en donnant à la force du courant une impulsion parfois décisive. L’impact d’un grand pédagogue comme Paulo Freire sur l’histoire de la pédagogie illustre parfaitement l’effet de cette influence à la fois sourde et profonde dès lors qu’il s’agit de réveiller les consciences et d’alimenter les esprits critiques chez ceux qui sont amenés à faire vivre ou revivre un véritable idéal démocratique.
Enfin, restent quelques confluents, plus petits, moins ambitieux, plus exotiques qui, dans un contexte de mondialisation de la pensée, viennent de temps à autre colorer légèrement l’eau des fleuves principaux. Nous nous intéresserons à l’un d’eux, celui qui, né dans les eaux lointaines dans lesquelles ont trempé Confucius et Lao Tseu, parvient, à travers la pédagogie spiritualiste, à suivre les digues des différents courants pour se constituer, pour chacun d’eux, en chemins de halage.
Ces chemins de halage ont notamment favorisé, nous le verrons, l’inscription au sein de l’école de techniques proches de la méditation, de la pleine conscience et même, comme nous le montrera Jigorō Kanō, d’un corpus de méthodes très proches, dans leur esprit, du judo et de l’arrière-fond idéologique qui, depuis son origine, caractérise ce sport.
Un courant traditionnel, un courant parallèle, un contre-courant et des chemins de halage… Voilà comment l’histoire et la contre-histoire de la pédagogie nous permettront de comprendre où nous en sommes et de mieux concevoir où nous pouvons aller dans les voies d’une éducation familiale et scolaire renouvelée.
Nous proposons, dans les pages qui suivent, de voyager sur ces différentes voies fluviales sans considérer aucune d’entre elles comme la voie unique, celle qui, se prétendant exclusive, mènerait nécessairement à l’excellence de tous ou à l’émancipation de chacun. Ce faisant, nous veillerons à ne jamais nous laisser emporter par un courant trop fort qui, balayant tout ce qui s’oppose à lui, imposerait aux parents ou aux enseignants une méthode radicale, unique et incompatible avec les autres.
Cette manière de procéder nous permettra en définitive de cumuler les forces de chaque alternative pédagogique de façon à constituer, à partir de leur assemblage, un ensemble cohérent d’éléments hétérogènes. Cet ensemble prendra alors, à l’école, la forme d’un dispositif et, en famille, celle d’une boîte à outils au sein de laquelle les parents peuvent, en connaissance de cause, puiser des ressources chaque fois qu’ils se sentent démunis dans l’éducation de leurs enfants.
Nous tenterons également de ne pas nous engager à l’aveugle sur n’importe quelle voie sans savoir au préalable où elle peut nous mener et comment elle entend nous y conduire. En agissant ainsi, nous serons à la fois plus lucides, mieux ouverts à l’expérience pédagogique et plus libres de choisir, en connaissance de cause, ce que nous voulons pour nos enfants et ce qu’ils deviennent quand l’école les transforme en élèves.
Ce faisant, nous pourrons également davantage nous interroger à propos de la société que nous souhaitons construire, tant il est vrai que l’école et la famille, par le style et les modes d’éducation qui s’y diffusent, se posent en espaces de proto-politiques fondamentaux susceptibles de préfigurer les modèles sociaux dans lesquels évolueront les adultes de demain. C’est de cette façon que l’histoire de la pédagogie et, plus encore, selon nous, sa contre-histoire, celle qui s’écrit dans l’ombre, à l’abri des lignes dictées par le discours dominant, permet de penser l’avenir et de réfléchir, en connaissance de cause, à des moyens de mettre véritablement en place un système éducatif démocratique au sein duquel l’éducation ne serait plus le privilège de quelques-uns mais deviendrait véritablement un droit pour chacun.
Il n’est évidemment pas question ici de promettre pour autant de « tout changer en un an », comme voudrait nous le faire croire une pseudo-pédagogue1 qui est à l’histoire de la pédagogie ce que Bécassine est à l’histoire de la Bretagne : une représentation caricaturale qui diffuse une image simpliste de ce qu’est réellement l’éducation en ayant pris soin au préalable de la vider de toute substance. Il lui suffit ensuite d’oser se lancer dans un discours qui s’appuie sur du vide pour affirmer du creux afin de prêcher, à grand renfort de publicité, une révolution qui ordonne en réalité de ne rien changer du tout et de poursuivre, en faisant mine de choisir des voies alternatives, le chemin bien balisé d’un enseignement pour privilégiés soucieux de ne surtout rien bousculer.
Ce n’est évidemment pas, on le devine, l’option que nous choisirons, et nous accepterons pour notre part l’idée que les réalités éducatives familiales ou scolaires sont nécessairement complexes et que les inflexions théoriques qui s’y manifestent ne permettent jamais à quiconque de prétendre, à lui seul, introduire un changement radical de l’ensemble ou réaliser un bouleversement complet de la totalité du système. Il peut juste, éventuellement, proposer des aménagements suffisamment doux pour s’inscrire dans l’histoire d’un mouvement sans brutaliser personne et en ne perdant évidemment jamais de vue l’enjeu fondamental qui suppose de s’adresser à tous en tenant compte de l’évolution de chacun et en veillant surtout à ne laisser personne en chemin.
Ce faisant, il deviendra possible de poser prudemment les socles d’une pédagogie évolutionnaire qui intègre les apports des différents courants et s’appuie sur ce que nous apprend l’histoire de chacun d’eux.
1 Céline Alvarez, Une année pour tout changer, Paris, Les Arènes, 2019.
I Histoire de la pédagogie traditionnelle
Le courant majeur… comme un long fleuve pas si tranquille
L’idée d’une forme traditionnelle de pédagogie laisse entendre qu’il existerait une manière d’éduquer consacrée par l’usage qui serait littéralement « entrée dans les mœurs » parce qu’elle serait, en quelque sorte, conforme à une tradition. Comme une « habitude » mémorisée, transmise de génération en génération, l’éducation « traditionnelle » ferait son chemin sans soubresaut, comme un bloc monolithique qui ne se réfléchirait pas et avancerait, immuable, à travers les âges pour transporter des manières indémodables d’éduquer en famille et à l’école.
Rien n’est évidemment plus faux. La pédagogie traditionnelle a naturellement, elle aussi, une histoire et cette histoire connaît inévitablement des évolutions dans la mesure où elle est, au même titre que tout système éducatif ou social, amenée à se modifier avec son temps en s’adaptant à ses modulations. Évidemment, cette forme pédagogique conventionnelle progresse dans un mouvement parallèle à celui qui se manifeste dans la société qui la contient sans chercher ni à en bousculer le rythme ni à en infléchir le sens. Le contraire de la tradition, ce n’est pas l’évolution, c’est la révolution. Et encore… Il est, nous le verrons, des pédagogies traditionnelles qui ont, dans l’aspect novateur qu’elles proposent, un petit côté « évolutionnaire » mieux marqué que certaines pédagogies qui se prétendent pourtant résolument « révolutionnaires ».
La pédagogie traditionnelle ne doit pas, en tout état de cause, être réduite à cette sorte de monstre empoussiéré qui refuserait d’avancer telle que nous le figurent trop grossièrement ceux qui, pour que rien ne bouge, font eux-mêmes mine de tout changer. Elle prend parfois par contre, il est vrai, l’apparence d’un pachyderme soumis qui se déplace lentement, placidement, sans faire de vagues, pour former des citoyens normés ou des sujets correspondant à ce que le monde social dominant attend d’eux. Essentiellement adaptative, la pédagogie traditionnelle tend ainsi naturellement à prendre une apparence conforme à celle que prévoit pour elle le système qui la fait naître.
La pédagogie traditionnelle ne fait pas peur parce qu’elle avance lentement. C’est ce qui plaît à ses défenseurs qui la trouvent rassurante, parce que, négligeant les brusques poussées révolutionnaires, elle reproduit les mouvements lents du système social dans lequel ils ancrent leurs représentations. C’est précisément ce que ses détracteurs lui reprochent quand, confondant lenteur et immobilisme, ils la décrivent comme figée dans son histoire, ankylosée par le poids des routines et désespérément accrochée à son passé.
Ceux-là même, trop peu soucieux d’analyser les systèmes sociaux, considèrent souvent superficiellement ceux-ci comme des structures inertes qui ne « bougeraient » qu’à coups de révolutions brutales. Et pourtant, tous les sociologues le diront, les sociétés se modifient sans fin et même si elles se heurtent à des forces d’inertie qui en ralentissent le mouvement, elles évoluent sans cesse. Les mouvements sont parfois imperceptibles, certes, mais ils sont réels, alors que certaines prétendues révolutions s’appuyant sur le principe de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, selon lequel il faut « tout changer pour que rien ne change », ne produisent qu’un retour plus ou moins spectaculaire au même.
Une société traditionnelle n’est donc pas une société immobile mais un mode d’organisation de la vie collective qui métabolise le changement pour ne pas donner l’impression de bouleverser les structures sur lesquelles elle s’appuie. L’éducation, quand elle se définit comme « traditionnelle », suit le même mouvement que le système social qui la contient, quand celui-ci n’avance qu’en s’appuyant sur le socle des normes apparemment immuables qui définissent son fonctionnement.
Il suffit dès lors souvent d’analyser la manière dont entend fonctionner une société pour comprendre la façon dont se met en place son système éducatif familial ou scolaire. Or, pour comprendre les fondations de notre société judéo-chrétienne et découvrir les soubassements philosophiques qui en justifient l’idéologie, sans doute faut-il convoquer l’héritage platonicien qui, comme nous le suggère l’histoire des idées qui nous est officiellement enseignée, l’a véritablement contaminée en profondeur.
En effet, l’enseignement par ostension, l’éducation par l’exemple et la démonstration magistrale se posent en véritables clés de voûte de l’édifice sur lequel se fonde la pédagogie traditionnelle. Ils constituent trois héritages directs de la philosophie de Platon.
1. RETOUR À LA SOURCE : PLATON ET SOCRATE COMME DONNEURS DE LEÇONS
L’allégorie de la caverne met en scène des hommes enchaînés et immobilisés dans une demeure souterraine, par opposition au « monde d’en haut », ignorant la source de la lumière et tournant littéralement le dos à ce savoir unifié dépositaire d’un monde supérieur constitué des merveilles du monde intelligible. Tout cela, évidemment, contribue à proclamer l’idée d’un savoir sacré que l’enfant, ignorant ce qui est bon pour lui, se verrait imposer en tant que vérité unique, source incontestable du bien dans un monde idéel en rupture complète avec le monde sensible. Évidemment, dans une telle perspective, il sera essentiellement question de se méfier des sens et de fonder l’acquisition du savoir sur le développement de l’intellect pur, de la raison unifiée ou de l’intelligence abstraite.
De tous les animaux sauvages, dit Platon dans Les Lois, « l’enfant est celui qu’il est le plus difficile de manier : autant est abondante chez lui, plus que chez tout autre animal, la source de la pensée, mais une source encore non équipée, autant il se montre fertile en machinations, âpre et d’une violence dont en aucun autre on ne trouve la pareille. Aussi a-t-on besoin de le brider comme avec de multiples rênes ».
Conduire l’enfant à s’humaniser en le disciplinant pour lui permettre d’accéder à un monde idéel qui lui est autant inaccessible que la pensée intelligente l’est pour un animal, prisonnier de ses sensations, aveuglé par l’éclat du vrai, incapable de concevoir un savoir unifié qui aurait valeur de vérité et inapte à concevoir l’Idée sous une forme qui lui soit intelligible, voilà le but de tout ce qui évoque l’éducation dans l’esprit de Platon.
Le monde des idées définit ainsi d’emblée le champ d’action des pédagogies traditionnelles, délaissant aux pédagogies actives le soin d’investir le monde sensible et d’en faire une source de connaissance. Le « terrain de chasse » des uns et des autres se trouve de ce fait d’emblée délimité. L’esprit séparé du corps, la tête coupée des mains, l’intellect sevré des sensations, la signification contrainte de trouver du sens en faisant abstraction des sens.
Platon sert ainsi les couverts pour que le Christ, plus tard, se mette à table. À charge, pour ce dernier, de fondre la vérité dans une croyance en un Dieu unique pour repasser les plats et inciter l’école à servir de courroie de transmission à la vérité, selon les uns, et à la foi, selon les autres. C’est comme cela, nous le verrons, que l’institution scolaire, même en affirmant sa laïcité, tendra à faire de l’enseignement une religion.
Socrate, philosophe dont Platon fut le plus célèbre disciple, n’a laissé aucun écrit. Sa pensée et son témoignage n’ont été transmis que par des voies indirectes. C’est dire si la transmission a pu jouer, chez ce penseur essentiel du Ve siècle avant J.-C., un rôle majeur. Or, qui dit transmission de connaissance évoque inévitablement l’enseignement et l’art de transmettre qui le rend possible, la pédagogie. En s’opposant aux sophistes qui affirmaient pouvoir enseigner le savoir à tous contre paiement, Socrate s’est donc révélé un puissant contestataire des modalités habituelles de transmission du savoir, alors même qu’en prescrivant la maïeutique, celui qui se décrivait comme un « accoucheur d’âme » ouvrait en réalité toutes grandes les voies dans lesquelles l’enseignement traditionnel allait s’engouffrer.
Force est en effet de constater qu’il ne s’éloignait lui-même pas tant que cela des modes de transmission privilégiés par les sophistes quand ils se considéraient comme les détenteurs exclusifs du savoir. Chez Socrate, l’esprit demeure le même. Seules les techniques changent. La vérité, le philosophe considère, quoi qu’il en prétende, que c’est lui qui la détient. Son art d’enseigner le conduit à y amener ceux qui, au départ, ne pensent pas comme lui, soit par les voies détournées que lui offre le raisonnement, soit par des détours syllogistiques maquillés en ruse, qu’il appelle l’ironie.
Dans tous les cas de figure, celui qui est sage, c’est lui, le maître, le philosophe qui, même quand il joue au naïf, sait pertinemment qu’il pense juste. Quant à celui qui passe pour un fou, voire pour un idiot, s’il persiste à s’arc-bouter trop longtemps sur sa position d’apprenti penseur, c’est l’autre, l’élève, celui qui apprend du maître en confrontant sa manière de raisonner balbutiante et instable à la réflexion solide comme un roc de celui qui détient le savoir parce qu’il l’a construit en raisonnant avec rigueur auparavant.
Voilà comment l’enseignement maïeutique socratique a contribué à sacraliser la forme d’un dialogue fondé sur la raison pour atteindre l’universalité dont il est le dépositaire ou, plus exactement, le passeur intermédiaire2. Seuls les dieux, en effet, selon Socrate, possèdent le véritable savoir. Les sages, eux, désirent le savoir. Socrate pense avoir pour mission de faire connaître aux hommes leur état d’ignorance en se préoccupant plutôt de leur âme que de leur corps ou de leurs biens afin qu’ils s’améliorent en avançant vers la connaissance universelle dont Socrate, même s’il passe son temps à se déclarer ignorant, se pose en garant légitime. Se présenter comme ignorant permet à Socrate d’engager ses interlocuteurs à faire eux-mêmes la recherche de la connaissance en s’appuyant essentiellement sur leur aptitude à raisonner et en laissant bien de côté les intuitions auquel le monde sensible soumet ceux qui se laissent prendre à son piège.
Les pédagogies fondées sur l’explication, la monstration et la démonstration trouveront évidemment dans ce substrat idéologique un terreau fertile pour se développer. Quant à Socrate, son ironie maïeutique et son ignorance feinte serviront de prétexte à des générations d’enseignants, dès lors qu’il sera question pour eux de s’autoriser le sarcasme qui brise et la dérision qui amenuise, au nom de la toute-puissance de ce savoir censé faire autorité dont ils se déclarent les dépositaires ou, à tout le moins, sur le chemin duquel ils se posent comme les indispensables intermédiaires.
Voilà comment la vision socratique et platonicienne de l’enseignement encouragera la pédagogie traditionnelle à considérer la conversion de l’élève comme l’objectif fondamental de tout acte d’enseignement. Qu’un fou se transforme en sage, qu’un athée se change en croyant, un paysan en bon citoyen. Tout sera bon à convertir pour une pédagogie traditionnelle à travers laquelle chaque cancre potentiel inattentif, bavard et perpétuellement remuant sera, pendant longtemps, idéalement conduit à se métamorphoser en bon élève studieux, silencieux et continuellement assis.
C’est par ailleurs à partir de cette source platonicienne et en s’inspirant de ces techniques socratiques que les philosophes rationalistes construiront des modes de penser et des façons de réfléchir rigoureusement soumis à l’incontestable souveraineté de la raison. Eux aussi contribueront ainsi à creuser le chenal dans lequel viendra se constituer la pédagogie traditionnelle pour y faire couler son courant.
2 C’est cette forme dialoguée particulière qui explique que « l’école, dans sa version traditionnelle, est le seul lieu didactique où celui qui sait quelque chose questionne celui qui, en principe, en sait moins que lui ! » Yves Chevallard, « La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné », Revue française de Pédagogie, 76, 1986, p. 89-91.
2. LES SOURCES DU COURANT : LA RAISON COMME SOCLE PHILOSOPHIQUE DES PÉDAGOGIES TRADITIONNELLES, EMMANUEL KANT ET RENÉ DESCARTES
Les pédagogies traditionnelles s’appuient essentiellement sur le développement de la raison, le progrès du raisonnement et l’entraînement de la mémoire pour produire leurs effets. De la vision platonicienne du monde à l’idéalisme transcendantal de Kant en passant par le rationalisme de Descartes, c’est en effet toujours la raison qui prétend faire entendre raison. Qu’elle soit pure, qu’elle se prenne d’agir ou qu’elle conditionne la faculté de juger, c’est toujours le principe de raison qui, à travers le cogito, se taille la part du lion.
Une pensée claire et ordonnée, une réflexion qui classe, une méthode qui plie et déplie le réel au gré d’une argumentation fondée sur la logique, un dualisme substantiel entre l’âme à nourrir et le corps à dompter… Tout cela pose évidemment les bases d’un courant pédagogique fort fondé sur le raisonnement et sa maturation. Un tel édifice, solide comme un roc, a longtemps ressemblé à un socle inaltérable en science de l’éducation tout comme en psychologie, et il n’y a finalement que peu de temps que António Damásio3, en osant pointer « l’erreur de Descartes », a songé à le secouer dans ses fondements.
Kant, dans ses Réflexions sur l’éducation, pose clairement le cadre d’une éducation qui fait l’homme en le rendant essentiellement « raisonnable ». À cette fin, il durcit même le ton quant aux méthodes préconisées, quand il affirme de manière métaphorique qu’un « lit dur est beaucoup plus sain qu’un lit mou4 »… Cette citation kantienne qui n’est, certes, pas sa plus célèbre, illustre néanmoins ce qu’il entend par l’idée d’une « éducation dure », c’est-à-dire, « celle qui fait que l’enfant ne s’habitue pas à avoir toutes ses aises ».
Prendre un caillou pour oreiller et une planche en bois comme matelas, voilà effectivement une suggestion bien dans l’esprit du kantisme ordonnant le repli du corps pour favoriser l’asservissement de l’esprit par l’imposition de la toute-puissante raison. C’est sans doute ce qui explique en partie pourquoi le « mobilier » scolaire a si longtemps été constitué de bancs peu propices au confort de l’enfant et à son envie naturelle de bouger.
Kant n’a évidemment pas fait que parler de literie dans ses réflexions sur l’éducation. L’homme, seule créature qui doive être éduquée, doit en effet, selon lui, avant même d’apprendre à penser – ce qui est le sens profond de l’éducation –, être discipliné. C’est la discipline qui, d’après Kant, transforme l’animalité en humanité. On envoie ainsi, dans la perspective qu’il défend, d’abord les enfants à l’école non dans l’intention qu’ils y apprennent quelque chose, mais afin qu’ils s’habituent à demeurer tranquillement assis et à observer ponctuellement ce qu’on leur ordonne. On peut difficilement être plus clair, et l’on comprend aisément, en lisant cela, comment Kant peut être considéré comme un levain philosophique pour la pâte molle de toutes les « pédagogies assises ».
Quant à la liberté, Kant, au nom de la nécessité de la discipline, la met résolument sous cloche ou, à tout le moins, sous étroite surveillance. « Cependant, l’homme, par nature, a un si grand penchant pour la liberté que, s’il commence par s’habituer à elle quelque temps, il lui sacrifie tout ! » argumente-t-il à la suite de cette mise sous contrôle. Sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, il marque ses distances avec Jean-Jacques Rousseau, dont il a par ailleurs toute sa vie été un grand admirateur et un lecteur assidu, lui reprochant d’appeler « penchant pour la liberté » ce qui n’est en définitive que rudesse et sauvagerie. Le « bon sauvage » rousseauiste en prend d’ailleurs pour son grade dans l’esprit de Kant. La brutalité étant, pour lui, l’apanage de celui qui n’est pas cultivé, tandis que la sauvagerie caractériserait celui qui n’est pas « discipliné ».
Cette rudesse originaire, cette sauvagerie de base, il est donc nécessaire de la polir chez l’enfant en le « dressant » littéralement. Le mot est « lâché ». Kant ne le retient pas. Dresser, dit Kant, vient étymologiquement de l’anglais To dress, qui signifie habiller, vêtir. Habiller, vêtir, cela veut dire civiliser, rendre propre à paraître, en un mot, polir… Voilà le but de l’éducation. Polir et, plus exactement, puisqu’il est encore question de convertir l’enfant, transformer le polisson en l’adulte policé qu’il devra devenir…
Kant, lui-même fils d’un modeste sellier, a été précepteur pendant neuf ans dans diverses familles de la noblesse de Königsberg. Le philosophe en devenir fera donc ses premières armes en milieu mondain. C’est là que le jeune homme se familiarisera avec les délicatesses de cette élite raffinée où les conversations brillantes rivalisent d’esprit et d’érudition. Il conservera de cette expérience un goût durable pour la courtoisie et la distinction en société. Un enfant de milieu pauvre et rustique métamorphosé en adulte expert en mondanité… L’art de la conversion par l’éducation, Kant l’avait donc ainsi vraisemblablement expérimenté pour lui-même avant de songer à en théoriser les fondements.
Quoi qu’il en soit, l’obéissance est, dans la logique kantienne, fondamentale pour le caractère de l’écolier. Mais pas n’importe quelle obéissance. Celle-ci est double. Premièrement, c’est une obéissance à la volonté absolue du guide et, secondement, c’est une obéissance à la volonté de celui-ci reconnue raisonnable et bonne. L’obéissance est soit dérivée de la contrainte – elle est alors absolue –, soit de la confiance – et elle est alors relative aux caractéristiques positives que l’on attribue à ce à quoi on obéit. Cette obéissance volontaire est, selon Kant, importante, mais la première, l’obéissance absolue, est également extrêmement nécessaire, puisqu’elle prépare l’enfant à l’accomplissement des lois auxquelles il devra obéir plus tard comme citoyen, même si elles ne lui plaisent pas.
Une fois encore, on ne peut être plus clair, tandis que, de toute évidence, l’objectif du courant traditionnel ne peut être mieux fixé et plus explicitement formulé. Ne pas bousculer l’ordre établi et assurer, par l’éducation, la paix sociale en favorisant la naissance d’un parfait citoyen prompt à obéir aux lois, non pas par crainte d’une punition qui serait posée « en vue de… » ou « pour… », c’est-à-dire avec une finalité qui doit être précisée, mais, pour demeurer kantien jusqu’au bout, d’une punition posée parce qu’une faute a été commise…
« Tu m’obéiras parce que c’est comme cela. Et tu accepteras la punition parce que tu as commis une faute, et il n’y a pas à discuter. » Voilà comment la perception de l’obéissance et la conception de la punition ont pu marquer la pédagogie traditionnelle d’un idéal kantien qui ne poussait pas à la remise en cause et invitait au contraire à s’imprégner de l’idée d’une obéissance absolue et de la contingence d’une punition rendue nécessaire par l’idée même de la faute.
C’est comme cela que Kant, en philosophant en pleine lumière, a posé les trois piliers de la manière traditionnelle de faire de la pédagogie : l’instruction par ostension, l’éducation par l’exemple et la démonstration magistrale.
L’instruction par ostension, premier pilier de la pédagogie traditionnelle, a effectivement clairement les faveurs de Kant. Quitte d’ailleurs, pour en affirmer la pertinence, à emprunter des raccourcis pour illustrer ses propos en s’improvisant éthologue. C’est ce qu’il fait notamment lorsqu’il évoque la manière dont les parents oiseaux enseignent le chant à leurs petits. « Il est touchant de voir, comme s’ils étaient dans une école, les parents chanter de toutes leurs forces avant leurs petits et ceux-ci s’efforcer de tirer les mêmes sons de leurs petits gosiers5 », commente alors le philosophe qui n’était, de toute évidence, qu’un observateur très superficiel et particulièrement imaginatif des mœurs des oiseaux et qui, pour nous convaincre que le chant d’oiseau n’a rien d’instinctif, est même prêt à emprunter tous les raccourcis, voire à en inventer d’autres, pour donner du poids à son argumentation… Comme quoi, on peut être un philosophe d’envergure et se révéler un lamentable ornithologue.
L’éducation par l’exemple, deuxième pilier du courant pédagogique traditionnel, est également hautement valorisée chez Kant. C’est d’ailleurs, selon lui, le rôle essentiel des parents, de servir d’exemple à leurs enfants pour que ceux-ci, en les imitant, développent naturellement ces dispositions en les améliorant. C’est de cette façon que l’éducation produira le développement de l’espèce et que l’espèce, alors améliorée, consolidera l’éducation qui est donnée. Ce cercle vertueux qui veut que « les lumières dépendent de l’éducation et qu’à son tour, l’éducation dépende des lumières » est bien dans l’esprit de ce siècle – dit des Lumières – qui se caractérise par une foi inaltérable dans le progrès continu de l’espèce humaine civilisée.
Enfin, le troisième pilier de la pédagogie traditionnelle, celui de la démonstration magistrale, Kant le pose résolument chaque fois qu’il insiste sur la nécessité de mettre en place les conditions d’une pédagogie qui fonctionne essentiellement comme un art « raisonné ». Pour Kant, et c’est là que réside la substance de son modèle pédagogique, l’éducation n’est pas portée à son terme avec le dressage. L’essentiel est que les enfants apprennent à penser et plus exactement à raisonner en fonction d’une Idée à atteindre, celle que le précepteur entend mettre le mieux possible à la portée de son élève dans son enseignement…
C’est à cet endroit que Kant reconnaît le mieux sa filiation directe avec la philosophie platonicienne et socratique. Il faut, soutient-il explicitement, « procéder socratiquement dans l’éducation de la raison6 ». Affirmant le bien-fondé de la stratégie pédagogique de Socrate qui, par son art de construire un dialogue, conduit l’élève à tirer beaucoup de choses de sa propre raison, Kant estime même que cette méthode doit servir de règle à l’autre méthode qu’il promeut, la méthode catéchétique. Cette méthode, qu’il qualifie de « mécaniquement catéchétique », par laquelle le Maître s’assure par des interrogations que la mémoire de l’élève est fidèle, est surtout valable, selon le philosophe, pour l’enseignement de la religion révélée. Pour le reste, il est bon que le maître s’adresse vraiment à la raison de l’élève et s’efforce de lui faire découvrir en lui-même ce qu’il veut lui enseigner.
« Raisonnez tant que vous voulez mais obéissez »… C’est sans doute à travers cette maxime, qu’il estime correspondre au despotisme éclairé de Frédéric II, que Kant met le mieux en évidence la ligne directrice principale de sa vision de la pédagogie : une raison centrale et beaucoup, beaucoup d’obéissance. Voilà de quoi influencer pendant plusieurs décennies la direction que suivra tranquillement le cours de la pédagogie traditionnelle…
Mais le bilan d’héritage de Kant serait forcément incomplet s’il ne tenait pas compte de l’apport qu’il a réalisé en tant que professeur d’université par sa façon de donner cours et sa capacité très socratique de contraindre ses élèves à penser par eux-mêmes en leur apprenant à philosopher sans leur enseigner la philosophie. Ce faisant, il encourageait l’application de sa devise « Sapere aude ! » (Ose savoir !) ou, pour le dire autrement, aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Voilà précisément une devise qui peut s’appliquer à l’ensemble de ce Siècle des lumières et qui invite chacun à interpeller sa raison en lui posant les trois interrogations fondamentales : que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que suis-je en droit d’espérer ? Voilà les questions que tout homme soucieux de devenir maître de lui-même doit arriver, au terme de son instruction, à se poser. C’est là en définitive le message profond de la pédagogie kantienne et la limite de la réflexion où il cherchait à conduire chacun de ses élèves…
Chez Descartes qui prône la même idée d’unicité du savoir, l’ordre logique des raisons et de l’appropriation des connaissances est relativement indépendant de l’ordre psychologique des découvertes. Pour le dire autrement, le rôle de l’individu dans la construction de son savoir est réduit à portion congrue, dès lors qu’il n’est pas question pour lui d’échafauder quoi que ce soit à partir de son expérience, mais qu’il est question de s’approprier les informations pour les transformer en connaissance en suivant un ordre rationnel indépendant de l’individu puisque fixé par la logique du raisonnement. Tout est donc mis en place, dans un tel contexte, pour précipiter l’avènement d’une pédagogie raisonnante, qui montre, démontre et argumente en suivant le cheminement d’une logique rationnelle indiquée par l’enseignant. À charge pour l’apprenant de le suivre en l’écoutant, en le regardant et en le comprenant.
Voilà comment l’enseignement traditionnel a pris racine… Pour bien comprendre comment il s’est mis, à partir de là, à fonctionner, nous proposons d’en suivre le cours en détaillant ce que deux de ses principaux concepteurs historiques ont pu en dire. Nous nous attarderons sur la construction du discours d’un pédagogue adulé dans le camp confessionnel, Jean-Baptiste de La Salle, et celui d’un autre, mieux apprécié dans le champ de la laïcité, Émile Durkheim .
3 António Damásio, L’erreur de Descartes. La raison des émotions, Paris, Odile Jacob, 1995.
4 Emmanuel Kant, Traité de pédagogie, Paris, Hachette, 1891.
5Ibid.
6Ibid.
3. SUIVRE LE COURS SUR LES DEUX BERGES : DEUX CAMPS DIFFÉRENTS MAIS DES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT COMMUNES
Le souci de parité, en nous incitant à prendre un pédagogue de chaque côté de la berge, nous permettra par ailleurs de constater que, sur le plan des principes et des moyens, les uns et les autres prêchent en définitive la même chose en s’appuyant sur un corpus de valeurs très semblable. Laïcité et religiosité, quand ils se rencontrent sur le terrain de la pédagogie traditionnelle, c’est en effet un peu « chou vert » et « vert chou ». Seule la destination finale diverge. Le chemin, lui, apparaît sensiblement similaire.
Dieu d’un côté, la Patrie de l’autre… Un parfait chrétien, un citoyen exemplaire… Peu importe ce qui fait l’objet de la conversion, les moyens pour la réaliser se révèlent en définitive sensiblement les mêmes. C’est ce qui explique sans doute que les parents, dès lors qu’il est question de voir dispenser à leurs enfants un enseignement traditionnel, se soucient en réalité fort peu de la « guerre des réseaux ». Celle-ci n’intéresse plus, somme toute, que quelques politiciens soucieux de plaire à ceux qui, revendiquant à grand bruit leur appartenance au mouvement confessionnel ou officiel, ressemblent de plus en plus à des anciens combattants.
Quand ils se rencontrent sur le champ du courant traditionnel, les deux réseaux présentent en réalité, actuellement, davantage de points communs que d’axes de divergence. C’est pour cette raison que pour comprendre l’évolution du courant, il est important de mettre en avant les invariants qui, malgré près de deux siècles d’écart, rapprochent de La Salle et Durkheim. Ces deux figures de proue du courant traditionnel n’ont apparemment pas grand-chose en commun. L’un est un religieux et l’autre, un partisan de la laïcité, et pourtant les modèles pédagogiques qu’ils proposent définissent un socle commun très similaire, celui d’une pédagogie qui se fixe pour objectif de confirmer le fonctionnement continu d’un système religieux ou social qui, pour se stabiliser dans la durée, manifeste le besoin d’assurer ses appuis dans la génération suivante en faisant autoritairement entendre sa voix dans l’école.
C’est pour cela que, pour comprendre comment se développe le courant traditionnel, il est important de mettre en évidence les invariants qui relient les méthodes qui ont été préconisées des deux côtés de sa berge.
LES INVARIANTS DES MÉTHODES TRADITIONNELLES FAÇON DE LA SALLE ET DURKHEIM
Premier invariant : c’est au maître et à lui seul que revient la maîtrise.
Le souci permanent de conversion de l’élève explique que, dans la pédagogie traditionnelle, l’enseignant ne se fait généralement pas appeler « maître » pour rien. Lui et le savoir qu’il représente entendent en effet occuper la position centrale. C’est l’enseignant qui s’arroge le monopole de la prise de parole, domine le groupe, et c’est lui qui ordonne l’ensemble des interactions verbales, autant celles qui le relient à l’élève que celles qui se réalisent entre les élèves.
C’est dans ce but que, depuis Jean-Baptiste de La Salle, les enseignants doivent pouvoir bénéficier d’une formation adaptée à leur fonction. Non pas pour enseigner leur matière : pour cela, les précurseurs de l’école ont longtemps imaginé qu’il « suffisait » de bien connaître soi-même la discipline dans laquelle on excelle pour en transmettre sans peine les principaux savoir-faire. Par contre, pour maîtriser le groupe et installer sur celui-ci une autorité sans faille, les adultes se sont vite rendu compte qu’il fallait disposer d’un minimum de compétence « pédagogique ». Ainsi, si la formation est apparue nécessaire, c’est essentiellement dans le souci de transmettre au maître, dans le contexte de l’enseignement simultané dont nous définirons les contours plus loin, l’aptitude à diriger un groupe et à affirmer par rapport à lui son autorité.
Cette aptitude à maîtriser le groupe d’élèves auquel il lui est demandé d’enseigner simultanément ne va pas de soi. Elle ne constitue pas une compétence « naturelle » qui distinguerait ceux qui ont suffisamment de charisme pour se faire respecter et les autres, incapables de faire taire le groupe pour laisser place à la parole du maître qui montre, démontre, explique et, de temps à autre, interroge un des élèves pour vérifier si son discours magistral a été entendu, écouté et compris. Cette manière d’enseigner implique de disposer d’un corpus de compétences tributaires d’une formation adaptée qui ne se réduit pas au disciplinaire, mais intègre l’ensemble des connaissances utiles pour comprendre et maîtriser la dynamique d’un groupe et concevoir comment chacun peut y être mis en condition d’apprendre.
Lorsqu’il exerçait cette fonction dominante de manière incontestable et souvent incontestée, l’enseignant, véritable chef de meute, s’attribuait le droit exclusif du recours à la violence – que celle-ci s’exerce physiquement ou par des détours agressifs plus subtils, dès lors qu’il est question de manier le sarcasme, de manifester de l’ironie ou de faire preuve de dérision. Une fois cette autorité diluée, les rapports de pouvoir ont pris la même voie et se sont répartis au sein de la classe pour s’exprimer sous des formes plus ou moins agressives et plus ou moins larvées, comme le suggère la multiplication des situations de violence scolaire et périscolaire7.
Dans un contexte scolaire qui fige les relations de domination, l’élève existe en ce qu’il écoute, répète et cherche à « imiter » le maître. C’est ce dernier qui ordonne et domine les interactions verbales. Concentré d’autorité, de pouvoir et de puissance, il donne et reprend la parole en interrogeant qui bon lui semble ou en autorisant, au gré de sa volonté, celui qui lève son doigt à s’exprimer. Dans ce contexte de déséquilibre des forces, l’exposition des contenus par l’enseignant qui enseigne, puis leur reproduction par l’élève qui apprend, constituent la clé de voûte de la relation pédagogique.
Ainsi, même lorsqu’il s’appuie sur l’activité du groupe et en fait un ressort pédagogique essentiel, l’enseignement traditionnel n’en demeure-t-il pas moins fondamentalement autocratique, parce qu’il fonde l’acte d’enseigner, quelle que soit la technique didactique utilisée, autour d’un personnage central : le maître, l’enseignant ou le professeur…
Deuxième invariant : l’enseignant doit chercher à se faire respecter, pas à se faire aimer.
Une deuxième caractéristique de cette forme d’enseignement, qu’il est convenu d’appeler traditionnel, réside dans le fait que la qualité affective de la relation pédagogique, fondamentalement impersonnelle, passe a priori au second plan.
L’exercice de l’autorité, le recours à la sanction et la stimulation de l’émulation sont considérés, dans cette forme d’enseignement, comme autant de vertus cardinales. Or, pour avoir les coudées franches dans les domaines visés par ce triple socle virtuel, il peut s’avérer très utile de parvenir à mettre son affectivité en veilleuse, voire à la refouler complètement. Pour avoir l’assurance de revêtir le costume de l’enseignant respecté tel qu’il est valorisé par l’école traditionnelle, certains préféreront ainsi, sans état d’âme, privilégier l’idée d’être craint sans être aimé à celle d’être aimé sans être craint.
Dans l’enseignement traditionnel, tel qu’il se définit dans ses fondements, l’enjeu ne consiste donc pas pour l’éducateur à « aimer ou être aimé ». Il est davantage pour lui question de dominer, maîtriser ou dompter, afin d’être obéi, respecté ou admiré. Sans doute est-ce là que se trouve la voie la plus sûre pour être en mesure d’imposer de force un savoir qui s’explique, se montre ou se démontre à des élèves qui n’existent dans la relation éducative que pour le recevoir passivement et l’intégrer massivement.
Pour de La Salle comme pour Durkheim, il ne peut être question d’amour que s’il est question de Dieu ou de la Patrie. Cette idée de renoncement aux affects interpersonnels va par ailleurs imprégner le courant de la pédagogie traditionnelle jusque dans ses développements les plus récents. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir la littérature relative à la pédagogie de maîtrise, à la pédagogie par objectifs, à la pédagogie différenciée ou aux neurosciences. La description de ces modèles indique que les tenants de ces nouvelles formes pédagogiques se soucient généralement de l’affection comme d’une guigne. Ils ne l’évoquent même pas comme si, dès lors qu’il était question d’enseigner, les affects n’entraient pas en ligne de compte.
Dans le contexte traditionnel, les enseignants n’ont, pendant très longtemps, pas été tenus d’aimer leurs élèves. Bien plus, l’idée qu’ils puissent avoir une « préférence » pour l’un d’entre eux a longtemps été envisagée comme une faute professionnelle. Cette suspicion a, par exemple, fait naître la notion, un peu surannée de nos jours, de « chouchou ». Ce qualificatif collait encore, il y a peu, aux basques de l’élève préféré du prof, stigmatisé pour avoir attisé une affection préférentielle à laquelle il ne devrait pas avoir droit. Cette estampille marquant les enseignants suspectés d’avoir des chouchous tire son origine de la mise en quarantaine des affects, qui a longtemps été la marque de fabrique de l’enseignement traditionnel tel qu’il a été posé sur ces bases. De La Salle, Durkheim et leurs contemporains n’y sont assurément pas pour rien…
Le rôle affectif de l’enseignant est actuellement, de toute évidence, bien plus largement reconnu qu’à ces glorieuses époques, en ce compris dans l’enseignement traditionnel. Aucun courant ne peut désormais, sur ce plan, revendiquer le monopole du cœur et l’exclusivité des échanges affectifs manifestes. Seule une vision caricaturale de l’enseignement traditionnel héritée du passé et figée dans ce qu’en ont écrit des pédagogues historiques laisserait entendre que l’enseignant gagne encore quoi que ce soit à se garder de toute marque d’affection et doit à tout prix se défier de son inévitable corollaire : la préférence.
Un film comme Les choristes présente une remarquable illustration de cette évolution. En prenant pour cadre une école de rééducation de l’après-guerre dont le projet pédagogique s’articule exclusivement autour de la notion de discipline et d’un système punitif simpliste qui se résume à l’application stricte de la formule « action-réaction », le scénario raconte l’histoire d’un professeur de musique, Clément Mathieu, qui va révolutionner l’institution scolaire en regroupant les élèves dans une chorale.
Ce feel good movie est resté dans la mémoire de chacun, non seulement parce qu’il a mis en valeur le talent musical du jeune interprète, Jean-Baptiste Maunier, qui y joue le rôle de soliste (effets directs d’une pédagogie différenciée bien comprise…), mais aussi parce qu’il a stimulé une double interrogation pédagogique qui demeure essentielle dans le courant traditionnel :
– le premier questionnement permet de concevoir que le contraire du chaos en pédagogie, ce n’est pas l’ordre structuré pour tous, mais davantage le sentiment d’harmonie collective vécu par chacun ;
– le second interroge la place prépondérante que l’affectivité doit nécessairement prendre dans tout système éducatif qui se préoccupe de singulariser chaque enfant au sein du collectif dont il fait partie.
La relation privilégiée entre Clément Mathieu et le petit Pépinot en témoigne à suffisance, et l’image finale du film, qui montre Clément, viré de son poste d’enseignant, acceptant que Pépinot, avec qui il a construit un puissant lien de confiance mutuelle, prenne le bus avec lui pour l’accompagner vers une destinée commune, se pose comme l’affirmation claire de ce que la force d’un lien d’attachement peut apporter à la qualité d’un apprentissage.
C’est cela, précisément, la leçon des Choristes… Et rien que pour cette raison, le film gagne sans doute à être vu et revu.