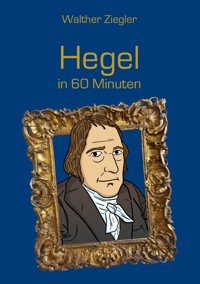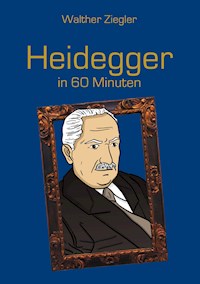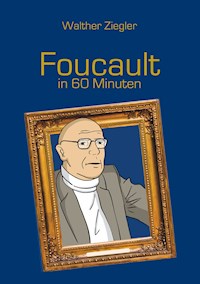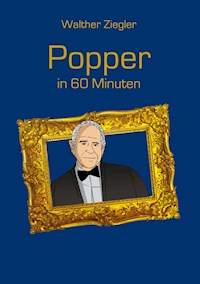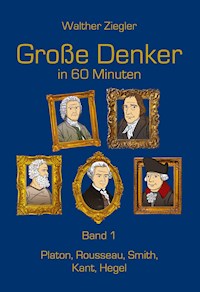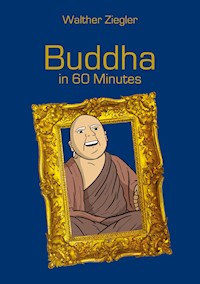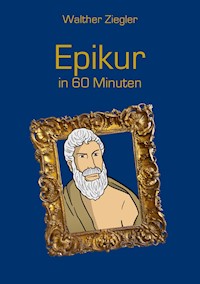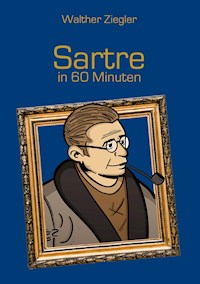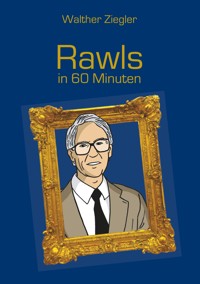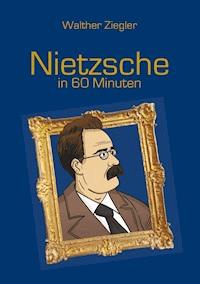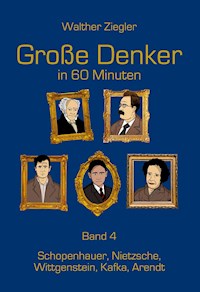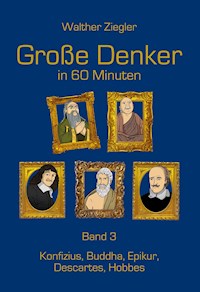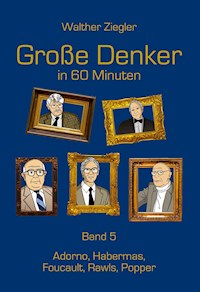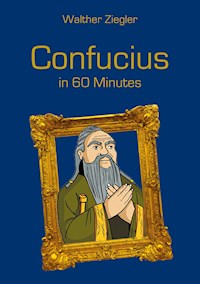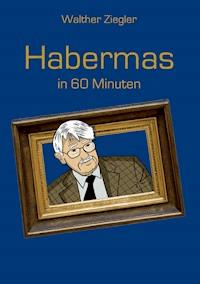Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
John Rawls est sans doute le penseur le plus important des États-Unis. Son ouvrage majeur, Théorie de la justice, paru en 1971, fait aujourd'hui encore l'objet de discussions dans le monde entier. Le titre à lui seul est provocateur. Car dans l'opinion dominante il ne saurait y avoir de « théorie de la justice » universellement valable étant donné que c'est toujours une question de point de vue. Ce qui paraît juste pour une personne sera considéré comme injuste par une autre. Et pourtant, Rawls est parvenu à donner une définition universellement valable de la justice, ou plus exactement de ce qui constitue une société absolument juste. C'est pour trouver cette définition ayant une validité intemporelle qu'il a élaboré son procédé brillant et désormais célèbre : la délibération sous le « voile d'ignorance ». Si nous autres, êtres humains, devions délibérer de manière absolument équitable et objective sur la répartition juste de la propriété, des revenus, de l'éducation et de nos autres perspectives de vie, personne ne devrait savoir à l'avance ce qu'il sera dans la société future - pauvre ou riche, homme ou femme, travailleur ou entrepreneur, qualifié ou pas qualifié, doué ou moins talentueux. Sans quoi un riche estimera par exemple que de grandes différences de revenus sont justes tandis qu'un pauvre les trouvera injustes. Seul le « voile d'ignorance », dit Rawls mot pour mot, « force chacun à prendre en considération le bien des autres ». Car chacun doit s'attendre à tout. Certes, une telle délibération voilée n'aura jamais lieu dans la réalité mais, avance Rawls, si elle avait lieu et si on menait le raisonnement jusqu'au bout, on parviendrait par elle aux deux seuls principes de société absolument justes : le principe d'égalité et le principe de différence. C'est à leur aune que se mesure la qualité de toute société moderne. Que signifient-ils en détail ? Pourquoi notre société actuelle est-elle, selon Rawls, injuste à de nombreux égards ? L'expérience de pensée de Rawls fonctionne-t-elle aussi dans d'autres domaines ? Si nous ignorions par exemple si nous serons des humains ou des animaux dans une société future, opterions-nous peut-être pour une société végétarienne ? Nul doute : avec sa « Théorie de la justice », Rawls fait étinceler tout un feu d'artifice de pensées novatrices. Le livre est paru dans la série prisée « Les grands penseurs en 60 minutes ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 65
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Merci à Rudolf Aichner pour son infatigable travail de rédaction critique, à Silke Ruthenberg pour la finesse de son graphisme, à Angela Schumitz, Lydia Pointvogl, Eva Amberger, Christiane Hüttner, Dr. Martin Engler pour leur relecture attentive, et à Eleonore Presler, docteur en philosophie, qui a effectué une dernière relecture linguistique et scientifique du texte français. Je remercie aussi monsieur le Professeur Guntram Knapp à qui je dois ma passion pour la philosophie.
Je tiens à remercier tout particulièrement mon traducteur
Bruno Rousselet
Table des matières
La grande découverte de Rawls
La pensée centrale de Rawls
Pourquoi nous posons la question de la justice : Les trois faits essentiels de l’humanité
La position originelle – Le degré zéro du choix de la société idéale
Le voile d’ignorance et la règle du maximin
Les deux principes de justice : Le principe d’égalité et le principe de différence
Robinson Crusoé, Vendredi, Dagobert Duck et John Rawls s’échouent sur une île
À quoi nous sert la découverte de Rawls aujourd’hui ?
Rehausser le niveau des moins favorisés – La critique rawlsienne du capitalisme
La répartition équitable des biens – Réalisable en pratique ou pure théorie ?
Le voile d’ignorance – Un principe de décision transposable ?
Le legs de Rawls : L‘éternelle exigence de justice
Index des citations
La grande découverte de Rawls
Professeur à Harvard, John Rawls (1921-2002) est sans doute le penseur le plus important des États-Unis. À l’âge de cinquante ans, il publie son ouvrage philosophique majeur, Théorie de la justice . Le simple titre constitue déjà, depuis sa parution en 1971 jusqu’à nos jours, une provocation. En effet, dans l’opinion dominante, une telle théorie ne saurait exister puisque la justice est toujours une question de point de vue personnel. Chacun, à partir de sa propre perspective, a une vision très différente de ce qui est juste ou injuste. Et voilà qu’un professeur de philosophie américain affirme avoir trouvé une définition de la justice qui soit intemporelle et valable pour tout le monde !
Le livre connaît alors une ascension fulgurante et, en l’espace de trois décennies, il acquiert une notoriété mondiale. Il compte aujourd’hui parmi les classiques de la philosophie et est considéré comme le plus important ouvrage d’éthique politique. Théorie de la justice est sans aucun doute une œuvre pionnière qui ne fascine pas seulement les scientifiques et les politiques ; elle est aussi inscrite, à juste titre, au programme d’étude de nombreuses écoles dans le monde.
Rawls y pose la grande question de la société juste : selon quels principes une démocratie moderne doit-elle être organisée ? De la réponse à cette question dépendent en effet beaucoup de choses – notamment l’appréciation de notre situation actuelle. Car nous ne pouvons en aucun cas, nous dit Rawls littéralement, nous satisfaire de moins que de la « société parfaitement juste » :
Dès les premières pages de son ouvrage majeur, Rawls formule l’objectif ambitieux et la dimension faramineuse de son projet :
Mais à quoi doit-elle ressembler, la « société parfaitement juste » ?
La question de la meilleure forme possible de vie commune connaît une longue tradition dans la philosophie. Dès l’Antiquité, Platon conçoit, dans son livre La République, un État idéal qui est gouverné de manière absolument juste par des rois-philosophes instruits. À la Renaissance, Thomas More nous dépeint, dans son roman Utopia, une communauté parfaitement harmonieuse de personnes vivant heureuses et sans propriété sur une île. Son néologisme « Utopia », qui vient du grec ancien « ou topos », ce qui signifie à peu près « en aucun lieu », est depuis lors entré dans le langage courant pour décrire des visions d’avenir. Et enfin Rousseau, à la veille de la Révolution française, nous présente, dans Du contrat social, une communauté idéale de citoyens absolument libres qui s’autogouvernent en assemblées du peuple.
Rawls n’est donc pas le premier à poser la question de la société idéale et juste. Pourtant, son apport s’avère en fin de compte bien plus important que celui de tous ses prédécesseurs. Dans sa théorie de la justice, il ne conçoit pas seulement une utopie, c’est-à-dire une représentation imaginaire de la société idéale ; il nous dote aussi, pour la première fois, d’une procédure permettant à tout un chacun de vérifier la juste répartition des biens et des perspectives de vie.
Car ce n’est pas tout d’esquisser une société idéale à force d’imagination ; encore faut-il, nous dit Rawls, pouvoir justifier pourquoi il s’agit bel et bien de la meilleure société possible. Rawls adopte une démarche tout à fait moderne : pour démontrer son concept de justice, il se réfère à l’approbation démocratique et au consentement de tous les citoyens – à l’inverse d’un Platon ou d’un More, par exemple. Selon son argumentation, les principes définis de la justice ne sont réellement justes que s’ils sont acceptés par toutes les parties prenantes d’une société.
Au fond, tous les individus qui s’associent dans une société devraient s’accorder préalablement, dans un contrat ou une charte, sur les principes selon lesquels ils veulent coexister à l’avenir — qu’ils privilégient par exemple une société inégale, avec des patriciens et des esclaves ou des capitalistes et des travailleurs, une société sans classe et sans propriété garantissant une égalité totale, ou encore une tout autre forme d’organisation :
Rawls est donc un partisan de ce que l’on appelle la « théorie du contrat », selon laquelle une société n’est légitime que si tous les membres conviennent eux-mêmes de leurs lois et de leurs principes de base dans une charte fondatrice ou un contrat, ou que du moins ils peuvent en théorie les approuver a posteriori. Dans le premier cas, on parle de « contrat historique » ; dans le second, de « contrat hypothétique ». Selon la théorie du contrat, les citoyens concluent donc un contrat dans lequel est régie la répartition équitable de tous les biens et perspectives de vie, et par lequel chacun se déclare d’accord de s’en tenir aux principes convenus :
De tels contrats historiques, dans lesquels un groupe de personnes décide une fois pour toutes ce qui doit être tenu pour juste et pour injuste dans la société future, ont bel et bien existé dans l’Histoire. En 1620 par exemple, les Pilgrim Fathers, un groupe d’émigrants puritains originaires d’Angleterre, conclurent pareil contrat fondateur durant leur longue traversée pour l’Amérique à bord du Mayflower. Le célèbre « Contrat du Mayflower » régissait toutes les modalités de la coexistence religieuse et séculière des émigrants sur le territoire de leur future colonie comme citoyens libres et égaux dans une communauté autogouvernée.
En tant que partisan convaincu de la théorie du contrat, Rawls aurait certainement souhaité que les Américains d’aujourd’hui puissent à nouveau voter pour décider des principes de justice selon lesquels ils coexisteraient à l’avenir et pour lesquels ils voudraient s’engager par contrat. Pourtant, même si Rawls était fréquemment invité à dîner chez l’ancien président Bill Clinton et qu’il entretenait de bonnes relations avec l’homme le plus puissant de la planète, il savait bien sûr qu’un tel vote ne pourrait jamais être réalisé. Par ailleurs, il lui semblait illusoire de redemander ultérieurement aux citoyens états-uniens s’ils voulaient approuver et adopter volontairement la constitution américaine, le mode de production capitaliste et la répartition inégale des biens :
À la différence des Pilgrim Fathers, nous autres, individus modernes, naissons selon Rawls dans une société bien déterminée, et on ne nous demande pas si nous trouvons justes ou injustes la forme de gouvernement, le mode de fonctionnement économique ou encore la répartition des richesses. Et même s’il était possible par exemple de demander à tous les nouveau-nés des États-Unis à une date déterminée – disons le jour de leur dix-huitième anniversaire – s’ils veulent encore vivre dans l’ordre social adopté par les Pères fondateurs ou s’ils préféreraient en choisir un nouveau, il se pourrait fort bien que cela ne donne pas un bon résultat. En effet, selon Rawls, chaque individu pourrait être tenté d’opter pour l’ordre social dont il attend le plus gros bénéfice :