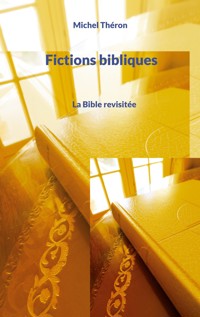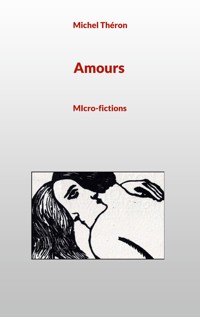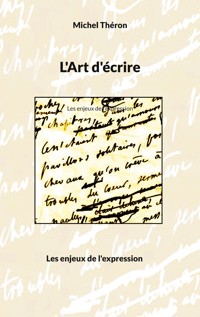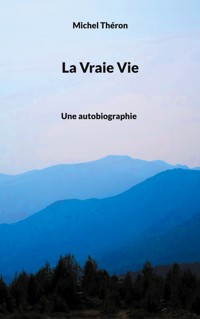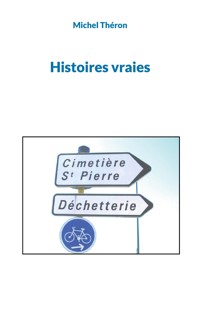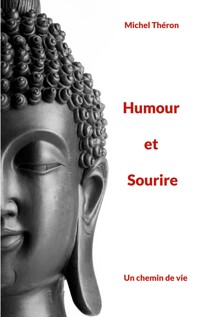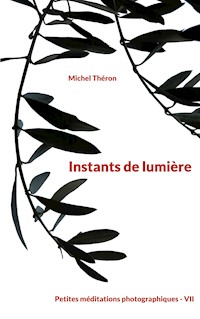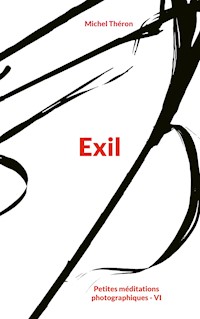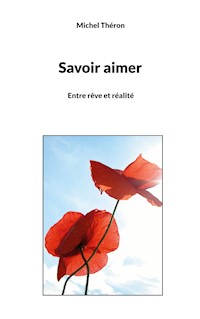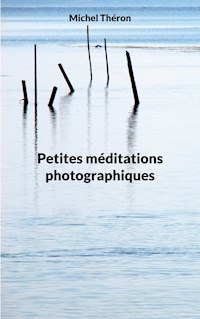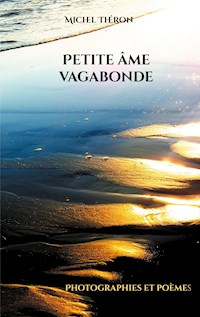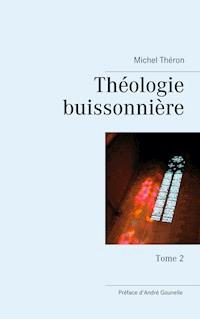
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Théologie buissonnière
- Sprache: Französisch
Extrait de la préface d'André Gounelle : Michel Théron nous offre une agréable et instructive promenade parmi plusieurs notions fondamentales de culture religieuse. Il a choisi pour les deux tomes de cet ouvrage environ 80 mots, rangés en ordre alphabétique, qu'il commente avec la gourmandise d'un fin lettré et une tendresse amusée pour les étrangetés du religieux mais aussi attentive à ses profondeurs... Malicieux, méditatif, réfléchi, bien informé et non conformiste, ce livre nous sort de nos routines, nous aide à penser sans jamais rien nous imposer... Cette promenade peut très vite déboucher, si on le désire, sur une exploration élargie et approfondie. Ce n'est pas un des moindres mérites de cet ouvrage que d'inciter à aller ailleurs et plus loin ; on sent ici tout l'art pédagogique du professeur incitateur ou éveilleur et non doctrinaire qu'a été Michel Théron.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Préface
Avant-propos
Ange
Animal
Bonheur / Béatitude
Colère
Connaissance
Croix
Espérance
Évangile
Famille
Fils de l’homme
Homme / Femme
Image
Justice
Nature
Obéissance
Parabole
Paradis
Pardon
Prière
Pureté
Satan / Diable
Sexualité
Silence
Solitude
Temps / Éternité
Vie
Abréviations et Sigles
Abréviations des livres bibliques
Sigles
Du même auteur
Et sur le même sujet...
Préface
Michel Théron nous offre une agréable et instructive promenade parmi plusieurs notions fondamentales de culture religieuse. Il a choisi pour les deux tomes de cet ouvrage environ 80 mots (rangés en ordre alphabétique depuis « Agneau de Dieu » jusqu’à « Zèle ») qu’il commente avec la gourmandise d’un fin lettré et une tendresse amusée pour les étrangetés du religieux mais aussi attentive à ses profondeurs. Il aime les phrases et les mots, il les décortique, les assaisonne, les déguste. Il relie les textes dans des jeux de miroirs et d’échos. Parfois, il va jusqu’à des calembours, mais ces calembours ont du sens (un exemple savoureux : « Ne peut-on préférer le Christ enseignant qui nous sauve au Christ qui nous sauve en saignant ? »). Il ne s’agit nullement d’un vocabulaire théologique et historique, pas plus que le Dictionnaire philosophique de Voltaire (à qui j’ai souvent pensé en lisant ce livre) n’est un dictionnaire technique de philosophie.
Bien que l’érudition y soit considérable, ce livre ne s’adresse pas à des spécialistes, mais plutôt à un public cultivé, marqué par un christianisme traditionnel qui le satisfait peu, même s’il est sensible à certain de ses thèmes. De très nombreux textes du Nouveau Testament sont commentés et expliqués (avec une insistance sur les mots employés, sur leur étymologie et sur leurs combinaisons grammaticales) ; l’évangile de Thomas est aussi souvent cité. Les références culturelles débordent largement la littérature classique ; elles s’étendent à la peinture, au cinéma, à la chanson, voire à la publicité, etc. Ces références n’éloignent pas du vécu concret, mais l’expriment et l’éclairent. Malicieux, méditatif, réfléchi, bien informé et non conformiste, ce livre nous sort de nos routines, nous aide à penser sans jamais rien nous imposer.
Un traité et un manuel sont faits pour être lus de bout en bout et leurs développements s’enchaînent méthodiquement. Cette Théologie buissonnière ne suit pas ce modèle : elle a été plutôt conçue pour être consultée notice par notice au gré de nos envies, de nos curiosités, de nos recherches et de nos réflexions. L’auteur n’impose pas au lecteur une progression, mais le lecteur choisit de cheminer, voire de vagabonder ou de flâner, dans ce que lui offre l’auteur. Grâce à un jeu de renvois non seulement d’un article à l’autre, mais aussi à des documents externes ou à des lectures complémentaires, cette promenade peut très vite déboucher, si on le désire, sur une exploration élargie et approfondie. Ce n’est pas un des moindres mérites de cet ouvrage que d’inciter à aller ailleurs et plus loin ; on sent ici tout l’art pédagogique du professeur incitateur ou éveilleur et non doctrinaire qu’a été Michel Théron.
André Gounelle
Avant-propos
Ce livre fait suite au premier tome paru sous le même nom chez BoD en 2018. Il ne comprend que vingt six entrées, alors que le premier volume en comprenait cinquante. À l’inverse, les entrées sont beaucoup plus développées que dans le premier volume. J’ai essayé en effet de ne pas répéter ce que j’avais déjà dit, et de développer d’autres pistes et perspectives. Néanmoins les deux volumes forment un ensemble, et j’ai renvoyé dans ce second tome, chaque fois que cela pouvait être utile, aux entrées du premier. Dans le corps du texte, l’astérisque (*) renvoie à une autre entrée de l’ouvrage, soit dans le premier tome, soit dans celui-ci.
Maintenant, j’aime bien cette expression de buissonnière appliquée à une réflexion libre. Le sens en est dérivé de l’expression école buissonnière. On ne sait pas assez qu’initialement elle désignait les « écoles tenues par les hérétiques dans des lieux écartés de la campagne », selon Littré. Et avec plus de précision, selon Pierre Larousse en son Grand Dictionnaire universel, les « écoles ou catéchismes que les Albigeois ou les Luthériens tenaient dans les campagnes et dans les bois ». Il ajoute que le Parlement de Paris les condamna le 7 février 1554, pour réserver l’enseignement à la direction exclusive du chantre de l’Église de Paris. Il s’agissait évidemment de faire que les réformés ne puissent soustraire leurs enfants au magistère ecclésial. Cet arrêt fut réitéré le 19 mai 1628. – Il est intéressant de noter que les dictionnaires récents, dont le Robert, ne font plus mention des « hérétiques » dans la tenue de ces écoles buissonnières. On y lit seulement, comme définition vieillie de l’expression : « École clandestine tenue au moyen âge en plein champ. » Restriction mentale, euphémisation, souci de ne plus raviver de vieilles plaies ? À nous donc de lire entre les lignes…
Personnellement le mot d’hérésie ne me choque pas du tout. Il s’agit seulement, comme le dit le mot en grec, d’un choix. Un dogme, un article de foi orthodoxe, c’est simplement une hérésie ou un choix qui a triomphé. Et une hérésie au sens moderne, un choix qui a été vaincu. Puisse ce livre réhabiliter tous ces choix qu’on a au fil des siècles diabolisés, mais qui, loin d’être des déviances postérieures à la promulgation de ce qu’on doit croire, étaient présents dès l’origine, dans l’effervescence des esprits qui a marqué les débuts du christianisme. On verra que certains de ces choix n’étaient pas sans pertinence, et que ce n’est pas parce qu’en fin de compte on s’est trouvé minoritaire qu’on avait tort.
Puisqu’on en est aux hérésies, je vais proposer un éclairage étymologique personnel, et sans aucun doute hérétique pour les lexicographes, sur cette expression de démarche buissonnière. Ne ferait-elle pas allusion à l’épisode biblique bien connu du Buisson ardent ? On sait que Moïse, voyant que le Buisson brûle mais ne se consume pas, détourne son chemin pour aller voir de plus près ce qui se passe, l’origine de ce prodige : « Moïse dit : ‘Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point.’ » (Exode 3/3)
Remercions ici Moïse pour sa curiosité : elle est l’âme même de l’être humain. Et comme lui, détournons-nous de notre chemin, je veux dire du chemin prémédité, qui est aussi très souvent celui de tous, pour aller voir les choses de plus près, c’est-à-dire sous un autre angle. Quittons donc comme lui les sentiers battus, faisons du hors sentier, n’hésitons pas à nous frotter aux buissons, quitte à nous y piquer ou brûler.
J’espère que ce livre y servira.
Remarque : La précédente édition de ce livre est parue chez BoD en 2017. Par rapport à elle, la présente édition a été mise à jour.
Ange
Ce nom vient du latin angelus, lequel calque le grec aggelos, qui veut dire Messager. C’est donc un nom purement fonctionnel. Les anges sont les intermédiaires entre la puissance divine et les hommes. Ils portent des messages, un peu comme nos préposés des postes : ce sont en quelque sorte des facteurs divins.
Dans l’A.T. il y a lieu de distinguer les anges de Dieu (héb. Elohim), et l’ange de Yahvé, ou du Seigneur, ou de l’Éternel, suivant la traduction à laquelle on se réfère : littérale, catholique ou protestante. Cette distinction correspond évidemment aux deux noms et aux deux visages de Dieu telle que la Bible juive les présente : certains d’ailleurs distinguent, dès le début de sa rédaction, un document élohiste et un document yahviste – v. t. I : Noms de Dieu*.
Pour ce qui est des anges de Dieu ou d’Elohim, on notera que ce nom est morphologiquement un pluriel, ce qui est bizarre s’agissant d’un Dieu unique, comme Voltaire l’avait déjà remarqué. Par cette forme de pluriel on pourrait comprendre le pluriel de Gn 1/26, qui ne serait pas qu’une clause de style, un pluriel de majesté : « Faisons l’homme à notre image… » Mais d’autres disent que Dieu s’adresse en cette occasion à sa cour, qui serait ainsi prise à témoin : et cette cour précisément est faite d’anges.
Elle comprend les Chérubins, dont l’intervention la plus connue sans doute fut de garder la porte du Paradis, qui fut interdit à Adam et Ève après leur faute : « … (Dieu) mit à l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. » (Gn 3/24) Initialement la vision des Chérubins devait être impressionnante, pour ainsi dissuader d’approcher, au moyen de leur épée. Il y a donc à l’origine, attachée aux anges, une grande numinosité (lat. numen : puissance sacrée)
Mais ensuite, sous l’influence sans doute des représentations artistiques chez nous, tout s’est aplati. Le chérubin est devenu un bel ange avenant : on le figure sous la forme d’une tête d’enfant avec des ailes, comparable au putto italien qui est un jeune garçon nu représentant l’Amour. Chérubin chez nous est un terme d’affection et de proximité. On sait que Beaumarchais dans sa trilogie théâtrale en a fait un jeune homme bien séduisant. L’ange a donc perdu toute son ancienne majesté : il n’est plus l’envoyé de Dieu, mais le messager du bonheur, du plaisir même.
De la cour de Dieu font partie aussi les Séraphins. C’est le pluriel d’un mot hébreu, qui vient de saraph, brûler. Ce sont donc les Brûlants. C’est pourquoi on les associe parfois aux douleurs qu’ils annoncent. « Laisse-la s’élargir, cette sainte blessure / Que les noirs Séraphins t’ont faite au fond du cœur », écrit Musset dans « La nuit de Mai ». Mais là aussi les Séraphins ont perdu au fil du temps leur numinosité plus ou moins menaçante, puisque l’adjectif « séraphique » signifie seulement angélique, éthéré.
C’est une loi commune dans le monde de l’expression que l’ancienne stature imposante cède souvent le pas à une certaine familiarité : toute l’histoire de la pensée et de l’art l’atteste assez. Ainsi Séraphin est devenu chez nous un prénom, celui par exemple de Séraphine de Senlis, peintre autodidacte et naïf qui a fait l’objet d’un film récent. Voyez aussi Seraphitus Seraphita, de Balzac, récit dont le titre même évoque l’androgynie inhérente aux anges. L’idée ici est celle d’une élévation loin de la terre, faite de renoncement : il n’est pas sans signification que l’ordre séraphique désigne celui des franciscains, connus pour leur choix de la pauvreté.
Ce que j’appellerai la dégradation de l’ange doit beaucoup à l’art saint-sulpicien (ou sulpicien). On sait que dans ce quartier parisien les commerces de bondieuseries kitsch ont pullulé au 19e siècle : images mièvres, dégoulinantes de sentimentalisme, de proximité, poussant au maximum l’empathie ou l’Einfühlung. Rapetissé, l’ange devient angelot. Si cet art peut être dit encore religieux, à cause de son sujet, il n’a plus rien d’un art sacré, car ce dernier implique toujours une distance entre la réalité évoquée et nous-mêmes, ce qui définit toute transcendance.
De ce mode de pensée abâtardi viennent beaucoup d’expressions chez nous : « tranquille comme un ange », « rire aux anges », par exemple. Alors que les anges par définitions sont dérangeants et effrayants. Au fond, « cri de l’ange » pourrait se dire de tout ce qui, dans l’art ou dans la vie, nous déchire, nous déstabilise, nous déracine ou nous casse irrémissiblement. En fait, le monde sulpicien connaît seulement le joli qui rassure, et non le beau et son effroi. D’ailleurs, quand une chose est banale, ne diton pas qu’elle ne casse rien ?
On sait que Jacob a lutté toute une nuit avec un homme mystérieux, qui a refusé de lui dire son nom, l’a blessé à la hanche, et finalement l’a béni : Gn 32/24-32. Comme Jacob dit lui-même à la fin de l’épisode qu’il a « vu Dieu face à face » (v. 30), on a assimilé ce personnage divin à un ange, émanation de Yahvé. La Lutte de Jacob avec l’Ange est le sujet d’un tableau célèbre de Delacroix, et l’adversaire du héros y est bien figuré avec les ailes d’un ange.
La « lutte avec l’Ange » est même devenue une expression proverbiale, qui se réfère à cet épisode. Il s’agit de l’affrontement de la Transcendance, dont on ne sort pas indemne. De sa blessure on peut sortir sinon physiquement boiteux comme Jacob, du moins définitivement meurtri. Peu importe la nature de cette Transcendance : dans L’Œuvre de Zola, la « lutte avec l’Ange » est l’affrontement de l’artiste et de son idéal. Le héros qui éprouve son appel à la fin se suicide par désespoir de ne pouvoir le réaliser.
On ne peut nier que les anges bibliques appartiennent à un vieux fonds polythéiste, et sont comparables au fond à l’Hermès ou au Mercure des Dieux antiques. Comme l’Hermès psychopompe des Anciens, les anges portent l’âme des justes, telle celle du pauvre Lazare, dans le « sein d’Abraham », c’est-à-dire en paradis : Lc 16/22.
Voyez les paroles du In Paradisum, dans le Requiem de Fauré, œuvre d’un agnostique pourtant, mais admirable : In paradisum ducant te angeli ; in tuo adventu suscipiant te martyres, et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem. Chorus angelorum te suscipiat, et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeas requiem. C’est-à-dire : « Que les Anges te conduisent au paradis, que les martyrs t’accueillent à ton arrivée, et t’introduisent dans la sainte cité de Jérusalem (i.e. la Jérusalem céleste). Que les Anges, en chœur, te reçoivent, et que tu jouisses du repos éternel avec celui qui fut jadis le pauvre Lazare ». – v. Paradis*.
« Être parmi les anges » signifie alors « être au paradis », ou « au septième ciel ». Le langage familier a pu même métaphoriser ce type d’expressions, au point que « voir les anges » peut y signifier « éprouver le plaisir sexuel, l’orgasme ». On est loin là, évidemment, de l’ange non sexué…
Mais l’art même a pu autoriser ce type d’interprétation. Ainsi l’extase de sainte Thérèse du Bernin la représente renversée en arrière et pâmée devant la flèche de l’Ange qui va la frapper, faisant glisser la mystique vers l’érotique. Le rôle de l’Ange assurément est de frapper. Mais la transverbération de la sainte a ici, à tout le moins, plusieurs significations. Cette polysémie est très fréquente dans l’art baroque : combien de Sébastiens percés de flèches nous laissent rêveurs devant le sens véritable du supplice qu’ils endurent !
À côté des anges de Dieu la Bible connaît l’Ange de Yahvé (ou du Seigneur), qui est Yahvé sous forme visible. On sait que celui-ci ne peut être vu sous peine de mort : « Yahvé dit : ‘Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre.’ » (Ex 33/20) Cette interdiction est absolue, et son fondement est psychologiquement fort juste. – v. t. I : Gloire*.
Il faut dire alors que l’entrée en scène de l’Ange de Yahvé la modère, et incarne tout ce qu’on peut voir de lui. Ainsi lors de l’épisode du Buisson ardent c’est seulement l’Ange de Yahvé qui apparaît à Moïse : Ex 3/2. La Septante a la même prudence. Cependant il est remarquable que dans la Vulgate c’est le Seigneur lui-même qui apparaît : Apparuitque ei Dominus… (« Et le Seigneur lui apparut… ») On peut se demander quel texte Jérôme a traduit ici.
On notera tout de même que dans l’histoire de Jacob racontée dans la Genèse, Dieu contrevient à l’ordre qu’il donnera plus tard dans l’Exode, puisqu’après l’épisode déjà mentionné de la lutte nocturne du héros avec l’homme mystérieux, il lui apparaît lui-même une nouvelle fois : Gn 35/9. – Peut-être peut-il y avoir, après tout, moins de numinosité que supposé, ou de terribilità au sens de Michel-Ange, dans le spectacle de la face de Dieu même.
On sait que le plafond de la Sixtine montre Yahvé, ou pour les chrétiens Dieu le Père sans vergogne (et tout notre art ensuite à l’avenant), ce qui non seulement aux yeux d’un Juif, mais encore aux yeux d’un chrétien orthodoxe est tout à fait blasphématoire. Pour un chrétien protestant, plus tolérant par principe, c’est seulement inadmissible.
Qui en effet peut être comme Dieu ? C’est ce que veut dire en hébreu Michel, devenu un archange (commandant ou chef des anges) et défenseur de la foi chrétienne dans son affrontement avec le Dragon : Ap 12/7. Il y aurait un énorme danger à oublier dans ce nom fonctionnel et définitionnel de Michel le point d’interrogation : ce serait la porte ouverte à toute idolâtrie. En effet « Qui est comme Dieu ? » n’est pas « Qui est comme Dieu ». C’est même son total opposé.
L’Ange exterminateur existe dans la Bible : c’est celui qui entrera dans les maisons des Égyptiens pour y faire un massacre, les maisons des Hébreux, elles, étant protégées par le sang de l’agneau pascal (Ex 12/23). Dans la Vulgate il est nommé percussor, celui qui frappe. C’est bien là, comme je l’ai déjà dit, le rôle initial et essentiel de l’Ange. Un des avatars de cet Ange exterminateur est l’Ange de la mort, qui existe dans maintes croyances populaires, tel l’Hankou des Celtes, présent dans le folklore breton par exemple.
Cependant pris littéralement il peut faire fantasmer à l’infini tous les exaltés qui veulent se prendre pour lui, en incarnant la colère divine et l’esprit de la vengeance. Histoire, art et littérature en sont pleins : Savonarole dans la Florence du 15e siècle, Achab dans Moby Dick de Melville, Aguirre ou la colère de Dieu de Werner Herzog, etc. Écoutez la colère imprécatrice d’Achab : « Qui me condamnera, alors que le Créateur lui-même devrait passer en jugement ? » Il est donc parfois tragique qu’un ange passe, ailleurs que dans les conversations… – Sur le sens habituel de cette expression, v. : Silence*.
Les anges ne doivent pas frayer avec les hommes. Le font-ils, qu’un processus néfaste s’engage. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu (i.e. les anges) virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. » (Gn 6/1-2) De cette union naquirent « les Géants, qui furent les hommes fameux (i.e. : les héros) de l’Antiquité » (Gn 6/4). Mais le cœur de l’homme ne s’en améliora pas pour autant, et face à la « trahison » de ses propres anges Dieu se comporta lui-même en Ange exterminateur : il dut avoir recours au Déluge pour remettre l’humanité sur de nouveaux rails (Gn 6/6 sq).
L’opposition ici est absolue avec le monde antique, qui est pourtant connu et cité – même si le mot « héros » ne figure pas dans le texte, et est remplacé par une périphrase (« les hommes fameux »), ce qui est le signe d’une grande hostilité à son égard. Pour la Bible, il ne faut pas mélanger le monde divin et celui des hommes, alors que pour les Anciens ce mélange était naturel : les héros ou demi-dieux naissaient de l’union d’un dieu et d’une mortelle. Deux esprits donc opposés : farouche exclusivisme d’un côté, accueil bienveillant du mélange de l’autre. Quelle part donner à Dieu dans ses relations avec les hommes, et quelle part aux hommes eux-mêmes ? À chacun de le dire, suivant son propre tempérament, et son évolution dans la vie.
Qu’en est-il du Diable ou de Satan lui-même ? On dit ordinairement qu’il faisait partie à l’origine de la cour des anges, et on s’appuie pour cela sur Jb 1/6 et 2/1 : « Or, les fils de Dieu (i.e. : les anges) vinrent un jour se présenter devant Yahvé, et Satan vint aussi au milieu d’eux. » Mais Satan a-t-il vraiment partie liée avec les anges ici ? Lui est seulement occupé à « rôder sur la terre et à s’y promener » (Jb 1/7 et 2/2). Apparemment c’est son occupation habituelle, et le contact de la terre lui plaît, un peu comme aux premiers anges celui des premières filles des hommes…
L’idée selon laquelle Satan est un ange déchu vient d’une interprétation particulière, non admise par tous, d’une prophétie d’Ézéchiel sur le roi de Tyr : « … Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes… » (Ez 28/16) – ainsi que d’une prophétie d’Isaïe sur le roi de Babylone : « Quoi donc ! tu es tombé du ciel, (Astre) brillant (Vulg. Lucifer), fils de l’aurore ! Tu es abattu à terre, Toi, le dompteur des nations ! » (Is 14/12) C’est de là donc que vient le surnom latin du Diable, Lucifer, porteur de lumière : c’est le nom donné à l’étoile du matin ailleurs dans la Vulgate (2 Pe 1/19). Le contexte est l’orgueil de celui qui veut s’égaler à Dieu, et qui sera châtié. C’est un thème fréquent, et dans le monde juif (voyez l’épisode de Babel), et dans le monde antique (voyez le cas de Prométhée).
Mais même si l’idée de Satan comme ange déchu vient d’interprétations par assimilation, toujours discutables, d’Ez 28 et d’Is 14, l’idée est intéressante : que le Diable ne soit pas un ennemi de Dieu depuis l’origine, mais s’en soit seulement détourné par la suite, montre que le mal n’est pas vu comme absolu, comme dans les dualismes religieux stricts, celui de l’Iran par exemple, ou encore celui du monde manichéen. Voir les choses sur le mode de la transition ou du passage, et pourquoi pas d’une nécessaire complémentarité n’excluant même pas l’inversion des rôles, est plus fin sans doute que les voir sur le mode de l’opposition. Et cela fait moins le lit du fanatisme et de la psychorigidité. – v. : Satan / Diable*.
L’idée de la chute des anges existe dès les épîtres pastorales : « Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » (2 Pe 2/4) Depuis on peut parler sans doute des « Anges de l’Enfer » : Hell Angels. La peinture s’est emparée du thème : La chute des anges rebelles un tableau de Pieter Bruegel l’Ancien (1562). C’est aussi un tableau célèbre de James Ensor (1889). Mais qu’un ange puisse chuter le rapproche de nous, qui chutons aussi, et le leste d’humanité. Pourquoi en refuser l’idée ?
Dans le film de Wim Wenders, Les ailes du désir (1987), coscénarisé entre le réalisateur et Peter Handke, les anges ne voient qu’en noir et blanc, tandis que le monde des humains est en couleurs. Il est donc naturel que les premiers aspirent au monde des seconds. Leur « chute » dans ce dernier sera une ouverture à une monde de sensations jusque là ignoré d’eux. À la fin, l’ange Damiel, qui a toujours ressenti le désir de porter à son tour la condition humaine, est si touché par Marion la trapéziste, si séduit par son âme et sa grâce qu’il décide finalement de devenir humain et, par conséquent, mortel.Il y a donc là une inversion du thème traditionnel, qui n’est pas sans intérêt. Ce film a inspiré La Cité des anges (City of Angels), film germano-américain réalisé par Brad Silberling, sorti en 1998.
Dans ce type d’œuvres, le choix finit par se porter délibérément sur la vie des hommes, même si elle est mortelle, et non sur celle des dieux, trop désincarnée et trop lointaine pour être vraiment intéressante. Ce choix humaniste est de principe, ou postulatoire. On pense aux paroles d’Alcmène à Jupiter dans Amphytrion 38 de Giraudoux : « Je ne crains pas la mort, c’est l’enjeu de la vie ». Ou encore : « Mon mari peut être pour moi Jupiter, Jupiter ne peut être mon mari. »
Quant à l’ange gardien, il vient sans doute de celui qui vient fortifier Jésus lors de son agonie à Gethsémani : « Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. » (Lc 22/43) Cependant on notera que ce verset, de même que le suivant sur la sueur de Jésus en grumeaux de sang tombant à terre, est absent de beaucoup de manuscrits, comme si on avait été effrayé par cette marque tragique d’humanité, nécessitant un tel secours divin. Trop de réalisme, réticence d’origine docète ou plus tard monophysite à humaniser Jésus ? Il reste que cet ange gardien est souvent utile, nouvelle version de la bonne étoile d’autrefois. On voudrait tout de même qu’il soit toujours là pour nous aider, qu’il ne soit pas absent au moment où on a besoin de lui, comme il se voit dans le cas de l’héroïne de Tess d’Uberville, de Thomas Hardy.
« Je suis l’ange gardien, la Muse et la Madone », lit-on dans « Réversibilité » de Baudelaire, qui opère par là un syncrétisme pagano-chrétien. L’ange gardien peut intercéder pour nous, comme il se voit à la fin de ce même poème : « Mais de toi je n'implore, ange, que tes prières, / Ange plein de bonheur, de joie et de lumières ! »
La réversibilité ne concerne pas seulement la SNCF, où elle est la possibilité pour les rames de TGV de rouler dans les deux sens. C’est aussi une notion théologique, selon laquelle les mérites des saints, anges, Mère de Dieu, etc., peuvent se reporter sur les pécheurs qui les prient. Mais la médiation des anges, comme celle d’ailleurs de la Madone, n’est admise dans l’Occident chrétien que chez les catholiques. Les protestants la refusent, fidèles sans doute à la condamnation du « culte des anges » qu’on lit en Col 2/18.
Socrate de la même façon avait son démon, pour le conseiller aux instants critiques. C’était un démon prohibiteur. Mais à côté de lui on pourrait imaginer un démon instigateur, comme fait malicieusement Baudelaire dans « Le mauvais vitrier », ou dans « Assommons les pauvres ! » (dans les Petits poèmes en prose). Ce serait une métaphore de nos impulsions les plus secrètes, les plus refoulées, qu’il est nécessaire parfois de laisser s’exprimer, pour mieux nous connaître et avoir de la vie une vision plus large que celle que nous donnent les convenances et la morale. Peut-être rudoyer un pauvre, pour reprendre l’exemple de Baudelaire, est-il plus propre à le faire réagir et à se mettre debout dans la riposte, donc à retrouver sa fierté d’homme, que tous les discours lénifiants sur la prétendue « dignité des pauvres », selon l’expression de Bossuet, qui anesthésient et « abrutissent » l’esprit. – v. : Satan / Diable*.
L’ange peut nous apporter une bonne nouvelle, comme l’ange Gabriel à Zacharie (Lc 1/19) puis à Marie (Lc 1/26). Comme nos postiers – et de fait l’Ange annonçant la venue du « Messie » dans Théorème de Pasolini (1968) est un facteur !
C’est de l’Annonciation lucanienne que vient notre Angélus, prière qui se dit le matin, le midi et le soir, accompagnée par le son des cloches, et qui rappelle au chrétien que le monde est sauvé parce que Dieu s’est fait homme en naissant de la Vierge. Cette prière est ainsi nommée à cause de son début dans la Vulgate : Angelus Domini nuntiavit Mariae – L’ange du Seigneur fit l’annonce à Marie… La connaissant, on comprendra mieux L’Angélus, tableau de Millet (1860), et même la belle et hypallatique expression « bleus angélus » de Mallarmé dans « L’Azur » : le son des cloches dans le ciel bleu.
Marie répond à l’Ange par un Fiat ! (Que cela se fasse, qu’il en soit ainsi !), où est toute la piété il me semble : il y a bien des cas dans la vie où il faut faire confiance, aux choses, aux êtres, même si on ne comprend pas. Ouvrir ses mains dans l’acceptation, non les serrer ou les crisper dans la rage et la révolte. La chanson des Beatles Let it be est une variation sur ce Fiat ! : When I find myself in times of trouble / Mother Mary comes to me / Speaking words of wisdom, let it be… (Quand je me trouve en difficulté / La Vierge Marie vient vers moi / Prononçant des paroles de sagesse : ‘Qu’il en soit ainsi…’) Rien de plus beau que ce Fiat !, ou ce Let it be !, même s’ils sont plus faciles à dire qu’à mettre vraiment en pratique…
Aussi l’ange peut nous délivrer de nos hésitations, comme celui qui apparut à Joseph tenté de répudier Marie enceinte : « Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : ‘Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit’. » (Mt 1/20) C’est alors une métaphore d’une illumination jaillie des profondeurs de l’inconscient. Du jour vient le doute, de la nuit et du songe vient la lumière. Voyez l’admirable tableau nocturne de Georges de La Tour : L’Ange apparaissant à saint Joseph, du Musée de Nantes.
L’ange peut signifier aussi l’union en nous du masculin et du féminin, et nous permettre de dépasser en nous la limitation où nous cantonne notre propre sexe : « Car, à la résurrection, les hommes ne prennent point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils sont comme les anges de Dieu dans le ciel. » (Mt 22/30) Rien n’empêche de prendre ici, comme les gnostiques, le mot « résurrection » de façon symbolique, d’y voir simplement une résilience, un nouveau départ dans notre vie – d’autant que les verbes du texte (« prennent », « sont ») sont des présents, et non des futurs. Alors l’ange est une figure de l’androgynie primordiale (voyez là-dessus le Banquet de Platon), de l’unité initiale perdue et à reconstituer : « faire le Deux Un », comme dit l’EvTh (logion 22).
On peut discuter à l’infini, comme à Byzance, sur le sexe des anges. C’est oublier précisément qu’ils n’en ont pas, ou qu’ils ont dépassé la malédiction de cette coupure : « sexe » appartient à la famille du latin secare, couper). –
v. : Homme / Femme*, Sexualité*.
En général, quiconque nous permet d’avancer dans la vie, une rencontre, une parole, un geste, ou tout simplement une vision, une intuition, est pour nous un ange. Et tout ce qui nous fait stagner, y compris dans notre propre pensée, est un démon, dans le sens négatif du mot. – Je fais ici exception, je le répète, du « démon instigateur » de Baudelaire, ou de celui dont parle Gide, quand il dit qu’« il n’y a pas d’œuvre d’art sans la collaboration du démon ».
Animal
Certaines cultures, même en faisant une différence fondamentale entre l’homme et l’animal, évoquent la possibilité de passage d’un état à l’autre. C’est le cas des Métamorphoses d’Ovide, dont c’est même le thème principal. Le début en est : In nova fert animus mutatas dicere formas corpora (« Je me propose de dire comment le changement de formes a abouti à de nouveaux corps »).
Notons par exemple la métamorphose d’Hécube changée en chienne, dont il est fait mention dans la pièce éponyme d’Euripide, et aussi dans les Métamorphoses (XIII, 569) : Conata loqui, latravit, écrit Ovide (« S’étant efforcée de parler, elle aboya »). Ce changement impressionnant et effrayant annonce celui de La Métamorphose de Kafka, où le héros est transformé en « misérable vermine » (insecte, cancrelat…).
Le tragique est dans l’animalisation d’un être humain, dans la défiguration de ce qui le caractérise même, le langage. On sait que l’animalisation touche aussi dans l’Odyssée les compagnons d’Ulysse, transformés en pourceaux. Que de tels changements ou mutations (dans tous les sens du mot, y compris le sens scientifique) soient possibles montre que ce qu’on appelle les « règnes » du vivant (minéral, végétal, animal, humain) ne sont pas étanches les uns aux autres.
Au contraire de cela se situe la Bible. Bien sûr les animaux partagent avec les plantes et les hommes le même statut d’« âme vivante » : les animaux reçoivent une âme (i.e. un souffle) de vie (Gn 1/30 – LXX : psukhèn zôès), et l’homme est promu en « âme vivante » (Gn 2/7 – LXX : eis psukhèn zôsan). L’étymologie du mot animal renvoie d’ailleurs au latin anima : « souffle, vie ». – v. t. I : Âme*.
Mais à part cette participation commune au souffle de tout ce qui a vie, les espèces dans la Bible sont bien séparées, imperméables les unes aux autres. Chaque catégorie d’animal est créée « selon son espèce » : Gn 1/12 ; 1/21 ; 1/25 ; 6/20 ; 7/14. Cette mise en ordre du monde n’admet pas les indistinctions, les confusions, les mélanges, ce qu’on voyait par exemple dans les métamorphoses païennes.
On notera que la Transfiguration de Jésus dans les évangiles synoptiques doit son nom à la traduction que fait Jérôme de la metamorphôsis du texte original, alors que transformatio aurait été possible en calquant totalement le grec : il s’est sans aucun doute agi pour Jérôme de bien distinguer le phénomène des métamorphoses mythologiques antérieures – v. t. I : Transfiguration*.
Beaucoup de cultures aussi, conformément à leur refus d’élever une barrière nette entre hommes et animaux, ont connu des divinités zoomorphes, telles en Égypte la déesse Bastet, à tête de chat, ou le Dieu Anubis, à tête de chacal, ou Horus à tête de faucon. En Inde, Gamesh, à tête d’éléphant. Le Sphinx, quant à lui, est commun aux Égyptiens et aux Grecs. On appelle zoolâtrie l’adoration de telles idoles.
Israël y est tombé un temps, avec la fabrication et l’adoration du veau d’or par Aaron : Ex 32/4. Mention de cet épisode est faite à plusieurs reprises ensuite, pour le fustiger : Ps 106/19-20 ; Neh 9/18. On sait la réaction violente de Moïse à cet égard : Ex 32/19 sq.
En fait Moïse et Aaron sont deux pôles de notre âme. Il y a en nous une partie qui se refuse à représenter Dieu, et une partie désireuse de sa représentation. – Moïse et Aaron est un opéra écrit par Arnold Schönberg en 1926 pour défendre l’esprit biblique et lutter contre l’antijudaïsme montant alors en Allemagne, et évidemment couplé à un néopaganisme.
Le point important pour caractériser l’esprit biblique ici est non seulement la différence irréductible, mais la supériorité affirmée de l’homme par rapport aux animaux. Dès l’origine, une fois les animaux créés par Dieu, c’est à Adam lui-même que revient la tâche de les nommer : « L’Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. » (Gn 2/19) C’est ici un passage de témoin décisif. Dieu se retire, s’efface devant l’homme : c’est à lui que revient la responsabilité de nommer, donc dans une culture où nommer a une telle importance, où le nom vaut l’être, on mesure l’honneur qui est fait à Adam. En tant que donnant l’être aux animaux, il est quasiment coresponsable avec Dieu de la création, il co-crée avec lui.
Avant même de créer les animaux, Dieu pensant qu’« il n’est pas bon que l’homme soit seul » cherchait pour lui une aide « qui lui fût assortie » : Gn 2/18. Ensuite, après la nomination des animaux, le texte porte : « Mais pour lui-même, l’homme ne trouva pas l’aide qui lui fût assortie. » (2/20) Alors Dieu crée la femme, pour faire moins sentir sa solitude à l’homme (Valéry disait au contraire pour mieux la lui faire sentir !), en tout cas pour pallier cette incapacité des animaux à satisfaire l’homme. Un esprit impertinent, suivant le déroulement chronologique des événements, en conclurait que la création de la femme vient après des essais infructueux d’Adam pour sortir de sa solitude. L’ombre de la zoophilie plane sur le texte…
De toute façon elle est sévèrement proscrite dans tous les textes ultérieurs : « Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. » (Ex 22/19 – cf. Deut 27/21) La raison en est donnée en Lev 18/23 : « C’est une confusion. » Gageons que la Pasiphaè du mythe grec, qui s’unit à un taureau, union dont sortit le Minotaure, aurait été dans cette culture immédiatement punie de mort, pour « confusion ».
On verra à Nature*, à partir de Gn 1/29, que l’homme à l’origine devait être végétarien, puisque recevant de Dieu, exclusivement, « toute herbe » et « tout fruit » à manger. Or après le Déluge, après la nouvelle alliance nouée à cette occasion entre Dieu et Noé, l’homme reçoit enfin latitude de manger, en plus de l’herbe, la chair des animaux : « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture : je vous donne tout cela comme l’herbe verte. » (Gn 9/3) On peut bien sûr continuer de parler d’une certaine fraternité entre les hommes et les animaux, mais désormais il est loisible de les tuer pour se nourrir. La colombe même, signe de paix dans l’épisode, on pourra la manger, mais alors on l’appellera pigeon ! Les animaux ont certes été sauvés dans l’arche, mais ils pourront désormais garnir la table…
De cette supériorité de l’homme sur les animaux, l’exemple le plus lyrique peut-être est le passage de Gn 1/26 : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Le verbe « dominer » est répété plus loin : « Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » (ibid. 1/28)
De cette idée de « domination », totalement anthropocentrique et très dépréciative au fond pour les animaux, pourra venir plus tard l’idée cartésienne des « animaux machines ». On sait que Malebranche, disciple de Descartes, battait sa chienne sous prétexte qu’elle ne sentait rien ! La Fontaine, dans son Discours à Madame de la Sablière, a critiqué cette vision ramenant les animaux à « de simples ressorts ». Mais déjà au siècle précédent Montaigne se demandait d’où l’homme tirait l’idée de sa propre supériorité vis-à-vis des animaux. « Quand je me joue à ma chatte, disait-il, est-ce moi qui joue ou elle qui joue avec moi ? ».
C’est cependant un fait que les mots « animal » et « bête » sont chez nous fortement péjoratifs. L’instrumentalisation que nous faisons des animaux, par exemple par la pratique des expériences sur cobayes ou de la vivisection, signifie notre choix culturel : gageons que d’autres cultures en seraient bien effrayées !
Face à cette option majoritaire dans la culture occidentale à racine biblique, on comprend pourquoi Darwin au 19e siècle a causé un séisme plus important que celui causé auparavant par Copernic et Galilée. En effet les astres nous sont bien lointains, et bien plus proches les animaux. Quel rapport d’eux à nous ? On les pensait tout différents, et voilà qu’on nous dit qu’effectivement ils nous sont bien proches. L’Église chrétienne enseignait jusqu’à une date récente qu’à côté du règne animal, et bien séparé de lui, il y avait un règne humain. Darwin a fait justice de cela : il est même faux de dire désormais que l’homme descend du singe. Il est un singe, cousin d’autres singes.
On voit dans Le Nom de la rose d’Umberto Eco qu’au Moyen-Âge le rire était méprisé par les gens d’église, au motif d’abord que Jésus n’a pas ri (mais comment le saiton ?), et aussi que le rire déforme les traits, donne au visage un caractère de face simiesque. Le danger en vérité n’est pas seulement qu’une fois partis sur ce chemin nous puissions rire des textes sacrés, mais aussi que nous reconnaissions notre parenté avec ce qu’aussi nous sommes : un animal.
C’est au contraire de l’éloignement, de la disproportion possible entre lui et nous que Dieu tire, dans le livre de Job par exemple, argument pour nous écraser : pour pourfendre les justes récriminations de Job, il recourt au crocodile et à l’hippopotame. « Prendras-tu le crocodile à l’hameçon ? Saisiras-tu sa langue avec une corde ? » (Jb 40/25, trad. Segond) Et encore : « Voici l’hippopotame, à qui j’ai donné la vie comme à toi !, etc. » (ibid. 40/15) Peu importe que ces animaux soient mythiques : LXX drakôn (Dragon) dans le premier cas, thèria (Bête fauve) dans le second. Pour la TOB, respectivement « le Tortueux » et « le Bestial ». L’intention est d’écraser la pauvre Job sous une majesté superlative qui doit lui clore la bouche.
Mais peut-on réellement conforter l’idée d’une théodicée (justice de Dieu) par le recours à de tels exemples ? Je me demande bien d’ailleurs, comme le fait Fritz Zorn dans Mars, si on peut vraiment se vanter d’avoir créé le crocodile…
Une façon intelligente de considérer l’animal est de le voir comme une partie de nous-mêmes. Si on prend par exemple l’épisode de la tentation de Jésus au désert, on voit que sa matrice non développée figure en Mc 1/12-13 : « Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. » On sait que Mt et Lc développent et explicitent la tentation en dialogue ou controverse rabbinique (pilpoul) entre Jésus et le Diable – v. t. I : Épreuve / Tentation*.
Mais la tentation première, ou la version première de la tentation, celle de Mc, est très intéressante. À nous cependant de la comprendre. « Il était avec les bêtes sauvages » peut signifier que Jésus se mesurait à ses démons intérieurs, ses pulsions. « Et les anges le servaient » peut vouloir dire que le salut dans cette lutte pouvait lui venir d’en haut, d’une instance supérieure dont il sentait aussi la présence en lui. Un psychanalyste freudien y verrait le conflit du moi partagé entre le ça (animal), et le surmoi ou idéal du moi (les anges).
L’évangile selon Thomas rapporte une parole de Jésus en son logion 7 : « Heureux est le lion que l’homme mangera, et le lion deviendra homme, et souillé est l’homme que le lion mangera, et le lion deviendra homme. » Cette parole, nouvelle Béatitude, n’a aucun équivalent dans les textes canoniques. Or elle est très intéressante, si on voit bien que la même expression « et le lion deviendra homme » répétée en deux contextes différents acquiert chaque fois elle aussi un sens différent, en vertu de cette figure de l’antanaclase qui est l’archétype stylistique majeur de tout l’EvTh.
On nous dit d’abord qu’il faut « manger le lion », c’està-dire qu’il faut intégrer, assimiler la bête en soi. Le lion alors s’humanise (« Et le lion deviendra homme »). Mais si au contraire nous sommes mangés par le lion, alors le lion s’incarne en nous, il prend forme d’homme : le scénario s’inverse et l’homme s’animalise, la formulation « et le lion deviendra homme » semblant être la même mais prenant manifestement un sens opposé. Ce scénario d’animalisation de l’homme est le sujet de la pièce d’Ionesco, Rhinocéros. Les sens possibles en sont multiples, à commencer par celui de la peste brune du nazisme contaminant les hommes. Mais on peut penser aussi à tous les autres totalitarismes, de quelque bord qu’ils viennent, et par exemple à la dictature du conformisme et du prêt-à-penser dans les démocraties dites libérales. – v. aussi : Satan / Diable*.
La traduction que donne J-Y Leloup de l’EvTh (Albin Michel, 1986) met ici pour la seconde occurrence : « et l’homme deviendra lion ». Elle explicite bien l’idée, mais c’est au détriment de la beauté du texte. Elle perd l’occasion de réfléchir qu’il donne, par son côté énigmatique même, à l’auditeur ou au lecteur : fidèle en cela à son intention générale, qui est une invitation à chercher. Voyez par exemple : « Celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher, jusqu’à ce qu’il trouve, etc. » (EvTh 2) Il est bien dommage dans ce type de texte de frustrer le récepteur, par des explications didactiques, du plaisir de créer lui-même le sens.
Selon la Bible, un jour viendra où l’animal ne fera plus peur. Ainsi, dans le paradis eschatologique, les bêtes féroces ne le seront plus, guidées qu’elles seront par un enfant : « Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l’ourse auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s’ébattra sur l’antre du cobra, et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne de la vipère. » (Is 11/6-9)
On peut certes railler ce texte en le prenant littéralement : peut-être, dira-t-on, que le loup et l’agneau coucheront ensemble, mais cette nuit-là l’agneau ne dormira pas beaucoup ! Mais c’est symboliquement qu’il faut le prendre. Un jour viendra où l’antagonisme de l’homme et de l’animal disparaîtra, sous la houlette de l’enfant éternel, du puer aeternus de toutes les sagesses et spiritualités du monde, incarnant l’idéal de la réunification de l’être, ainsi qu’il se voit par exemple dans tout l’EvTh. Notez que cette attente future peut très bien être une réalisation présente, à condition bien sûr de se dégager totalement de l’eschatologie, et de pousser jusqu’au bout la symbolisation dans ce passage, l’animal n’y figurant que nos monstres intérieurs. – v. : Paradis*.
Il ne sert à rien en effet de nier l’animalité en nous, nous devons l’intégrer. Sans s’appuyer sur elle et sur ce qu’elle représente nous n’avançons pas, nous stagnons. Il en est de l’animal comme du vent, qui peut renverser le voilier, mais sans lequel le voilier reste immobile. Le rôle du pilote est de jouer avec toutes ces forces qui peuvent lui sembler incommensurables, mais qu’il peut diriger à sa guise : « Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. » (Ja 3/4)
Parfois considérer une image vaut tous les discours. Soit par exemple l’icône bien connue de saint Georges à cheval terrassant le Dragon : le cheval que monte saint Georges n’est autre que le Dragon apprivoisé. Il y a eu changement d’état, le cheval étant blanc, et le Dragon, sombre. Mais il n’y a pas eu négation. Comme le cavalier, nous devons nous appuyer sur l’animalité même pour l’affronter.
La spiritualisation finale de l’homme implique qu’il parte de son animalité. « Il est semé corps animal (sôma psukhikon), il ressuscite (litt. il est réveillé, egeiretai) corps spirituel (sôma pneumatikon). S’il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » (1 Co 15/44) Ce « réveil » est donc bien une transformation, la métamorphose pourrait-on dire de ce qu’il y a d’animal en l’homme.
En réalité ce qui nous fait peur, l’animal en nous, n’attend que notre pitié pour se transformer. Autant l’animal refoulé devient dangereux, exactement comme celui que les chasseurs blessent, autant l’animal aimé peut devenir aimable. C’est la leçon du conte La Belle et la Bête, qui n’est pas que pour les enfants : il faut donner sa compassion à quelqu’un pour que de monstre repoussant qu’il était il puisse se transformer en Prince charmant. Il sortira, par exemple, du crapaud que l’on voudra bien caresser. – J’ai développé ce thème dans mon ouvrage La Source intérieure (Golias, 3e éd. 2015, chapitre : « Extérieur et intérieur »).
Je pense aussi au cas de King Kong dans le premier film éponyme (1933) : ce ne sont pas les avions qui auront triomphé de lui au sommet de son gratte-ciel, mais le premier regard de la Belle, ainsi que le dit expressément le commentaire final. Il n’a pas eu la chance, pour se transformer, de rencontrer de la part de celle-ci un regard compatissant.
Il ne faut pas toujours opposer l’homme et l’animal. J’ai signalé que la Genèse proscrit le mélange des règnes. Je soulignerai simplement ici que la poésie au contraire le pratique constamment, via la métaphore, qui est un transfert, un passage d’un domaine à un autre. Voyez par exemple La Chevelure, de Baudelaire, où les cheveux participent à la fois du minéral, du végétal, et de l’animal : « Ô toison, moutonnant jusque sur l’encolure… Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde / Sèmera le rubis, la perle et le saphir… » Si la zoophilie est condamnable, ici elle est pratiquée – symboliquement. Donc elle est désamorcée sur le plan littéral, et rendue inoffensive sur le plan symbolique. Cette sublimation des pulsions est d’ailleurs une fonction majeure de l’art, ainsi que des constructions symboliques qui sous-tendent les cultures.
Le poète refuse la distinction, dans les deux sens du mot : la séparation, et la noblesse (plutôt ce qu’on appelle ainsi). Et cette « confusion » que la Bible prohibe, c’est au contraire ce qui lui paraît le plus précieux : il retrouve un état d’immersion ou holistique, symbiotique, qui est celui d’un paradis restauré. État donc aussi de fraternité avec les animaux. Voyez la parole magique par quoi débutent les Contes : « C’était au temps où les bêtes parlaient… »
Les métaphores, les hypallages (« proximité animée des êtres… ») sont des moyens pour le poète et l’artiste de rebrouiller, pour une plus grande contiguïté de vie, ce que Dieu a débrouillé lorsque dans la Genèse il a tiré le monde du chaos pour l’ordonner en un cosmos. Ici pour moi, Dieu n’est qu’une métaphore de notre esprit logique, de notre intellect qui met en ordre le monde par des séparations ou des décisions potentiellement meurtrières (décider et occire ont la même racine). Il est bon alors parfois de revenir au tohu-bohu primitif, tel que Rimbaud le présente au début du Bateau ivre : « Et les péninsules démarrées / N’ont pas connu tohu-bohus plus triomphants. » On peut écouter aussi un autre prophète, Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra : « Il faut porter en soi un chaos, si on veut enfanter une étoile dansante. Je vous le dis : Vous portez en vous un chaos. » – v. : Paradis* et Silence*.
Je viens de parler de poésie. Mais tout notre langage courant est plein de ce monde magique et confus. Proust certes mêle végétal et humain quand il parle des Jeunes filles en fleur. Mais que faisons nous d’autre, quand nous disons de telle jeune fille qu’elle est « une belle plante » ? Voyez aussi les hypocoristiques, ou diminutifs d’affection, qu’échangent ceux qui s’aiment : « Mon petit loup », « Mon gros canard », etc. Lire une correspondance amoureuse est souvent visiter une ménagerie... Point donc n’est besoin d’être un peintre comme Arcimboldo par exemple, dont toutes les œuvres mêlent allègrement tous les genres ou règnes existants, pour se sentir en état de fusion et de fraternisation avec tout ce qui a vie.
Cet idéal de fraternisation avec les animaux, François d’Assise l’a bien incarné. Giotto l’a illustré, en montrant François parlant aux oiseaux. Et un poème comme celui de Francis Jammes, Prière pour aller au paradis avec les ânes, de même qu’un film comme Au hasard Balthazar, de Bresson, dont le héros est un âne, sont tout imprégnés d’esprit franciscain. Voyez aussi L’Âne patience d’Henri Bosco.
Il reste maintenant à aborder deux derniers points qui eux me semblent très problématiques : la distinction qu’opère le judaïsme entre animaux purs et animaux impurs, et la valorisation que fait le christianisme majoritaire du sacrifice d’une victime expiatoire, incarné dans la figure de l’Agneau de Dieu.
Outre les lois dites « noachiques » (v. : Vie*), on lira dans Lev 11 et dans Deut 14 les prescriptions alimentaires juives concernant les animaux. On peut sourire des arguties et des détails invoqués : « Ceux qui ont le sabot fendu et qui ruminent, ceux-là, vous pouvez les manger… mais quant au lièvre, qui rumine, mais n’a pas de sabots, pour vous il est impur ; et quant au porc, qui a le sabot fendu, mais ne rumine pas, pour vous il est impur. » (Lev 11/3 et 6-7) Les plantigrades sont exclus (Lev 11/27). De même parmi les animaux aquatiques il ne faut manger que de ceux qui ont « nageoires et écailles », à l’exclusion absolue de tous les autres (Lev 11/9). Et parmi la gent ailée il faut exclure les espèces qui ont quatre pattes, à moins qu’elles n’aient « des jambes qui leur permettent de sauter sur la terre ferme », comme les sauterelles, les grillons, les criquets, etc., qui eux sont consommables (Lev 11/20-23). En général, il faut non seulement ne pas manger, mais même s’abstenir de toucher un animal impur, car son impureté nous contamine par contagion (Lev 11/8, et passim).
Deux remarques peuvent être faites ici. D’abord cette division entre animaux purs et animaux impurs ne correspond pas du tout au texte inaugural de la Genèse, où Dieu bénit tous les animaux sans exception, aquatiques, terrestres et aériens, en leur disant : « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre. » (Gn 1/22) De ce point de vue, le discours de saint François, du type « mon frère le loup, ma sœur l’araignée » est plus conforme au texte de la Genèse que les exclusions circonstanciées du Lévitique ou du Deutéronome.
Ensuite, et la question est sans doute plus grave, Israël a considéré que s’il était lui-même un peuple pur en observant les prescriptions susdites, ceux qui ne les observaient pas (les non juifs, ou gentils) étaient impurs. Aussi la commensalité avec eux était impossible. Aux yeux d’un ancien Grec ou Romain, cela était particulièrement inadmissible : cela contrevenait aux lois élémentaires de l’hospitalité, qui prescrivaient d’accueillir l’hôte à sa table, de façon inconditionnelle, quelles que fussent ses habitudes et manières. L’idiosyncrasie du peuple juif en matière de comportements alimentaires a dû le faire considérer très tôt comme un peuple barbare, ou à tout le moins non humainement civilisé ou « poli ». Ce type d’attitude a sans doute beaucoup plus fait pour le marginaliser dès l’Antiquité que des questions de foi ou de dogmes religieux.
La vision (« extase ») de Pierre à Joppé fait éclater cet exclusivisme, et illustre la catholicité (l’universalité) de l’église naissante, pour la défense de laquelle le texte a été écrit : « Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et s’abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit : ‘Lève-toi, Pierre, tue et mange !’. » (Ac 10/11-13) Ce « Tue et mange ! » m’a toujours impressionné, et j’imagine ce qu’un écrivain pourrait en faire en le tirant de son contexte…
Quoiqu’il en soit, Pierre évidemment a peur de tuer un animal impur, mais Dieu le rassure : « Mais Pierre dit : ‘Non, Seigneur, car je n’ai jamais rien mangé de souillé ni d’impur.’ Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui : ‘Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé.’ (ibid. 14-15) C’est donc la voix du Dieu de la Genèse qui se fait entendre, non de celui du Lévitique ou du Deutéronome… À l’évidence, ce texte a une signification polémique anti-juive. Christianisme et judaïsme s’y séparent, le premier ouvrant la nouvelle foi au maximum de gens, le second restant dans des prescriptions et des rites traditionnels.
Le dernier point problématique que j’ai annoncé concerne le statut de l’animal comme victime « efficace » d’un sacrifice fait à Dieu. On sait que Jésus, à partir d’une lecture particulière du chapitre 53 d’Isaïe (le Serviteur souffrant, acceptant son sacrifice, tel l’agneau silencieux qu’on mène à la boucherie) a été appelé « Agneau de Dieu » : « Le lendemain, il (i.e. : Jean le Baptiste) vit Jésus venant à lui, et il dit: ‘Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde’. » (Jn 1/29 ; v. aussi : 1/36).
Le lien aux anciens sacrifices d’animaux pris comme victimes propitiatoires est évident : « Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! » (He 9/13-14)
Il me semble curieux que d’un côté on ne puisse manger soi-même le sang d’un animal, qui est sa vie, et que de l’autre on puisse tout de même l’offrir à Dieu en signe d’expiation : « Sans effusion de sang il n’y a pas de pardon. » (He 9/22) Que fera Dieu de ce sang qu’on lui offre ?
En fait, je ne vois pas personnellement comment le sacrifice d’animaux, nos frères, pourrait nous purifier de quelque façon que ce soit. Et à l’Agneau de Dieu johannique on peut préférer celui de l’EvTh, au logion 60, qui doit rester en vie pour ne pas être mangé, et à l’image duquel nous sommes constamment : « Ils virent un Samaritain emmenant un agneau et entrant en Judée. Il dit à ses disciples : ‘Pourquoi celui-ci tourne-t-il autour de l’agneau ?’ Ils lui dirent : ‘Pour le tuer et le manger.’ Il leur dit : ‘Aussi longtemps qu’il vit, il ne le mangera pas, sauf s’il le tue, et qu’il devienne un cadavre.’ Ils dirent : ‘Autrement, il ne pourra pas le faire.’ Il leur dit : ‘Vousmême cherchez un lieu pour vous dans le repos, de peur que vous ne deveniez cadavre, et que l’on ne vous mange.’ »
Cherchons donc « ce lieu pour nous dans le repos », un peu comme les hésychastes ou les quiétistes, et faisons en sorte de « ne pas être mangés », c’est-à-dire à ne pas être morts dès cette vie-ci, et dévorés par les prédateurs dont elle regorge. – v. t. I : Agneau de Dieu*, Repos*, Sacrifice*.
Bonheur / Béatitude
L’homme cherche toujours le bonheur. Il suffit de lire le début du De vita beata de Sénèque : « Tous les hommes veulent vivre heureux ». C’est évidemment sur la suite, sur les moyens d’y parvenir, qu’ils sont, comme l’ajoute le moraliste, dans la nuit. Pensons aussi à la phrase de Pascal : « Tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. »
De façon plus précise et plus formelle, une Béatitude est une parole de sagesse (ou sapientielle), qui commence par : « Heureux celui qui… » Par exemple, « Heureux celui qui a pu connaître les raisons des choses ! » (Felix qui potuit rerum cognoscere causas !) de Virgile, ou encore « Heureux les paysans, s’ils connaissaient leur bonheur ! » (O fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas !), du même Virgile, sont des Béatitudes. Dans le premier cas, la formule peut servir d’arme aux rationalistes militants, pour qui la religion repose sur l’ignorance. Savoir si dans le second elle convaincra ceux qui sont concernés, est une autre question…
« Béatitude » vient du latin beatus