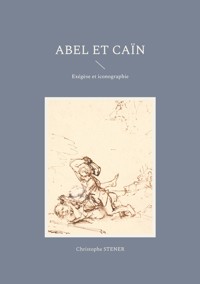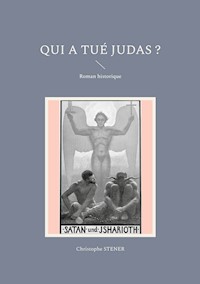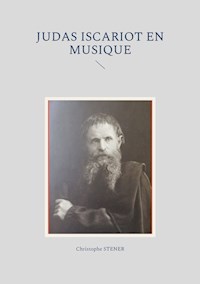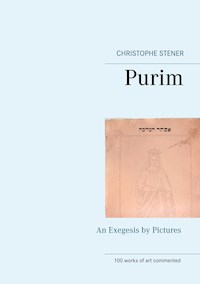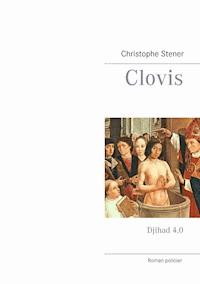Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Christine part, pour survivre au suicide de son fils, sauver des boat people en mer de Lybie. Elle en reviendra avec la force de vivre et de pardonner à celle qui a, par amour, causé sa mort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A tous ceux qui risquent leur vie en mer pour sauver d’autres vies
Sommaire
Mare nostrum
Sugar daddy
Paul et Virginie
Œdipe
A la recherche du temps perdu
Mafia
Malik
Pardon
Regain
Table des illustrations
Bibliographie de Christophe Stener
Chapitre UN
Mare nostrum
Octobre 2017
Les trois cents chevaux déployés par les deux moteurs Honda du Zodiac de l’ONG Mare nostrum i luttaient contre la houle qui les repoussait des côtes de Lybie. Les trente premiers milles marins étaient les plus périlleux pour les réfugiés embarqués sur des barcasses de pêche propulsées par un moteur de voiture bricolé qui calait parfois quand il ne tombait pas en panne d’essence. Les passeurs ne remplissaient qu’au tiers les jerricans d’essence comptant sur les bateaux de la force Triton pour récupérer les bateaux à la dérive. C’était un jeu de la roulette russe dantesque. Un bateau sur dix ou vingt, personne n’en avait le nombre exact, s’abîmait renversé par une vague trop haute ou flottait, comme une baleine morte, quelques rescapés accrochés aux bastingages de ces radeaux de la Méduse ii. Les trafiquants d’homme avaient empoché les milliers de dollars payés par ces cohortes d’Ivoiriens, de Maliens, d’Erythréens et Soudanais et de bien d’autres nationalités encore, qui pour certains fuyaient une mort proche dans leurs pays dévastés par les guerres civiles pour une mort lointaine, mais non certaine, sur les eaux de la Méditerranée, et qui, pour d’autres, cédaient au mirage de l’eldorado européen. Les hommes de main, un ramassis de sicaires du régime abattu de Mouammar Kadhafi, de pécheurs reconvertis au métier bien plus lucratif de naufrageurs, de soldats sans solde et de purs mafieux, avaient violé les femmes les plus jeunes, prélevé quelques hommes jeunes et forts pour les vendre sur les marchés aux esclaves improvisés du port de Tripoli, et jeté ce bétail humain sur les flots démontés. La mer Méditerranée, furieuse, prélevait sa dime sur la folie humaine.
Christine, agrippée à la corde du plat-bord, ses cheveux gris trempés de pluie mêlée d’embruns, ne pouvant s’empêcher d’admirer la beauté de la mer en fusion qui bouillonnait, se creusait et bouchonnait le canot dont les moteurs, hors d’eau, hurlaient un instant avant de replonger en bouillonnant de colère dans les eaux brunes. Le spectacle était dantesque. John, le capitaine irlandais, donnait des coups de barre pour prendre les vagues les plus hautes de biais tentant d’esquiver ce qu’il appelait, sans humour, les montagnes russes. Il hurlait quelques ordres brefs au pilote qui était, à la proue, fouillait du regard la confusion aqueuse, à la recherche d’un bateau en détresse. Les nuits d’été, les naufragés, par mer calme, dérivaient dans l’immensité, allumant leurs téléphones portables, pour ceux qui n’en avaient pas été dépouillés et ces faibles lucioles étaient leur seul fil de vie. Mais en octobre les flots démontés ne laissaient que quelques heures d’espoir à une embarcation sans moteur, surchargée d’hommes et d’eau embarquée, avant que la houle ne la renverse. C’était un labeur sans fin. Les damnés de la Mer iii tentaient le passage par la mer vers l’île de Lampedusa, distante de seulement 292 kilomètres, et de là la terre promise d’Italie, sachant que les passeurs les abandonneraient, dès les côtes disparues pour repartir à bord de semi-rigides équipés de moteurs flambant neufs pour aller embarquer une nouvelle cargaison humaine. Ils mettaient leurs espoirs dans le secours des navires de la force Triton. Une fois transbordés sur les navires patrouillant les eaux internationales, leurs tourments, ils le croyaient, seraient achevés. Chacun se racontait, pour se rassurer, l’histoire colportée jusqu’au village le plus reculé d’Afrique, d’un cousin qui avait trouvé un havre là-bas, de l’autre côté des mers et qui avait envoyé l’argent pour se faire rejoindre par femme et enfants.
La violence des éléments, la mer furieuse, le vent glacial qui la gelait malgré la parka marine et le gilet de sauvetage, la violence des hommes qui l’avait menée là, elle qui, jeune, avait été une voileuse, monitrice aux Glénans, tout cela l’apaisait. Elle ne ressentait plus que son corps meurtri, bousculé, pris à parti par la lutte du bateau avec les flots furieux. Le calme de John la rassurait. Il avait les yeux tristes, d’une couleur changeante comme la mer. Il ne riait jamais mais souriait tristement quand ils rentraient d’expédition après avoir pêché des hommes iv comme il disait, détournant la formule christique. Lui aussi, il hébergeait un fantôme ; un drame l’avait conduit là à risquer sa vie pour celle des autres. Les militants de l’association Mare nostrum, pudiques, gardaient secrets les raisons qui leur avaient fait quitter le confort des villes d’Europe pour le désert salé. Seuls quelques jeunes, activistes écolos ou anarchistes reconvertis, péroraient sur leurs motivations, l’ordre du monde, les puissants, les salauds… Christine, elle, ne faisait pas de politique. Elle ne prétendait pas changer le monde ; elle cherchait seulement à s’oublier et à se faire oublier du monde. L’humanitaire était son refuge, sa cachette, son exil, sa thébaïde. Anachorète, c’est vivre sans famille, sans toit, seul avec sa peine, c’est une forme de suicide calme, doux, lent. Mystique, elle aurait pu chercher Dieu mais, comme certains Juifs rescapés d’Auschwitz avaient perdu la foi, n’ayant pas comme Job dépassé cette aporie terrible d’un Dieu qui frappait les Justes, le Mal qui l’avait tué au bonheur l’avait détaché du monde mais ce n’était, à la différence du nirvana promis pas le bouddhisme, pas une absence de joie et de peine, c’était un sentiment de vide, de plomb fondu qui lui coulait dans les veines. Damnée, elle s’abandonnait à ce labeur humanitaire pour s’interdire de crier sa peine.
John consulta le GPS du bateau pour vérifier leur position. Dans une dizaine de minutes, il devrait, à l’estimé de leur réserve d’essence, abandonner leur patrouille pour rejoindre leur base de Sfax en Tunisie. La mer était trop forte. Le vent de force 7 ‘grand frais’, menaçant 8 ‘coup de vent’, avait dissuadé jusqu’aux négriers de prendre la mer de peur pour leur propre sécurité. Peur de ne pas pouvoir rentrer au port, peur de ne pouvoir échapper aux navires de haute mer qui traquaient ces pirates modernes. C’est à ce moment que le pilote hurla : « Navire à 3 heures ! ».
Christine tendit son regard sur le tribord du bateau dans la direction indiquée par le matelot. Les crètes des vagues marquaient à peine l’horizon délayé de gris acier et de sépia, qui lui semblait un de ces lavis peints par Victor Hugo à Guernesey. Les creux dévoilèrent un instant une barcasse, qu’agitait tel un ludion, le tapis roulant des vagues précipitées. L’image de La vague, l’estampe de Hokusai, vingt à l’esprit de Christine au spectacle de l’embarcation qui disparaissait puis reparaissait derrière une déferlante. Christine se reprocha ces références artistiques en ces circonstances tragiques, réalisant alors qu’elle était à la fois complètement impliquée dans cette mission de sauvegarde de naufragés et étrangère à ses propres sentiments, dédoublée en quelque sorte par la dureté causée par son immense douleur propre, anesthésiée, incapable de partager les souffrances des autres hommes par son égotique dol. Le dol, une unité de mesure de la douleur créé en 1945. Cette lucidité à évoquer des références culturelles et scientifiques en plein drame humanitaire lui fit honte. Christine décida alors de démissionner de Mare Nostrum et rentrer en France, dès leur retour à la base, car elle ne supportait plus ce qu’elle qualifiait d’hypocrisie, sa présence non engagée ; elle trahissait la confiance des autres militants de l’association, elle occupait indûment une place qu’il lui fallait abandonner pour un(e) autre plus sincère, plus empathique. Sa décision atténua la honte qu’elle ressentait à son coupable détachement mais lui laissa un goût de fiel car elle se sentit encore plus vide de tout amour. Christine ne s’aimait plus ; elle ne pouvait aimer les autres parce qu’elle avait perdu son grand amour, son seul amour.
Pendant ces réflexions, John avait manœuvré vers l’épave à la dérive. Des bras se levaient dans le jour qui tombait, des cris dans des langues inconnus, des pleurs d’enfants maintenant audibles. Ils étaient peut-être vingt ou vingt-cinq naufragés. Le Zodiac ne pouvait embarquer qu’une dizaine de personnes. John ordonna au matelot de prendre la barre et saisit son téléphone satellitaire pour alerter le navire de la force Triton en patrouille quelque part pour leur demander un renfort sur zone. La communication s’établit rapidement avec un interlocuteur au fort accent italien. Dans le crépitement, John donna la position indiquée par le GPS sachant que le courant allait en quelques minutes les éloigner mais le capitaine de l’aviso saurait calculer une estimation de la position de l’embarcation au vu des vents et du courant. Son interlocuteur indiqua ne pouvoir rejoindre la position avant deux heures de temps car il était au large de la côte italienne. Cela laissait une chance, une faible chance car la nuit tombait. John prit sa résolution : sauver dix femmes et enfants et abandonner les hommes, mais aussi des femmes et des enfants à leur sort. Impossible de prendre en remorque le navire chargé de mer. Se mettre à couple avec l’embarcation et se laisser partir au gré du vent les aurait éloigné de la côte tunisienne qu’ils ne pourraient plus alors la rejoindre mettant en danger la vie de son équipage et celle de la dizaine de rescapés qu’il pouvait maintenant, mais maintenant seulement, sauver. Il devait faire ce choix terrible de dix vies à sauver.
Le matelot lança un bout au bateau en panne de moteur. Les rescapés étaient épuisés. Depuis combien d’heures voire de jours avaient-ils dérivé ? Des corps étaient affaissés sur les plats bords, sans mouvement. Un homme pourtant réussit à attraper la corde et à l’arrimer. John mit ses moteurs au point mort et cria en anglais : « Who speaks english on board ? ». Un homme lui répondit. Un jeune homme qui parlait un anglais surprenamment bon. Son accent était oxfordien ! Christine savait que parmi les réfugiés il y avait des paysans, des déshérités mais aussi des cadres éduqués, des proscrits politiques. L’inconnu comprit sans peine la situation. Se tournant vers le reste des passagers, il leur traduisit les paroles de John. Ils ne se révoltèrent pas. Les hommes embrassèrent leurs femmes et leurs enfants et leur ordonnèrent d’avancer vers la vie. Certaines femmes pour sauver plus d’enfants décidèrent de rester à bord aussi. John embarqua les huit enfants du bateau des réfugiés et deux femmes. John transborda au bateau la moitié de ses feux de détresse, expliquant du geste au traducteur comment les allumer. Il lui fit passer également une lampe tempête, un bidon d’eau et les rations dont il disposait. Il donna l’ordre de larguer, se libérant de l’autre bateau, quand l’un des corps inanimés sur le bordage de l’autre bateau bascula, emporté par un paquet de mer. Christine sans réfléchir se précipita à l’eau pour agripper le corps et le maintenir grâce sa propre gilet qui, autogonflant, s’était, en un instant, empli d’air. Le traducteur lui lança le bout qu’elle réussit à attraper d’une main, se laissant hisser à bord avec le noyé. John suivit la péripétie attendant qu’elle soit montée à bord avant de revenir se mettre bord à bord. Il lui hurla de remonter à bord du Zodiac. Christine refusa. Il lui en donna alors l’ordre. Elle refusa à nouveau calmement, lui souriant tristement et faisant signe à une des femmes de monter à sa place sur le Zodiac. John comprit qu’il ne pourrait pas l’obliger à se sauver. Il lui donna alors le téléphone UHF