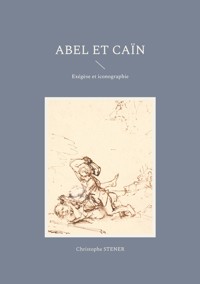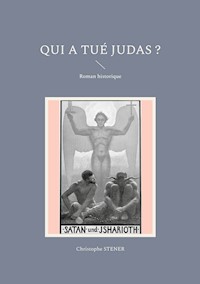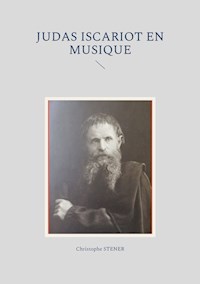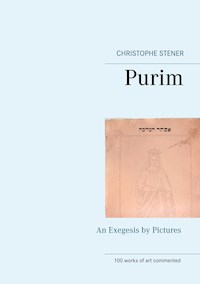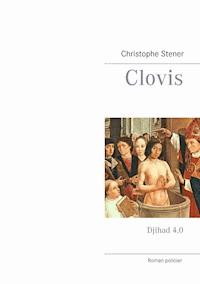Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
Troisième tome de la série Djihad 4.0, 14 Juillet raconte la tentative d’attentat contre le Président François Hollande et le roi d’Arabie saoudite, commis le jour de la Fête nationale française, par un ‘soldat perdu’, de retour de Syrie, au moyen d’un drone chargé de gaz sarin. L’attentat, financé par des rétrocommissions du Fifagate, sera alerté grâce un renseignement fourni par Israël suite à la défection d’un officier iranien impliqué dans le programme nucléaire secret conduit par la Syrie, avec le soutien de l’Iran et de la Corée du Nord. Basée sur des faits historiques, l’intrigue romanesque met en scène le Lieutenant Malik Benamar de la DGSI, héros des deux tomes précédents, Exposée et Double feu, dans une enquête qui le conduira de Paris à la Mecque et à Deir ez-Zor en Syrie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Crédits photographiques
Page de couverture
TV News
Dernière de couverture
Peace for Paris
Dessiné par Jean Julien, dessinateur français résidant à Londres, et partagé via Twitter dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015
Avertissement
Si certains faits et personnages historiques servent de toile de fond aux enquêtes du lieutenant Malik Benamar de la DGSI, celui-ci est un héros romanesque.
Imaginée en 2015, l’intrigue de 14 Juillet 2016 est fictive, comme l’est celle des deux tomes précédents de la série Djihad 4.0 : Exposée et Double feu.
Ce tome peut être lu séparément ; les références aux épisodes des ouvrages précédents sont signalées.
Par convention, il est fait usage du nom Daech, acronyme arabe de l’Etat islamique, sauf dans la bouche des islamistes qui revendiquent le caractère étatique du califat proclamé le 29 juin 2014.
Un glossaire des mots étrangers, des acronymes et des termes technique figure en fin d’ouvrage.
En skat
Sommaire
Prologue - La prise de la Mecque
Orchard
Le soldat perdu
La chambre du fils
Une vie après la mort
Zamzam
Le transfuge iranien
Deir ez-Zor
Anonymous contre Daech
Dabiq
Armageddon Ἁρμαγεδών
Les damnés de la mer
Les attentats du 13 novembre 2015
Fifagate $$$
L’agent sportif
Activation cellule dormante
Gaz sarin C
4
H
10
FO
2
P
Brocéliande
Debrief
Deal DGSI-Mossad
La taupe
Le traitre
Le traître démasqué
La filoche ratée
Le pacte de sang
Diversion
Protocole
Le Crillon
Big data
L’attentat
Epilogue – Légion d’honneur
1 - Prologue
La prise de la Mecque
Ce mardi 1er du mois de Mouharram 1400, le mois considéré par les musulmans comme le plus sacré des quatre mois sacrés, celui qualifié de mubarak (béni), l’Islam entra dans le XVe siècle de l’hégire, le calendrier lunaire musulman, soit le 20 novembre 1979 du calendrier romain. A la Mecque, le hajj (grand pèlerinage), l’un des cinq piliers de l’islam, est achevé depuis trois semaines, mais plus de cinquante mille pèlerins sont réunis dans la Masjid al-Haram (la Mosquée sacrée), la plus grande du monde, au cœur du Haram al-Sharif, le lieu le plus saint de l'Islam, avec, en son centre, la Kaaba où est enchâssée la pierrenoire que les musulmans tentent de toucher au cours des tawaf (circumambulations) durant leur pèlerinage.
A 5:20, Cheikh Mohammed Ibn Soubbayil, l’imam s’apprête à lancer l’appel à la prière relayé par les haut-parleurs des sept minarets quand il est bousculé par un jeune homme, le visage mangé d’une barbe noire, les yeux exaltés qui s’empare du micro et annonce : « Je m’appelle Jouhaymane Al Otaibi. Voici Mohammed Al Qahtani. C’est le Mahdi qui vient apporter la justice sur terre. Reconnaissez le Mahdi qui va nettoyer le royaume de la corruption ! ». A cet appel, deux cents complices, déguisés en fidèles, sortent des armes de guerre jusqu’alors cachées sous leurs gandouras ; quelques tirs ; la plupart des soldats se rallient, un soldat qui fait mine de s’opposer est abattu ; sacrilège du sang répandu dans le lieu de prière.
Du haut du minbar, Al Otaibi se répand en imprécations contre la dépravation de la famille royale des Al Saoud qu’il accuse de livrer la terre sacrée aux occidentaux. Il appelle au ralliement des vrais croyants. Toute la cité sainte entend les imprécations du forcené hurlées dans les hauts parleurs. La foule de pèlerins affolés, loin de répondre à son appel, fuit, paniquée, la mosquée. Les insurgés, pour la plupart des soldats saoudiens entraînés et quelques recrues étrangères, ne gardant qu’une centaine de fidèles en otages, prennent alors position dans la mosquée, postant des tireurs d’élite en haut des minarets.
L’imam, qui a réussi à fuir, a donné l’alarme. On réveille, en son palais royal, le roi Khaled ben Abdelaziz Al Saoud. S’il n’était de santé fragile, le souverain aurait pu se trouver présent à la prière du lever du jour. En l’absence du prince héritier Fahd, à Tunis pour un sommet arabe, et du prince Abdallah, chef de la Garde Nationale, au Maroc, le roi dépêche à La Mecque ses autres frères, Sultan, ministre de la Défense, et Nayef, ministre de l’intérieur, pour coordonner les opérations. Craignant un complot ourdi de l’étranger, le prince Nayef fait couper toutes les communications téléphoniques et télex avec l’extérieur du pays.
Les premiers assauts de la Garde nationale saoudienne, désordonnés, peu volontaires, sont rapidement repoussés par les rebelles, laissant de nombreux soldats loyalistes morts. Pour lever la réticence de certains soldats à combattre dans le Haram al-Sharif, le Saint des Saints de l’islam, le roi Khaled obtient dans la matinée des grands oulémas du royaume une fatwa référençant la sourate II, verset 191 du Coran : « Ne les combattez pas près de la Sainte Mosquée, à moins qu’ils ne luttent contre vous en ce lieu même et, s’ils vous combattent, tuez-les car tel est le châtiment des incrédules ». Les insurgés résistent, arcade par arcade, couloir par couloir, cave par cave, à la prise de la Mosquée. Les assaillants sont repoussés à nouveau.
En Iran, l'ayatollah Khomeini, qui a renversé le régime du Shah le 11 février 1979, installant la théocratie des ayatollahs, affirme lors d'une émission radiodiffusée que les États-Unis sont à l'origine de la prise d'otages. Cette rumeur se propage très rapidement dans l’Islam. À Islamabad, le 21 novembre1979, dès le lendemain de l'attaque, une foule en colère prend d'assaut l'ambassade américaine et la brûle complètement. Une semaine plus tard, une émeute à Tripoli y incendie l'ambassade américaine.
Le roi Khaled appelle au secours américains et français. Le président Valéry Giscard d’Estaing envoie, dès le 23 novembre, par avion Falcon spécial, un commando composé de trois gendarmes du GIGN commandé par le capitaine Barril, commando accompagné de membres du SDECE. Les français sont, formellement, convertis à la hâte pour pouvoir accéder à la Mecque, lieu interdit aux non musulmans. On envisage un temps de noyer les caves où se sont retranchés les terroristes pour les électrocuter avec un câble à haute tension. L’injection de gaz incapacitant, du CB (chlorobenzylidène malononitrile), apporté par le GIGN, dans les souterrains où sont retranchés les terroristes, par des trous perforés dans les dalles de béton, aura raison de l’insurrection.
Dans la nuit du 4 au 5 décembre, Jouhaymane Al Otaibi et cent soixante dix de ses partisans se rendent. Officiellement, cent soixante dix sept rebelles sont morts dans les combats, dont l’éphémère Mahdi, tandis que les forces de l’ordre auraient perdu cent vingt sept hommes. Les pertes réelles sont probablement bien supérieures des deux côtés. On ne connaîtra jamais le nombre exact de pèlerins tués lors des assauts.
Les insurgés survivants sont soumis à la question par les services de sécurité saoudiens. Le 9 janvier 1980, soixante-trois décapitations ont lieu dans huit villes d’Arabie Saoudite.
Ahmed al Rusaed, saoudien, issu d’un clan réputé loyal aux Al Saoud, fut l’un de ces rebelles décapités le 9 janvier 1980. Son frère, Saad al Rusaed membre de la Garde nationale, qui a participé à l’assaut, contraint et forcé, jura de le venger en tuant un membre de la famille royale des Saoud, sang pour sang.
Ce que révèlera l’enquête c’est que, loin de la thèse officielle, la prise de la Mecque n’a pas été organisée par un ennemi extérieur mais par des saoudiens. Le chef de l’insurrection et instigateur du complot, Jouhaymane Al Otaibi, a servi de 1955 à 1973 dans la Garde nationale, la garde prétorienne des Al Saoud. Il est issu du clan Al Otaibi, une importante famille du Najd, qui avec le clan Qahtani dont est issu le prétendu Mahdi, par ailleurs son beau-frère, rejoignirent l’Ikhwan, le groupe de bédouins fanatiques qui soutinrent Ibn Séoud dans sa conquête du trône saoudien en 1902. Les tribus Al Otaibi et les Al Qahtani se révoltèrent ensuite en 1929 contre le roi Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud, dit Ibn Séoud, qu’elles jugeaient apostat à la vraie tradition musulmane, mais elles furent battues lors de la bataille de Sabilla où le Sultan bin Bajad Al Otaibi, grand-père de Jouhaymane, trouva la mort.
Mohammed Al Qahtani, le prétendu Mahdi, est par sa mère, apparenté aux Quraysh, la tribu du prophète. Son prénom, Mohammed, est le bon et la date choisie, symbolique, pour frapper l’imagination des croyants, selon le stratagème de Jouhaymane Al Otaibi qui avait écrit trois ans auparavant : « Même un faux Mahdi vaut mieux qu’un faux imam ».
Les services de sécurité saoudienne, obnubilés par le risque d’irrédentisme chiite dans le royaume, ont complètement manqué à la surveillance de Jouhaymane qui, après avoir démissionné de la Garde nationale, était devenu, à l’université islamique de Médine, l’élève et le disciple de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, le principal chef religieux d’Arabie Saoudite, un intégriste qui professait que la Terre est plate. Jouhaymane s’affilie alors à la cellule médinoise du groupe salafiste Al-Jamaa Al-Salafiya Al-Muhtasiba présidé par le même Ibn Baz, groupe ultra-orthodoxe qui publie des pamphlets contre la famille régnante lui reprochant d’introduire, sous la pression occidentale, des Bid‘ah (innovations) impies : le travail des femmes, la télévision, les shorts des joueurs de football ou encore l’image du roi sur les billets de banque.
Arrêté l’été 1998, avec une centaine d’activistes, le futur rebelle sera libéré sur l’intervention de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, son mentor.
Mahrous Ben Laden, frère de Oussama Ben Laden, le futur fondateur d’Al-Qaïda, qui aurait aidé les rebelles à introduire des armes en utilisant des camions du Saudi Binladin Group (SBG), un leader mondial du bâtiment et de placements financiers, qui conduisait des travaux sur le site, fut arrêté. Mahrous ne sera pas décapité mais libéré de prison en raison des liens étroits unissant les Ben Laden et la famille royale des Saoud. Mahrous, repenti, rejoignit les affaires familiales. Il fut même nommé à la tête de la branche de Médine mais aurait été tenu à l’écart de la direction du groupe car jamais complètement pardonné par le trône. Mahrous remplissait toujours ces fonctions de direction lors du 11 septembre 2001.
Si le Conseil suprême des oulémas, dirigé par Ibn Baz, donna raison au régime saoudien et condamna les insurgés, il obtint, en échange, une série de mesures contre la timide libéralisation qui s'était amorcée en Arabie saoudite.
La levée en masse des musulmans contre le régime saoudien espéré par Jouhaymane ne s’est pas produite mais l’attaque de la Mosquée de la Mecque a semé le grain du terrorisme islamiste :
le régime, soucieux de répondre au risque de prosélytisme des ultra-orthodoxes, donna en effet des gages aux imams tenants d’un wahhabisme sans concessions mais sans réussir à éteindre la critique en pureté religieuse qui fit résurgence le 13 novembre 1995 lors de l’ attentat contre la Garde nationale saoudienne à Ryad, action attribuée à Al-Qaïda; Al-Qaïda, armé par les EU et l’Arabie saoudite lors de la guerre contre l’occupation soviétique de l’Afghanistan de 1979 à 1989, s’était retourné en effet, après la défaite soviétique, contre ses anciens soutiens quand les EU décidèrent de faire obstacle à la prise de pouvoir des talibans alliés d’Al-Qaïda, sans pour autant soutenir le Commandant Massoud, jugé plus acceptable, lequel Massoud sera assassiné par des membres d’Al-Qaïda se prétendant journalistes, le 9 septembre 2001,
le régime saoudien laissera le clergé wahhabite se livrer au prosélytisme religieux en formant des imams salafistes envoyés ensuite en missionnaires dans et hors le monde musulman,
l’Arabie saoudite servit de terre d’exil aux Frères musulmans chassés d’Egypte par le régime de Sadate, lesquels se vengèrent en l’assassinant le 6 octobre 1981,
la présence de non Saoudiens, des Egyptiens, des Yéménites, des Koweitiens, des Irakiens, des Soudanais et même deux Afro-Américains (l’un fut tué, l’autre extradé), dans les décapités, témoigne dès 1979 de la diffusion au monde musulman du terrorisme islamiste salafiste,
Mohammed Islambouli, frère de l'assassin du président Sadate, et futur membre des réseaux d'Al-Qaïda, était à La Mecque au moment des événements et en rapporta le livre d'Utaybi, distribué aux pèlerins bloqués dans l'enceinte sacrée durant les premières heures des événements,
la compromission d’un membre de la famille Ben Laden dans l’opération anticipe sur la création d’Al-Qaïda par Oussama Ben Laden que des membres du mouvement d'Utaybi rejoignirent.
L’année 1979 fut ainsi une année charnière dans le développement du terrorisme islamiste, année ouverte, le 11 février 1979, par la prise du pouvoir de l’Ayatollah Khomeiny en Iran et clôturée par l’entrée des soviétiques, le 24 décembre 1979, en Afghanistan, provoquant le soutien des Etats-Unis et de l’Arabie Saoudite aux moudjahidines d’Al-Qaïda et ce jusqu’à la capitulation russe en 1989.
Si Nayef Al Saoud, le ministre de l’intérieur saoudien fit un communiqué soulignant le courage lors de l’assaut de gardes issus du clan Al Otaibi, il décida néanmoins de remplacer la Garde nationale saoudienne par une nouvelle garde personnelle triée sur le volet. Ce que Nayef ignorait c’est que le cousin de l’un des rebelles, membre de la garde ayant participé à la contre-attaque, choqué par la répression sanglante et sensible à l’appel des insurgés pour un islam purifié, décida de le venger en abattant un membre de la famille royale des Al Saoud. Recruté parmi la nouvelle garde prétorienne du roi, Saad al Rusaed adhéra en secret aux Frères musulmans et escalada un à un les échelons de la hiérarchie jusqu’à devenir le garde personnel du roi. Ce que Rusaed ignorait c’est que le chef de la cellule des Frères musulmans à laquelle il avait adhéré ferait allégeance, sans le dire, au Calife autoproclamé Ibrahim, Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri qui s’autoproclamera Calife Ibrahim sous le nom de Abou Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Qurashi le 29 juin 2014.
Le régime saoudien nourrit ainsi, une vipère aspic, en son premier cercle, cachée dans la garde rapprochée du monarque, comme dans un couffin de dates, un de ces couffins qui avaient servi à dissimuler les armes introduites par les insurgés avant l’assaut et leur avaient permis de tenir un siège de plus de dix jours. Le serpent allait attendre trente-sept ans pour piquer.
En juin 2015, date du début de notre récit, le colonel Saad Al Rusaed avait fait une brillante carrière. Il commandait la garde privée du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud et à ce titre devait se rendre avec lui à Paris pour le défilé du 14 juillet 2016 à l’invitation du Président Hollande, lequel était soucieux de conforter les relations déjà excellentes avec l’Arabie saoudite.
Le Président François Hollande avait été en effet le premier Chef d’Etat occidental invité d’honneur au Conseil de coopération des pays du Golfe du 27 mai 2015, à l’invitation du descendant d’Ibn Saoud, un signal clair de mécontentement à l’égard de l’allié américain, jugé trop timoré dans son opposition au régime de Bachar al-Assad. Cette invitation venait mettre un point d’orgue à la signature de la vente, le 16 février 2015 de 24 avions Rafale à l’Egypte, pour 5,2 milliards d’euros, coût largement financé par l’Arabie saoudite et, le 4 mai 2015, de 24 avions de combat Rafale au Qatar pour une valeur de 6,3 milliards d’euros.
2 - Orchard
En 2006, un officier de haut rang syrien, en voyage à Londres, prit une chambre dans le quartier de Kensington. L’homme laissa imprudemment son ordinateur portable dans sa chambre. Le Mossad força la porte et copia le contenu du disque dur. Les Israéliens découvrirent les plans du complexe nucléaire d’Al Kibar, dans la province syrienne de Deir ez-Zor, avec le calendrier des à diverses phases du projet et une foule de données techniques. Sur l’une des images, le Mossad remarqua la présence d’un Asiatique aux côtés d’un Arabe. Les deux hommes furent identifiés comme étant Chon Chibu, l’un des experts nucléaires nord-coréens les plus éminents, l’autre était Ibrahim Othman, le directeur de la commission de l’énergie atomique syrienne. Une vidéo prise à l’intérieur de l’installation secrète, montrait, selon certains experts américains et israéliens, un réacteur nucléaire sur le modèle de celui de Yongbyon en Corée du Nord. Cette vidéo rendue publique par la CIA en 2008 et présentée aux Nations-Unis ne convainquit alors pas tous les experts mais décida Israël à frapper de manière préventive.
Le 6 septembre 2007, à 12:40, l’armée de l’air israélienne détruisit à Deir ez-Zor un immeuble que le Mossad soupçonnait d’abriter le réacteur nucléaire à but militaire Al-Kibar. Dix ingénieurs nord-coréens auraient été tués dans l’attaque. Le Wall Street Journal du 19 septembre titra « Osirak II ? » par référence au réacteur irakien détruit par Tsahal en 1981. La Syrie déposa une plainte auprès des Nations Unis pour le raid qu’Israël refusa de confirmer ou de nier. Au-delà de cette protestation formelle, la Syrie adopta ensuite un profil bas suite, ne faisant aucune déclaration publique sur le bombardement largement publié dans la presse généraliste et commentée alors abondamment par les spécialistes militaires.
Deux semaines après l’attaque, Pyongyang démentait toute coopération avec la Syrie. Quant à l’AIEA, elle ne confirma pas la présence d’une centrale nucléaire sur le site détruit.
Les spécialistes de guerre aérienne et électronique analysèrent la tactique israélienne pour esquiver la défense anti-aérienne syrienne. Depuis la guerre des Six Jours, la Syrie avait en effet déployé, avec l’aide des soviétiques, une des plus puissantes capacités anti-aérienne du Moyen-Orient. La neutralisation des capacités syriennes débuta par le brouillage électronique puis la destruction, par des bombes à guidage laser ou par des missiles antiradars Harm, du radar syrien situé à Tall al-Abuad près de la frontière turque. Cet destruction du radar permit aux F-15 d'escorte et F-16 d'attaque au sol, appareils non-furtifs, de rester aussi indétectables que possible durant leur trajet aller et retour. Immédiatement après cette attaque initiale de pénétration, la quasi-totalité des stations radars syriennes fut désactivée pendant plusieurs minutes. Cette aveuglement des stations radar fut rendue possible par la grande centralisation, typiquement russe, de la configuration du dispositif syrien et l’usage des bandes HF et UHF, vulnérables au brouillage par déception et cyber piratage. L’IAF (Israel Air Force) recourut à la technologie « Suter », au départ un outil développé par BAE Systems, et notamment intégré dans les drones. Un avion israélien Gulfstream G-550 Etam ELINT, dédié à la guerre électronique, localisa précisément les émetteurs radars syriens, intercepta les signaux inhérents et les renvoya à leurs sources en injectant des flux intoxicateurs de données. Ces données irriguèrent ensuite la boucle interne de surveillance anti-aérienne et établirent une « liaison toxique » qui permit aux Israéliens de littéralement « corrompre » la surveillance antiaérienne syrienne et de falsifier ou d'effacer la signature radar des F-15 et F-16 de l'IAF. Confiants dans le secret entourant la centrale nucléaire, les syriens n’avaient installé aucune DCA qui aurait pu faire repérer les installations par Israel. Le satellite israélien Ofeq-7, lancé le 11 juillet 2007, avait fourni des images avec une résolution multispectrale inférieure à 50 cm qui permirent de caler les guidages laser et GPS des bombes larguées faisant mouche à coup sûr contre l'installation nucléaire syrienne.
A 12:40 l’escadrille israélienne envoya au chef d’état-major de l’armée de l’air israélien, Eliezer Shkedi, le mot de code ‘Arizona’ indiquant le largage de dix-sept tonnes de bombes sur la cible. Shkedi informa immédiatement le Premier ministre Olmert, le ministre de la défense Ehud Barak et Tzipi Livni, la ministre des affaires étrangères qui suivaient l’opération dans un bunker dans l’hypothèse d’une réplique militaire syrienne qui ne se produisit pas. Le plan d’urgence en cas de guerre entre la Syrie et Israël n’eut pas besoin d’être activé, la Syrie ne se livrant qu’à des gesticulations diplomatiques.
Au-delà de la neutralisation de la centrale nucléaire syrienne, Israël avait, par ce raid aérien, adressé un message ‘fort et clair’ à l’Iran. Israël n’hésiterait pas à frapper jusqu’en Iran si sa sécurité nationale était menacée.
Le Lieutenant-colonel Gilal Meyer avait été l’organisateur du raid de 2007. La réussite de l’opération lui valut une promotion éclair au grade de colonel et surtout une proposition pour commander la Sayeret Matkal – le commando de l’état-major, l’unité d’élite qui s’était notamment illustrée lors de la libération des otages israéliens sur l’aéroport d’Entebbe en 1976.
Gilal Meyer n’était pas un sabra. Ses parents avaient quitté l’URSS, Son père Eliezer était un mathématicien de génie qui avait obtenu la médaille Fields, le Nobel de mathématiques car il n’existe pas de Nobel de mathématiques, la raison, probablement légendaire, étant que Alphonse Nobel, l’inventaire de la dynamite, avait été cocufié par le professeur de mathématiques de sa maitresse, Sophie Hess. Le père, profitant de la libéralisation de la période Gorbatchev, avait pu se faire accompagner de sa femme et de son jeune fils, à un congrès de mathématiques à Vienne et de là, il était passé à l’Ouest. Il enseignait à l’université hébraïque de Jérusalem. Sa mère, Sarah, fille et petite-fille de rabbin, était une excellente pianiste et une talmudiste reconnue.
Gilal parlait couramment, outre l’hébreu et le russe, ses deux langues natives, l’arabe et l’anglais. Diplômé d’une maîtrise en physique nucléaire, il fut chargé d’une mission critique pour la sécurité d’Israël : la surveillance des programmes nucléaires secrets des pays arabes.
Le programme irakien, engagé avec le soutien de la France du Président Valéry Giscard d’Estaing, et de son Premier ministre Jacques Chirac, avait été émasculé par le bombardement par l’aviation israélienne du réacteur Osirak, surnommé « O’Chirac » par la presse israélienne, le 7 juin 1981. Les ambitions nucléaires de Kadhafi, conduites malgré la signature du TNP (Traité de Non Prolifération) avec l’assistance du Pakistan et de la Corée du Nord, n’avaient, grâce à l’opération occidentale de renversement du ‘Guide de la révolution’ en 2011, pas eu le temps de se concrétiser. La Syrie, féal de fait de l’Iran chiite, qui bouclait les fins de mois du régime alaouite et sauvé Damas des hordes islamistes par l’envoi de miliciens de la brigade Al-Qods et de soldats du Hezbollah libanais, restait, aux yeux d’Israël, une menace malgré l’opération Orchard. L’Iran restait la menace principale mais l’accord sur la démilitarisation du programme nucléaire iranien, obtenu à l’arraché, le 1er avril 2015, par un Président Barak Obama soucieux de justifier avant la fin de son second et dernier mandat son prix Nobel de la paix, décerné avec bien de précipitation le 9 octobre 2009, obligea le gouvernement de Benyamin Netanyahu à écarter, fort contre son gré, l’option militaire.
Israel qui avait tout fait pour compromettre et retarder le programme nucléaire iranien par des assassinats ciblés d’ingénieurs iraniens et l’infection des centrifugeuses par le virus Stuxnet, conçu de concert par le NSA et l’unité 8200 de Tsahal, actions toujours déniés par l’Etat hébreu, voyait tous ses efforts désavoués par l’allié américain qui pactisait avec le régime des ayatollah qui ne reconnaissait pas l’existence légitime d’Israel et armait à sa frontière le Hezbollah.
3 - Le soldat perdu
Jean Le Drenec avait cru à l’armée.
Gamin, le dimanche, il était fier de trottiner pour suivre le pas rapide de son père, son père, Gwenn Le Drenec, maréchal des logis chef de la Gendarmerie, le ‘margi’ (maréchal-des-logis-chef) comme l’appelait ses subordonnés. Le grand-père aussi avait été gendarme. Cela semblait, chez les Le Drenec, dans l’ordre de choses de donner le fils aîné au service de la nation. Bretonne, la famille comptait aussi des recteurs chez les aïeux mais la religiosité des Le Drenec s’était émoussée avec l’affectation dans des compagnies de gendarmerie cantonnées en Provence - Alpes Côte d’Azur, pays sécularisé. L’armée avait pour politique de muter les gendarmes en dehors de leur pays natal; cela, certes, nuisait à leur connaissance du terrain mais les rendait, estimait la hiérarchie, incorruptibles à d’éventuelles accointances claniques.
Le père emmena Jean, dès ses dix ans, chasser la bécasse comme son père l’avait fait avant lui, et le père de son père. La bécasse, un gibier rare et difficile à tirer, qui partait au dernier moment, sous vos pieds, en volant en rase motte, de biais, qu’il fallait débusquer aux aurores glacées de décembre dans les landes humides. Jean tira ses premiers coups de fusil dés ses quinze ans, n’attendant pas l’âge légal du permis de chasse. Il se révéla un excellent tireur.
La mer manquait à Jean, épuisé par la chaleur de la garrigue de Carpentras où était affecté son père. Heureusement, il y avait les grandes vacances qu’il passait sur l’île d’Arz, chez la grand-mère Le Drenec.
Jean retrouvait ses copains d’une année sur l’autre. Les ramassages de palourdes, les mini régates sur les Hobie Cat, les pèche de nuit, interdites, à la foëne étaient autant de compétition entre garçons. Etait venu le temps des pelotages puis des amours. Les copains d’alors se disputaient les jolies filles de l’île, comptant les touristes comme un gibier saisonnier ne valant pas que l’on se fâche pour elles. Bretons, ils étaient, spontanément, sans réflexion, un peu écologistes, réfractaires aux autorités parisiennes, exaltés par le risque de la mer, snobant les terriens.
Grâce à son bac scientifique, Jean avait été incorporé comme élève sous-officier à l’école de gendarmerie de Tulle. Grand et costaud, il avait postulé après quelques années de service, d’apprentissage routinier, pour le corps d’élite de la gendarmerie, le GIGN qui l’avait fait tant rêver enfant. La sélection était drastique ; moins de un candidat sur deux cents était reçu au sortir d’une éprouvante série de tests physiques et psychologiques. Sa lignée gendarmique, une remarquable performance dans les épreuves sportives et son habilité au tir, l’avaient fait retenir malgré une réserve du psychologue qui avait noté une « fragilité émotionnelle, due à un besoin excessif de reconnaissance, trahissant un manque de confiance en soi ». Le colonel chargé de la sélection finale, était passé outre, mettant ce trait de caractère sur le compte de la jeunesse du candidat, alors âgé de vingt-trois ans, soulignant la notation très élevée du « sens du service » du candidat.
Le GIGN, c’était, pour Jean, un rêve d’adolescent. Les prouesses du capitaine Barril et du commandant Prouteau lors de la libération à Djibouti en févier 1976 des enfants pris en otage dans un car scolaire par des militants indépendantistes du Front de libération de la Côte des Somalis, ou lors de la mutinerie de centrale de Clairvaux en janvier 1977 ou encore lors de la prise d’otage à l'hôtel Feschi en février 1980 en Corse, avaient alimenté les conversations chez les Le Drenec , le dimanche autour de la garbure, sa mère ayant adopté les plats du terroir d’accueil, n’infligeant de breton que le far aux pruneaux au dessert. Son père, Gwenn Le Drenec, soutint mordicus les gradés du GIGN, lors de la polémique en 1982 sur les conditions d’arrestation des irlandais des Vincennes.
« Je voudrais bien les y voir, tous ces jean-foutre ! Si c’était eux qui devaient partir à l’assaut de terroristes planqués dans des immeubles piégés, ils seraient moins flambards, moi, je vous le dis ! » s’exclamait Gwenn Le Drenec en faisant chabrot.
La relaxe du commandant Prouteau prononcée dix ans plus tard, en janvier 1992, fut célébrée chez les Le Drenec comme une reconnaissance trop tardive de l’innocence du commandement du GIGN.
Les chauffards, les voleurs, les criminels et les terroristes constituaient la hiérarchie des ennemis publics, affirmait, péremptoire, le père : « Un chauffard, on lui retire son permis; un voleur, on le met à l’ombre; un criminel, on le met à la chaîne comme un chien enragé; un bon terroriste est un terroriste mort ! »
Jean avait pris longtemps tous ces mâles sentences pour parole d’évangiles. Et puis son père était tellement fier de lui depuis son intégration au sein du GIGN. Qu’il ne puisse pas s’en enorgueillir auprès des collègues, car les affectations devaient rester confidentielles pour des raisons de sécurité, restreignait malheureusement les célébrations au cercle familial.
Jamais le père ne demandait au fils quel avait été son activité passée mais il guettait secrètement, lors des déjeuners dominicaux, devenus trop rares, sur son visage les signes de fatigue. Jean qui avait été un adolescent enjoué était devenu un taiseux au corps sculpté d’un seul bloc de muscles.
Sa mère ne lui posait également aucune question. Il repartait chaque dimanche, docilement, avec le reste de far breton et une bouteille de cidre bouché, « du vrai, pas de la pisse d’âne » selon la scie du paternel. Ses camarades de chambrée bâfraient le far forn (breton) en affirmant, rigolards, que c’était « encore plus énergisant que les rations de dotation » et rotaient le cidre breton qui galéjaient-ils « faisait pisser dru ».
Non, ce qui préoccupait la maman de Jean, c’était son célibat. Jean avait aimé d’un amour désespéré une jeune femme diabétique. Leur idylle avait duré quatre ans. Elle était venue faire un stage aux Glénans, à Arz. D’une blondeur de Rubens, elle en avait les formes généreuses. Les garçonnes moquaient gentiment ses rondeurs. Jean, venu bavarder avec ses copains moniteurs au centre de voile, avait eu le coup de foudre. Son RS 500 étant parqué sur le terre-plein voisin, il croisait la belle flamande quand il descendait ou remontait son skiff lors de ses sorties en mer. Les deux timides se regardaient doucement, sans se parler. Le dernier jour du stage, les monos organisèrent un barbecue avec du punch. Rentrant son bateau, Jean fut invité à manger une brochette et boire un coup. Ils se croisèrent, cognèrent leurs verres en plastique. « Yer’mat ! » dit Jean qui lui expliqua que cela voulait dire « A la vôtre » en breton. Ils parlèrent, parlèrent sans fin, comme des noyés qui reprennent leur souffle. Quand il fallut se séparer, il lui prit la main, ouvrit sa paume et y écrivit au stylo son adresse mail en lui disant : « Voilà; tu m’écris si tu veux; c’est toi qui décides ».
Le frôlement doux de ses doigts sur sa main fut comme le plus doux baiser pour Justine, c’était son prénom, il ne connaissait même pas son nom.
“Deux jours plus tard, il reçut un mail si bref mais qui disait tant. « Je t’aime » écrivait, pudiquement, Justine.
Jean répondit : « Je t’aime ».
Leurs amours débutèrent ainsi et le désir fut beau et la tendresse immense entre ces deux êtres timides et si taiseux avec ce qui n’était pas l’autre. Ils riaient de se tenir la main, de simplement se regarder. Leur lit était un océan qu’ils peuplaient de tempêtes voluptueuses qui les laissait épuisés et sereins, sur le ressac de leur corps satisfaits. Seulement inquiets du plaisir de l’autre, ils voulaient donner avant de recevoir; leurs étreintes étaient longues, douces, prenant souffle comme une mer qui se forme. « Beaufort 8 » disait en plaisantant Jean pour qualifier l’intensité de son plaisir, « Beaufort 11 » répondait en souriant Justine.
Et puis le diabète de Justine s’aggrava. Elle dut bientôt s’autoadministrer des injections d’insuline plusieurs fois par jour. Ils ne devaient plus faire l’amour, avait dit le médecin car cela pouvait provoquer chez elle un collapsus. Elle, plaisantant, disait qu’ils ressemblaient aux amants de Love Story.
« Fais-moi l’amour une dernière fois. Je mourrai dans tes bras » lui demanda-t-elle, mi rieuse, mi sérieuse, lors de ce qui devait être leur dernier week-end.
Jean ne s’était jamais pardonné de ne pas avoir accédé à sa demande et satisfait son ultime volonté. Par amour, il s’était refusé à elle ; par amour, il la perdit loin de lui.
Justine, devenue aveugle, passa les derniers mois de sa vie chez ses parents. Depuis, Jean vivait dans le culte morbide de Justine. Il cachait son insondable tristesse à ses parents. Justine et lui avaient voulu garder leurs amours secrètes, loin du regard blasé des gens normaux qui ne croyaient pas à l’absolu. « Fleur bleu », « un grand gars aussi sain encombré d’une malade », auraient moqué les gens raisonnables.
Ce que Jean ne disait pas non plus à ses parents, c’est que sa vie au sein du GIGN le décevait. « Le GIGN c’est comme l’arme atomique, moins on s’en sert, mieux on se porte » déclarait le Capitaine, chef de peloton, plaisantant leur inaction forcée. Pour ne pas rouiller les mécaniques de compétition de ce corps d’élite, le commandement enchaînait les trekkings de survie en pleine nature, les sauts en rappel sur des murs d’immeubles, les séances de tir instinctif. Mais Jean s’ennuyait sans oser se l’avouer.