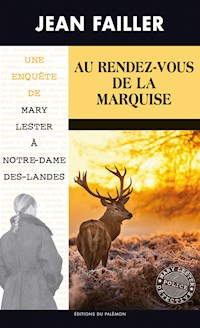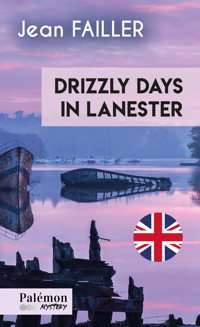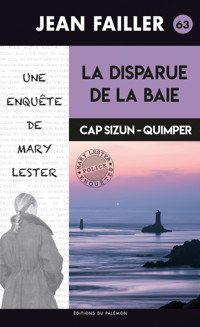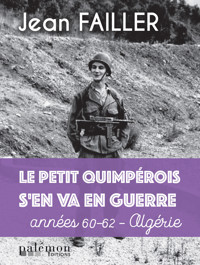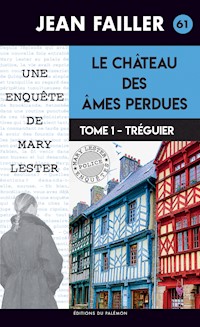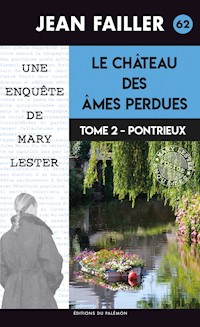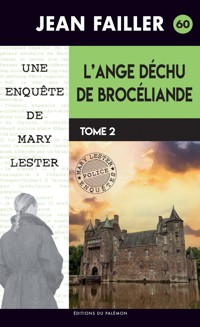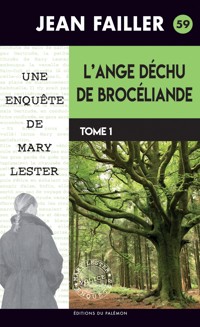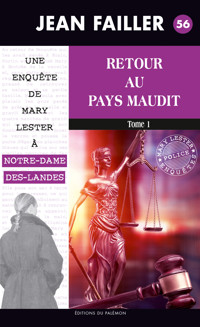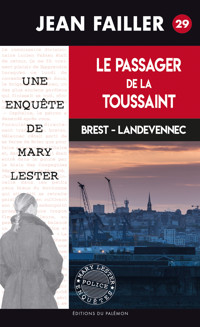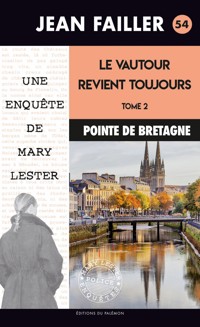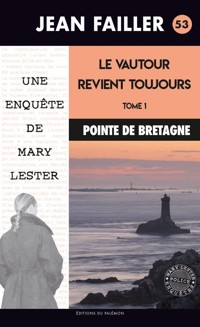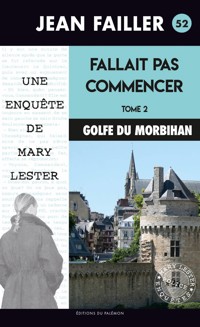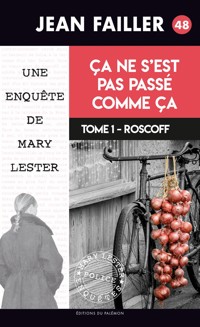
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les enquêtes de Mary Lester
- Sprache: Französisch
Une succession de disparitions tragiques intriguent l'enquêtrice Mary Lester...
Avec la fin de la saison touristique, Roscoff, cet ancien havre de corsaires, retrouve sa quiétude. Cependant, pas de trêve pour les agissements malveillants d'une poignée de malfaisants, au grand dam de Monsieur le maire qui prépare les prochaines élections municipales. Or, voilà qu'en plus, les eaux du port du Bloscon deviennent le théâtre de noyades répétées... "Accident !" conclut à chaque fois, bien rapidement, le chef de la brigade de gendarmerie de la ville. Une telle succession de disparitions tragiques ne peut qu'intriguer le commandant Lester qui ne se fie pas volontiers aux apparences. Détachée à la demande du juge Laurier, et accompagnée de son fidèle garde du corps, le capitaine Fortin, elle va s'installer le temps de l'enquête dans la charmante petite ville de Roscoff.
Découvrez une nouvelle enquête passionnante de Mary Lester à Roscoff, au cœur de la Bretagne, avec ce polar régional empli de suspense !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Le tout est empreint d’un humour subtil, sarcastique, caustique, bon enfant, selon les épisodes et les situations, tout en gardant un esprit pragmatique, cartésien, dans le développement de l’intrigue et la résolution logique de l’énigme. - Blog Les lectures de l'oncle Paul
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Failler est un ancien mareyeur breton devenu auteur de romans policiers, qui a connu un parcours atypique ! Passionné de littérature, c’est à 20 ans qu’il donne naissance à ses premiers écrits, alors qu’il occupe un poste de poissonnier à Quimper. En 30 ans d’exercice des métiers de la Mer, il va nous livrer pièces de théâtre, romans historiques, nouvelles, puis une collection de romans d’aventures pour la jeunesse, et une série de romans policiers, Mary Lester.
À travers Les Enquêtes de Mary Lester, aujourd'hui au nombre de cinquante-neuf et avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus, Jean Failler montre son attachement à la Bretagne, et nous donne l’occasion de découvrir non seulement les divers paysages et villes du pays, mais aussi ses réalités économiques. La plupart du temps basées sur des faits réels, ces fictions se confrontent au contexte social et culturel actuel. Pas de folklore ni de violence dans ces livres destinés à tous publics, loin des clichés touristiques, mais des enquêtes dans un vrai style policier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CE LIVRE EST UN ROMAN.
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
REMERCIEMENTS
Martine Bertéa
Anne Boëlle
Claire Borgo
Jean-Claude Colrat
Delphine Hamon
Lucette Labboz
Meven Le Donge
Myriam Morizur
À MES AMIS
Jean-François Coatmeur
Yves Craff
René Gouzien, « Gary »
Anne-Marie Guyonnet, « Nanou »
Michel Kermarec
Sezny Lansonneur, « Tonton »
Claude Le Loch’
Jean-Claude Müller-Boyer
Jacques Riou, « Jakez »
Chapitre 1
Samedi 2 novembre
Confortablement carré dans un fauteuil de toile, à la terrasse d’un bar faisant face au vieux port de Roscoff, un solide gaillard d’une bonne trentaine d’années considérait d’un œil distrait les promeneurs qui arpentaient le terre-plein menant à l’embarcadère pour l’île de Batz.
Il s’était installé pour déjeuner à la terrasse de la Brasserie de la Mer, un restaurant de belle réputation, situé face au bassin maintenant à sec, où quelques gros bateaux de pêche aux couleurs multicolores reposaient sur leurs béquilles le long de la jetée de granit.
L’été indien se prolongeait au-delà de toute espérance et, en ce début novembre, le soleil brillait comme au plus fort du mois d’août dans un ciel d’azur où couraient de petits nuages blancs, légers comme de la gaze.
L’homme avait consulté la carte que lui avait apportée une jeune serveuse jolie comme un cœur et son choix s’était arrêté sur la côte de bœuf.
La jeune fille l’avait prévenu que ce plat était prévu pour deux personnes, mais il avait argué avec une bonhomie pleine d’assurance :
— T’inquiète pas pour ça, petite, comme disait ma grand-mère, « quand il y en a pour deux, il y en a pour un ».
La fille l’avait regardé avec de grands yeux éberlués. Il en avait souri et, ajoutant à sa confusion, il avait repris :
— Et mon grand-père disait… Tu veux savoir ce qu’il disait, mon grand-père ?
La fille, subjuguée, hocha la tête affirmativement, alors l’homme ajouta sentencieusement :
— Trop n’a jamais manqué !
Après un moment de silence, il s’enquit :
— Tu te demandes pourquoi je te dis ça ? Et, sans attendre la réponse, il précisa : C’est pour que tu ailles en cuisine dire à ton chef que je ne veux pas une petite côte de petit bœuf, mais une vraie grosse côte de très gros bœuf, avec de la béarnaise, beaucoup de béarnaise et, bien entendu, des frites pour deux.
Il avait demandé ça en roulant des yeux féroces, d’une voix caverneuse, une voix d’ogre en quelque sorte.
— Bien Monsieur, souffla d’une toute petite voix la jeune serveuse, impressionnée.
Elle nota avec application la commande sur son bloc et allait s’en retourner, mais l’ogre la retint :
— Attends, ne te sauve pas comme ça, je n’ai pas commandé les hors-d’œuvre…
Il relut rapidement la carte et opta pour une douzaine d’huîtres numéro trois…
Elle nota scrupuleusement et demanda :
— Et comme boisson ?
— Qu’avez-vous comme bière ?
— Un peu de tout, Monsieur. Vous voulez la carte ?
Il regarda la fille avec amusement.
— Qu’est-ce que tu me conseilles ?
Elle hasarda :
— La Coreff ? C’est la bière du pays.
— Alors une chope de Coreff, s’il te plaît.
La jeune fille l’avait regardé avec considération. Ça changeait des touristes anorexiques qui prenaient une crêpe pour deux !
En ces temps de crise où les clients avaient des oursins dans le porte-monnaie, un chaland de cette envergure suscitait le respect.
Elle disparut et revint rapidement poser un demi de bière mousseuse devant Fortin.
Il empoigna le verre qui parut soudain tout petit dans sa grande main.
— Qu’est-ce que c’est que ça ?
— C’est la bière que vous avez commandée, Monsieur !
— J’avais demandé une chope !
Il regarda la jeune fille qui se troublait et précisa :
— Une chope, c’est deux demis !
Il vida son verre d’un seul trait, s’essuya les lèvres d’un revers de main et dit d’un air satisfait :
— Elle est bonne ! Rapporte-m’en une autre, s’il te plaît.
Et il ajouta :
— Mais une grande, cette fois !
La jeune fille retourna dans le restaurant. Elle revint avec une assiette de grosses huîtres, accompagnée d’une corbeille de fines tranches de pain bis, un ravier de beurre salé et une chope qui ressemblait – anse en plus – à une petite barrique.
L’homme grogna de satisfaction en la remerciant. On sentait que c’était sincère. Alors il entreprit de déguster ses huîtres en connaisseur.
Dès lors, plus rien ne sembla exister. La jeune serveuse se retira discrètement.
En dépit du beau temps, il était le seul client à avoir choisi de déjeuner en extérieur. Quand il eut fait un sort à ses huîtres, la jeune fille réapparut.
— Parfait ! s’exclama-t-il. C’était parfait ! La suite !
Elle apporta une assiette entièrement recouverte par une pièce de boucherie de belle épaisseur, et un plat contenant les frites.
— Ma foi, ça m’a l’air très bien, fit l’homme en humant la viande.
Il entreprit de la saler, la poivrer et l’oindre de la sauce béarnaise qui était contenue dans une soupière de poupée, en céramique.
Il menait ces opérations avec une application attentive. Ça avait tout du repas du fauve et on sentait qu’il ne tolérerait pas d’en être distrait.
La jeune fille s’éclipsa.
Lorsqu’elle réapparut vingt minutes plus tard, il ne restait plus de la côte « pour deux » qu’un os sur lequel un chien n’aurait guère trouvé plus que l’odeur de la viande. Sans avoir trop l’air d’y croire, elle risqua :
— Un dessert, Monsieur ?
L’homme regarda sa montre et, considérant sans doute qu’il avait le temps, laissa tomber :
— Pourquoi pas ?
La fille s’empressa :
— Je vous donne la carte ?
Il répondit par une autre question :
— Avez-vous des profiteroles ?
— Oui ! dit la fille en hochant la tête avec conviction. Avec de la chantilly, Monsieur ?
Il haussa ses larges épaules.
— Évidemment ! Des profiteroles sans chantilly, c’est plus des profiteroles, petite ! Va pour les profiteroles… Et il ajouta comme pour lui-même : J’adore les profiteroles !
Il sortit de la poche de son blouson de cuir noir un canif minuscule qui tranchait comme un rasoir et entreprit de tailler une allumette afin de s’en faire un cure-dents. Il apportait à cette occupation une attention extrême et, lorsque le mince morceau de bois blanc lui parut assez effilé, il s’en servit avec une satisfaction manifeste.
Ce n’était pas d’une rare élégance, mais vu la carrure du bonhomme, personne ne se serait risqué à lui en faire l’observation.
Puis il réclama un café que la fille lui servit avec empressement, déploya son journal, L’Équipe, en bâillant et marmonna :
— Qu’est-ce qu’elle fout, la Mary ?
Chapitre 2
Au même moment, « la Mary », alias le commandant Lester, finissait de déjeuner à l’intérieur du restaurant avec monsieur Jacques Kériven, le maire de Roscoff, qui l’avait invitée.
Le premier magistrat de la commune avait de sérieux ennuis avec la corporation turbulente des dockers du port.
— Je ne sais plus quoi faire, avait-il avoué, c’est pourquoi je me suis permis…
Il la regardait avec l’audace des timides, un regard qui lui fit penser à celui d’un certain Henri Coppeau qui était venu solliciter son aide, un soir de novembre, à Quimper.1
Jacques Kériven, maire de Roscoff et conseiller départemental du canton, était la version moderne de ce qu’était, au temps du grand roi, un hobereau de province par rapport à un courtisan de Versailles. Il n’avait rien d’un de ces ténors de la politique formés aux grandes écoles ni de ces « experts » qui pérorent sans vergogne sur les plateaux de télé, qui se fourvoient régulièrement et qui reviennent de semaine en semaine, toute honte bue, asséner avec un aplomb infernal le contraire de ce qu’ils avaient solennellement annoncé la veille.
Mary était en présence d’un sexagénaire au front dégarni, d’aspect plutôt réservé, qui considérait les gens et les choses avec circonspection par-dessus ses lunettes en demi-lune, comme s’il n’attendait que des contrariétés de la part de ses contemporains.
Il portait sans aisance aucune un complet-veston gris de confection, assorti d’une cravate grenat qui tire-bouchonnait un peu. Une tenue de notable, qu’il revêtait comme un déguisement quand les affaires l’appelaient à la mairie et que, de retour à sa ferme, il laissait choir avec satisfaction pour revêtir une combinaison de travail et chausser des bottes.
De son véritable métier, Monsieur le maire était cultivateur. Aurait-il voulu se faire passer pour un intellectuel qu’il n’aurait trompé personne. Ses mains ossues, tavelées, annonçaient sans équivoque l’homme habitué depuis l’enfance aux rudes travaux des champs.
Il ne se risquait d’ailleurs pas à jouer un rôle qui ne lui convenait pas, face à l’élégante jeune femme qui se trouvait devant lui. Il semblait même avoir du mal à trouver une contenance, mais aussi à trouver ses mots.
Mary le considérant avec sympathie, elle tenta de briser la glace :
— Ainsi vous connaissez monsieur Kerloc’h ?
Le visage sévère de son vis-à-vis s’éclaira furtivement.
— Oui… ma femme et la sienne sont parentes. Je ne vous dirai pas à quel degré, mais leurs familles se fréquentaient autrefois.
— Cousines à la mode de Bretagne, quoi !
Monsieur le maire parut satisfait de la formule. Il répéta avec conviction :
— C’est ça, à la mode de Bretagne ! Il nous a raconté les déboires qu’il a rencontrés avec un de ses administrés, nous avouant au passage que sans votre intervention, il ne s’en serait jamais sorti.2 Lorsque je lui ai confié que j’étais un peu dans les mêmes ennuis, il a tout de suite cité votre nom.
— C’est bien aimable à lui, dit Mary, mi-figue mi-raisin, en pensant qu’au train où allaient les choses, elle pourrait bientôt ouvrir une agence de police privée. Alors, que se passe-t-il dans cette bonne ville de Roscoff ?
Machinalement, le maire malaxait une boule de mie de pain entre ses doigts puissants.
— Vous le savez peut-être, notre port a acquis une certaine importance, tant en trafic de marchandises que de passagers. Le monde agricole exporte le plus gros de sa production3 vers la Grande-Bretagne.
— Comme au temps des Johnnies4, lança Mary pour montrer qu’elle n’était pas totalement inculte en matière d’histoire locale.
— Mon grand-père était un Johnnie, annonça fièrement monsieur Kériven.
« Ça y est, il se dégèle… », pensa Mary. Ça devait être l’évocation de ce qui passait, dans ce pays de traditions, pour d’authentiques quartiers de noblesse. Il poursuivit :
— Comme les autres, il traversait le Channel, trimballait sa cargaison d’oignons sur le cadre de son vélo et les vendait en faisant du porte-à-porte en Angleterre. Inutile de préciser que c’était un travail épuisant. Le soir, les Johnnies se retrouvaient dans une grange, faisaient leur petite cuisine sur un feu de bois et dormaient sur la paille.
Mary compatit :
— Ça n’était pas un métier de tout repos !
Le maire acquiesça :
— Certes non, mais c’est du passé, tout a bien changé heureusement ! Les productions se sont diversifiées et le trafic a plus que décuplé. Maintenant, ce sont les ferries qui transportent les légumes par palettes entières.
— C’est donc une part importante de l’industrie locale…
— Oui, avec le tourisme. Des milliers d’Anglais transitent par Roscoff pour leurs vacances, comme des milliers de Français traversent le Channel pour les mêmes raisons.
— C’est pour ça que Roscoff est une ville prospère… Où est le problème ?
— Le problème, ce sont les dockers… Il médita un instant et précisa : Je ne veux pas dire tous les dockers, non. La plupart se comportent normalement.
Mary compléta :
— Seulement, il y a quelques pommes pourries dans le panier, c’est ça ?
— C’est tout à fait ça, confirma le maire.
— Vous les avez identifiés ?
Il eut un pauvre sourire.
— Bien entendu !
— Et vous ne pouvez pas sévir ?
— Sévir contre les dockers ? Le remède serait pire que le mal !
— Vraiment ?
— Vraiment ! Leur esprit de corps est bien connu et toucher à l’un d’entre eux, c’est se mettre toute la corporation à dos. Leur capacité de nuisance est considérable. Imaginez qu’ils déclenchent une grève en pleine saison… Le port serait bloqué, les légumes resteraient pourrir à quai, le flux touristique se tarirait immédiatement… Ça aurait sur l’économie de la région des répercussions incalculables.
Sur le front du maire, des rides s’étaient creusées. Visiblement, ce scénario devait hanter ses nuits.
— Je vois. Alors vous laissez filer ?
— Que faire d’autre ? Les commerçants se plaignent, l’Office de Tourisme et la Mairie sont submergés d’un flot de récriminations. Il montra de la main l’immense terre-plein vide tandis qu’il expliquait : À la belle saison, tout ça c’est recouvert de voitures… Une place est réservée à la manutention et, si un malheureux estivant a le malheur d’empiéter sur cet espace, fût-ce d’une demi-roue, ces salopards s’ingénient à le bloquer, parfois toute une journée.
Mary scruta le grand espace désert.
— Il y a trois voitures garées là-bas…
Elle indiquait le fond du parking, à une centaine de mètres du restaurant où ils étaient.
— Probablement des dockers… dit le maire. C’est leur coin.
— Leur coin ?
— Oui, comme je vous l’ai dit, il y a un espace réservé aux manutentions.
Une silhouette féminine, chargée de paquets, s’approchait des véhicules. Elle s’arrêta devant une Mini crème à toit noir, décontenancée : les deux 4X4 qui cernaient sa voiture la serraient de si près qu’il lui serait impossible d’ouvrir sa portière.
Par comble de malchance, un gros tracteur rouge traînant une remorque s’arrêta juste devant les trois voitures. Cette fois, son véhicule était bloqué.
— Voilà, dit le maire, ce que j’évoquais tout à l’heure.
Mary s’étonna :
— Mais ils vont se déplacer !
— Ça m’étonnerait. Ces minus vont maintenant venir boire un verre ici, à la terrasse, et la pauvre dame va maronner pendant une heure ou deux.
Mary s’indigna :
— Vous n’intervenez pas ?
— Je l’ai déjà fait…
— Et alors ?
— Alors ils auront pris soin de mettre le tracteur en panne et ils ne bougeront pas d’un centimètre.
— Appelez les gendarmes !
— Pff… le temps qu’ils arrivent… D’ailleurs, je soupçonne les gendarmes de les prévenir.
— Qu’est-ce qui se passe dans ce cas ?
— Dans ce cas, quand ils arrivent, toutes les voitures ont disparu, bien évidemment !
Là-bas, il y avait visiblement eu des mots entre les dockers et l’automobiliste, et les dockers quittaient les lieux, laissant la pauvre femme avec ses paquets.
— Qu’est-ce qu’ils font ? demanda Mary.
Le maire soupira :
— Comme je vous l’ai dit, ils vont venir s’arsouiller en terrasse, en jouissant du désarroi et de l’impuissance de leur victime.
« En toute impunité ! » se dit Mary pour elle-même. Elle n’en revenait pas !
Le pronostic du maire était juste. Les ouvriers du port faisaient route vers la terrasse du restaurant où ils se trouvaient.
Un beau trio en vérité : il y avait deux petits trapus dont l’un avait des oreilles décollées et le troisième, une bouille rebondie, qui semblait avoir été piquée par des abeilles.
Mary baptisa immédiatement l’homme aux grandes feuilles « l’Artichaut » et son pendant « le Chou-fleur ». Quant au troisième, c’était une sorte de barrique sur pattes, grand, gros et chauve, qui marchait en se dandinant, les bras écartés du corps.
Tous les trois portaient leur salopette bleue comme un uniforme.
Choisissant une table en terrasse, ils s’installèrent confortablement dans les sièges de rotin et commandèrent des consommations.
Parvenant mal à dominer sa colère, l’élégante quinquagénaire, qui les avait suivis, demanda avec une politesse presque excessive :
— Pourriez-vous déplacer votre tracteur, s’il vous plaît ? Je voudrais récupérer ma voiture…
Le gros avait pris l’air matois d’un coq de village.
— Vous ne voyez pas qu’on est occupés !
— Vous êtes occupés ? répéta la dame, décontenancée.
Contre toute vraisemblance, le gros homme affirma avec une belle assurance :
— Oui, on travaille, nous !
— Vous travaillez ? s’étonna la dame en croisant les bras.
Visiblement, la moutarde commençait à lui monter au nez. Elle hocha la tête, désemparée devant une pareille mauvaise foi.
— Je vois… dit-elle.
— Vous voyez quoi ? demanda le bonhomme, goguenard.
— Je vois que j’ai affaire à de gros travailleurs ! Mais qu’importe, cela vous autorise-t-il à bloquer ma voiture ?
Visiblement, le gros homme était le meneur. À ses côtés, ses deux comparses ricanaient servilement. Il répondit d’un ton rogue :
— Vous n’aviez pas à vous garer sur une place interdite !
La dame répéta, incrédule :
— Interdite ?
Le gros confirma :
— Parfaitement ! Vous êtes garée à un endroit réservé aux manutentions et nous, c’est là qu’on travaille.
La femme objecta :
— Il n’y a pas de pancarte le signalant.
— Si Madame, dit le gros en montrant un tout petit panneau de stationnement interdit situé à vingt mètres de là. Vous ne savez pas lire ?
— Mais je ne suis pas arrivée par là ! protesta la dame. Je venais de l’autre côté, de la chapelle, et il y avait déjà des voitures en stationnement.
— Ouais, ce sont les nôtres.
— Parce que vous avez droit de vous garer et moi pas ?
— Exactement !
Le gros, les bras croisés sur sa bedaine, avait pris un air important.
— C’est réservé aux ouvriers du port.
— Et vous en faites partie ?
— Exactement !
— Donc ma voiture vous gênait ?
— Elle ne nous gênait pas, mais elle aurait pu ! fit remarquer finement un de ses acolytes.
— Eh bien, je vais l’enlever, comme ça, elle ne vous gênera plus !
— Vous l’enlèverez quand on voudra, fit le gros, soudain mauvais. On n’est pas en vacances, nous, on bosse !
— Je vois ça, redit la dame en regardant les verres ostensiblement.
Elle sortit son téléphone portable de sa poche et forma un numéro ; elle était dans un tel état d’exaspération qu’elle dut s’y reprendre à deux fois.
— Vous appelez les gendarmes ? fit le gros, ironique.
— Que voulez-vous que je fasse d’autre ? Que j’attende votre bon vouloir ?
— Vous allez ramasser un PV pour stationnement interdit.
— Je cours le risque, dit-elle, sarcastique. Je redoute moins les gendarmes que trois ivrognes.
L’Artichaut se redressa.
— Holà, dit-il en prenant les autres à témoin, c’est qu’elle nous insulte, la bourge !
— Laisse tomber, dit le gros, si elle croit que c’est comme ça qu’elle va nous amadouer… Il défia la dame, ironique : Eh bien, elle se goure !
Puis s’adressant à sa malheureuse victime, il la nargua :
— M’est avis qu’vous êtes là encore pour un petit moment, ma bonne dame…
1. Voir Le testament Duchien, même auteur, même collection.
2. Voir Te souviens-tu de Souliko’o ? même auteur, même collection.
3. Artichauts, choux-fleurs, pommes de terre, salades.
4. Les Johnnies étaient ces jeunes paysans qui, quelques décennies plus tôt, franchissaient la Manche pour aller vendre des oignons en Angleterre.
Chapitre 3
À quelques tables de là, le capitaine Fortin avait suivi la scène et il commençait à trouver que les zigues poussaient le bouchon un peu loin. Il se redressa, avec l’intention d’intervenir lorsque son téléphone sonna.
Fronçant les sourcils, il décrocha et entendit un commandement impérieux :
— Bouge pas, Jipi !
Il avait immédiatement reconnu la voix du commandant Lester.
Il hoqueta :
— C’est toi, Mary ?
— Qui veux-tu que ce soit ?
— Tu as vu ça ?
— Oui, j’ai vu, et c’est pour ça que je t’appelle.
— Je vais leur raboter la gueule, à ces connards ! gronda le grand.
Il entendit son interlocutrice protester :
— Surtout pas !
Il s’indigna :
— Tu veux que je les laisse faire ?
— Ne bouge pas, je te dis ! Je m’occupe de tout ! J’arrive, et on ne se connaît pas. Pigé ?
— Gigo ! dit le grand.
En langage de voyou, ça voulait dire « oui ».
Il raccrocha, résigné. Qu’est-ce qu’elle était encore en train d’inventer, celle-là ?
Le maire, qui avait suivi cette conversation avec stupéfaction, la regardait, éberlué.
Elle se leva.
— Excusez-moi de vous planter là, Monsieur le maire, mais l’occasion se présente de régler l’histoire qui vous préoccupe, il ne faut pas la laisser passer…
Ce dernier s’inquiéta.
— Qu’est-ce que vous allez faire ? demanda-t-il, angoissé.
Elle le rassura sans développer davantage :
— Ne vous en faites pas et ne vous en mêlez pas. On se retrouve à la mairie tout à l’heure ?
Sans attendre la réponse, elle dévala l’escalier qui menait à la terrasse et vint vers la dame qui paraissait au bord des larmes.
— Que se passe-t-il, Madame ?
— On m’a bloqué ma voiture ! dit-elle d’une voix étranglée.
Elle montra son téléphone.
— Je n’arrive pas à avoir la gendarmerie, ils sont sur répondeur !
Soudain, elle éclata en sanglots.
— Qui a bloqué votre voiture ? demanda Mary Lester.
Elle hoqueta :
— Eux, là !
Elle désignait le trio qui ricanait en se balançant des coups de coude.
Mary s’approcha des trois hommes.
— Peut-on savoir à quoi vous jouez ? lança-t-elle.
Le Chou-fleur la toisa.
— De quoi qu’elle se mêle, celle-là ?
Elle lui répondit par une autre question :
— Pourquoi avez-vous bloqué la voiture de cette dame ?
— Qu’est-ce que ça peut te foutre ? répondit élégamment le Chou-fleur tandis que l’Artichaut bredouillait :
— C’est un sta… un stationnement interdit.
Les mots trébuchaient dans sa bouche, indiquant que les apéros commençaient à faire leur œuvre.
— Et alors ? Vous êtes chargés de faire la police ?
Il répéta, vindicatif et suffisant :
— La police… La police… On ne va pas la déranger pour ça, la police !
Le Chou-fleur tapa du poing sur la table, en faisant sauter les verres.
— Y en a marre d’être emmerdés par des connards de bourges Parigots en vacances ! Ça lui fera les pieds !
— S’il y a des connards ici, regardez dans la glace, vous en verrez trois, de catégorie supérieure !
Le gros fit mine de se lever.
— Qu’est-ce qu’elle a, cette pisseuse ? Tu te prends pour qui, connasse ?
Un autre bredouilla :
— Elle nous… elle nous insulte ! Puis, brandissant la main, il la menaça : Tu veux que je t’en colle une ?
— Je vous en dissuade… dit-elle sans le quitter des yeux.
Sa voix était aussi glaciale que son regard. Dompté, le bonhomme se rassit et quêta du regard, auprès de celui qui paraissait être le chef de cette bande de Pieds Nickelés, un conseil sur la conduite à tenir.
Mary rompit car elle sentait Fortin prêt à bondir et elle ne voulait surtout pas d’une bagarre générale. Elle toisa les trois ivrognes qui la contemplaient d’un air méfiant, semblant se demander à qui ils avaient affaire, avant de leur jeter, méprisante :
— Vous êtes non seulement de grands travailleurs, mais aussi de grands courageux ! Persécuter une femme seule… Il en faut, du cran ! J’admire !
Forts de leur position, les trois corniauds ricanaient sans faire mine de bouger. La dame tremblait d’indignation. Son visage décomposé trahissait sa tension et Mary eut peur qu’elle ne se trouvât mal. Elle la prit par le bras, la soulagea de ses paquets et proposa :
— Si vous voulez bien, je vais vous reconduire chez vous. Vous viendrez récupérer votre voiture lorsque ces abrutis auront libéré la place, ce qui ne saurait tarder.
L’homme à la tête d’artichaut dit, narquois :
— J’t’en foutrai, moi, des abrutis… T’es pas près de récupérer ta caisse !
Il regarda ses acolytes d’un air triomphant, comme s’il venait de faire un trait d’esprit, et chercha leur soutien :
— Pas vrai, les gars ?
Les deux autres acquiescèrent mollement.
« Merde, se dit Fortin, la Mary qui cale ! Il doit se passer quelque chose… »
Elle disparut avec la dame. La DS 3 était garée dans une rue adjacente ; elle installa sa passagère qui continuait de se moucher et lui demanda d’attendre un peu. Elle rappela Fortin :
— Cool, Jipi, cool !
Il n’était pas dans les habitudes de Mary Lester de céder à ce genre de rigolos. Il s’indigna :
— Tu te dégonfles, Mary ?
— Pas du tout ! fit-elle sèchement.
Il proposa :
— Tu ne veux vraiment pas que je leur tire les oreilles ?
Elle répliqua catégoriquement :
— Certainement pas !
Elle savait que si Jipi s’amusait à « tirer les oreilles » de ces voyous, c’est dans le fond du port qu’ils allaient finir de cuver leur pastis. Et comme la marée était basse… Elle lui ordonna même :
— Tu vas leur payer un coup !
— Quoi ?
L’indignation du grand n’était pas feinte.
— Je te dis que tu vas leur payer une autre tournée.
— Ben merde !
— Il n’y a pas de merde qui tienne ! Fais-les boire !
— Je crois qu’ils ont leur dose ! dit le grand.
— Tu m’as entendue ? insista-t-elle.
Il remarqua :
— Toi, tu as une idée derrière la tête…
— Il y a de ça, reconnut-elle, mais pour qu’elle aboutisse, il faut que tu sois très gentil avec ces connards.
Elle répéta sa recommandation :
— Fais-les boire…
Fortin sourit :
— Ce ne sera pas ce qu’il y a de plus dur…
— Alors, exécution !
Elle raccrocha et revint vers la DS dans laquelle la dame s’épongeait les yeux.
Mary prit le volant et la reconduisit chez elle.
— Maintenant, dit-elle, coupant court à ses remerciements, je retourne au port chercher votre voiture et je vous la ramène.
— C’est vraiment trop gentil, souffla la dame en lui tendant les clefs de l’Austin.
Mary lui adressa un clin d’œil complice.
— Entre femmes, il faut bien se soutenir !
Pendant que Mary et la « bourge » échangeaient ces mondanités, Fortin fulminait : « Ce qu’il ne faut pas faire dans ce putain de métier tout de même ! », mais, patelin, il adressa un sourire complice aux vaillants dockers qui fêtaient leur victoire, et fit admiratif :
— Ben vous, on peut dire que vous n’avez pas peur !
Le gros se frappa la poitrine du poing, tel un gorille affirmant sa toute-puissance sur sa tribu.
— Peur des Parigots, nous ? Manquerait plus que ça !
Ses deux assesseurs, le Chou-fleur et l’Artichaut, ricanaient bêtement.
— J’comprends, dit Fortin de son air le plus niais. Mais des fois, ce genre de gonzesse, ça a des relations…
— Qu’est-ce qu’on en a à foutre de ses relations, à cette pétasse ? beugla le gros, bravache. Hein, les gars, qu’on n’en a rien à foutre ?
— Hon hon ! acquiescèrent les deux abrutis à tête de légume.
Le Chou-fleur balbutia :
— On est des dockers et si on se fout en grève, tout ça, c’est bloqué ! D’un ample geste du bras, il désigna le port, l’embarcadère, la criée, puis menaça : Alors, faut pas nous faire chier ! Plus de légumes, plus de crabes, plus de poisson, plus de touristes, bordel de merde ! Et regardant fièrement le gros type, il se rengorgea : Pas vrai, Bébert ?
— Tu l’as dit, bouffi ! fit le nommé Bébert qui connaissait ses classiques.
Puis il considéra la carrure de Fortin avec respect.
— T’es qui, toi ?
Fortin baissa la tête.
— J’suis pas d’ici, je viens de Rennes. J’suis au chômedu.
— Tu faisais quoi ?
— J’travaillais dans le bâtiment. Conducteur de bull. Mais le contrecoup5 m’avait dans le collimateur, alors je lui ai botté le cul. Pas de pot, il paraît que je lui ai pété le coccyx. Résultat des courses : il ne peut plus s’asseoir et moi, le singe m’a lourdé. Faute lourde, qu’il a dit.
— C’est pas de bol, compatit Bébert tandis que Chou-fleur ricanait :
— Faute lourde, t’es lourdé… Y a rien à dire !
Il leva son verre en direction de Fortin et lui proposa en guise de consolation :
— T’en prends un ?
Le grand hocha la tête.
— C’est pas de refus !
Bébert commanda à haute voix :
— Quatre pastis, et que ça saute !
La serveuse, qui jusque-là avait eu les yeux de Chimène pour le capitaine Fortin, tourna la tête d’un air de dire : « C’est bien la peine d’être aussi costaud pour s’écraser devant ces voyous ! » Cependant, elle apporta les verres d’anis et Fortin trinqua avec le trio, puis s’extasia encore, de son air le plus niais :
— Putain, qu’est-ce que vous lui avez mis à cette bourge !
Il posa son verre et ajouta :
— Et l’autre, la petite gonzesse, c’était qui ?
— J’en sais rien, dit Bébert en séchant son verre d’un trait, j’en sais rien et je m’en fous. Elle a bien fait de se tirer avant que je lui en retourne une ! Il ajouta, sentencieux : J’aime pas les pisseuses qui la ramènent…
— La femme… bredouilla l’Artichaut, la femme elle a qu’à rester chez elle ! Comme j’dis toujours, la femme au f… foyer !
Le Chou-fleur ajouta, ce devait être une plaisanterie convenue entre eux :
— Et l’homme au bi… bi… bistrot !
Devant ce trait d’esprit, Fortin se joignit à l’hilarité générale. Puis, comme il se doit, il remit sa tournée, et les deux hommes-légumes montrèrent qu’ils connaissaient les usages en remettant la leur.
Ce jour-là, les arbustes en pot qui bordaient la terrasse du bar du port furent arrosés au pastis car le grand y versa subrepticement les verres que lui apportait une serveuse aux lèvres pincées, qui paraissait de plus en plus écœurée par le tour que prenait l’affaire. Les autres étaient vraiment trop bourrés pour s’apercevoir de quelque chose.
Enfin, Bébert se leva en vacillant :
— On n’a pas que ça à foutre, les mecs, faut ramener le tracteur au dépôt !
Le Chou-fleur consulta sa montre et constata avec une gravité d’ivrogne :
— Ça va faire une plombe qu’on est en heures sup’ !
Les trois « ouvriers du port » finirent par regagner leurs véhicules en tirant des bords. Bébert se hissa péniblement sur le siège du gros tracteur rouge. Le moteur vrombit, crachant un épais nuage de fumée noire et, un 4X4 devant, un autre derrière, la caravane s’ébranla.
Elle n’alla pas loin : au sortir du parking, deux véhicules de gendarmerie vinrent bloquer le passage. Quatre gendarmes en sortirent et trois d’entre eux se dirigèrent vers les engins immobilisés. Chacun d’entre eux, après un bref salut réglementaire, annonça :
— Contrôle de gendarmerie, veuillez couper le contact et présenter les papiers du véhicule !
À quelques pas de là, se faisant toute petite derrière une poubelle, Mary filmait la scène avec son téléphone.
Bébert voulut forcer le passage.
— Ça va pas ? Vous ne voyez pas qu’on est des ouvriers du port ? On ramène le tracteur au dépôt !
— Vous le ferez plus tard, dit le gendarme qui l’avait pris en charge, en attendant, veuillez présenter vos papiers !
— Mais qui c’est, celui-là ? éructa Bébert.
Le gendarme se présenta avec une politesse exquise :
— Adjudant Dieumadi, gendarmerie nationale.
— Pfff… marmonna avec une moue méprisante le Chou-fleur qui avait baissé la vitre de sa portière, il n’est même pas d’ici !
— Vous faites sans doute allusion à la couleur de ma peau ? demanda le gendarme d’une voix dangereusement douce.
Il était en effet d’une belle couleur café au lait.
Bien qu’il eût le cerveau embrumé par l’alcool, le Chou-fleur sentit le vent du boulet. Il bredouilla piteusement :
— Non, non… C’est juste qu’on connaît tous les gendarmes dans le coin et…
— Et vous ne me connaissez pas.
Le Chou-fleur baissa la tête.
— C’est ça, acquiesça-t-il en faisant le gros dos.
— Je viens de Guyane, Monsieur. Et, au cas où vous l’ignoreriez, la Guyane, c’est aussi la France.
Les Pieds Nickelés se regardèrent, perplexes. Visiblement, ils n’étaient pas plus calés en géographie qu’en histoire.
Le gendarme haussa les épaules et d’une voix ferme, il commanda :
— Maintenant, et je ne le redirai pas, veuillez couper le moteur et descendre du véhicule !
L’homme fort de la bande regimba :
— Descendre ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’on a fait de mal ?
— On ne vous accuse de rien, fit le gendarme, nous allons simplement procéder à un contrôle d’alcoolémie. Il n’est pas nécessaire d’avoir commis une infraction pour être contrôlé.
— Mais…
Bébert était désarçonné. Puis la fureur l’emporta :
— Moi, me faire contrôler par ce… par ce macaque !
Le visage du gendarme devint gris, mais il parvint à maîtriser sa colère. Il ordonna à ses hommes :
— Ça suffit ! Embarquez-moi ces messieurs !
Empoigné par deux vigoureux gaillards, le colosse fut conduit sans ménagement dans le fourgon de la gendarmerie.
Devant cette démonstration de force, penauds, le Chou-fleur et l’Artichaut le suivirent sans faire d’histoires.
— Fin de l’épisode ! dit Mary en coupant son appareil.
Elle regarda les deux véhicules bleus s’éloigner avec un mince sourire.
Lorsqu’elles eurent disparu, Fortin s’approcha.
— À quoi on joue ?
— À calmer les ardeurs de ces trois salopards. Il paraît qu’ils pratiquent ce petit jeu depuis pas mal de temps. Le maire venait juste de m’en parler et, comme il craint leur pouvoir de nuisance, il n’est pas intervenu à ce jour. Quand il m’a montré leur manège, j’ai eu peur que tu n’interviennes un peu… comment dire… virilement.
— J’allais leur péter la gueule, ouais, dit le grand, vindicatif.
Elle hocha la tête.
— C’est bien ce que je pensais ! Et elle martela : C’était justement ce qu’il ne fallait pas faire, Jipi ! Cette fois, ils vont passer quelque temps à l’ombre et, avec les chefs d’inculpation qu’ils ont sur les cornes, ils auront du mal à faire croire à la répression syndicale.
Fortin renifla, ne cherchant pas à argumenter contre ce que venait de dire le commandant Lester. Il se contenta de poser sa sempiternelle question :
— Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?
Elle lui montra les clefs de l’Austin.
— J’ai promis à Madame de lui ramener sa voiture. Allez, tu me suis…
Il prit les clefs de la Citroën de Mary et soupira, résigné :
— OK.
Ce qu’il appréciait avec le commandant Lester, c’est qu’il n’avait pas à se creuser les méninges. Elle ordonnait, il exécutait. « Une équipe parfaitement rodée », comme se plaisait à dire le commissaire Fabien, leur patron.
Mary se casa à grand-peine dans la petite Austin qui était bien plus luxueuse que celle qu’elle avait eue autrefois, tandis que Fortin prenait le volant de la DS 3.
Puis il la suivit jusqu’au domicile de la dame et, tandis que Mary pénétrait dans la propriété et rejoignait la maison sur une allée de gravier blanc, il stationna entre les deux piliers de l’entrée.
La dame les attendait sur le perron, elle paraissait avoir retrouvé son calme.
— Pardonnez-moi, dit-elle, je ne me suis pas présentée. Je suis madame Chapelain.
S’attendait-elle, à l’énoncé de son nom, à une réaction de Mary Lester ? Mary ne broncha pas. Elle inclina la tête en une sorte de petit salut et se présenta à son tour :
— Mary Lester, enchantée !
Un instant déconcertée, madame Chapelain se reprit et demanda :
— Comment cela s’est-il terminé ?
— Vos trois persécuteurs ont été embarqués par les gendarmes.
Madame Chapelain hocha la tête en silence puis guida Mary jusqu’à une belle maison qui faisait face à la mer.
— Donnez-vous la peine d’entrer…
Mary, avec un sourire, obtempéra.
La jolie madame Chapelain était habillée d’un tailleur gris ; elle avait négligemment jeté un foulard Hermès sur son épaule et arborait aux pieds de superbes Louboutin.
Tout ce que Mary Lester adorait !
Elle ouvrit sa porte et s’effaça avec la condescendance d’une châtelaine recevant une parente pauvre.
Mary remarqua qu’elle avait les pommettes trop tendues pour que ça soit naturel. Vue de près, la dame accusait plutôt une bonne soixantaine de printemps, ce qui la menait pas loin de l’automne. Sa bouche, aux lèvres trop pleines pour n’avoir pas été retouchées elles aussi, avait les commissures tirées vers le bas dans un pli d’amertume.
Mary eut le fâcheux sentiment que c’était là une invitation de convenance, comme on aurait dit à un livreur qui venait de décharger une corde de bois : « Allez donc à la cuisine, mon brave, la cuisinière vous servira un verre de vin… ».
Le regard de la femme s’était arrêté sur la voiture où Fortin attendait, ses grandes mains posées sur le volant.
— Votre ami n’entre pas ?
— Il est timide, dit Mary.
— Timide, avec une pareille carrure ?
— Eh oui, dit Mary sans donner plus d’explications.
— Dommage… dit madame Chapelain avec un petit air équivoque.
Apparemment, cette dame aimait les beaux mâles, surtout quand ils avaient trente ans de moins qu’elle.
Jipi, lui, humait l’air comme un épagneul : ça sentait le fric, le gros fric. Une odeur qui le laissait toujours terriblement méfiant. Le gravier blanc des allées était trop parfaitement ratissé, les haies trop bien taillées, le gazon trop bien tondu… Et puis, cette putain de tire…
Fortin s’y connaissait mieux en bagnoles qu’en procédure pénale et avait immédiatement repéré la Bentley. Une grosse. Et il l’avait chiffrée : au moins trois cent cinquante plaques… Ça n’était pas son monde…
Chez lui, ce qui tenait lieu de gazon était une sorte de prairie tondue deux fois par an et bordée de poteaux de ciment soutenant des fils de fer sur lesquels madame Fortin faisait sécher sa lessive.
Quant à la barrière de bois qui fermait le domaine, il fallait l’actionner à la main, mais elle était presque toujours ouverte. Avec lui, les dames Chapelain qui voulaient jouer les cougars tombaient sur un bec !
— Tout rentre dans l’ordre, dit Mary. Votre voiture est intacte et les méchants sont à l’ombre.
Madame Chapelain ne paraissait pas d’humeur aussi légère.
— C’est vous qui avez prévenu les gendarmes ? demanda-t-elle.
— Oui Madame.
— Vous êtes plus chanceuse que moi ! dit celle-ci d’un air pincé. Je n’ai eu qu’un répondeur.
Mary ne jugea pas utile de lui avouer qu’elle connaissait le gendarme Dieumadi qui lui devait sa promotion au grade d’adjudant.6 Le Guyanais lui avait adressé des remerciements chaleureux lorsqu’il avait été nommé à Saint-Pol de Léon. Il savait bien à qui il devait cette promotion-éclair…
— J’ai également eu le répondeur à Roscoff, mentit-elle, alors j’ai sollicité la gendarmerie de Saint-Pol de Léon. Ils étaient là dans les dix minutes qui ont suivi.
— Je n’y avais pas pensé, reconnut madame Chapelain. Il est vrai que j’étais tellement énervée !
Elle indiqua une porte à double battant, aux vitres biseautées.
— Si vous voulez venir par là…
Sur ses pas, Mary traversa un vaste vestibule lambrissé de bois sombre ; un large escalier, impeccablement ciré, menait aux étages. Une grande salle de séjour s’ouvrait sur la mer par de larges baies. Le sol était parqueté de chêne à bâtons rompus et le plafond à la française laissait voir des poutres et des solives, en chêne elles aussi.