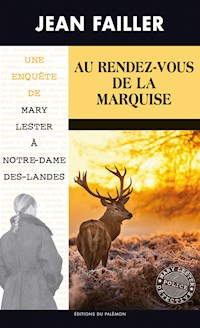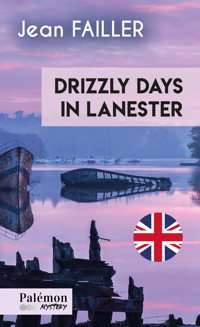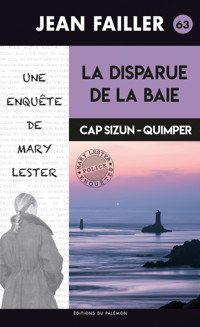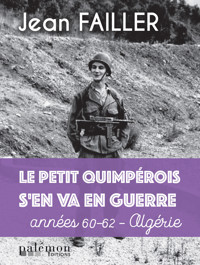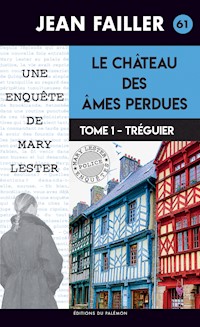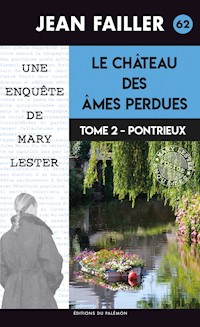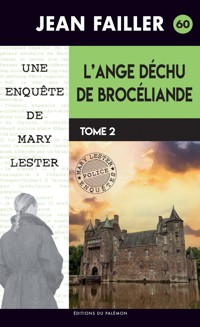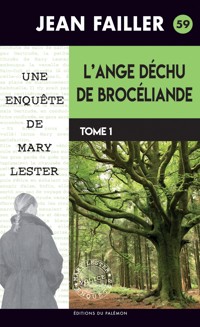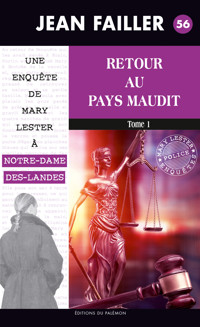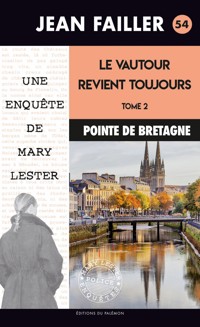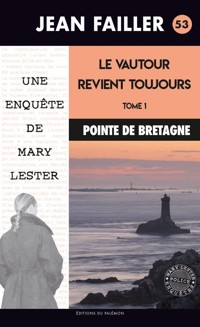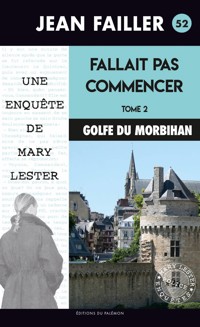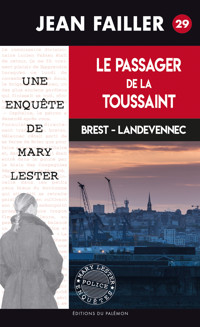
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les enquêtes de Mary Lester
- Sprache: Französisch
Le passé finit toujours par nous rattraper...
De retour à Quimper après une longue convalescence, le commissaire Fabien me confie une bien étrange mission : rencontrer un magnat du commerce qui aurait des ennuis. Le genre de job que j’affectionne, comme vous le savez…
Mais voilà, ce Monsieur m’est recommandé par un ponte de la place Beauvau, l’ineffable commissaire Mervent, devenu bras droit du ministre de l’Intérieur. Pour faire preuve de bonne volonté, car Mervent m’a rendu un signalé service lors d’une précédente enquête, je décide de rendre visite à monsieur Pinchard en son domicile de Landévennec.
Celui-ci me révèle que son fils Matthieu, condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son meilleur ami et en fuite depuis sa condamnation, vient d’être retrouvé. Où s’était-il caché pendant ces quinze ans ? Tout simplement à quelques encablures du domicile de son père, au monastère de Landévennec où il était connu sous le nom de « Frère Grégoire ». Tout est rocambolesque dans cette histoire, depuis la mort de Jacques Courtois, l’évasion de Matthieu Pinchard et même son arrestation à Brest vingt ans plus tard par le plus grand des hasards. Moi, vous me connaissez, dès qu’il y a mystère, il faut que je voie l’envers du décor.
De Landévennec à Plougastel-Daoulas, du port de commerce de Brest au quartier de Pontanézen, c’est en long en large et en travers que je vais arpenter cette mystérieuse rade. Et je ne serai pas déçue ! Vous non plus, j’espère !
Cordialement vôtre,
Mary Lester
Cette fois, c’est au tour de la capitaine Lester de prendre les commandes de la narration pour nous offrir un récit d’enquête haut en couleur !
EXTRAIT
— Capitaine, le patron a demandé après vous.
Formulation directement traduite du breton. Mélennec n’était sorti de sa ferme de Briec que pour faire son service militaire et, dans la foulée, il était entré dans la police par le biais des Compagnies Républicaines de Sécurité.
J’avais cru voir une étincelle dans les petits yeux bleus du bonhomme qui attendait sa retraite paisiblement en cultivant son jardin, un embonpoint prospère et une trogne fleurie. D’ailleurs, au passage, il m’avait balancé un clin d’œil complice et il avait prononcé « Le Patron » avec une emphase telle qu’on devinait une majuscule à l’article comme on le fait lorsqu’il s’agit d’une divinité.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
C'est agréable de se balader avec Mary dans les rues de Brest la blanche […] C'est donc à la fois une jolie balade et une énigme bien mystérieuse à découvrir. - Gouelan, Babelio
À PROPOS DE L’AUTEUR
Cet ancien mareyeur breton devenu auteur de romans policiers a connu un parcours atypique !
Passionné de littérature, c’est à 20 ans qu’il donne naissance à ses premiers écrits, alors qu’il occupe un poste de poissonnier à Quimper. En 30 ans d’exercice des métiers de la Mer, il va nous livrer pièces de théâtre, romans historiques, nouvelles, puis une collection de romans d’aventures pour la jeunesse, et une série de romans policiers, Mary Lester.
À travers Les Enquêtes de Mary Lester, aujourd'hui au nombre de cinquante-neuf et avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus, Jean Failler montre son attachement à la Bretagne, et nous donne l’occasion de découvrir non seulement les divers paysages et villes du pays, mais aussi ses réalités économiques. La plupart du temps basées sur des faits réels, ces fictions se confrontent au contexte social et culturel actuel. Pas de folklore ni de violence dans ces livres destinés à tous publics, loin des clichés touristiques, mais des enquêtes dans un vrai style policier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JEAN FAILLER
Le passager
de la
Toussaint
BIBLIOGRAPHIE
CE LIVRE EST UN ROMAN
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres,
des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant
ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
REMERCIEMENTS
Anne Boelle
I
Le commissaire divisionnaire Lucien Fabien était de retour. Ça me fit vraiment plaisir de l’apprendre lorsqu’en ce lundi de novembre humide et doux, le brigadier Mélennec, un des plus anciens gardiens qui finissait sa nuit, m’interpella à mon arrivée au commissariat :
— Capitaine, le patron a demandé après vous.
Formulation directement traduite du breton. Mélennec n’était sorti de sa ferme de Briec que pour faire son service militaire et, dans la foulée, il était entré dans la police par le biais des Compagnies Républicaines de Sécurité.
J’avais cru voir une étincelle dans les petits yeux bleus du bonhomme qui attendait sa retraite paisiblement en cultivant son jardin, un embonpoint prospère et une trogne fleurie. D’ailleurs, au passage, il m’avait balancé un clin d’œil complice et il avait prononcé « Le Patron » avec une emphase telle qu’on devinait une majuscule à l’article comme on le fait lorsqu’il s’agit d’une divinité.
Pendant l’indisponibilité du commissaire Fabien, les « en tenue », comme les officiers, avaient eu à subir un fonctionnaire détaché du ministère. Il avait sévi le temps que le patron se relève d’une délicate intervention chirurgicale.
On n’aurait pas aimé le garder, ce commissaire Mervent !
Pendant les deux mois qu’avait duré l’intérim, il s’était montré pointilleux à l’excès pour des détails qui n’en valaient pas la chandelle et incompétent pour les affaires plus sérieuses.
Comme aurait dit Talleyrand, « souvent insuffisant mais toujours suffisant ». Une formule qui allait comme un gant à ce technocrate tombé dans la police par les hasards conjugués d’une ambition démesurée et des disponibilités ministérielles.
Bref, tout le monde était ravi d’en être débarrassé. Et comme dans ce pays, la peau d’âne prévaut sur l’expérience, Mervent, diplômé de l’ENA s’il vous plaît, avait retrouvé une nouvelle fonction plus digne de ses ambitions au ministère. Il allait pouvoir y grenouiller allègrement avec d’autres arrivistes de son acabit.
« Qu’importe où il sera, avait soupiré Fortin en apprenant son départ, du moment que c’est loin de chez nous… » Opinion qui faisait l’unanimité du personnel au grand complet.
Je toquai à la porte directoriale et j’entendis avec bonheur sa voix, toujours sèche et brève :
— Entrez !
J’obtempérai et considérai avec ravissement le commissaire divisionnaire Lucien Fabien assis derrière son bureau.
— Patron ! m’exclamai-je, ce que ça fait plaisir…
Il se leva et vint à ma rencontre :
— Plaisir partagé, Mary !
Je serrai sa main maigre et nerveuse et nous nous secouâmes le bras pendant une poignée de secondes.
— Vous semblez être en pleine forme, mentis-je.
— C’est ce que m’ont dit mes médecins, répondit-il avec un sourire en forme de rictus. Et comme ils s’y connaissent beaucoup mieux que moi…
Il me présenta une chaise et retourna s’asseoir. Le commissaire Fabien, petit par la taille, n’avait jamais eu de problèmes de surpoids. Cependant je le trouvais amaigri, un peu voûté, comme s’il s’était recroquevillé sur lui-même. Des poches bleuâtres sous les yeux marquaient un visage où l’os saillait sous la peau ; ses doigts, toujours en action, semblaient chercher quelque activité. Les traces jaunes de nicotine qui les tachaient avaient disparu.
— Je vois que vous avez renoncé à fumer, bravo !
Il regarda sa main droite, frotta son pouce contre son index et dit d’un air mi-figue mi-raisin :
— Rien ne vous échappe, n’est-ce pas ?
Il haussa les épaules, fataliste :
— Prescription formelle de la faculté, avec madame Fabien pour veiller à leur bonne exécution.
— Ça ne rigole pas !
— Comme vous dites.
Il balaya son bureau des yeux, s’attardant sur la bibliothèque contenant les ouvrages de droit reliés en cuir, puis des affiches subversives datant de mai 1968 qu’il avait fait mettre sous verre et pendre aux murs, ce qui surprenait toujours le visiteur non averti.
Il hocha la tête :
— Je ne sais pas si vous êtes si contente que ça de mon retour, mais moi je revis. Si vous saviez ce que j’ai pensé à ce bureau sur mon lit d’hôpital !
— Et si vous saviez ce que tout le monde ici a pensé à vous pendant l’intérim du commissaire Mervent !
— Vous aussi ? demanda-t-il à brûle-pourpoint.
— Surtout moi, acquiesçai-je.
— Je n’en crois rien, dit Fabien, l’air sceptique. Il paraît qu’au ministère, Mervent ne tarit pas d’éloges à votre sujet.
J’en restai muette.
Il me considéra, amusé :
— Ça semble vous surprendre !
— Ça me surprend tellement que je n’en crois pas un mot.
En prononçant ces paroles, je n’étais pas tout à fait honnête ; j’avais fait en sorte de mettre ce Mervent honni de tout le commissariat dans ma poche, car l’expérience m’a prouvé qu’il n’est jamais inutile d’avoir une relation haut placée dans un ministère.1
— Vous avez tort, Mary, vous vous trouveriez bombardée commandant un de ces jours, que ça ne me surprendrait pas.
Il me regardait avec, aux lèvres, un mince sourire ironique.
— Vous plaisantez, patron !
— Pas du tout, pas du tout ! Mervent a l’oreille du ministre et…
Je le coupai :
— Et il n’espère tout de même pas que je vais le rejoindre place Beauvau ?
— Et pourquoi pas ? Savez-vous combien d’officiers se damneraient pour entrer au ministère ?
— Je n’en fais pas partie ! fis-je avec conviction.
Et j’ajoutai :
— D’ailleurs, je n’aurais aucune compétence pour ce genre de boulot.
Je n’ajoutai pas que je n’avais aucune dilection pour la vie parisienne, mais c’était pourtant la vraie raison de mon hostilité à cette idée. À vrai dire - mais ce n’est pas une opinion administrativement recevable -, je trouve que, pour mon goût, Paris est bien trop loin de la mer.
— Ce n’est pas rédhibitoire, dit Fabien, l’incompétence pour faire carrière dans les ministères semblerait même être un atout.
Je souris à mon tour :
— Ça, ce n’est pas politiquement correct, patron !
Fabien eut un geste de main et un mouvement des lèvres explicites.
— À mon âge, dit-il d’un ton las, je ne me soucie plus d’être politiquement correct, ni même d’être bien en cour. Je suis au taquet2, Mary, qu’est-ce qu’on peut me faire, me mettre à la retraite ? Tôt ou tard, il faudra que j’y aille.
Il me regarda avec un sourire triste :
— Je suis une vieille bête fourbue qui a suffisamment tiré sur la charrette pour se permettre de ruer encore une fois ou deux dans les brancards.
Oh là, il avait le moral dans les chaussettes, papy, comme aurait dit Fortin. Il était temps de le secouer :
— Quel égoïsme, m’exclamai-je ! Et nous alors ?
Il fit mine de s’étonner :
— Vous ? Qui, vous ?
— Eh bien les gars du commissariat ! Voyez pas qu’on nous colle un autre Mervent ? Ah, on serait bien !
Il se mit à rire de bon cœur, comme si mes propos l’enchantaient, ce qui était d’ailleurs probablement le cas.
— Votre confiance m’honore, Mary.
Et il ajouta, rêveur :
— Et comme elle me fait du bien !
Il rêvassa un moment sur son futur qui approchait dangereusement vite. Adopterait-il un petit chien pour aller le promener matin et soir ? Irait-il jouer aux boules avec d’autres retraités ? Je le voyais mal dans cette situation.
Peut-être que madame Fabien le pousserait à acheter un camping-car pour mener ses vieux os au soleil d’Andalousie pendant les mois d’hiver. Ils stationneraient sur un parking près d’autres ci-devant importants, occupant leurs loisirs à comparer les avantages respectifs de leurs maisons roulantes avant de sortir le barbecue et les fauteuils de toile pour boire l’anisette. Madame Fabien lui ferait sa petite soupe et lui compterait ses petits granules homéopathiques et ils mangeraient en tête-à-tête en regardant leur petite télévision.
Je me retins de sourire, mais ça n’avait rien de drôle.
Franchement, je ne voyais pas le patron dans ce rôle-là non plus. Sa place était ici, derrière ce bureau, dans ce commissariat ! Je ne l’imaginais pas ailleurs.
Pas plus que moi-même je ne m’imaginais ailleurs.
Nous étions restés silencieux quelques instants et il n’était pas difficile de comprendre que nos pensées avaient suivi le même cours.
Je finis par m’exclamer :
— À chaque jour suffit sa peine, patron ! Que nous réserve celui-ci ?
Il descendit de sa rêverie et soupira :
— Ah… Ce jour d’aujourd’hui comme disent les imbéciles…
Ses yeux se perdirent dans le vague si bien que je me demandai si ce bon commissaire avait totalement évacué les produits anesthésiants qu’on lui avait injectés dans les veines. Il répéta :
— Ce jour d’aujourd’hui…
Puis il s’esclaffa :
— Quelle expression idiote !
Il me regarda alors comme si je venais d’entrer dans la pièce.
— On vit une drôle d’époque, Mary !
Je faillis m’exclamer : « À qui le dites-vous ! », mais je me retins. Le commissaire poursuivit :
— Des gens puissants semblent penser qu’on peut utiliser la police nationale à des fins personnelles.
Je fronçai les sourcils :
— Qu’entendez-vous par là ?
— Ce que j’entends par là, c’est qu’un foutu épicier en gros, vous savez ces types qui ont des usines à vendre de tout dans la périphérie des villes…
— Un propriétaire d’hypermarché ?
— Ouais, et pas des moindres ! Un de ces types, qui importe de la camelote chinoise par cargos entiers et qui fait là-dessus des profits indécents, semble avoir des ennuis.
— Et alors ?
— Alors, il souhaiterait que vous vous penchiez sur ses petits problèmes.
— Moi ? demandai-je en ouvrant de grands yeux. Qu’ai-je à faire des ennuis de ce monsieur ? Et comment…
— Comment a-t-il eu vent de votre existence ? Vous ne devinez pas ?
Un rideau se déchira devant mes yeux. Je m’exclamai :
— Mervent !
Il ironisa :
— Quelle perspicacité ! Ce bon Mervent a été particulièrement impressionné par votre habileté à retrouver l’assassin du fameux Bouboule.3 Et également par la manière dont vous avez rendu la petite Tristani à sa mère.4 C’est ça ? C’est bien ça ? Tristani ?
Je la jouai modeste :
— Bof, ce n’était pas un exploit, patron.
— Exploit ou pas exploit, vous avez permis à Mervent de briller auprès du préfet, et comme je crois qu’il y avait également un ministre dans le coup…
— Le ministre de la mer, en effet, un ami personnel de madame Tristani.
— Voilà pourquoi le zigoto s’est retrouvé en si bonne place à l’Intérieur. Conseiller particulier du ministre, ce n’est pas rien !
Je regardai le patron en souriant :
— Et je parie qu’il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
— Exactement. Les dents lui poussent, à ce petit gars. Il les avait déjà longues, mais un jour, rien qu’en baissant la tête, il va rayer le parquet ! Môssieur se voit déjà Calife à la place du Calife.
Je fis remarquer :
— Pour ça, il faudrait peut-être qu’il soit élu !
Fabien approuva :
— Exactement ! Et c’est là qu’intervient le roi du discount. Il détient le nerf de la guerre, l’argent.
— Je vois, dis-je. Donc Mervent, pour avoir accès au trésor, fayotte auprès de l’industriel.
Fabien hocha la tête affirmativement :
— En gros, c’est ça !
Je m’appuyai à deux mains sur les rebords de ma chaise et me redressai.
— Et vous entrez dans ce jeu ? Je croyais que vous étiez « au taquet » - pour reprendre votre expression - et que vous n’en aviez rien à faire du politiquement correct !
Il me regarda droit dans les yeux et répéta pratiquement ma phrase, en l’agrémentant au passage d’un terme que je n’avais pas osé utiliser :
— Je suis au taquet, et je n’en ai rien à foutre du politiquement correct, de Mervent et du marchand de nouilles !
— Alors, expliquez-moi ?
— J’ai pensé que ça vous amuserait.
— Trop aimable ! Vous savez bien, patron, que lorsque la politique se mêle des affaires de police ou de justice, ça ne donne jamais rien de bon.
— Sauf quand la policière s’appelle Mary Lester, dit-il avec un sourire sibyllin.
Je le regardai sans répondre. Quel rôle voulait-on encore me faire jouer ? J’avais été si bien manipulée par Mère Marie-Madeleine de la Contrition, lors d’une précédente enquête5, que j’étais devenue méfiante.
Le sourire de Fabien s’élargit :
— Vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangée ?
— C’est un peu ça, dis-je.
— Le mieux est peut-être d’y aller voir ?
Je plissai les yeux, circonspecte :
— Je ne peux pas en savoir un peu plus avant d’y aller voir, comme vous dites ?
Le commissaire hocha la tête :
— Il s’agit d’une vieille histoire dans laquelle s’est trouvé impliqué le fils Pinchard.
— Pinchard ! m’exclamai-je, rien que ça ?
C’était là le plus gros et le plus redoutable poisson de cette famille de requins qui régente le commerce moderne en Europe.
— Rien que ça ! Je vois que ça vous dit quelque chose.
— Évidemment !
Comment l’oublier, celui-là ? Ses enseignes brillaient haut et loin dans toutes les cités commerciales de France et d’Europe.
Je demandai :
— Et quand j’aurai vu, comme vous dites, aurai-je le choix ?
— Absolument ! dit le commissaire. Vous accepterez ou vous refuserez.
— Si je refuse, vous m’en tiendrez rigueur ?
Il leva les mains en un geste de protestation excessivement emphatique :
— Moi ? Certes pas !
Après un temps de silence, il ajouta :
— Cependant, Mervent sera déçu.
— Mervent, Mervent, bougonnai-je, s’il savait…
Fabien me coupa :
— Chut ! fit-il tendant les mains devant lui d’un air de dire : « Je ne veux pas entendre ça ».
Puis il ajouta :
— Je vous affecterai simplement à une autre mission.
— Une enquête ? demandai-je méfiante.
— Tout de suite les grands mots, dit le commissaire. Dans la police il n’y a pas que des enquêtes à faire. Il faut aussi accomplir des besognes administratives.
Je soupirai :
— Comme les statistiques sur la délinquance…
— Oui, ah… ça, c’est tous les mois. Je suis heureux de voir que vous ne les oubliez pas, ces statistiques !
« Vieil hypocrite » pensai-je. Ses yeux bleus riaient, il paraissait assez fier de lui. Son séjour à l’hôpital ne semblait pas avoir affecté son machiavélisme atavique.
— D’ailleurs, maintenant que nous disposons d’un petit génie de l’informatique, poursuivit-il, tout ceci devrait être plié en deux temps trois mouvements.
— En deux temps trois mouvements, marmonnai-je entre mes dents, c’est ça. Et qui lui fournira les données, au petit génie informatique ?
Il articula :
— Son supérieur hiérarchique, évidemment !
— Et, comme par hasard, ce supérieur hiérarchique ne peut être que le capitaine Lester.
— N’est-ce pas vous qui avez intrigué pour que ce Passepoil Albert soit affecté chez nous ?
Je n’allais pas me défausser sur Fortin, qui était le vrai responsable de cette affectation, car Passepoil, dans une enquête précédente6, s’était montré d’une redoutable efficacité. Cependant le mot « intrigué » me défrisait. Franchement, vous qui me connaissez, est-ce dans mes manières d’intriguer ? Encore que…
Le patron pressa le mouvement :
— Alors, qu’est-ce que vous décidez ?
— Il habite où, votre marchand de nouilles au mètre cube ? demandai-je.
— Pas très loin, vous ne risquez pas de vous perdre.
— Mais encore ?
— Landévennec, vous connaissez ?
— Chez les moines ? m’exclamai-je, manquait plus que ça !
— Je savais bien que votre mysticisme naturel se réjouirait de cet environnement, jubila-t-il.
Mon mysticisme naturel… Que ne fallait-il pas entendre !
— Où est le dossier ? demandai-je agacée.
Fabien souriait, ravi de m’avoir bousculée.
— Il est déjà sur votre bureau, Mary.
Je me levai en secouant la tête, tout était déjà manigancé avant que j’arrive.
Je pris un air pincé en me levant :
— Merci patron !
— Vous pouvez me remercier, en effet, dit Fabien, il y a une promotion au bout de cette affaire si vous savez la mener avec votre doigté habituel.
Je haussai furieusement les épaules et Fabien sourit de plus belle. Il savait le peu de cas que je faisais de cet avancement qui fait courir les fonctionnaires et qui, inexorablement, me mènerait derrière un bureau comme le sien si je n’y prenais garde.
1. Voir Bouboule est mort, même auteur, même collection.
2. Expression courante dans la police indiquant qu’on ne peut plus prétendre à une autre promotion professionnelle.
3. Voir Bouboule est mort, même auteur, même collection.
4. Voir Ça ira mieux demain, même auteur, même collection.
5. Voir Ça ira mieux demain, même auteur, même collection.
6. Voir Ça ira mieux demain, même auteur, même collection.
II
En quittant Quimper, il y a deux itinéraires pour aller à Landévennec : la route touristique par le magnifique village de Locronan, Plonévez-Porzay, Sainte-Marie-du-Menez-Hom, Argol et enfin Landévennec. Inutile de vous dire que c’est la voie que je préfère tant elle est belle et, hors la saison touristique, peu fréquentée.
L’autre consiste à emprunter la voie express Quimper-Brest et à tourner au Faou pour suivre le fond de la rade de Brest par la corniche, puis traverser le vieux pont suspendu de Térénez qui enjambe le lit de l’Aulne. C’est la voie la plus rapide et elle ne manque pas de charme non plus. C’est donc celle que je choisis pour aller rencontrer Gaston Pinchard, le célèbre industriel qui avait requis ma présence à Landévennec.
Après avoir franchi le pont suspendu, la route se faufilait dans les bois. Entre les branches des arbres dépouillés de leurs feuilles, j’apercevais le plan d’eau qui scintillait sous le soleil. Je m’arrêtai un instant près d’un petit belvédère aménagé à flanc de colline pour que le promeneur puisse admirer le panorama.
Au milieu de l’eau, comme un grand radeau circulaire, une île couverte de conifères. En contrebas, le cimetière de bateaux. Plusieurs navires de guerre peints en gris M297 flottaient de guingois au bout de leurs chaînes, tels des bêtes harassées et résignées en attente d’abattoir.
À main droite, une route menait au monastère, mais ce n’était pas là que j’allais. Je poursuivis ma descente vers le bourg de Landévennec, passai devant l’église de pierres jaunes et continuai vers le port.
Un grand parking bordait la mer. En retrait, derrière de hauts murs de pierre masqués par des hortensias arborescents, s’élevaient de nobles demeures aux volets clos.
Seule la plus importante d’entre elles, une bâtisse de pierres grises, semblait habitée.
Une colonne de fumée montait d’un tas de feuilles mortes, mêlant son âcre odeur aux fortes senteurs du varech desséché. Dans ce jardin aux allures de parc, quelques beaux spécimens de palmier prospéraient, ainsi que d’autres plantes exotiques que je ne pus identifier, probablement rapportées par un marin passionné d’horticulture au retour d’une lointaine expédition coloniale.
La marée basse découvrait des étendues de vase noire, le haut de la grève était caillouteux. Quelques barques reposaient sur leurs béquilles et un semblant de digue au béton verdi par les algues s’avançait vers la mer.
C’est au pied de cette digue que, quinze ans plus tôt, on avait découvert le cadavre de Jacques Courtois, un jeune homme de vingt-quatre ans, fils d’un commerçant aisé de Châteaulin qui possédait une maison de vacances à Landévennec.
La tête du cadavre portait des ecchymoses suspectes, mais l’enquête avait révélé des traces d’eau salée dans les poumons de la victime, ce qui prouvait que Jacques Courtois avait succombé par noyade.
À l’époque, l’enquête avait conclu à la culpabilité de Matthieu Pinchard, l’inséparable ami de Jacques Courtois, et il avait été condamné à vingt ans de réclusion par la cour d’assises du Finistère.
Peu après Matthieu Pinchard s’était évadé dans des conditions rocambolesques pendant son transfert à la prison de Brest et n’avait jamais été retrouvé jusqu’à ce jour où… Mais n’anticipons pas.
Landévennec est un village paisible comme on en compte plusieurs sur les bords de la rade de Brest. Ce qui lui vaut sa notoriété, c’est le monastère fondé par saint Gwénolé, compagnon du roi Gradlon au cinquième siècle de notre ère.
De nos jours on visite les ruines de l’ancien sanctuaire que guerres et pillages n’ont pas épargné. Il ne subsiste plus de l’édifice que des pans de murailles au granit gagné par les mousses et les embryons de massives colonnes de pierre s’élevant à quelques mètres du sol.
Les moines d’aujourd’hui se sont installés dans des bâtiments neufs au-dessus de ces vestiges et les croyants du monde entier viennent avec ferveur y suivre les célébrations religieuses.
Le bourg s’étend le long d’une rue principale à flanc de coteau coupée par des chemins de traverse qui mènent à la mer. On n’y compte en hiver que quelques douzaines d’habitants.
J’y trouvai un Hôtel des Flots Bleus (fermé pour travaux) dans lequel monsieur Hulot n’aurait pas été dépaysé s’il y était venu en vacances, une épicerie municipale, une crêperie (fermée elle aussi) et deux restaurants dont la spécialité était les moules-frites. L’un d’eux, bien que désert, paraissait ouvert.
Dans le village, certaines maisons portaient plusieurs siècles d’existence sur leurs toitures aux grosses ardoises, creusées par le temps. Les autres, sans grand intérêt architectural, étaient pour la plupart construites en petites pierres appareillées, dans le style des années trente. Gravé dans des plaques de marbre verdi scellées sur les piliers d’entrée, on lisait le nom de ces maisons : Villa sans soucis, Les Mimosas, Ker Angèle… Toute une époque.
L’époque où les « congés payés » venus de Brest ou de Châteaulin en tandem considéraient ces bâtisses de riches avec respect.
La journée tirait à sa fin ; le soleil pâle de novembre déclinait rapidement derrière les bois défeuillés et une brume froide semblait monter du sol. Tout soudain, l’atmosphère se glaçait. Je frissonnai.
Pas folichon, ce lieu, du moins en cette saison. En été ce devait être nettement plus gai.
La mer remontait, poussant des petites vagues crêtées d’écume sale sur la vase et les mouettes s’étaient rassemblées le long de la digue, dans l’attente, sans doute, d’un hypothétique pêcheur qui jetterait des tripailles de poisson à l’eau.
Je craignais fort que cet espoir ne fût déçu, apparemment il n’y avait aucun bateau en vue.
Sur le terre-plein du port, un camping-car s’était installé pour la nuit.
La demeure de monsieur Pinchard n’était autre que celle qui avait les fenêtres ouvertes, celle où la vie transparaissait au travers d’un feu de feuilles mortes. Ker Manech’, ainsi s’appelait cette grande maison austère que son propriétaire aurait voulu faire passer pour un manoir. Mais alors un manoir de création récente, devant dater, comme les autres maisons, de l’entre-deux-guerres. Il y avait un portail fraîchement peint en bleu. Je sonnai, ce qui déclencha l’allumage d’une lampe que je n’avais pas vue. Une voix d’outre-tombe me demanda ce que je voulais. Je me présentai :
— Capitaine Lester, pour monsieur Pinchard.
Il y eut un temps de silence pendant lequel je sentis qu’on me scrutait, puis la voix grésilla dans l’appareil scellé dans le mur : « Un instant ». Ce fut plus qu’un instant, je crus qu’on m’avait oubliée, mais alors que j’allais sonner une nouvelle fois, j’entendis des pas sur le gravier de l’allée. Une clé joua dans la serrure d’une petite porte latérale et je me trouvai en présence d’une femme vêtue d’un sarrau de nylon, paraissant âgée d’une bonne cinquantaine d’années. Elle me détailla longuement des cheveux aux chaussures.
— Bonjour madame, lui dis-je.
Elle hocha la tête sans répondre et me fit signe d’entrer. De nouveau j’entendis la clé dans la serrure, puis la femme me précéda en traînant ses sabots de bois et je la suivis.
L’allée, garnie de cailloux blancs, était admirablement ratissée, les pelouses admirablement tondues, et pas une feuille morte ne traînait sur le gazon, ce qui était un exploit en novembre, surtout dans une propriété entourée de hautes futaies de chênes et de châtaigniers.
Devant la maison, le sol était empierré de pavés de granit probablement arrachés aux ruines de chapelles perdues dans les bois.
La femme ouvrit la porte, peinte en bleu elle aussi, et m’introduisit dans un hall dallé de larges pierres, probablement de la même provenance que celles de la terrasse, puis dans une pièce de séjour où mon petit appartement aurait tenu tout entier. Il y régnait une douce chaleur avec une odeur de fumée à peine perceptible. Ici, le sol était parqueté de chêne et, sous la table monumentale - provenant probablement de quelque monastère tombé en déshérence -, on apercevait un somptueux tapis oriental. Dans la cheminée, monumentale, brûlait un feu de bûches et, devant ce feu, paraissant se chauffer les fesses, se tenait un grand vieillard aux cheveux blancs dont les grandes mains ossues étaient refermées sur le pommeau d’une canne.
— Capitaine Lester ? demanda-t-il d’une voix éraillée, sans me tendre la main.
— Oui. Monsieur Pinchard je suppose ?
Il hocha la tête et me fit signe de m’asseoir dans un fauteuil devant l’âtre. Lui-même se posa avec effort dans un Voltaire et, le dos très droit, garda ses mains jointes sur le pommeau de sa canne.
Si je n’avais su que ce monsieur était l’un des hommes les plus riches de France, je l’aurais pris pour un docker, pour un fermier, pour un type habitué à batailler quotidiennement contre les difficultés de la vie. D’ailleurs il était vêtu d’un pantalon et d’une veste de velours bronze à grosses côtes, comme en portent les paysans.
Ses cheveux blancs étaient soigneusement coiffés avec une raie sur le côté et des sourcils broussailleux protégeaient des yeux d’un gris étrange, un gris clair aux teintes d’alumine qui me fouillaient comme des rayons laser. Sa bouche aux lèvres minces restait pincée, méfiante.
Je me sentis soudain mise à nu sous ce regard inquisiteur.
— Je suis Gaston Pinchard, confirma-t-il d’une voix qui ne tremblait pas. Et voici ma fille, Cathy.
Il s’agissait de la personne qui m’avait ouvert la porte et que j’avais prise pour une dame de compagnie. Elle était venue se placer derrière le fauteuil de son père et elle inclina légèrement la tête, comme pour un salut, lorsqu’il prononça son nom.
De petite taille, trapue, elle ne ressemblait pas du tout à son géniteur : un visage tout en rondeurs, un petit nez épaté, des yeux sombres et mobiles.
Mais elle devait à son père un port de tête et un maintien pleins d’une fierté sourcilleuse frisant l’arrogance, qui semblait être la marque de famille. Il était difficile de lui donner un âge, sa vêture sans aucune recherche était celle d’une femme de la campagne et il y avait du gris dans ses cheveux noirs. Cinquante ? Soixante ans ? Je restai perplexe.
— Je suis veuf, dit Gaston Pinchard, et Cathy tient ma maison depuis le décès de ma femme.
J’avais lu dans le dossier que m’avait confié Fabien que la fille de Pinchard avait été mariée mais que son époux avait pris la tangente avant même d’assurer sa descendance. Vu l’allure de l’héritière, je le comprenais un peu.
— Voulez-vous prendre quelque chose ?
C’était Pinchard qui m’avait fait cette offre, plus par souci des convenances que pour m’être agréable.
— Non, merci monsieur, dis-je.
Cathy, qui ne semblait être restée là que pour prendre une éventuelle commande, partit silencieusement.
— Vous résidez ici toute l’année ? demandai-je histoire de rompre le silence.
— Le plus souvent, oui. Mes affaires m’appellent parfois à Paris où j’ai un pied-à-terre, mais dès que je le peux, je reviens à Landévennec.
Et il ajouta, en guise d’explication :
— Ma femme est enterrée ici…
Je hochai la tête sans mot dire, me demandant s’il vivait seul avec sa fille dans cette imposante demeure. Il répondit à cette question que je n’avais pas posée :
— Il y a un couple de gardiens qui habite le manoir à l’année, Marcel Drennec et sa femme Germaine. Marcel s’occupe de l’entretien de la propriété et Germaine des tâches du ménage.
— Ils ont des enfants ?
— Oui, mais ils sont adultes, et ils ont leur vie ailleurs. Le fils est sous-officier dans la Marine nationale, les deux filles sont mariées et n’habitent plus ici depuis longtemps.
Il secoua la tête impatiemment :
— Mais ceci n’a bien sûr aucune incidence sur ce qui nous préoccupe.
Puisqu’il l’affirmait… Je jugeai qu’il était temps d’en venir aux faits :
— Euh… à propos de votre euh… invitation…
— J’ai demandé le concours de la police à mon ami Mervent…
Il s’arrêta de parler, semblant soudain se demander pour quelle raison il avait requis mes services.
— Je suppose, dit-il enfin, que votre supérieur vous a confié le dossier concernant mon fils.
— En effet…
Et, croyez-moi, c’était un dossier des plus complets que je n’avais fait que feuilleter rapidement avant de venir à Landévennec, mais que je me proposais d’étudier plus à fond si la chose s’avérait nécessaire.
La tête du vieil homme perdu dans ses pensées oscillait. Ses yeux regardaient dans le vague.
— Humm ! fis-je pour attirer son attention.
Il tressaillit et redescendit sur terre.
— Je sais que votre fils a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle et qu’à l’issue de ce procès, à la faveur d’un banal accident de la circulation, il a disparu.
Je le fixai lorsque je prononçai ces mots : « un banal accident de la circulation », mais il ne tiqua pas. Je me demandai si cet accident providentiel était aussi banal qu’il y paraissait. Probablement habitué au bluff dans ses affaires, le père Pinchard devait être un formidable joueur de poker.
C’était aussi un homme puissant habitué à ce que choses et gens plient devant sa volonté. Il pouvait fort bien avoir fomenté cette évasion. La presse de l’époque - pour ce que j’en avais lu en survolant le dossier - ne s’était pas privée d’évoquer cette hypothèse car Pinchard, à ses débuts, entretenait une sorte de garde prétorienne de gros bras sélectionnés dans ses chantiers ou dans ses entrepôts, qu’il n’hésitait pas à lancer contre les opposants à ses implantations commerciales.
— Mon fils vient d’être arrêté, dit-il sans me lâcher des yeux.
Je le fixai, interloquée :
— Votre fils ? Je croyais qu’il avait disparu…
Dans le dossier, on en était resté là.
— Oui, mais il a refait surface et la police a mis le grappin dessus.
— Quand ça ?
— Avant-hier.
Je devais faire une drôle de tête, et il y avait de quoi. Ce sacré Lucien (j’appelle mon patron par son prénom - jamais en sa présence, rassurez-vous - quand j’estime qu’il agit un peu cavalièrement avec moi) ! Là, il dépassait les bornes : avoir omis de m’avertir que Matthieu Pinchard avait été retrouvé ! C’était le meilleur moyen de me faire passer pour une imbécile. Oh, mais, il me le paierait !
Négligeant ma surprise, Pinchard ajouta :
— Il a été arrêté par erreur.
Je répétai, incrédule :
— Par erreur ?
— Disons plutôt par un concours de circonstances malheureux.
— Où se cachait-il ? demandai-je.
— Il ne se cachait pas, on pouvait le voir tous les jours.
— Où ça ?
— Ici.
— À Landévennec ?
— Oui.
Je regardai autour de moi :
— Dans cette maison ?
Il secoua la tête négativement :
— Non.
Et, après un temps de silence, il ajouta :
— Au monastère.
Je tombai des nues :
— Vous voulez dire que votre fils…
Il termina ma phrase en articulant chaque mot pour que je m’en pénètre bien :
— Je veux vous dire que mon fils s’est fait moine, voilà ce que je veux dire !
Ce fut à mon tour de laisser filer le temps.
— Vous le saviez ?
— Non, fit-il rageusement. Mon fils était à deux encablures de la maison et je ne le savais pas !
Son dépit était trop visible pour que je puisse douter de sa sincérité.
— Mais comment…
— Comment il s’est fait arrêter ?
— Oui, enfin non…
Je ne savais plus ce que je disais. Je finis par demander :
— Comment a-t-il fait pour se cacher chez les moines ?
— Humph ! fit Pinchard, dès qu’il s’est évadé, juste après le procès, pendant son transfert à la prison, les flics ont bouclé les aéroports, visité les gares, les ports. Ils s’imaginaient que le fils Pinchard, comme on disait, chercherait à gagner quelque pays chaud où il vivrait peinard avec le fric de papa. Jamais ils n’auraient pensé à le chercher dans un monastère.
Il secoua la tête et marmonna :
— Et moi non plus !
Puis il me regarda, la bouche pincée, et précisa :
— Il faut dire qu’à cette époque, Matthieu était un fichu petit con !
Il cracha :
— Un gosse de riche ! Il lui fallait toujours la dernière voiture de sport - qu’il cassait régulièrement - et il amenait ici des petits bourges de son acabit pour des parties où l’alcool coulait à flots, et si ça n’avait été que l’alcool…
Il eut un geste évasif.
— Il y avait aussi de la drogue, je suppose, dis-je.
— Si j’en juge par les prélèvements que sa mère faisait pour les caprices de son petit chéri, j’ai tout lieu de le croire.
Il me regarda d’un air de défi :
— Ça vous étonne ?
— Ces histoires de drogue ? Pas du tout. Ce qui m’étonne, en revanche, c’est que vous ayez cautionné ces comportements.
Il s’emporta :
— J’ai cautionné… J’ai cautionné… Je n’ai rien cautionné, ma petite dame ! Seulement je n’étais pas là. Les affaires… Vous ne savez pas ce que c’est !
— Je me doute, dis-je, que diriger un empire comme le vôtre doit laisser peu de place à une vie familiale.
— C’est exactement ça. L’absence du père et une mère faible…
Il leva les bras, fataliste.
— Au bout du compte, tout est de ma faute, ne cherchez pas d’autre coupable que moi, je ne lui ai pas assez botté le cul !
Il n’était plus temps de lui faire remarquer que sa présence attentive et affectueuse aurait probablement rendu ce châtiment vexatoire tout à fait inutile.
— Où s’est passé l’accident qui a permis à votre fils de s’échapper ?
— À Brest, près du port de commerce.
Je m’étonnai :
— Il est nécessaire de passer par là pour gagner la maison d’arrêt ?
— Non, plus maintenant. Mais à l’époque, il y avait des travaux et la circulation était détournée. Un camion de travaux publics a heurté le fourgon cellulaire et l’a immobilisé. Le chauffeur du camion avait coupé la priorité aux flics et ceux-ci ont voulu le faire souffler dans le ballon. Des dockers qui passaient par là ont pris fait et cause pour le chauffeur et tout est parti en vrille. Les dockers avaient beaucoup bu, ils ont balancé des pavés sur les flics qui ont dû battre en retraite. Du coup, les dockers ont libéré les quatre détenus ; lorsque les renforts de police sont arrivés, il ne restait plus que l’épave du fourgon, vide. Matthieu avait disparu et les flics ne devaient plus le revoir, jusqu’à avant-hier…
J’avais lu le rapport des gendarmes sur cette rocambolesque évasion et je me promis de le relire en détail.
Il émit un petit rire amer :
— Rassurez-vous, il n’a pas commis d’autre délit. Un accident de la circulation en allant à Brest…
Je m’exclamai :
— Encore ?
— Oui, dit Pinchard, c’est à n’y pas croire, hein ? Ce que c’est que la vie, tout de même ! Un accident l’a libéré, un accident le remet en prison. Enfin, quand je dis libéré, je m’entends. Chez les moines aussi on dort en cellule !
— Vous ignoriez donc que votre fils était dans la communauté religieuse ?
— Je vous l’ai dit, il me semble !
— Je ne vous repose la question que parce que ça paraît incroyable.
Il ricana sinistrement :
— C’est incroyable, je vous l’accorde ! Il faut croire que je ne suis pas plus futé que les flics. Compte tenu de la vie que menait Matthieu avant cet…
Il hésita et finit par dire :
— Cet incident…
Tu parles d’un incident ! Il y avait quand même eu un mort !
— Le monastère est le dernier lieu où j’aurais pensé le trouver !
— Vous auriez pu le voir…
— Comment ça ?
— Je ne sais pas… En allant assister à la messe, par exemple.
— Pour tout vous dire, maugréa-t-il, je n’ai jamais été préoccupé par les histoires de religion. Je suis un homme d’action, moi. Alors penser que des types s’enferment pour la vie pour réciter des patenôtres, ça me dépasse.
À propos de patenôtres, il aurait dû lire dans la Bible l’épisode du veau d’or et il aurait alors compris qu’il avait joué le mauvais cheval, pour rester dans les évocations agricolo-bibliques.
— Et votre femme ?
— Marguerite ? Elle avait de la religion et elle assistait régulièrement aux offices.
— Et elle n’a pas reconnu son fils ?
— Pour tout vous dire, elle n’allait pas jusqu’au monastère. L’église paroissiale lui suffisait.
— Votre fille n’y allait pas non plus ?
— Ma fille est comme moi. Physiquement, elle ressemble à sa mère, mais pour le reste c’est mon portrait tout craché.
— Tandis que votre fils…
— À l’inverse, mon fils me ressemble physiquement, mais il avait le caractère faible de Marguerite.
Pinchard prononçait ce prénom avec une nostalgie certaine. Assurément, la mort de son épouse l’avait sérieusement affecté. Il haussa les épaules :
— Ceci explique peut-être qu’il se soit si bien accommodé de la vie monacale.
— Aurait-elle été heureuse de le savoir chez les moines ?
Le visage du vieil homme se rassombrit.
— Je ne sais pas. Peut-être. Cette histoire a tellement secoué Marguerite que lorsque Matthieu a été inculpé dans cette triste affaire, elle a eu une commotion cérébrale. Elle est morte quelques mois plus tard.
— Votre fils n’a donc pas assisté aux obsèques de sa mère…
— Évidemment non !
Il réfléchit et ajouta :
— En tout cas, je ne l’ai pas vu. Il faut dire qu’il y avait tant de monde ! L’église était trop petite, la plupart des gens sont restés dehors. Une délégation de moines a chanté le requiem. Maintenant que j’y pense, peut-être Matthieu était-il parmi eux, mais comme ils se tenaient sous leur capuche, je ne l’ai pas reconnu.
Bien entendu, personne n’aurait eu l’idée de chercher un repris de justice parmi ces saints hommes.
— Votre fils a eu un accident en voiture, il lui arrivait donc de sortir du monastère ?
— Oui, je l’ai appris depuis. Il avait la responsabilité de la boutique. Vous savez, les moines ont une sorte de magasin où ils vendent divers articles. Matthieu se rendait fréquemment à Brest avec la camionnette de la communauté pour effectuer certains achats. À l’entrée de Brest, une voiture volée poursuivie par la police est venue s’écraser contre la camionnette. Il y a eu des blessés, Matthieu fort heureusement n’a été que contusionné et a pu regagner le monastère après être resté en observation à l’hôpital pendant vingt-quatre heures. Je ne sais comment ça s’est fait, peut-être est-ce la procédure normale, toujours est-il que les flics ont relevé les identités de tous les gens impliqués dans cet accident.
— Pourtant votre fils n’y était pour rien ! fis-je remarquer.
— Non, dit Pinchard d’une voix froide, mais l’un des voyous se faisait appeler Grégory.
Il me fixa de son regard froid et articula :
— Mon fils, en religion, est Frère Grégoire.
Il ricana sinistrement et répéta :
— Grégory, Frère Grégoire ! Amusant, non ?
Il n’avait pourtant pas l’air de trouver la coïncidence amusante. Sans attendre mon approbation, il poursuivit :
— Vous savez mieux que moi comment ça se passe, un de vos collègues a introduit toutes ces données dans l’un de ces ordinateurs perfectionnés et puis…
Il eut un geste de la main montrant que la situation s’était alors emballée.
— Et il s’est aperçu, poursuivis-je, que Frère Grégoire n’était autre que Matthieu Pinchard, un condamné de droit commun en cavale depuis quinze ans.
L’industriel hocha la tête affirmativement :
— Voilà. Ils sont venus l’arrêter au monastère voici deux jours.
— Où est-il actuellement ?
— À la maison d’arrêt de Brest.
— Vous l’avez vu ?
— Non, pas encore.
— Vous irez le voir ?
— Certainement.
Je restai silencieuse. Que voulait-il que je fasse ? Son fils avait été condamné par une cour d’assises, il s’était enfui et n’avait plus jamais fait parler de lui. Cependant, sa dette à la société, comme on dit, demeurait et s’il pensait que la machine judiciaire allait l’oublier, il était bien naïf.
Je regardai le vieillard toujours droit sur son siège, les mains serrées sur le pommeau de sa canne.
— Je suppose que vous avez fait appel à un avocat ? demandai-je.
— Ouais, grommela Pinchard.
— Que vous a-t-il conseillé ?
Le vieil homme ricana lugubrement une nouvelle fois :
— Il réfléchit à la question… Comme il y a un fait nouveau, il espère que le procès pourra être repris.
Le fait nouveau était évidemment l’arrestation de Matthieu Pinchard, Frère Grégoire en religion. Inconfortablement posée sur l’extrême bord de ce fauteuil trop grand, trop haut, trop profond, je regardai le vieillard :
— Monsieur Pinchard, qu’attendez-vous exactement de moi ?
7. Référence de la peinture des bateaux de la Marine nationale.
III
Pinchard se pencha en avant, comme pour me parler de plus près et, s’il n’y avait pas eu cette table basse de vieux chêne sculpté pour nous séparer, j’aurais pu craindre qu’il s’effondre sur mes genoux.
— Ce que j’attends de vous, gronda-t-il, c’est que vous apportiez la preuve que mon fils est innocent !
J’en restai comme deux ronds de flan :
— Rien que ça ?
Ses yeux gris flamboyèrent :
— Si vous ne vous en sentez pas capable…
Une voix calme s’éleva, sa fille était entrée silencieusement par une porte que je n’avais pas vue :
— Voyons, papa, comment veux-tu que le capitaine Lester ait une vue précise de cette affaire ? Peut-être faudrait-il lui expliquer…
— Lui expliquer quoi ? demanda le vieil homme en se tournant vers sa fille avec la difficulté d’un homme qui a le dos raide. Lui expliquer que ton frère n’a tué personne ? Nous le savons, non ?
Il était temps que j’intervienne, on dérapait dans l’irrationnel :
— Avoir une intime conviction est une chose, monsieur Pinchard, mais dans un état de droit, ça ne suffit pas. Il faut aussi apporter des preuves.
— Eh bien, trouvez-les ! fit-il avec humeur. C’est votre métier, non ?
— Vous souhaitez que je reprenne l’enquête quinze ans après…
— Quatorze ans, précisa-t-il. Quatorze ans que je n’ai plus de fils.
Il brandit sa canne et balaya l’air au-dessus de ma tête en montrant les tapisseries anciennes pendues aux murs, les tableaux de maître, les statues polychromes blotties dans les recoins, éclairées par des spots savamment dissimulés.
— Nous avons l’opportunité d’innocenter mon fils, je ne la laisserai pas filer !
Il y eut un silence, puis il demanda en me fixant de son regard gris :
— Savez-vous d’où je viens, mademoiselle ?
Si je le savais ! Qui l’ignorait, d’ailleurs ? Les journaux s’étaient complus à conter la success story de Gaston Pinchard, qui, parti de rien, était devenu une des plus grosses fortunes de France sinon d’Europe. Visiblement, il allait me la resservir une fois encore.
— Je viens de l’Assistance publique, mademoiselle, je n’ai connu ni mon père, ni ma mère, ils sont morts dans le naufrage du Saint-Philibert en 1932. Évidemment ça ne vous dit rien, le naufrage du Saint-Philibert !
— Si, monsieur, dis-je, pas fâchée de lui en boucher un coin. C’est ce bateau d’excursion qui a coulé dans l’embouchure de la Loire. Cinq cents passagers, vingt-huit rescapés, je crois.
Gaston Pinchard en resta silencieux un instant, puis il demanda :
— Comment savez-vous cela ?
Je répondis, un peu fière de moi :
— Dans la police on sait beaucoup de choses, monsieur.
Il fronça les sourcils, semblant se demander si je me moquais de lui. Je n’allais pas lui expliquer que, lors d’une enquête dans le Morbihan8, j’avais eu à connaître cette tragique histoire, qu’elle m’avait marquée et que je m’en souvenais parfaitement.
— J’avais quelques semaines, dit Pinchard d’une voix sourde, on a retrouvé mon berceau flottant sur la mer démontée parmi les débris du naufrage. J’étais l’un des vingt-huit rescapés. Un miraculé. Mais un miraculé de deux mois qui n’avait plus personne au monde.
J’ai grandi à l’Assistance publique où, rebelle, j’ai été puni, battu. Je n’ai jamais cédé, même aux châtiments les plus sévères ; alors j’ai été placé en maison de redressement où le régime était plus dur encore. J’étais voué aux bataillons d’Afrique lorsque je me suis enfui pour me réfugier à Paris où je ne connaissais personne. À quatorze ans, j’en paraissais dix-huit et j’étais porteur aux halles. À dix-huit ans, j’étais fort à ces mêmes halles. À vingt ans, je me suis mis en ménage avec la veuve d’un boucher qui avait deux fois mon âge…
Il avait jeté cette dernière information d’un air de défi, comme si elle avait été de nature à troubler ma pudeur. C’était mal me connaître. Il en faut plus pour me choquer.
Je connaissais la suite. L’après-guerre venue, tout était à reconstruire. Ayant appris le métier, Gaston Pinchard avait plaqué sa bouchère et créé son premier commerce. En 1954, il possédait une vingtaine de points de vente dans la capitale.
En 1960, après un voyage aux États-Unis, il ouvrait sa première grande surface. Dix ans plus tard, ses enseignes couvraient la France entière.
Pinchard avait réussi, sa fortune était faite, il avait acheté cette grande maison - baptisée manoir - au pays de sa femme, il avait deux enfants, une fille qu’il avait mariée avec le directeur d’un de ses magasins et un fils qu’il destinait aux hautes études. Un fils qui prendrait sa succession et qui ferait flotter le nom de Pinchard sur la terre entière…