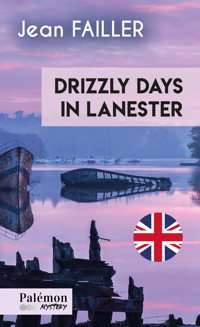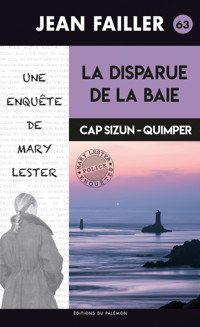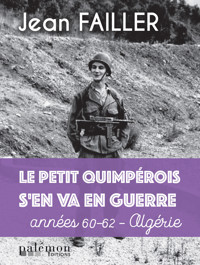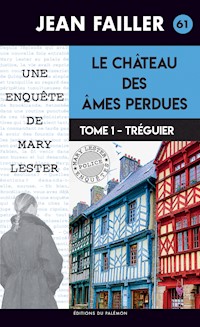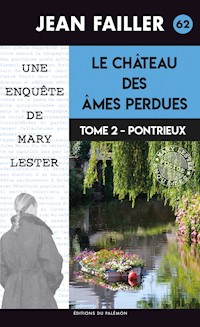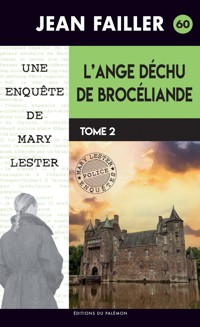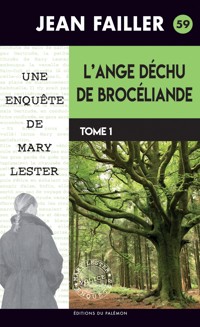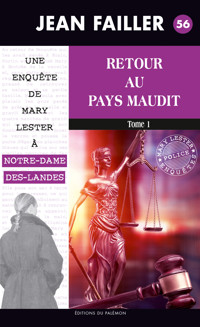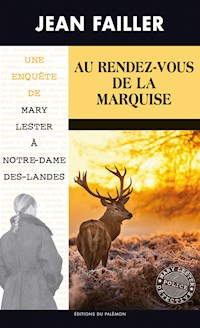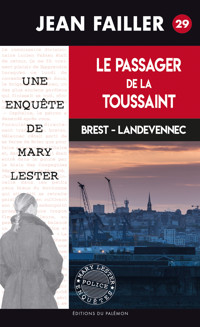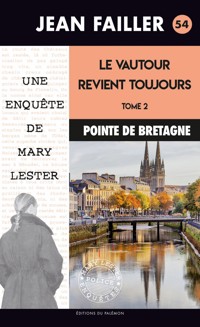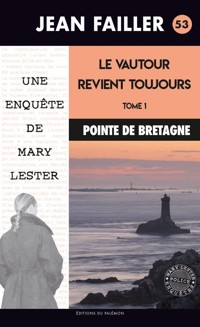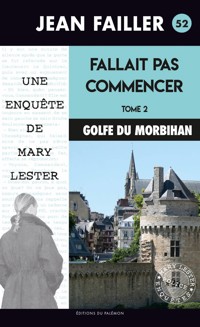Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palémon
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Plongez dans les souvenirs de Jean Failler au cœur de la Bretagne...
Avec ces mémoires, d’un intérêt patrimonial certain, Jean Failler nous livre un formidable témoignage plein d’émotion de la vie en Cornouaille entre 1940 et 1960, de Quimper (sa ville) à Douarnenez (son port) en passant par Plonéour-Lanvern (sa campagne). On se délecte de ses récits épiques, de ses souvenirs attendris, qui rappellent sans nul doute ceux de Marcel Pagnol ou de Pêr-Jakez Helias…
Une autobiographie touchante et captivante !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Auteur de pièces de théâtre, de romans historiques, de romans policiers.
Jean Failler vit et écrit à l’île-Tudy (Finistère).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
AVERTISSEMENT
Comme beaucoup de jeunes de ma génération, je n’ai pas appris le breton à l’école – lieu d’où il était farouchement banni par les hussards noirs de la République, sous peine de punition sévère – mais au contact de mes grands-parents bigoudens, qui ne connaissaient pas d’autre langue.
Si je l’ai parlé – et qu’il m’en reste fort heureusement quelques rudiments – je n’ai donc jamais su l’écrire.
J’ai bien évidemment – comment pourrait-il en être autrement ! – émaillé ce récit d’expressions bretonnes qui étaient, durant mon enfance, incontournables à Quimper et à Douarnenez. Je les ai couchées ici brutes de décoffrage, telles que je les ai toujours entendues, et perçues, sans me préoccuper de leur orthographe que je n’ai jamais maîtrisée. Car pour moi, le breton, c’est ça !
Je prie donc les puristes de notre belle langue de ne pas m’en vouloir pour ces approximations ! Et conseille à ceux qui souhaiteraient la découvrir de se munir d’ouvrages plus « sérieux » sur la question…
Quimper 1943
Premiers pas d’un petit Quimpérois dans sa ville.
Sur les quais de l’Odet, un vieil homme marche lentement en tenant un enfant par la main.
L’enfant, c’est moi, Jean Armand Failler, né à Penhars, une petite commune voisine de Quimper, rue Victor Hugo, le 26 février 1940, soit cent trente-huit ans jour pour jour après le grand poète et cent soixante-seize jours après la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. J’ai donc passé les cinq premières années de ma vie dans un pays en guerre.
Penhars était alors, avec Kerfeunteun et Ergué-Armel, l’une des communes rurales qui côtoyaient le chef-lieu du département1.
La préfecture du département, Quimper n’était encore qu’une petite ville enserrée entre ses deux églises, celle de la paroisse Saint-Mathieu et la cathédrale Saint-Corentin, impressionnant édifice de granit dont les doubles tours hardiment pointées vers le ciel dominent la vallée de l’Odet, aimable fleuve côtier qui la traverse paresseusement avant de se jeter dans la mer à Bénodet.
Le bourg de Penhars était alors majoritairement habité par des Bigoudens comme celui de Kerfeunteun l’était par des Melenigs2, et Ergué-Armel par des indigènes du pays de Fouesnant.
Ces ruraux, attirés par la ville mais méfiants tout de même, s’arrêtaient en lisière de l’agglomération ; probablement parce que c’était encore la campagne et qu’il leur était plus facile de s’y loger, mais aussi pour rester au plus près de leur bourg de naissance afin de pouvoir s’y réfugier au moindre signe hostile.
En quatre siècles, les Failler n’avaient guère bougé de leur terroir. En remontant leur généalogie, on trouve l’attestation du mariage d’un Jan Le Phallier aux registres paroissiaux de Beuzec Cap Caval – qui englobait alors Penmarc’h – en 1640.
Le Phallier, qui signifie « le faucheur », indique donc probablement la profession de cet ancêtre. D’autres étaient enregistrés comme « laboureurs de terre » ; de nos jours, on dirait ouvriers agricoles. Au fil du temps et de la fantaisie des recteurs chargés de la tenue des registres, Le Phallier devint Le Fallier, puis Le Failler et enfin Failler.
Parcourant une demi-lieue de dune, ils avaient également déménagé de Beuzec Cap Caval, paroisse aujourd’hui disparue dont il ne subsiste que la très vieille église et quelques maisons contemporaines, pour s’établir à Tréguennec, où ils demeurèrent quelques siècles avant de faire une lieue de plus pour se fixer à Plonéour-Lanvern, gros bourg rural qui dispute à Pont-l’Abbé le titre de véritable capitale du Pays bigouden.
Un concours de circonstances fit naître mon père à Pont-l’Abbé, dans le quartier populaire de Lambour où sa mère était keginerez3 dans une auberge.
Cependant, dès qu’il le put, le couple regagna Plonéour-Lanvern où mon grand-père Jean-Noël était journalier agricole, louant ses bras au gré des saisons, selon les besoins de propriétaires terriens presque aussi misérables que lui.
Au sortir de la grande guerre – il était revenu presque intact de l’enfer de Verdun – Jean-Noël, paysan sans terre, avait trouvé une situation dans un manoir des environs : contre la jouissance de la maison de garde du domaine, il devait en entretenir les abords et la longue allée bordée de hêtres qui menait à la demeure des maîtres et, plus évidemment, surveiller les lieux.
Déjà riche de cinq enfants, il avait jugé l’affaire avantageuse car, outre la maison de garde, il pouvait disposer d’une parcelle de terre qui lui permettait de cultiver des légumes et donc, de nourrir sa nichée.
Mon père, Jean-Eneour-Pierre-Marie Failler, neuvième du nom, avait six ans lorsque son père partit pour une guerre meurtrière qui devait durer quatre ans.
Il avait donc dix ans lorsque ce dernier revint de cet enfer avec ses deux bras et ses deux jambes. Il était surtout traumatisé, bien qu’il tentât de n’en rien laisser voir, par les horreurs qu’il avait vécues pendant ces longues années.
Peu loquace de nature, dès qu’une conversation menait à la Grande Guerre, Jean-Noël devenait carrément muet, laissant, avec un petit sourire triste et des hochements de tête entendus, d’autres « héros » s’épancher sur leurs exploits dans les tranchées.
Il en était donc revenu presque intact. Presque… Gazé à l’ypérite à Verdun, il y avait « gagné » une vue troublée et des yeux constamment larmoyants, ce qui avait irrémédiablement gâché ses talents de tireur d’élite. Bien sûr, comparé à ceux qui avaient perdu un bras, une jambe voire la vie, c’était presque bénin et ces maux n’avaient pas justifié l’octroi d’une pension qu’il avait d’ailleurs négligé de demander. Ne sachant ni lire ni écrire et ne parlant que breton, comment aurait-il pu plaider sa cause auprès d’une administration peuplée de petits chefs imbus de leur supériorité sur ces misérables ploucs ?
Il retrouva donc avec satisfaction la petite maison de garde et sa chère Naïg qui devait lui donner cinq autres enfants.
Mon père eut la chance de fréquenter l’école laïque jusqu’à l’âge de douze ans. C’était une époque où les gens de sa condition ne traînaient guère sur les bancs de l’école, surtout quand on était l’aîné d’une famille où une dizaine de bouches bien endentées attendaient leur pitance deux fois par jour. D’ailleurs, pour la plupart de ses condisciples, l’école était un insupportable pensum et ils préféraient mille fois travailler aux champs qu’ânonner l’alphabet et suer sur les quatre opérations. Ce n’était pas le cas de mon père. Lui apprenait facilement et avec plaisir, pour le plus grand bonheur de son maître qui envisageait sérieusement un succès au Certificat d’études primaires.
Cependant, il fallut que ce hussard noir de la République fît une grande lieue à pied à travers champs pour décider mon grand-père à laisser à son aîné une journée pour se présenter à l’examen.
Jean-Noël ne voyait pas l’intérêt qu’il y avait à perdre son temps en une période de l’année où tous les bras disponibles étaient requis pour les travaux des champs. Selon l’usage, dès l’âge de sept ans, âge décrété « de raison » par le clergé – il menait à la communion privée –, les enfants accompagnaient les adultes aux champs pour aider dans la mesure de leurs moyens aux récoltes des premières pommes de terre, des haricots verts, et des petits pois.
À l’époque, en Pays bigouden, le destin d’un enfant issu d’une famille pauvre était tout tracé : les travaux de la ferme. La terre avait besoin de bras. La mer aussi, pour qui naissait dans un port. Dès ses douze ans, promu au rang de petit mousse, il embarquait sur la chaloupe d’un père, d’un oncle ou d’un cousin.
Il faut croire que l’instituteur sut se montrer persuasif puisque mon père put bénéficier d’une journée de repos pour tenter de décrocher ce Graal de l’instruction publique.
Jean-Eneour-Pierre-Marie Failler, qui ne manifestait aucun goût pour les travaux agricoles, réussit le prestigieux examen haut la main.
Auréolé de ce succès, il entra en apprentissage chez le menuisier du village.
*
Jean-Enéour Failler monte à Paris.
Lorsque Jean-Noël, mon grand-père, fut démobilisé en 1918, mon père avait dix ans. Comme on l’a vu, ce dernier passa le Certificat d’études à douze ans et entra aussitôt en apprentissage chez le menuisier du bourg, à Plonéour-Lanvern, ravi de pouvoir échapper à ces travaux des champs qui le rebutaient tant.
À seize ans, ayant appris tout ce que son patron pouvait lui apprendre, il sentit qu’il était temps de changer d’air.
Lors d’un séjour au pays, une vague tante de sa famille, dont le mari s’était exilé à la capitale où on embauchait des manœuvres pour creuser le métro, incita mes grands-parents à lui confier leur aîné. Elle se faisait forte de le loger et de lui trouver un emploi.
Les rares audacieux qui avaient osé quitter le village natal pour les feux de la capitale jouissaient alors d’une aura toute particulière.
L’aventure tenta mon père. Il nota soigneusement l’adresse de la tante Lisette et se prépara pour le grand départ. Pour n’avoir pas à payer le train, grand-mère Naïg eut recours aux services d’un marchand de bestiaux qu’elle avait connu lorsqu’elle officiait dans les cuisines de l’auberge où cet homme important avait ses habitudes. L’homme avait justement des porcs à convoyer jusqu’à Vaugirard. Le garçon n’avait qu’à s’installer dans le wagon avec les bêtes, il passerait pour un convoyeur et le tour serait joué.
Ce fut donc dans cet arroi peu reluisant que notre Rastignac bigouden prit pied dans la capitale.
De là, ce fut grâce à un périple épuisant par les rues de cette capitale immense, demandant son chemin en montrant le papier où figurait l’adresse de la tante Lisette, qu’il parvint à trouver son nouveau gîte.
Il se sentait en terre étrangère, hostile même. Bien sûr, il parlait le français appris à l’école, mais à la maison, tout le monde communiquait en breton. Il ne comprenait pas ces gens qui parlaient trop vite et qui s’écartaient d’un air dégoûté car le voyage – une journée parmi les cochons – l’avait imprégné d’une puanteur tenace.
Enfin, épuisé, affamé, il parvint chez tante Lisette qui le réconforta comme elle le put. Son mari et elle étaient logés petitement et lui avaient généreusement octroyé une paillasse dans un réduit obscur.
Cependant, c’était une base de départ. Tante Lisette le présenta à un entrepreneur en menuiserie. Celui-ci employait une quinzaine d’ouvriers dans un vaste atelier vitré. Il considéra mon père avec curiosité et lui demanda s’il savait travailler. Celui-ci opina vivement de la tête, alors le patron lui désigna un établi qui paraissait libre et demanda à un de ses employés de lui apporter une douzaine de planches. Puis, lui montrant une porte finie, il commanda : « C’est bon, montre-nous ça. Tu as la journée pour faire la même porte… »
Les autres ouvriers contemplèrent d’un air gouailleur ce freluquet trop maigre, s’attendant à le voir fondre en larmes.
Mon père ne leur donna pas cette joie. Il tomba la veste et se mit à l’œuvre. Soucieux de relever le défi, il ne prit même pas le temps de déjeuner. Mais au soir, une porte à panneaux chevillée était terminée, en tout point semblable à celle qui lui avait servi de modèle, et sans une seule pointe.
— C’est bon, lui dit le patron, tu es embauché. Passe au bureau pour qu’on t’enregistre. Sois-là demain à huit heures et tâche d’être ponctuel.
Et il ajouta, ce qui ravit mon père :
— La journée que tu as passée à faire cette porte te sera payée.
Mon père devait rester quelque temps chez cet employeur et se fit des connaissances parmi les compagnons qui œuvraient à ses côtés. Il ne demeura pas longtemps chez tante Lisette et trouva à se loger dans un petit hôtel où nombre d’ouvriers séjournaient. Dès qu’il le put, il renouvela sa garde-robe et prit, comme ses compagnons d’atelier, l’habitude l’aller à la douche municipale le dimanche matin.
Peu à peu, son patron, qui l’appréciait, lui confia de nouvelles responsabilités en le nommant chef d’équipe pour une branche d’activité dans laquelle l’entreprise était renommée : l’installation de magasins, activité où son savoir-faire et sa débrouillardise firent des merveilles. Et il put enfin expédier des mandats à Plonéour-Lanvern où grand-père Jean-Noël peinait à nourrir les huit enfants encore au logis avec son maigre salaire d’ouvrier agricole.
*
Retour sur les quais de l’Odet.
Je poursuis ma route, ma petite main dans celle de mon grand-père maternel François.
La marée est pleine et l’eau verte venue de la mer affleure la route, si bien que les sabliers qui déchargent leur cargaison de maërl ou de sable fin devant le palais de justice paraissent posés sur la chaussée. Dans des halètements de moteurs et le cliquetis de chaînes, des bennes aux mâchoires d’acier arrachent la moisson marine à la cale.
Des cordillères artificielles s’élèvent ainsi peu à peu, jusqu’au Cap Horn. Le quartier a pris le nom d’un bistrot situé là où l’Odet, corseté de granit le temps de traverser la ville, reprend ses aises pour couler paisiblement jusqu’à la mer.
C’est alors le port de commerce de Quimper dans lequel les lougres et les goélettes déchargent les bois du Nord ou le charbon gallois.
Les sabliers, de plus petite taille, déversent leur butin du jour plus haut, tout au long de la route qui mène au Pays bigouden. Quant aux lougres transportant du vin, ils remontent presque jusqu’à la jonction du Steir et de l’Odet, jusqu’à la cale Alavoine, du nom d’un important négociant en pinard de la place.
Une faune curieuse rôde toujours autour de ces déchargements, mystérieusement prévenue de l’arrivée d’un nouveau bateau. Quelques désœuvrés espèrent trouver là matière à gagner trois sous en « donnant la main » pour les manutentions de déchargement.
Les plages les plus proches, Bénodet ou Beg-Meil, sont à quatre bonnes lieues de Quimper, donc hors de portée de la plupart de ses habitants qui n’ont que leurs jambes pour se déplacer. Ce sont, pour la majorité, des gens de petite condition, ouvriers ou manœuvres qui, venus de la campagne, gagnent leur pain « à la sueur de leur front », comme il est dit dans la Bible, et plutôt mal que bien.
Aux marées de bon coefficient, puisqu’ils ne peuvent pas aller à la plage, c’est la plage qui vient à eux dans les flancs de ces sabliers ventrus, le Roger, le Camille et quelques autres.
Les montagnes de maërl gris, que les paysans d’alentour viennent chercher avec leurs charrettes traînées par de robustes postiers bretons pour amender leurs champs, n’ont pas la faveur des quêteurs de coquillages, mais les sables d’or du Letty recèlent fréquemment de coquillages estimables comme des coques, des pieds de couteaux, des palourdes, des couilloù kwezic, voire des lançons que l’on se dispute avidement.
Il faut faire vite. À peine la benne a-t-elle largué sa cargaison que chacun se précipite, grattant avidement le sable à pleines mains et guettant d’un œil inquiet le prochain envoi. Le préposé à la manœuvre du treuil ne se soucie pas des traînards et on peut penser qu’il trouve même un malin plaisir à déverser son mètre cube de sable dégoulinant d’eau de mer sur le dos des retardataires.
Mon grand-père François, ancien patron pêcheur de Douarnenez que la maladie a cloué à terre loin de son cher Rosmeur4, vient alimenter sa nostalgie en respirant l’odeur de marée basse qui s’exhale de cette cargaison arrachée aux fonds marins.
La rue de la Providence, où sa femme Mélanie, ma grand-mère, a trouvé un « pas-de-porte », comme on disait alors, pour exercer son métier de repasseuse afin de faire bouillir la marmite familiale, est à deux jets de pierre de l’opulente rue Kéréon où s’étale un luxe impensable de bijouteries, de riches fourrures, et de tissus que l’on débite au mètre. La rue de la Providence est un quartier pauvre qui respire la misère et dans laquelle tout un quart-monde s’entasse dans des masures branlantes.
À Douarnenez, grand-père était un patron respecté dont la parole comptait ; dans la rue de la Providence, il n’est désormais qu’un pauvre déclassé de plus, juste bon à promener les enfants.
Je viens d’avoir trois ans et, trois quarts de siècle plus tard, je me souviens de cette époque comme si c’était hier. Étrange chose que la mémoire qui, au printemps de la vie, marque de façon indélébile nos jeunes cervelles.
Nous traversons la rue devant la cale Saint-Jean qui fait face au palais de justice pour voir le spectacle de plus près. Cela ne présente aucun risque car, sur cette artère aujourd’hui si fréquentée par la circulation automobile, il ne passe pas une voiture par heure, et encore, c’est en général un tacot brinquebalant marchant au gazogène – n’oublions pas que c’est la guerre et que l’essence, réservée à l’occupant, est rare – qui frôle parfois les trente kilomètres heure.
Grand-père salue les matelots du sablier, qu’il connaît désormais. Ne comptez pas sur un vieux marin pour aller balader sa progéniture à la campagne. Ses pas le conduisent obligatoirement vers la mer, surtout au temps des grandes marées qui lui rappellent son Douarnenez natal.
François Marot n’est pas un grand marcheur comme peut l’être Jean-Noël, mon pépé de Plonéour. À vrai dire, il n’est bien que sur l’eau, dans un bateau de pêche. Ne lui parlez pas de yachts de plaisance, il y en a si peu que pour lui ils n’existent pas. Il prend ces coques immaculées, avec leurs hauts mâts vernis et leurs grandes voiles blanches et évanescentes comme des traînes de mariées, pour des incongruités, des bateaux de crâneurs, des anomalies de riches qui ne savent que faire de leur argent. D’ailleurs, ne leur faut-il pas, pour faire naviguer ces esquifs, le concours de vrais marins débauchés de leurs chaloupes sardinières ? Pour lui, un vrai bateau ne peut être qu’un outil de travail qui sent le poisson, la saumure et le coaltar, non pas un « bateau madame », si gracieux soit-il.
Nous continuons notre périple vers le Cap Horn, nom du bistrot de madame Pernez, réputé pour ses berlingots – les bonbons – « souverains contre le mal de mer ». Une pancarte publicitaire l’atteste.
C’est de là que partent les vedettes Reine et Perle de l’Odet qui font visiter « la plus belle rivière de France » – une autre pancarte le certifie – aux touristes en quête du frisson d’une aventure navale.
Mais par la grâce des berlingots de madame Pernez, et peut-être aussi grâce au cours paisible de la belle rivière, ils surmonteront fièrement les affres du mal de mer.
La Reine est à quai. Nous montons à bord pour saluer Noël Le Mut, un cousin de Jean-Noël, mon grand-père bigouden. Noël, qui fut batelier de sable lui aussi, est passé au grade envié de commandant de ce promène-couillons, comme les appelle le père Naour, le tailleur de pierre qui œuvre face à la rivière.
Noël Le Mut, qui passe sa vie sur l’Odet, apprend les dernières nouvelles à pépé : ces vedettes de promenade seraient – faute de clients – reclassées en bateaux de pêche.
Les deux vieux hochent la tête en évoquant cette époque de misère.
Je n’y comprends pas grand-chose car l’échange se fait en breton ; aussi, je m’impatiente et je tire sur la main de grand-père :
— Tu viens, tu viens ?
Il résiste. Visiblement, les nouvelles que diffuse Noël l’intéressent.
— Chom peoc’h t’en !5
Et Noël, qui n’est pas un grand bavard, comme son nom l’indique – Le Mut signifie « le muet » en breton – me frotte la tête affectueusement :
— Dihabask eo !6
Grand-père a un geste fataliste :
— Yaouank eo !7Kenavo, Noël…
— Ar wech all8, François.
Nous reprenons pied sur le quai et grand-père m’apprend les nouvelles communiquées par tonton Noël : l’Isolda est arrivée à Bénodet, où elle est amarrée sur le coffre de la Marine nationale, et elle remontera probablement le lendemain avec la marée jusqu’à Quimper.
L’information est d’importance car l’Isolda est une goélette norvégienne qui transporte des bois du Nord pour le compte de la maison Marsesche, laquelle a ses entrepôts sur les quais.
Des madriers bruts de sciage pleurent des larmes ambrées qui répandent un merveilleux parfum de résine. Et ça sent comme chez nous, quand papa installe le sapin de Noël.
Plus loin, l’entreprise Feillet importe des charbons anglais qui font de grosses montagnes sombres dans la cour de l’entrepôt où tout est noirci de charbon. Derrière les grilles, des hommes de peine, maculés de noir eux aussi, chargent des sacs sur un fardier qu’un cheval va tirer dans les rues de la ville. Les charbonniers, ainsi appelle-t-on ces hommes qui portent avec aisance sur leur dos des sacs d’un quintal pour descendre à la cave ou hisser dans les étages la houille qui assurera le chauffage des appartements. Leurs faces noires couvertes de poussière m’effrayent un petit peu.
Et plus haut, au confluent de l’Odet et du Steir, juste avant le pont Pissette, une cale, la dernière du domaine maritime, permet aux pinardiers de débarquer leurs barriques destinées aux chais de messieurs Alavoine et Darnajou, importateurs de vins.
Quimper est une ville où les négociants, les propriétaires de conserveries et les commerçants de la rue Kéréon tiennent le haut du pavé. Certains d’entre eux possèdent, luxe suprême, une villa à Bénodet ou Beg-Meil. Ils s’y rendent au beau temps dans leurs superbes Traction-Avant Citroën.
Le populaire ne renonce pas pour autant aux joies de la plage. Un comité a fondé la fête des Gueux qui se rend les dimanches où la marée est haute à la grève éponyme sise sur la rive gauche de la baie de Kerogan.
Quand la mer « est en haut », comme on dit ici pour parler de marée haute, on ne voit plus les immenses étendues de vase noire, et même qu’en haut de la laisse de mer, près des joncs, il y a une assez large bande de sable presque blond.
À la belle saison, le populo s’y rend en groupe le dimanche en entonnant la chanson Les bons gueux de Bretagne, composée pour la circonstance par le chansonnier local, Eugène Rouyer, dit Gégène.
On saucissonne sur la grève ; le PPVR (pain pâté vin rouge) connaît un grand succès. Et puis on se baigne, on crie, on chante, on se chamaille à grand bruit. Les gosses, en slip Petit Bateau faute de caleçon de bain, marchent avec délectation dans la vase noire et tiède pour se faire des bottes, précurseurs innocents de ces thalassos où, de nos jours, les bobos se rendent pour les mêmes soins, mais bien plus onéreux. Bref, on rigole bien et on rentre le soir « barbouillés de cerises par des chemins bordés de palissades grises. », comme dit le poète André Rivoire.
Ah, la belle vie, le dimanche, à la fête des Gueux !
On en oublie presque que le lendemain, il faudra pointer à l’aurore pour une longue journée de travail.
Nous reviendrons voir si la goélette a pu remonter jusqu’aux quais du Cap Horn, car grand-père s’est lié de sympathie avec le capitaine Olsen, un rude gaillard qui ne parle pas un mot de français et, cela va de soi, grand-père n’en sait pas davantage en norvégien. Néanmoins, ce sont deux hommes de mer et Olsen raconte, tandis que grand-père acquiesce en hochant gravement la tête.
— Qu’est-ce qu’il a dit le monsieur, pépé ?
Grand-père me caresse les cheveux en souriant et me glisse à l’oreille :
— C’est un secret. Je te dirai ça tout à l’heure, à la maison.
Demain, c’est sûr, j’aurai une nouvelle histoire du commandant Olsen perdu dans les glaces et qui, pour survivre, a dû manger du phoque cru pendant un mois ; ou encore, la fois où il a tué une baleine d’un seul coup de harpon en plein dans l’œil, sauvant ainsi de la famine toute une tribu d’esquimaux qui dérivait sur un iceberg. Depuis, bien entendu, ce sont ses frères de sang, à la vie, à la mort.
Un rude gaillard qui n’a pas froid aux yeux, ce capitaine Olsen !
Le reflux a commencé ; grand-père n’a pas besoin de montre pour voir la renverse, il est temps de rentrer sous peine « d’attraper des pironneaux », version douarneniste de « se faire engueuler », ce qui pend au nez des retardataires quand la soupe est servie.
Nous remontons lentement au long des façades ternes, car la ville est grise d’un gris triste et mouillé. Les maisons sentent la pauvreté, du linge sèche aux fenêtres, des odeurs de chou bouilli assaillent nos narines au hasard d’une porte mal fermée, d’une fenêtre entrebâillée.
On entend des cris, des chansons, des querelles, parfois le claquement d’une main sur une joue, suivi de hurlements. Alors grand-père roule de gros yeux :
— J’aurais pas voulu la recevoir, celle-là !
Chez grand-mère, la soupe sent bon et le petit fourneau à charbon de bois sur lequel elle fait chauffer ses fers entretient une douce chaleur dans l’atelier.
— Tu manges la soupe avec nous, décide mémé.
Je suis ravi et je rejoins grand-père dans l’arrière-magasin qui sert de cuisine.
De son couteau de poche qui tranche comme un rasoir, grand-père taille de fines lamelles dans un pain bien rassis. Il accomplit cette tâche avec une méticulosité extrême qui requiert toute son attention.
Sur la cuisinière à charbon, le pot houarn9 laisse échapper une vapeur délicieuse qui embaume toute la petite pièce.
Tonton Jean et tante Hélène sont arrivés. Ce sont les deux cadets de la fratrie et ils ne sont pas encore mariés. Jean, qui a dû renoncer à sa vocation de marin, est apprenti prothésiste dentaire, et Hélène se forme à la dactylographie pour devenir secrétaire. Je les adore tous les deux. Jean me fait des petits bateaux en cire avec des chutes récupérées chez son dentiste, et Hélène, avec sa si belle voix, nous apprend des chansons qu’avec mes cousines Huguette, Jacqueline et Annie, on récitera à deux voix.
Mémé sert la soupe, une vraie soupe de maçon comme dit grand-père. Pour qu’elle soit réussie, assure-t-il, il faut que lorsqu’on y enfonce la cuillère, elle y reste plantée toute droite.
De ce point de vue, elle est parfaite. Grand-mère poursuit la distribution : chacun a le doit à une carotte, deux pommes de terre, un oignon et une feuille de chou.
— Mémé, j’aime pas les oignons !
— Tu n’aimes pas les oignons ? dit pépé. C’est le meilleur ! Tu me donnes ta part ?
Je la lui abandonne sans regrets.
Ensuite, le lard, qui a fait de gros yeux jaunes sur la soupe, est partagé équitablement. La dégustation se fait dans un silence religieux. Puis grand-mère sort du four de la cuisinière un plat de terre dans lequel quatre pommes cuites ont admirablement rissolé. Mémé, qui calcule tout au plus juste, n’avait visiblement pas compté sur un convive supplémentaire. Grand-père se sacrifie :
— Puisque tu m’as donné ton oignon, je te donne ma pomme.
Comme je suis honteusement favorisé, mémé me gratifie d’une noix de beurre qui fond sur ma pomme brûlante.
Nous sommes en 1943, en pleine guerre. Un morceau de beurre est un trésor inestimable. On m’a vanté les mérites du chocolat, mais je n’en ai jamais goûté. Chez madame Renaud, l’épicière de la rue du Chapeau Rouge, il y a au mur une belle affiche sur laquelle on voit une petite fille en jupe et bottines, appliquée à écrire sur un mur jaune, en lettres capitales, CHOCOLAT MENIER. Évidemment, ça donne envie. Les réclames, c’est fait pour ça, mais il y a belle lurette que les étagères sont vides.
Tante Hélène, sur un vieux vélo, fait le tour des cousins de grand-mère qui sont restés dans leurs petites fermes dans la campagne du Cap Sizun et qui, de ce fait, ne subissent pas les rigueurs du ravitaillement comme les gens de la ville. Elle ne revient jamais bredouille, rapportant au petit bonheur la chance quelques œufs, des pommes de terre, un morceau de lard salé comme celui qui a fini dans la soupe ce soir, un demi-poulet, des pommes, parfois un peu de blé que grand-mère réduit en farine dans son moulin à café (qui n’a pas vu un grain de café depuis bientôt trois ans) pour faire une sorte de pain et parfois, luxe inouï, un quart de beurre soigneusement emballé dans un « papier beurre » qu’on lavera soigneusement, après l’avoir méticuleusement raclé, pour une prochaine utilisation. Grand-père passe tous les matins aux halles où il rencontre des marchandes qu’il a connues lorsqu’il faisait la pêche. Elles se souviennent de lui :
— Ah, c’est toi qui es là, François ? Tiens, j’ai une araignée qui est extrémisée. Envoie-la avec toi. Si tu la mets dans l’eau de suite10, elle sera an teuzar11.
Et François revient rue de la Providence fier comme Artaban, tenant par les pinces un butin qui n’est plus en état de recevoir l’extrême-onction car la pauvre bête a rendu l’âme – si tant est que les araignées de mer aient une âme – depuis belle lurette.
Ça ne fait rien, elle ira dans la grande marmite où l’eau bout en permanence et on s’en régalera.
Grand-père et grand-mère sont logés petitement au-dessus du magasin. Ils ont leur chambre sur la rue de la Providence et Jean et Hélène se partagent le petit débarras qui donne sur la grande cour derrière la maison. Hélène bénéficie d’un divan et Jean déplie un lit-cage métallique que l’on replie dans la journée.
Évidemment, il n’y a pas de salle de bains – il n’y a même pas d’eau à l’étage – et la toilette se fait sommairement dans une cuvette posée sur une petite table au-dessus de marbre, sous laquelle il y a le seau de tôle émaillée pour les nécessités nocturnes.
Le samedi, tonton Jean et tante Hélène se payent le luxe d’une douche aux bains municipaux.
Après cette expédition avec grand-père et cette korfen12 de soupe, mes yeux se ferment. J’entends Hélène parlementer avec Mélanie. Quelque chose se trame, certainement. Finalement, elles décident de me coucher par terre, entre le lit de son frère et le sien. Elle a disposé une grosse couette de plumes qui me fait une sorte de nid et a jeté sur moi une couverture. Je ne l’ai même pas sentie faire, je dors déjà, bien au chaud, sécurisé par tout l’amour qui irradie autour de moi dans cette pauvre pièce où le plâtre grisâtre du plafond est fendu de longues lézardes.
Quand je me réveille, au matin, je suis seul. Je me demande où je suis et soudain, je me souviens. Je suis chez mémé Marot. Une pressante envie me pousse vers le seau et c’est pépé qui vient à mon secours. Je me lave les mains dans la cuvette, je me dépicousse les yeux, j’enfile ma culotte, mon pullover et mes galoches de carton bouilli à semelle de bois – que pépé va nouer – et me voilà prêt à affronter la journée.
Mémé est depuis longtemps à l’œuvre : elle a allumé son fourneau à charbon de bois et s’attelle au blanchissage des faux-cols que les bourgeois de la ville confient à ses soins experts, en pestant contre ces avaricieux qui, pour n’avoir pas à payer leur blanchisseuse trop souvent, conservent leur faux-col tout un mois, ce qui les rend pratiquement indécrassables.
Grand-père m’a préparé mon petit-déjeuner dans un grand bol : une soupe de café – comme hier on avait eu une soupe de légumes – qui n’a de café que le nom, celui-ci ayant été remplacé par de la chicorée.
Comme il n’y a ni lait ni sucre, le brouet est particulièrement amer. Qu’importe, j’ai faim, et quand on a faim, on ne fait pas le difficile.
J’entends la clochette qui annonce l’ouverture de la porte du magasin, puis la voix chaleureuse de mon père :
— C’est un garçon ! Où est petit Jean ?
Pour la famille, j’ai toujours été petit-Jean par rapport à grand Jean, mon père.
Je me précipite :
— Papa !
Il me regarde avec des yeux rieurs et m’embrasse. Je grimace, il ne s’est pas rasé, ça pique. Ça ne lui ressemble pas car, chaque matin, il se fait de la mousse avec son blaireau et passe son rasoir sur le cuir de sa ceinture qui fait office d’affûtoir. Puis il se rase soigneusement.
— Félicitations, mon garçon, me dit-il. Tu as un petit frère !
— Ça alors ! Un petit frère ?
— Oui, il s’appelle Gildas.
C’est un prénom assez peu usité.
Grand-père marmonne en exagérant son accent douarneniste :
— Judas ? On n’a pas idée d’appeler ce pauvre enfant Judas !
Évidemment, il fait exprès. Je m’insurge :
— Gildas, il s’appelle Gildas !
Il se rend :
— Ah, Gildas… Alors ça change tout. C’est joli, ma foi.
Et il m’embrasse, et il m’embrasse encore. Voilà pourquoi j’étais confié aux bons soins de Mélanie et de François !
— Vous prendrez bien un café, Jean ! invite ma grand-mère.
Il accepte, bien sûr, et nous voilà tous les quatre autour de la petite table de la cuisine. Papa raconte que tout s’est bien passé, que Renée, ma mère, est à la clinique du docteur Le Pape et que tout va bien.
Dans l’après-midi j’irai avec Mélanie et François faire la connaissance de mon petit frère qui est vraiment très petit.
*
Comment une famille douarneniste se retrouva à Quimper.
Suite à une pêche miraculeuse en 1927 – d’un coup de senne13, il avait chargé à ras bord sa chaloupe de gros mulets – mon grand-père François tomba gravement malade. C’est par une nuit glaciale de février, trempé sur son bateau non ponté, qu’il contracta une pleurésie. Il resta plusieurs semaines entre la vie et la mort et ne s’en sortit que grâce aux bons soins de grand-mère, mais tellement affaibli qu’il ne fut plus jamais en état d’exercer son dur métier. Grand-mère, repasseuse de son état, n’avait pas trouvé dans la ville un pas-de-porte où exercer son industrie. À Douarnenez, la pêche connaissait alors un incroyable essor, et le moindre emplacement commercial se vendait à prix d’or.
Ayant eu connaissance de la situation précaire dans laquelle la famille se trouvait, Daniel Flanchec, le maire communiste de la ville, vint voir grand-mère pour lui proposer l’aide que la commune dispensait aux indigents.
Proposition que grand-mère prit très mal : « Moi, aller tendre la main, monsieur le maire ? Jamais ! Tant que je pourrai travailler, je gagnerai le pain de mes enfants ! » Et comme à Douarnenez elle ne pouvait pas travailler, ce fut l’exode.
Grand-mère emprunta une charrette à bras, y entassa son pauvre mobilier, son mari malade et les deux plus petits enfants, Jean et Hélène, et se mit dans les brancards. Les deux aînées, Marie-Josèphe et Renée, ma mère, suivaient à pied en poussant la carriole dans les côtes. Sans connaître l’expression, grand-mère avait brûlé ses vaisseaux, il n’y avait plus de retour possible.
La providence vint à son secours car, dès son arrivée en ville, elle trouva à louer un local dans la rue de la… Providence, justement. L’emplacement, quoiqu’un peu excentré, était proche du cœur de la ville et plutôt mal famé. Les bourgeoises ne s’y hasardaient guère. Là subsistaient tant bien que mal des petits métiers : monsieur Duprat cordonnier, madame Ollivier débitante de vin, les demoiselles Pétillon rempailleuses de chaises et cardeuses de matelas, madame Henry épicière, monsieur Riou boucher, madame Quéau mercière, madame Tanneau y vendait des blouses et des chemises, madame Marmier des boutons, un maréchal-ferrant, un rémouleur, un raccommodeur de faïence et de porcelaine qui réparait aussi les parapluies victimes d’une bourrasque trop forte…
Le local en question se composait d’une boutique donnant sur la rue, avec une arrière-boutique à usage de cuisine. À l’étage, comme déjà évoqué, deux pièces logeaient toute la famille.
Dans la pièce donnant sur la rue, grand-mère installa des planches sur deux tréteaux en guise de table, ainsi que son fourneau à charbon de bois pour chauffer les fers à repasser, puis elle se mit à l’ouvrage.
Elle avait fait peindre les boiseries encadrant sa vitrine en bleu pâle. Sur le fronton, on pouvait lire en grosses lettres blanches la raison sociale : Blanchisserie Fine et sur la vitre de la porte : Mme Marot.
La qualité de son travail ne tarda pas à être reconnue et elle s’attacha bientôt la clientèle exigeante des bourgeois quimpérois.
À Douarnenez, le rez-de-chaussée de la maison du Rosmeur fut loué à un couple de retraités.
Exilé loin de son port natal, loin de la mer, grand-père s’étiolait. Il errait comme une âme en peine entre les halles, où les étalages de poissons et de crustacés lui rappelaient son métier perdu, et le port de Quimper qui avait pris le nom d’un bistrot, le Cap Horn, où de grands voiliers venaient encore décharger des marchandises venues des mers du Nord (bois résineux) du pays de Galles (charbons) ou des vins de Bordeaux.
Comme on l’a vu, dès que je sus marcher, il m’entraîna dans ses errances, s’arrêtant parfois au palais de justice pour écouter bouche bée les plaidoiries des maîtres du barreau. Certains procès attiraient les foules. C’était dans ce palais de justice que Guillaume Seznec avait été jugé et condamné au bagne pour le meurtre de Quémeneur, un politicien affairiste dont on n’avait jamais trouvé le cadavre. Cette sentence avait divisé l’opinion bretonne entre les pros et les anti-Seznec comme l’affaire Dreyfus avait divisé la France, un demi-siècle plus tôt.
Je m’entendais bien avec mon grand-père François. Il racontait de si merveilleuses histoires !
*
Les Marot étaient une vieille famille de marinspêcheurs de Douarnenez qui comptait sept enfants : Olympe, la sœur aînée, Marie, mon grand-père François, l’aîné des garçons, Pierre, Mathieu, Jules et Aline, la petite dernière.
De complexion chétive, mon grand-père François fut pourtant embarqué comme mousse à l’âge de sept ans sur une chaloupe sardinière, l’Anastasie.
Bien que le patron, Bernard, fût un brave homme, la vie était rude sur ces chaloupes non pontées.
Comme tous les malheureux enfants embarqués dans ces esquifs précaires, il reçut plus de coups de sabot et de taloche que de témoignages d’affection.
De ces tâches trop dures exercées trop tôt, il devait garder une scoliose qui lui permit, à quelque chose malheur est bon, d’échapper à la conscription et à la terrible guerre de 14/18.
Ainsi formé à la dure, il devint rapidement maître pêcheur, si bien que la famille se cotisa pour lui offrir son premier bateau alors qu’il avait dix-huit ans.
Grand-mère n’était pas, comme François son mari, originaire de Douarnenez. Ses parents, René et Catherine Goyat, venaient de Mahalon, dans le Cap Sizun. Paysans pauvres, ils avaient perdu la même année leur vache et leur cheval et s’étaient donc trouvés totalement ruinés. Dans l’impossibilité – faute de cheval – de cultiver leurs maigres terres, ils s’étaient donc rapprochés de Douarnenez, la ville de toutes les prospérités où fumaient les hautes cheminées de briques rouges d’une cinquantaine d’usines. René Goyat avait tout de suite trouvé à s’employer en qualité de manœuvre chez Lemarchand, une conserverie de poissons. Le malheureux devait y mourir asphyxié en nettoyant une chaudière à l’usine.
Le couple s’était établi au Golvez, au fond de l’anse du port de Tréboul, où Catherine, la mère, tenait un estaminet et préparait des casse-croûte pour les marins qui rentraient de mer.
René et Catherine eurent quatre enfants : Marie, Jean-Marie, Joseph et Mélanie, ma grand-mère. Marie, l’aînée, entra en religion à Marmande où, sœur converse car pauvre et sans perspectives pour la communauté de toucher quelque héritage, elle mourut sous le voile en pleurant son Douarnenez perdu. Mon arrière-grand-mère Catherine mourut dans le train en allant visiter la tombe de sa fille à Marmande ; et aux premiers jours de la Grande Guerre, grand-mère Mélanie perdit ses deux frères Jean-Marie et Joseph.
Mélanie restait seule au monde. En l’espace de dix ans, elle avait perdu son père, sa mère, sa sœur et ses deux frères. Comble de malheur, sa première fille, Éléonore, mourut au berceau.
Voilà pourquoi notre grand-mère Mélanie, si vaillante, si dévouée, si attentive à la peine des autres, garda toute sa vie un gros chagrin au fond du cœur.
*
J’étais, à ce qu’on m’a dit, un charmant bambin qui fit, dans les premiers temps de son existence, le ravissement et la fierté de ses parents.
Mais, c’est bien connu, il ne faut pas se fier à l’eau qui dort. Je devais, au fil des ans, trahir honteusement les grandes espérances que l’on avait mises en moi.
D’abord, le charmant bambin révéla vite un caractère coléreux que mon père réprima tout de suite de la manière forte : quand je piquais une colère, il me prenait sous son bras, ouvrait le robinet en grand et me collait la tête sous le jet. À demi-noyé, j’étais bien contraint de me taire, mais cette méthode vigoureuse n’allait pas sans laisser de traces et, aujourd’hui encore, j’étouffe et je panique quand je bois la tasse en me baignant.
Mon grand-père François usait d’une méthode plus douce et infiniment plus efficace : quand je commençais, pour une raison ou pour une autre, à trépigner, il me disait d’un air désolé : « Le diable est entré dans votre corps ? » Et il me repoussait doucement : « Allez donc, je ne vous cause plus ». Le voussoiement était alors la marque d’un profond désamour. Dans une discussion animée, il n’était pas rare d’entendre un protagoniste à court d’arguments s’exclamer : « Je suis fâché de vous, je vous cause plus ! »
C’était là une sentence extrêmement grave.
Rageur, je quittais la pièce, généralement en tapant du pied. Il ne fallait pas longtemps pour que je m’ennuie de grand-père qui me racontait de si merveilleuses histoires. Alors, timidement, je revenais vers lui et il feignait tout d’abord de ne pas me voir. Puis, sentant mon embarras, son regard se posait sur moi et il demandait d’un ton indifférent : « Ah, vous êtes là ? » Je répondais timidement : « Oui, pépé ». « Le diable est sorti de votre corps ? » « Oui, pépé ». « Bon, venez faire du noillic, alors !14»
Je ne me faisais pas prier pour escalader ses genoux et je demandais timidement : « Tu me racontes une histoire, pépé ? »
Alors, sans se faire prier davantage, il entamait l’interminable histoire de Joclair et Beausoleil, deux personnages auxquels il arrivait les plus invraisemblables aventures. On ne savait pas qui, de l’enfant ou du vieillard, s’amusait le plus.
Grand-mère, tout en repassant ses coiffes, écoutait le récit et haussait les épaules avec réprobation : « Ma gue permetted… sotoniou tout ! Vous allez rendre droche ce pauvre enfant ! » Ce qui pourrait se traduire par « Ce n’est pas permis toutes ces bêtises, vous allez rendre ce pauvre enfant idiot ! »
Le pauvre enfant vivait sur les genoux de l’ancêtre des moments d’intense bonheur. Et tant pis s’il en est resté un peu droche.
Parfois, pourtant, certaines choses me paraissaient si invraisemblable que je m’inquiétais : « C’est vrai, pépé ? »
Et il affirmait, la main sur le cœur : « Mais gast ar guron15, bien sûr qu’elle est vraie, mon histoire, d’ailleurs, je viens de l’inventer ! »
Si ça n’était pas là une garantie de véracité !
Car, si ce bon grand-père avait une incroyable faculté d’invention, grand-mère, elle, en était totalement dépourvue et prenait tout au pied de la lettre. Elle ne voyait dans ce que son mari me racontait qu’un invraisemblable tissu de mensonges. Et, dans le classement de ses valeurs, le mensonge arrivait dans le peloton de tête des gros pêchés. Elle nous ressassait : « c’est pas bien de mentir… Il ne faut pas voler… quand on donne sa parole, c’est sacré… »
Bien sûr, tous ces principes étaient excellents et je me suis toujours efforcé de ne pas trop m’en écarter, mais elle ne faisait pas la différence entre le mensonge et l’imaginaire.
Un peu plus tard, devant la famille réunie, on me fit mourir de honte. J’étais allé passer quelques jours de vacances chez le parrain de ma mère, un ancien sous-officier de cavalerie qui faisait office de vétérinaire à Douarnenez. Le tonton René, héros de la guerre 14/18, avait fini son temps avec le grade de « maréchal-soignant » comme d’autres sous-officiers étaient « maréchaux-ferrants ». Après la Grande Guerre, les petites fermes bretonnes étaient nombreuses et ne connaissaient pas encore le tracteur. Le marc’h labour16 était donc l’animal indispensable à la ferme et, du fait de son expérience militaire, le tonton René s’y entendait comme personne pour les soigner. C’était donc un personnage important qui « avait du foin dans ses bottes » – qui était riche. Les pauvres, eux, n’avaient que de la paille pour leurs sabots. Et ils n’avaient pas de bottes !
Il habitait au cœur de Douarnenez, rue du Pont, une vaste maison ceinte d’un haut mur avec une grande cour, des hangars, et des écuries.
Le dernier né de tonton René et de tante Hélène, Jean-Noël, était un petit tardillon venu bien longtemps après ses deux sœurs et son frère mais qui était tout de même mon aîné de cinq ans.
Dans cette grande cour, il y avait les chiens de chasse du tonton René, des poules, des lapins et aussi une chatte.
J’adorais jouer avec cette bête. La tante Hélène Bossenec – on lui donnait encore son nom de jeune fille pour qu’il n’y ait point de confusion avec l’autre Hélène, la jeune sœur de maman – me confia que la chatte allait bientôt avoir des petits et que, si je voulais, elle m’en donnerait un.
Je me pris aussitôt à rêver que j’avais moi aussi mon petit chat et, de retour à la maison, je fis à la famille extasiée une description lyrique des chatons, de leur façon d’être, de se comporter… Bref, je dus y mettre tant de conviction que je trompai mon monde et que, moi-même, je finis par croire à l’existence de ces merveilleux chatons.
Quelques jours plus tard, la tante Hélène Bossenec, passant à Quimper, vint comme il se doit rendre visite à la famille. Ma mère la remercia bien sûr de m’avoir hébergé et lui fit compliment d’avoir de si jolis petits chats.
Tante Hélène s’exclama, surprise : « Les petits chats ? Mais ils ne sont pas encore nés ! »
Tous les regards se tournèrent vers moi, je me recroquevillai sur ma chaise.
Furieux de s’être laissés prendre à mon récit, les grands me tombèrent sur le râble :
« Tu n’es qu’un menteur ! », dit mon père sévèrement.
Et ma mère, vexée, renchérit : « De quoi j’ai l’air ? »
Et grand-mère rajouta sa sentence : « Ce n’est pas beau de mentir ».
Grand-père m’adressa un clin d’œil complice qui me réconforta. Il était vraiment le seul qui me comprenait.
Parfois, il me lisait des histoires dans de gros bouquins cartonnés et je trouvais cela tellement merveilleux que j’avais fort envie, moi aussi, de connaître le secret de la lecture. Avec son aide, et celle de Sœur Angèle que je présenterai plus loin, je sus lire très tôt.
Cet épisode me rendit fort circonspect et, dès lors, je gardai mes rêves bleus pour moi.
*
Tranchées.
Comme on l’a vu, je suis né aux premiers jours de la guerre, à une époque où le parking la Tour d’Auvergne était encore un vaste espace nu cerné de hauts platanes sur lequel se tenait le marché aux chevaux. Avant la guerre et l’avènement progressif de l’automobile, le cheval était le premier collaborateur du cultivateur.
Au labour, il tirait la charrue, et pour aller en ville, on l’attelait à la charrette.
Le grand marché aux chevaux de Quimper était donc le précurseur du salon de l’automobile et toute la paysannerie des environs s’y précipitait, qui pour acheter un nouvel animal, qui pour vendre les siens.
Au Moyen-Âge, c’était une terre d’asile entourée de couvents. Il subsiste de cette époque trois bâtiments imposants : celui des dames de la Retraite, le Sacré-Cœur de Jésus devenu le lycée Brizeux, un établissement de grande réputation où les jeunes filles de bonne famille faisaient leurs humanités sous les férules aussi vigilantes qu’impitoyables de mademoiselle Lemasson, directrice, et madame de Kermadec, surveillante générale. Depuis, l’agriculture a cédé la place à la culture et à la caserne du 118e Régiment d’Infanterie ; on ne joue plus les gaîtés de l’escadron mais du théâtre sérieux dans un bâtiment imposant, beau comme une cage à poules.