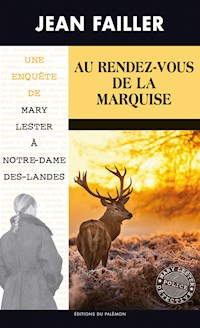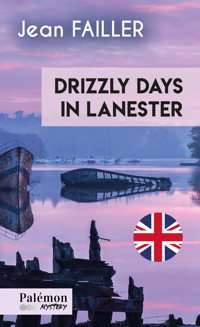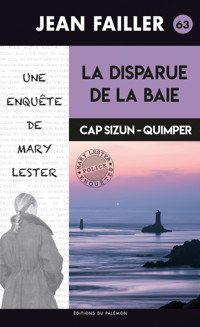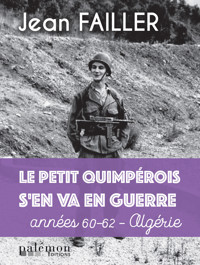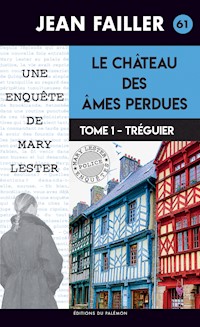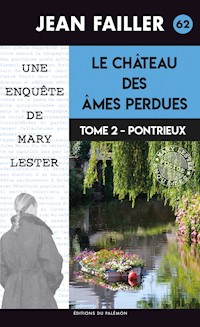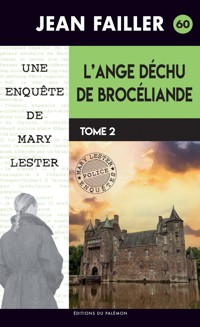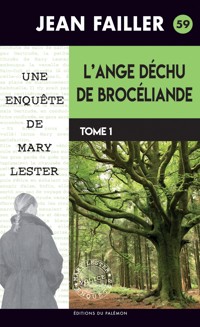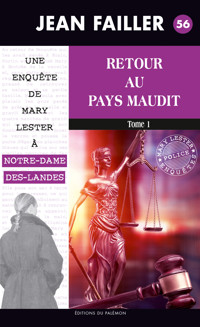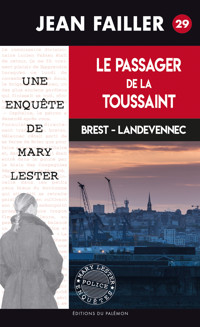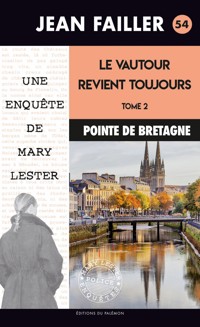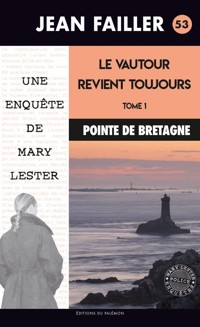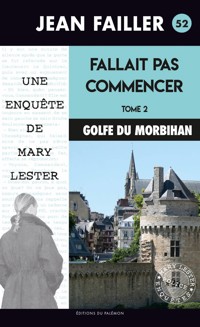Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes de Mary Lester
- Sprache: Französisch
Un paysage sauvage et maritime devient le lieu d'une étrange scène de crime.
Une interminable plage de sable fin balayée par les vents de l’Atlantique, un célèbre comédien en quête de solitude et une cavalière de concours hippiques venue entraîner son cheval sur cette grève...
D’immenses bâtiments de béton édifiés au ras des marais par les Allemands pendant la Guerre 39-45 afin de concasser des galets destinés à construire leur mur...
C’est dans ce décor magnifique et désolé que le comédien et la cavalière vont se rencontrer et découvrir, au cours d’une promenade sentimentale, le corps sans vie d’une jeune femme.
Impliquée bien malgré elle, Mary Lester est priée par sa hiérarchie de se pencher sur cette mort mystérieuse.
S’agit-il d’un tueur en série ? Un handicapé mental qui erre sur la palud semble faire un coupable idéal... Mary Lester se met en quête de la vérité.
Découvrez la cinquantième enquête de Mary Lester, à la recherche d'un mystérieux tueur sur la côte Atlantique.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Le petit plus, c’est le ton humoristique employé. Les dialogues sont savoureux et l’art de la dialectique n’échappe pas à Mary Lester qui sait renvoyer dans les cordes l’adjudant de gendarmerie revêche." - Blog Les lectures de l'oncle Paul
"Jean Failler et son héroïne sont malicieux, c'est aussi pour cela qu'on prend un vrai grand plaisir à lire leurs aventures. C'est à la fois sérieux et drôle ; sérieux parce que la mort d'une personne c'est rarement joyeux et drôle parce que les réparties de Mary Lester et du capitaine Fortin le sont souvent." - yv1, Babelio
"Un policier sympathique et rafraîchissant.. Tout se passe dans la baie d'Audierne entre Audierne et la pointe de la Torche" - zabeth55, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Failler est un ancien mareyeur breton devenu auteur de romans policiers, qui a connu un parcours atypique ! Passionné de littérature, c’est à 20 ans qu’il donne naissance à ses premiers écrits, alors qu’il occupe un poste de poissonnier à Quimper. En 30 ans d’exercice des métiers de la Mer, il va nous livrer pièces de théâtre, romans historiques, nouvelles, puis une collection de romans d’aventures pour la jeunesse, et une série de romans policiers, Mary Lester.
À travers Les Enquêtes de Mary Lester, aujourd'hui au nombre de cinquante-neuf et avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus, Jean Failler montre son attachement à la Bretagne, et nous donne l’occasion de découvrir non seulement les divers paysages et villes du pays, mais aussi ses réalités économiques. La plupart du temps basées sur des faits réels, ces fictions se confrontent au contexte social et culturel actuel. Pas de folklore ni de violence dans ces livres destinés à tous publics, loin des clichés touristiques, mais des enquêtes dans un vrai style policier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Les ouvrages de Jean Failler sont disponibles à la Bibliothèque Sonore du Finistère.
CE LIVRE EST UN ROMAN.
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
REMERCIEMENTS
Jean-Claude Colrat
Delphine Hamon
Lucette Labboz
Michèle Le Gall
Myriam Morizur
Marie Perceval
Nathalie Simon
Isabelle Stéphant
À tous les fidèles lecteurs qui ont accompagné Mary Lester au cours de sa tumultueuse carrière, en gage de reconnaissance et d’amitié.
J. Failler
Chapitre 1
Chaque fois qu’Armand Demaisieux parcourait les sentiers sableux de la baie d’Audierne, lui revenaient en mémoire des souvenirs déjà lointains de l’extraordinaire petit hôtel d’Iroise perché à l’extrémité de la Pointe du Raz.
C’est son ami Maurice Roney qui, un jour de spleen, l’avait entraîné dans cet établissement du bout du monde, où il venait fréquemment entre deux tournages pour se nettoyer le cerveau (à l’époque, le mot « se ressourcer » n’avait pas encore fait fortune.)
— Tu comprends, lui avait dit son aîné, là-bas on est à l’abri de tous les peigne-cul de Saint-Germain-des-Prés.
Et pour cause ! L’hôtel d’Iroise ne pouvait se prévaloir de la moindre étoile car l’établissement, qui comptait douze chambres rudimentaires, n’avait été électrifié qu’à la fin des années cinquante et n’avait connu le chauffage qu’au début des années quatre-vingts.
Et puis au début des années quatre-vingt-dix, alors qu’une horrible zone commerciale avait défiguré le site, le gouvernement avait décidé de classer la Pointe du Raz comme « grand site national ». Il convenait donc de faire table rase de toutes les constructions qui parasitaient la majestueuse pointe de granite enfoncée dans la plus tumultueuse des mers.
Les marchands de ce temple de la nature qu’est l’austère Pointe du Raz avaient été refoulés dans les terres, et avec eux on avait mis à bas l’hôtel de légende de Marie Le Coz qui avait vaillamment résisté aux plus monstrueuses tempêtes d’Ouest. La fureur des hommes est parfois aussi aveugle que celle des éléments et la pauvre bâtisse n’avait pas pesé lourd face aux bulldozers des démolisseurs.
Les pétitions de quelques nostalgiques dans son genre n’avaient pas réussi à faire fléchir la résolution de politiques désireux de rendre au Raz et à sa pointe leur caractère sauvage, effaçant toute trace du passage de l’homme et de ses automobiles.
Voilà, une page était tournée mais Armand Demaisieux, sociétaire de la Comédie-Française et acteur de cinéma très en vogue, avait gardé la nostalgie de la cassine au toit d’ardoise, minuscule point blanc dans ce site écrasant et pourtant havre de grâce pour les amants en quête de solitude.
Il avait donc déplacé son lieu de villégiature quelques kilomètres plus au sud, sur une palud aussi rase et aussi déshéritée que celle du raz de Sein, près du village bigouden de Tréguennec que les surfeurs de toute la région avaient choisi pour ses hautes déferlantes qui se brisaient inlassablement sur la côte dans un fracas de fin du monde.
Sous la tempête comme sous le soleil, Armand Demaisieux passait là des heures heureuses en solitaire avec de bons livres, une bonne cheminée et de grandioses balades au long des étroits sentiers de sable bordés d’oyats, de ravenelles et de lamiers pourpres, offrant avec délectation son visage à l’âpre haleine chargée d’embruns portés par le vent du large.
La marée basse avait découvert une immensité de sable blanc qui éblouissait quand le pâle soleil d’hiver parvenait à trouer les nues. Au loin, les longues houles venues du milieu de l’Atlantique dessinaient une ceinture de mousse écumante là où commençait la terre. L’Océan semblait faire patte de velours avant de remontrer ses crocs en se lançant impétueusement à la conquête de cet espace que terre et mer se partagent équitablement depuis la nuit des temps, l’estran.
À cinquante ans, et presque autant de films tournés, Armand Demaisieux avait acquis une confortable aisance financière car, contrairement à bien d’autres artistes, il n’était pas une cigale et il ne se soumettait à l’obligation de paraître que dans le cadre des promotions obligées, lorsqu’un nouveau film sortait en salle.
Et s’il y faisait bonne figure, l’exercice le rebutait de plus en plus au fil des ans. Les journalistes, toujours friands de petits scandales et d’anecdotes croustillantes, restaient sur leur faim et, dépités, le qualifiaient volontiers de misanthrope, voire de mal embouché, ce qui le laissait de glace et le faisait même sourire.
Mince, de haute taille, d’une élégance très british, il posait sur le monde un regard vif, souvent bienveillant mais parfois désabusé.
À sa grande surprise, car il se croyait seul sur cette dune qui semblait ne jamais devoir finir, il aperçut une silhouette solitaire qui s’avançait vers lui. Agacé, il changea de direction pour éviter l’importun mais celui-ci ne semblait pas plus désireux que lui de faire une rencontre. Il changea également de direction, si bien que, sans le vouloir, les deux seules âmes présentes sur la palud en ce temps de Toussaint firent une route de collision comme on dit dans la marine et, le sentier étant particulièrement étroit, il était inéluctable qu’ils se rencontrassent.
Demaisieux n’avait pas changé l’allure de son pas, mais il lui sembla que l’autre personne avait ralenti le sien, comme si elle redoutait cette rencontre. Puis, il lui sembla qu’elle traînait la patte et enfin il devina, sous le ciré jaune et le bonnet de laine noir qui lui couvrait la tête, une silhouette féminine.
Galamment, lorsqu’ils furent presque au contact, Demaisieux s’effaça pour laisser le passage.
La jeune femme – car elle lui parut jeune – fit également un pas de côté, ce qui lui arracha un gémissement.
Alarmé, Demaisieux s’enquit :
— Vous vous êtes fait mal ?
— Ce n’est rien, dit-elle avec un sourire un peu crispé, tout à l’heure je me suis bêtement tordu la cheville, et voilà que je recommence !
Elle le rassura d’un sourire :
— Mais ce n’est pas grave, je vous remercie.
— Vous allez loin comme ça ?
— Je rentre à l’hôtel de la Pointe…
Demaisieux s’exclama :
— Mais c’est au moins à quatre kilomètres !
— Vous croyez ?
— Oui. Ce n’est pas très loin de chez moi et j’y prends régulièrement mes repas.
La jeune femme s’étonna :
— Vous avez une maison par-là ?
Il acquiesça :
— Oui… enfin, je dispose d’une maison…
Il sourit :
— Oh, ce n’est qu’un très modeste penty1 qu’un de mes amis a retapé et qu’il met généreusement à ma disposition.
Elle hocha la tête :
— Vous en avez de la chance !
Il acquiesça une nouvelle fois :
— Oui, on peut le dire, les maisons sont rares sur la palud2… Elle fit un pas et, esquissant un sourire qui avait tout d’une grimace :
— Il ne faut pas que je tarde. Bonne journée !
Elle reprit sa route en claudiquant. Demaisieux, immobile, la suivit du regard jusqu’à ce qu’elle disparaisse dans un creux de dune. Puis, troublé, il se décida brusquement à faire demi-tour et suivre l’inconnue.
Il n’eut pas un long chemin à faire pour la retrouver. Assise sur le bord du chemin, elle avait ôté sa chaussure et se massait la cheville en grimaçant.
Il s’inquiéta :
— On dirait que c’est plus grave que vous ne le pensiez !
Elle eut un sourire contraint :
— Ça va aller, je vous remercie.
Il secoua la tête avec commisération en regardant la cheville gonflée :
— Mais non, vous savez bien que ça ne va pas aller !
La dune était déserte et un vent fort soufflait de la mer, agitant les touffes d’oyats comme des chevelures folles.
Il s’assit auprès d’elle pour s’abriter de ce vent qui semblait forcir avec le flot montant et ajouta :
— C’est bien imprudent de partir randonner sur un terrain aussi accidenté avec de simples tennis !
— C’est vrai, reconnut-elle un peu sèchement, mais cela étant établi, qu’est-ce qu’on fait ?
Il proposa :
— Vous allez vous appuyer sur moi et nous allons regagner votre hôtel. Ensuite, il faudra vous faire soigner.
Elle s’inquiéta :
— Vous voulez me conduire aux urgences ?
Il avait décelé une fêlure d’inquiétude dans sa voix. Certaines personnes sont mortellement angoissées à la simple idée de devoir aller à l’hôpital.
— Je ne pense pas que ce sera nécessaire, dit-il en regardant la cheville fine, légèrement enflée. Si vous voulez faire une halte dans mon gîte, qui est plus proche que votre hôtel, je vous propose un bain d’eau froide très salée suivi d’un bandage serré. Ensuite je vous ramènerai à votre hôtel en voiture.
Il lui adressa un bon sourire :
— Une bonne nuit de repos là-dessus devrait suffire à remettre les choses en place.
Elle questionna à brûle-pourpoint :
— Vous êtes médecin ?
Il sourit :
— Absolument pas, mais j’ai tout de même appris des rudiments de secourisme. Soigner une foulure en fait partie. Cependant, finies les longues marches pour quelque temps.
— Il n’était pas dans mes intentions d’aller aussi loin, assura-t-elle. En fait, je devais faire une balade à cheval et il s’est trouvé que le maréchal-ferrant passait ce matin au club de la Torche et que ma monture ne serait pas prête à temps. Alors, en attendant, j’ai décidé de marcher et la magie des lieux a fait que je me suis laissé emporter. C’est bête, hein ?
— Comme tous les accidents, acquiesça-t-il. Mais je ne me suis pas présenté : Armand Demaisieux, actuellement en vacances.
Elle lui tendit une jolie petite main en souriant :
— Enchantée, Florence de Saint-Marc, cavalière.
Il serra la petite main avec chaleur :
— C’est un métier, ça, cavalière ?
Elle lui répondit sur le même ton :
— Et vacancier, c’est un métier ?
Il rit :
— Touché ! Armand Demaisieux, comédien.
Elle s’exclama :
— Oh, Monsieur Demaisieux ! Excusez-moi ! Je savais bien que votre visage me disait quelque chose.
— Il n’y a pas d’offense, sourit-il.
— Si je m’attendais à trouver pareille célébrité sur la palud de Tréguennec un soir de novembre…
Le comédien expliqua :
— Chaque fois que je termine un tournage, je viens sur cette côte sauvage pour retrouver la vraie vie, loin des contraintes qu’impose mon métier.
— Voilà le pourquoi des vacances de Toussaint !
Elle laissa passer un temps de silence et ajouta :
— C’est drôle, les raisons de ma présence ici en cette saison sont un peu analogues aux vôtres. Je rentre du grand concours hippique international de Berlin et Artaban, comme moi, avait besoin de souffler un peu.
— Artaban ?
— C’est mon cheval. Artaban du Hallier de Paimpont, mon plus fidèle compagnon.
Il salua, admiratif :
— Avec un tel nom il doit avoir au moins huit quartiers de noblesse !
Elle rit :
— Huit ? Vous êtes loin du compte, cher Monsieur ! Artaban a un pedigree à faire pâlir de jalousie la reine d’Angleterre.
On la sentait très fière de son bel alezan. Elle ajouta :
— Je viens ici car je peux le faire galoper sur la grève. L’eau salée est excellente pour ses articulations.
Il la taquina en souriant :
— Comme pour les vôtres ?
Elle lui rendit son sourire :
— Nous verrons ça !
Après un temps de silence un peu embarrassé, elle demanda :
— Montez-vous à cheval ?
Demaisieux fit une grimace :
— Moins bien que vous certainement, dit-il. Mais pour tourner dans des films de cape et d’épée, j’ai dû apprendre les rudiments.
— Les rudiments seulement ?
— Oui, pour les scènes les plus épiques, je suis doublé par des cascadeurs professionnels.
Elle le taquina à son tour :
— C’est de la triche !
Il reconnut :
— Vous avez raison, mais la production ne veut pas courir le risque que je me blesse en cours de tournage.
Et il ajouta, pour se dédouaner :
— Il faut bien que les cascadeurs gagnent leur vie !
— Vu comme ça… reconnut-elle. Et elle ajouta :
Ça vous irait que nous fassions une balade à cheval ensemble un de ces jours ?
Il accepta sans hésiter :
— Avec le plus grand plaisir !
Il lui offrit son bras pour qu’elle puisse marcher sans trop s’appuyer sur sa cheville endolorie, puis par un chemin creux, ils arrivèrent au gîte du comédien.
C’était une adorable maison basse faite de blocs de granit qui paraissaient d’autant plus gros que la maison était enfoncée dans un repli de dune qui la protégeait des vents de la mer.
— Mais c’est magnifique ! s’exclama la jeune femme sincère.
Le comédien poussa la porte en ogive et recommanda à son invitée :
— Baissez bien la tête, les premiers habitants de cette demeure devaient être des nains pour avoir conçu des ouvertures aussi basses. J’aime mieux vous dire qu’ici le confort est plutôt sommaire : l’eau provient d’une citerne qui recueille la pluie du ciel et on doit se contenter de toilettes sèches.
Il rit :
— C’est plutôt spartiate, mais je m’en accommode très bien.
— Comme je vous comprends, dit-elle.
Il la fit asseoir dans un fauteuil devant la grande cheminée de granit où se mourait un feu qu’il raviva en y jetant deux poignées d’aiguilles de pin et quelques billettes de chêne. Puis il lui prodigua les soins que nécessitait son état, avec une extrême douceur.
Il avait fait chauffer de l’eau et, quand la cheville douloureuse fut soigneusement bandée, il servit un thé accompagné de petites galettes au beurre salé tout en devisant aimablement de tous ces petits riens qui, mis bout à bout, font les meilleurs souvenirs de vacances.
Enfin, il raccompagna la jeune femme à son hôtel dans la petite voiture qu’il avait louée à un garagiste du bourg.
Ils dînèrent ensemble à l’hôtel de la pointe et se quittèrent en se promettant de se revoir.
Ce fut fait dès le lendemain quand il vint prendre de ses nouvelles.
Florence allait mieux. Un médecin consulté assura que les premiers soins avaient été parfaitement assurés par le comédien, et qu’à l’aide d’une canne anglaise, Florence de Saint-Marc pourrait se déplacer tout à fait normalement.
Ils se retrouvèrent donc avec plaisir et, tout en papotant, traversèrent la plage de Pors Carn, laissant derrière eux la pointe de la Torche, et atteignirent la civilisation qui curieusement, au-delà de la route, commençait par le musée préhistorique. Derrière un muret de pierres sèches couvertes de lichen on apercevait des stèles, des allées couvertes faites d’énormes blocs de granit et des vestiges regroupés là par des archéologues du siècle passé.
Au-dessus de la grève, le Gwen ha Du, l’austère drapeau breton noir et blanc, claquait fièrement au vent, accoté à un pavillon de moindre taille, rouge et or, l’oriflamme des barons du Pont, devenue par extension l’emblème du pays bigouden.
— Est-ce que vous me permettez, pour vous remercier de votre sollicitude, de vous offrir une galette chez Marie-Cath ? demanda-t-elle.
— Comment refuser une galette chez Marie-Cath ! s’exclama Demaisieux. Cependant…
— Cependant quoi ?
— Cependant je suis un peu vieille France et je n’ai pas l’habitude de me faire inviter par une jeune femme.
Elle sourit malicieusement :
— Vous préférez les vieilles ?
Il ne répondit pas, et sourit. Autant l’admiration excessive de ses fans le gênait, autant la délicieuse impertinence de la jeune cavalière le ravissait. Elle n’avait rien d’une vamp, mais il émanait d’elle un charme indicible.
Il la prit par le bras et la guida vers une petite table libre. L’odeur de la galette complète au lard grillé lui mettait déjà l’eau à la bouche.
Depuis la paillote blottie dans un creux de dune, on apercevait la pointe de la Torche bordée de l’écume blanche produite par les rouleaux venus du large qui venaient s’y briser inlassablement.
Les oyats frissonnaient sous le vent et quelques canots, à l’abri précaire d’une pointe rocheuse défendant un mouillage de fortune, faisaient vaillamment face à la lame, encensant comme des chevaux rétifs à la longe, au bout de leurs corps-morts.
Au bar composé de planches rustiques, quatre hommes à la carrure épaisse échangeaient d’une voix rude sur le temps, la pêche, les prix en criée et aussi sur toutes ces réglementations nouvelles et stupides que des incompétents trop payés là-bas, à Bruxelles, inventaient pour leur pourrir la vie.
Depuis l’arrière-bar où s’activaient cuisiniers et serveurs, Marie-Cath promenait un regard bleu sur son domaine, se déplaçant tantôt pour accueillir des clients connus de longue date tantôt pour s’enquérir des impressions de nouveaux venus, toujours avec une bienveillante et attentive élégance.
Sans qu’il parût y avoir la moindre tension, une activité de ruche régnait sous cet univers de toiles tendues que, par moments, une rafale de vent gonflait comme les voiles d’une nef immobile.
Et la mer était là, toute proche, tantôt verte, tantôt bleue, « glaz » comme disent les Bretons qui semblent avoir inventé ce mot pour définir l’indéfinissable et changeante couleur de l’immense masse liquide toute couronnée de blanc.
Saisis par la magie des lieux, Demaisieux et sa compagne, acagnardés l’un contre l’autre, s’attardèrent à contempler le spectacle inouï que la nature, puissante et débonnaire, leur offrait en cette fin de journée d’automne.
Un pâle soleil parvenait par instants à percer les nuages gris et bas, projetant une lueur trop vive sur cet univers glauque.
1. Petite maison paysanne.
2. Ou palue : signifie marais en vieux français. C’est un milieu apparemment hostileà l’homme car marécageux, que l’on appelle de nos jours une zone humide.
Chapitre 2
La Toussaint était toujours une période de mélancolie et d’enchantement pour Mary Lester. De mélancolie car elle pensait plus ardemment à ses chers disparus, à sa mère, qu’elle n’avait jamais connue car elle était morte en la mettant au monde. C’était là une de ses grandes douleurs et elle préférait être seule pour mélancoliser à sa guise.
Elle ne manquait jamais de fleurir la tombe de ses grands-parents, qui l’avaient élevée et dont elle conservait un souvenir ému.
En cette période sacrée, toute intrusion extérieure aurait été très mal perçue. Ses amis le savaient, tout comme son patron, le commissaire divisionnaire Fabien, qui lui octroyait, sans qu’elle ait à la réclamer, une semaine de vacances à cette époque. Voilà pour la mélancolie.
L’enchantement était dans le fleurissement éclatant de la ville. À cette occasion les jardiniers municipaux se surpassaient. Au long de l’Odet qui traversait la ville, des jardinières suspendues aux rambardes de vieux fer pendaient d’extraordinaires touffes de chrysanthèmes aux riches couleurs où les ocres se mariaient à des bruns roux d’où jaillissaient comme des feux d’artifice des jaunes d’or éclatants ou de sanglantes inflorescences écarlates.
À marée haute, cette exubérante floraison se reflétait dans le vert des eaux saumâtres qui remontaient de l’estuaire.
Pour la circonstance, Mary ne bougeait guère de sa petite maison de la venelle du Pain-Cuit, sa fidèle amie Amandine était ravie d’avoir « sa » Mary pour elle toute seule et de pouvoir lui mijoter les petits plats dont elle avait le secret.
Pour autant elle restait discrète, mais pas inactive car, après avoir préparé un excellent déjeuner, fait la vaisselle et rangé la cuisine, laissant Mary à ses rêveries, elle s’affairait dans le jardin à préparer la terre pour les plantations de printemps.
Mary appréciait cet après-midi de détente dans son canapé, devant un feu de bois, en relisant les auteurs qui avaient enchanté sa jeunesse. Son héros favori, en cette période de méditation, était le capitaine Hornblower, passé par ses mérites – et par la grâce de Cécil Scott Fitzgerald, son père littéraire – de l’état de novice à celui d’amiral de sa Très Gracieuse Majesté.
Elle se rendait compte qu’il lui fallait toujours, fût-ce par personne interposée, de l’action, de l’aventure, des plaies et des bosses.
Avec les tribulations du cap’tain Hornblower, elle n’était pas déçue !
Elle ne lui trouvait qu’un défaut, celui de n’être pas français, mais bien sujet britannique, autrement dit notre ennemi héréditaire.
Mais baste, le temps des vaisseaux à trois ponts et à triple rangée de canons était loin et il y avait prescription. On ne montait plus à l’abordage du vaisseau ennemi le sabre entre les dents et désormais, quand on faisait la guerre, il fallait prendre bien garde à ne tuer personne !
Près d’elle, sur le canapé, Mizdu somnolait, apparemment heureux d’être auprès de sa maîtresse, ronronnant lorsque la main de Mary glissait sur son beau pelage noir. Qui l’aurait observé attentivement eût pu voir sa paupière s’ouvrir brièvement et son œil d’émeraude flamboyer le temps d’un instant. Il ne fallait pas se tromper, le grand chat était en veille, prêt au besoin à se transformer en machine de guerre pour défendre son périmètre.
Lasse de lire, Mary se leva, s’installa au piano et, après avoir fait quelques gammes pour délier ses doigts, elle attaqua la Sérénade de Schubert. Amandine, qui était dans le jardin, lâcha immédiatement ses instruments aratoires pour venir tendre l’oreille à la porte.
Elle était totalement sous le charme lorsque la sonnerie du téléphone vint interrompre cet instant de grâce. Agacée, Amandine se précipita dans la cuisine d’où provenait l’insistante sonnerie. Toute à sa musique, Mary n’avait pas entendu ou pas voulu entendre. Ce fut donc Amandine qui se chargea de répondre, d’une manière bien peu amène. Madame Lester n’était pas là… Non elle ne savait pas quand elle rentrerait, et d’ailleurs, appelait-on les honnêtes gens pendant leurs congés ?
Un ricanement déplaisant se fit entendre dans l’appareil et une voix rocailleuse laissa tomber :
— Holà, honnêtes, c’est vite dit !
Amandine sentit le rouge lui monter au front.
Elle riposta avec indignation :
— Vous n’êtes qu’un malotru !
Puis elle raccrocha rageusement et activa la fonction « silence » en marmonnant : « Tu peux toujours essayer de rappeler, espèce de… »
Elle ne précisa toutefois pas l’espèce à laquelle elle assimilait le jean-foutre qui lui avait gâché la Sérénade.
Mary, alertée par les éclats de voix, poussa la porte :
— Qui était-ce, Amandine ?
— Un grossier personnage ! dit sa vieille amie avec humeur. Un malotru qui ne s’est même pas présenté et qui a laissé entendre que vous n’étiez pas honnête !
Mary fronça les sourcils :
— Qui était-ce ?
— Je vous dis qu’il ne s’est pas présenté !
— Que voulait-il ?
— Il demandait après vous.
Puis elle ajouta, boudeuse :
— Je croyais que vous étiez en vacances !
Mary assura :
— Mais je suis en vacances.
— Alors on n’a pas besoin de vous téléphoner !
C’était catégorique. Pour Amandine, le téléphone était une machine infernale et sa sonnerie stridente préludait le plus souvent à un départ rapide de Mary pour une de ces expéditions dont elle revenait parfois un peu cabossée.
— C’était peut-être Yann, suggéra Mary.
Amandine balaya la suggestion :
— Yann ? Sûrement pas ! Il ne m’aurait pas causé comme ça, et d’ailleurs, j’aurais reconnu sa voix.
— Alors, peut-être mon père ?
— Le commandant ? Ah non ! Sa voix je la connais aussi, comme celle de Fortin et de monsieur Fabien.
Mary bâilla :
— Bah, on verra ça demain.
— Vous ne jouez plus ! déplora Amandine avec des trémolos dans la voix.
— Allez si, tiens, puisque c’est vous. Je vous joue le Nocturne de Chopin, et après, je m’accorde une petite sieste.
Chapitre 3
Bien qu’il se crût protégé par son âge contre une telle mésaventure, au bout de quelques jours passés en compagnie de Florence de Saint-Marc, Armand Demaisieux dut en convenir : un charme étrange l’avait saisi, Cupidon était passé, le comédien était amoureux, éperdument, irrémédiablement amoureux.
Et, comble de bonheur, l’intrépide cavalière répondait à ses sentiments.
Ils avaient galopé sur l’interminable grève qui s’étend de la Torche à Audierne, déjeuné dans les meilleurs restaurants d’alentour, visité des musées, des expositions, assisté à des concerts, toujours ensemble, la main dans la main comme des ados.
Le pire était qu’il ne se sentait même pas ridicule. Aurait-il vu un presque quinquagénaire se comporter de la sorte qu’il s’en serait moqué et aurait marmonné : « Le barbon et le tendron… on se croirait dans une comédie de Labiche… ».
Sarcasme d’ailleurs inapproprié pour ce qui le concernait, car à l’approche de la cinquantaine, Demaisieux, s’il n’était plus un jeune homme, restait un homme jeune et séduisant. Quant à Florence, qui avait coiffé Sainte-Catherine depuis dix ans, il émanait de sa silhouette sportive un charme subtil autant qu’irrésistible. Elle n’était pas à proprement parler « un tendron », ce qui pour Demaisieux ajoutait à sa séduction.
Depuis un mariage raté avec une starlette écervelée en ses vertes années, Demaisieux s’était juré de ne plus commettre la folie qui consistait à attacher une femme à sa vie.
Des femmes… Il en avait eu à satiété évidemment ! Et des belles ! C’est le métier qui voulait ça. Mais on ne lui avait jamais connu de liaisons qui eussent duré plus qu’un mois.
Et voilà que tout soudain, en moins de huit jours, il était prêt à envoyer tous ses beaux principes par-dessus les moulins.
Florence, quant à elle, ne lui avait pas caché ses précédents échecs sentimentaux. Des fiançailles rompues, de brèves liaisons avec des sportifs qui ne cherchaient que le plaisir d’un soir… autant de déceptions, de désillusions qui l’avaient laissée défiante et désabusée. Elle avait fini par s’accoutumer à la solitude jusqu’à ce jour où une cheville tordue l’avait précipitée dans les bras de celui qu’elle considérait peut-être hâtivement (mais n’est-ce pas le propre des coups de foudre ?) comme l’homme de sa vie.
Tout a une fin, hélas ! Le comédien devait impérativement regagner la capitale car le tournage d’un nouveau film était imminent. Le contrat qu’il avait signé l’engageait pour la mi-novembre et son billet d’avion était retenu de longue date.
C’était donc la dernière journée qu’il passait avec Florence et tous deux avaient le cœur lourd.
S’il avait pu, il aurait envoyé ce maudit contrat au diable, mais Armand Demaisieux était un homme de parole. On ne revient pas sur ce qui est signé et, au cinéma, le flash-back n’a cours que sur l’écran.
La jeune femme avait souhaité, pour cette première séparation, qu’ils refassent, comme un pèlerinage, le chemin qu’ils avaient parcouru lors de leur première rencontre.
Ils allaient donc, au long de la piste sableuse bordée d’oyats, silencieux, la main dans la main, appuyés l’un à l’autre pour lutter contre le vent frisquet qui soufflait d’ouest, chacun perdu dans ses pensées, échangeant parfois quelques brèves paroles.
L’air était limpide et frais. La dune exhalait son parfum de ravenelles et de mélisse qui se mariait heureusement avec l’âcre senteur de la marée basse.
Sur la grève, la masse incongrue d’un blockhaus de béton s’enfonçait lentement mais sûrement dans le sable. Cette pièce de défense construite par la Wehrmacht lors de la dernière guerre était censée s’opposer à toute tentative de débarquement venue de la mer.
La longue étendue sableuse qui s’étirait sur une trentaine de kilomètres entre Saint-Guénolé et Audierne paraissait en effet convenir particulièrement bien à une offensive maritime et les stratèges nazis n’avaient pas manqué de s’en apercevoir, édifiant dans les dunes, tout au long de la côte, des nids de mitrailleuses qui avaient disparu sous le sable.
On sait que finalement les Alliés préférèrent la Normandie pour leur débarquement. Ce monstrueux blockhaus qui avait été le cœur du système de défense avait en fait été construit en retrait de la côte, à une centaine de mètres de la dune de galets qui, à l’époque, protégeait l’arrière-pays des assauts de la mer.
Les ingénieurs de la Wehrmacht avaient immédiatement vu en ces milliers de tonnes de galets d’excellents matériaux pour construire leur célèbre mur de l’Atlantique et une usine de broyage avait fonctionné pendant les années d’occupation.
La guerre finie, les galets avaient disparu et les furieuses vagues venues du centre de l’Atlantique avaient fait reculer de plusieurs centaines de mètres l’ancienne limite de la dune à qui ces barbares avaient, à des fins guerrières, enlevé sa protection naturelle, laissant l’arrière-pays inondé d’eau de mer pendant les longs mois d’hiver.
Des canards, des sarcelles et parfois des oies bernaches peuplaient ce no man’s land déshérité, trouvant protection, provende et tranquillité dans les joncs et les typhas car les plus enragés chasseurs ne s’aventuraient guère dans ces prairies tremblantes où – et ce n’était pas une légende – nombre d’imprudents avaient perdu pied pour ne plus jamais reparaître.
L’usine de broyage maintenant ouverte à tous les vents subsistait toujours, lugubre bâtisse qui rappelait de sinistres souvenirs aux derniers survivants de cette terrible époque qui se gardaient bien de l’approcher, comme si elle eût encore, après trois quarts de siècle, dégagé des ondes maléfiques.
Le vent, qui hurlait aux encoignures de la gigantesque caisse de ciment, résonnait lugubrement dans cette grande conque vide.
Armand Demaisieux qui sentit son amie frissonner s’inquiéta :
— Vous avez froid ?
Curieusement, bien qu’ils ne se fussent pas quittés de toute la semaine, il continuait à la vouvoyer. Cette marque de respect très vieille France cadrait bien avec son personnage et Florence lui en savait gré.
Elle secoua négativement la tête.
— C’est la faute du vent…
Puis elle ajouta :
— Je n’aime pas cet endroit, partons.
— Il n’est pas particulièrement réjouissant, reconnut Armand, il y règne une bien curieuse atmosphère.
— C’est pour ça que je ne l’aime pas, dit Florence en frissonnant de nouveau. Il a dû s’en passer des horreurs là-dedans !
Armand considéra la masse sinistre de ciment gris que quelques tags multicolores n’arrivaient pas à égayer.
— Je le crains, dit-il gravement. Vous avez raison, faisons demi-tour.
Florence ne se fit pas prier et tourna le dos à l’édifice lorsqu’elle sentit son compagnon se figer.
— Que se passe-t-il, Armand ? demanda-t-elle d’une voix angoissée.
— J’ai vu quelque chose… Il y a quelqu’un là-bas…
Elle voulut l’entraîner :
— Mais non, il n’y a personne !
Et, voulant se persuader, elle ajouta :
— Quelque sac plastique qui s’est accroché aux joncs. Il n’y a jamais personne dans la journée. La nuit, parfois, il y a des bandes qui organisent des rave-parties, mais pas en cette saison.
Comme il était plus grand qu’elle, il voyait mieux le terrain. Il insista :
— Mais si, je vous l’assure… Il faut que j’en aie le cœur net : je vais aller voir.
Florence serra fort la main de son compagnon.
— Je vous en prie, ne me laissez pas seule !
Il la morigéna gentiment :
— Voyons Florence, nous ne craignons rien ! Ce n’est même pas à cinquante mètres !
— Pff ! fit-elle dépitée. Quelque ivrogne ou quelque drogué qui cuve… Il n’y a que ça par ici. Et si vous alliez y perdre pied ? Ces marais ont la réputation d’être très dangereux !
— Qui que ce soit, dit-il fermement, si c’est un être humain, il a peut-être besoin d’assistance. Je vous en prie…
À regret, elle lâcha sa main et souffla d’une voix étranglée :
— Eh bien, allez-y ! Mais j’ai un mauvais pressentiment.
Armand marcha à grands pas jusqu’à la lugubre bâtisse et aperçut, couchée dans les oyats, une silhouette qui semblait dormir, le visage dans le sable.
Perplexe, le comédien s’approcha et il s’aperçut alors qu’il était en présence d’une femme.
Après un instant d’hésitation, il la prit aux épaules et tenta de la retourner. Mais la rigidité cadavérique avait déjà fait son œuvre. Visiblement, la pauvre créature était morte depuis quelques heures déjà. Il put tout de même deviner derrière les traces de sang séché qui le souillait le visage d’une jeune et jolie femme aux longs cheveux auburn. Vêtue d’un jeans et d’un vieux pull-over, les pieds nus, la jeune morte n’avait plus besoin de rien.
Les jambes trémulantes, il revint vers son amie qui, les bras croisés, frissonnait autant de peur que de froid.
— C’est une jeune femme, dit-il d’une voix blanche. Elle est morte… Je crois bien qu’on l’a tuée…
Il sortit son téléphone portable et appela les secours.
Chapitre 4
Mary Lester prenait paisiblement son petit-déjeuner sous la véranda, une sorte de jardin d’hiver tout en profondeur dans lequel s’activait Amandine qui, s’étant elle-même instituée cuisinière, jardinière, secrétaire particulière, aurait pu être désignée sous le nom de « factotum » si cette fonction avait connu une forme féminine. Las ! Il n’y en avait pas, ce qui devait bien faire enrager quelques « chiennes de garde » entichées d’écriture inclusive et autres lubies « modernes ».
Depuis le temps des Incroyables et des Merveilleuses qui mettaient leur point d’honneur à ne plus prononcer les « r », chaque époque a connu ses extrémistes du langage. D’aucuns s’en irritaient, d’autres – et Mary en faisait partie – souriaient de cette nouvelle mode. Il suffisait d’attendre, celle-ci ne tarderait pas, comme toutes les précédentes, à sombrer dans le ridicule avec leurs « incoyables » et leurs « meveilleuses » du XXIe siècle.
Dans cet espace qui recevait le soleil toute la journée (quand le temps était beau), Amandine avait disposé des étagères où elle entreposait les plantes les plus fragiles qui n’auraient pas supporté les rigueurs de l’hiver.
Il y flottait un parfum composite de fleurs séchées auquel s’ajoutait le fumet de l’excellent café que dégustait Mary Lester en se régalant d’une délicieuse baguette beurrée toute chaude encore de sa sortie du fournil. Le petit-déjeuner était pour Mary Lester un moment sacré et il n’était pas question qu’on vînt la déranger avant qu’elle en eût terminé avec ce qui était presque une cérémonie.
Pourtant, comme toute règle a ses exceptions, ce jour-là un furieux se mit à tambouriner à la porte de la rue et il y allait de si bon cœur que son tintamarre parvint aux oreilles de Mary Lester.
Irritée, elle se leva, s’approcha de la source du bruit et regarda prudemment par l’œilleton aménagé dans la porte de grosses planches pour voir qui était le casse-pieds qui troublait sa quiétude.
À sa grande surprise, elle reconnut le commissaire Fabien et jugea, à son expression renfrognée, qu’il était fort contrarié. Que se passait-il donc pour que cet homme pondéré agisse de la sorte ? Un événement extraordinaire, à coup sûr !
Intriguée, elle libéra le verrou et ouvrit la porte. Fabien était à cran, il explosa :
— Enfin, c’est pas trop tôt ! Vous êtes sourdingue ou quoi ?
— Bonjour patron, lui répondit-elle d’une voix séraphique. Que se passe-t-il ? Il y a le feu au commissariat ?
— S’il s’était agi de feu, j’aurais appelé les pompiers ! dit-il sèchement.
— Très juste ! reconnut-elle.
Puis elle s’effaça :
— Mais entrez donc !
Après une hésitation il franchit le seuil en marmonnant :
— Pardon…
Sur ces entrefaites, Amandine qui revenait du marché arriva le panier au bras.
— Qu’est-ce qui se passe ici ? demanda-t-elle à son tour en regardant le commissaire sans aménité.
Sa présence à cette heure matinale augurait mal de la suite de la journée. Il allait sûrement réquisitionner SA Mary pour quelque tâche probablement délicate mais à coup sûr dangereuse.
— Je croyais que vous étiez en vacances, ajouta-t-elle d’un ton acide en regardant Mary.
Mary soupira en regagnant la table :
— Moi aussi !
Elle posa sa main sur la tasse qu’elle avait délaissée quelques minutes pour venir ouvrir la porte au commissaire
— Amandine, voulez-vous me refaire un peu de café s’il vous plaît ? Le mien est froid.
Elle regarda Fabien qui semblait dans ses petits souliers.
— Je n’aime pas le café froid.
Elle ajouta à l’adresse d’Amandine qui s’était retirée dans la cuisine :
— Je suis sûre que le commissaire en prendra une tasse également.
Fabien grogna :
— Vous ne trouvez pas que je suis assez énervé comme ça ?
Amandine, qui n’appréciait pas la situation, glissa fielleusement :
— J’ai aussi du tilleul, ou de la verveine…
— Eh bien, Amandine ? la reprit Mary gentiment.
La tension qui était montée tout d’un coup baissa de deux crans. Le commissaire ne releva pas l’insolence et accepta l’invitation :
— Je vous remercie, un petit café, ça ira bien !
— Tout ça ne me dit pas, fit Mary toujours calme, les raisons de cette agitation matinale.
Le commissaire répondit vivement :
— Si vous aviez répondu au téléphone, vous n’auriez pas à poser la question.
— Pardon, objecta Mary, quand je suis en vacances je m’octroie le droit de couper ce maudit appareil. Est-ce interdit ?
— Bien sûr que non, mais vous avez répondu hier soir et vous avez envoyé sur les roses le major Papin !
Mary tombait du ciel :
— Moi j’ai envoyé quelqu’un sur les roses ?
— Le major Papin, parfaitement !
— C’est qui ce major Papin ?
— Le patron de la gendarmerie en pays bigouden.
Elle hocha la tête faussement admirative :
— Vous m’en direz tant ! Et il prétend que je l’ai envoyé sur les roses ?
La porte de la cuisine s’ouvrit et Amandine apparut, apportant sur un plateau un pot de café, une tasse et un sucrier.
— Ce n’est pas Mary qui a envoyé ce malpoli sur les roses, c’est moi ! affirma-t-elle d’un ton rogue.
Le commissaire la regarda, surpris. Jusqu’à ce jour, elle avait toujours été d’une extrême amabilité envers « Monsieur Fabien » comme elle l’appelait.
— Vous, Madame Trépon ? s’étonna-t-il.
Les mains sur les hanches, dans une attitude de défi, Amandine confirma crânement :
— Moi, parfaitement !
Elle servit le commissaire et demanda avec le plus grand naturel :
— Prendrez-vous une tartine beurrée ?
L’agacement du commissaire était tombé. Il soupira :
— Une tartine beurrée ? Pourquoi pas, après tout… Mais racontez-moi donc comment s’est passée cette conversation téléphonique.
— D’abord, il n’y a pas eu conversation, rectifia Amandine. Le téléphone de Mary a sonné et, comme elle était occupée, j’ai répondu. Une grosse voix m’a demandé : « Commandant Lester ? ». Alors évidemment j’ai dit non.
— Évidemment, répéta le commissaire.
— Notez bien, dit Amandine en dressant son index devant son visage, notez bien qu’il n’a même pas dit bonjour ! Est-ce que ce sont des façons ?
Le commissaire, qui venait d’être pris en flagrant délit d’incivilité – ça lui arrivait parfois mais seulement quand il était pressé –, concéda du bout des dents que non.
— Alors il m’a ordonné : « Passez-moi Lester, et grouillez-vous ! »
Elle avait croisé les bras sur son tablier bleu et fixait le commissaire.