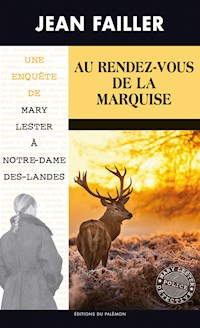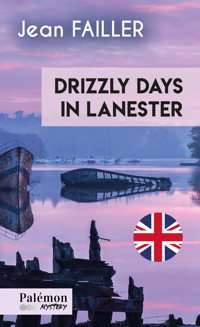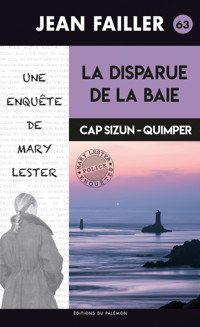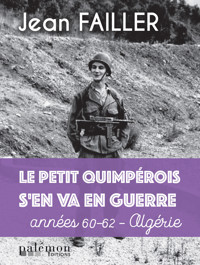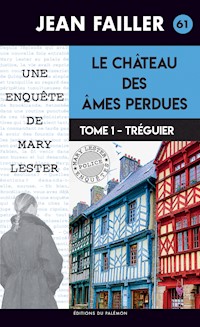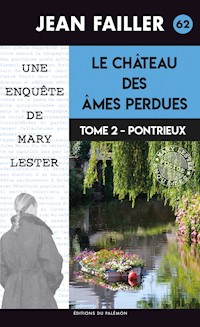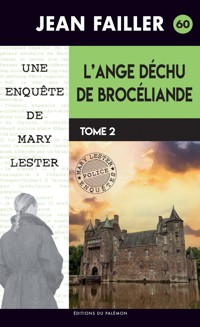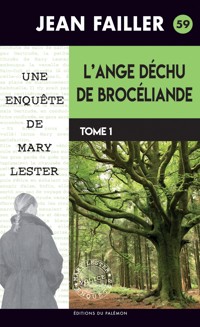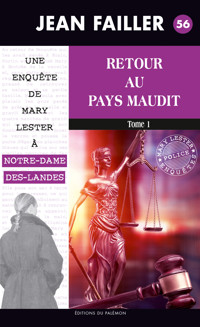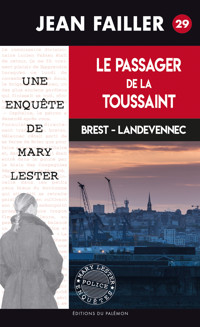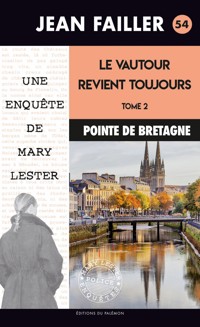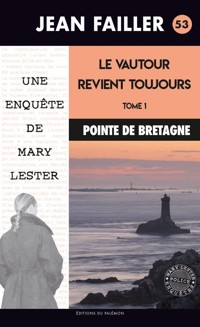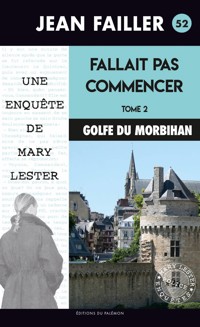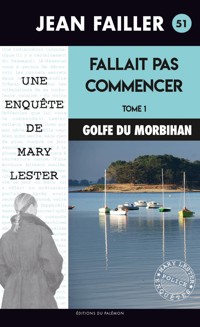
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes de Mary Lester
- Sprache: Französisch
Mary Lester, accusée à tort, est mise en prison. À sa sortie, elle fera tout pour découvrir la vérité !
La rencontre de Mary Lester avec un ancien camarade de l’école de police l’amène à fourrer le nez dans une histoire trouble mettant en cause la femme d’un officier du commissariat de Vannes – ce qui déplaît fortement au commandant Ponchon, auquel elle s’était heurtée lors d’une enquête précédente...
Un détective privé étant retrouvé mort peu après avoir reçu la visite de Mary, Ponchon en profite pour lui faire porter le chapeau et la placer en garde à vue.
Après cet épisode déplaisant, Mary poursuit discrètement ses investigations par le truchement du lieutenant Gertrude Le Quintrec, détachée du commissariat de Quimper, ravie de se trouver pour une fois en première ligne et bien décidée à se montrer à la hauteur de la tâche.
Découvrez le 51e tome d'une enquête passionnante de Mary Lester dans le Morbihan.
EXTRAIT
L’antre du petit génie de l’informatique se trouvait sous le toit. Mary sortit son appareil, et fit apparaître les photos qu’elle avait prises du commandant Borrigneau.
— Qu’est-ce qu’il te faut ? demanda Passepoil.
— Un montage. Je vais te demander quelque chose de bien particulier : tu vas aller sur un site porno, tu vas me choisir une situation bien gratinée entre un homme et une femme, et tu vas faire un montage en remplaçant le portrait de l’homme par la photo que je vais te montrer.
Passepoil la regardait, ahuri.
— Tu peux le faire ? s’inquiéta-t-elle.
— Techniquement, ça ne pose aucun problème, assura Passepoil.
— Néanmoins tu es intrigué…
— C’est le moins qu’on puisse dire.
— Eh bien, je ne t’expliquerai rien aujourd’hui, mais dans quelque temps, tu seras mis au courant.
On y va ?
Passepoil commença par faire glisser les photos du commandant Borrigneau sur son ordinateur, puis, rouge de confusion, il ouvrit un site pornographique. Des dizaines de vignettes s’affichèrent.
— Il n’y a que l’embarras du choix, dit-il.
Mary ne s’attarda pas et choisit l’image d’une bimbo plantureuse recevant, dans une position acrobatique, les hommages vigoureux d’un quadragénaire qui avait à peu près la morphologie de Borrigneau.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Pour le 51ème, l'auteur est en forme et nous emmène en Bretagne Sud puisque c'est là que Mary Lester, notre célèbre commandant de police et héroïne de toute cette série policière, est en congé forcé." - Coventgarden, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Failler est un ancien mareyeur breton devenu auteur de romans policiers, qui a connu un parcours atypique ! Passionné de littérature, c’est à 20 ans qu’il donne naissance à ses premiers écrits, alors qu’il occupe un poste de poissonnier à Quimper. En 30 ans d’exercice des métiers de la Mer, il va nous livrer pièces de théâtre, romans historiques, nouvelles, puis une collection de romans d’aventures pour la jeunesse, et une série de romans policiers, Mary Lester.
À travers Les Enquêtes de Mary Lester, aujourd'hui au nombre de cinquante-neuf et avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus, Jean Failler montre son attachement à la Bretagne, et nous donne l’occasion de découvrir non seulement les divers paysages et villes du pays, mais aussi ses réalités économiques. La plupart du temps basées sur des faits réels, ces fictions se confrontent au contexte social et culturel actuel. Pas de folklore ni de violence dans ces livres destinés à tous publics, loin des clichés touristiques, mais des enquêtes dans un vrai style policier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Les ouvrages de Jean Failler sont disponibles à la Bibliothèque Sonore du Finistère.
CE LIVRE EST UN ROMAN.Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
REMERCIEMENTS
Jean-Claude Colrat
Delphine Hamon
Lucette Labboz
Michèle Le Gall
Myriam Morizur
Marie Perceval
Nathalie Simon
Isabelle Stéphant
Prologue
Une indiscrétion informatique (il y a certainement du Passepoil là-dessous) nous a permis de découvrir les carnets secrets dans lesquels Amandine Trépon tient à jour les tribulations de sa turbulente voisine – du moins ce qu’elle peut en savoir car, si grande que soit l’affection que lui voue le commandant Lester, celle-ci laisse filtrer sur son métier ce qu’elle veut bien qu’on sache, mais rien de plus.
Jusqu’à ce jour Amandine remplissait à la plume de petits carnets à couverture noire, d’une écriture joliment moulée. Mais voilà que la modernité est entrée dans sa vie le jour où Mary lui a offert un ordinateur portable.
Après avoir rechigné, bougonné, voire pesté contre l’appareil, Amandine a découvert qu’il était infiniment plus commode que les antiques machines mécaniques sur lesquelles elle avait tapé tant d’actes et de minutes au temps de sa vie laborieuse de clerc de notaire.
Depuis, elle ne jure plus que par son « petit Mac », comme elle l’appelle familièrement, et s’en sert en mode traitement de texte avec une virtuosité éblouissante, sans se douter que, ce faisant, elle met à portée du diabolique Albert Passepoil (et de quelques-uns de ses semblables) ses pensées les plus secrètes.
Que le lecteur ne cherche pas ici de propos graveleux, ce n’est pas le genre de la fidèle Amandine ! Rien qui ressorte du carré blanc, juste des considérations quotidiennes et d’ordre général sur Mary Lester rapportées par son amie la plus proche.
Bien entendu, nous respectons le style d’Amandine, qui ne s’apparente ni de près ni de loin – le lecteur l’aura deviné – à celui plus fleuri et plus pittoresque du capitaine Fortin. Nous citons :
Voici la fin du mois de mars, cette jolie saison où l’on entrevoit enfin le bout de l’hiver.
Les hirondelles sont arrivées ce 11 mars précisément (je note chaque année l’apparition de la première de ces grandes voyageuses) et volettent allègrement autour des vieilles maisons de la venelle où, à l’automne précédent, elles ont laissé leurs nids pour aller passer l’hiver au soleil.
(En deux phrases, le lecteur est édifié : on est plus proche de la comtesse de Ségur que de San-Antonio.
Je crois que son enquête à Roscoff l’an dernier avait ébranlé Mary plus qu’elle n’avait voulu le laisser paraître.
Le méchant coup reçu sur la tête, sans parler du bain forcé dans le port de plaisance, aurait pu lui être fatal si Jean-Pierre Fortin, comme d’habitude, ne s’était porté à son secours.
Il faudra bien qu’elle prenne conscience que cette fois elle n’a pas été loin d’y laisser sa peau.
Je désespère de la voir un jour devenir raisonnable et si monsieur Fortin n’était pas avec elle pour parer les mauvais coups auxquels elle s’expose avec une inconscience qui fait frémir, où en serions-nous ? Je tremble rien que d’y penser.
Outre cela, l’infernal culot de maître Chapelain, l’instigateur de tout ce drame, l’a complètement déstabilisée. Cet aplomb insensé dans le mensonge la dégoûte plus encore que les exactions de Paoli, ce soldat perdu qui a gardé de son passage chez les légionnaires l’habitude d’obéir aveuglément au supérieur qui donne les ordres.
D’après elle, dans le civil, où il s’était retrouvé, il n’avait pas su faire la part de choses, et comprendre qu’un patron n’est pas forcément un supérieur aux ordres duquel il convient d’obtempérer sans discernement.
Son incarcération dans les geôles de la République lui avait donné le temps de réfléchir et il avait dès lors déballé ce que maître Chapelain, ce sale type, appelait avec un cynisme éhonté « sa version » des faits.
J’en reste tout indignée. Je crois bien que, plus encore que les voyous comme ce Paoli qui – je ne l’oublie pas – a essayé de tuer Mary, je déteste ces fripouilles en col blanc, comme on dit, qui s’arrangent toujours pour passer au travers des mailles de la loi.
Bien évidemment Mary a été appelée à témoigner dans le procès d’Ange Paoli car les éléments qu’elle avait recueillis exonéraient le voyou des crimes dont l’accusait maître Chapelain et accablaient le célèbre avocat qui, faute de preuves, ne put être convaincu d’avoir menti devant le tribunal mais ne trompa personne.
L’affaire est en délibéré et, selon Mary qui s’y connaît bien, on peut compter sur le célèbre fiscaliste pour la faire durer, aidé par sa batterie de conseillers tous plus retors les uns que les autres.
Mary en a tout de même tiré une consolation : la candidature de Chapelain à la mairie de Roscoff est définitivement grillée, tout comme la brillante carrière politique qu’il était en train d’échafauder pour devenir le maître du Léon et du Trégor.
Une satisfaction encore : Renevot, Moal et Cabioch, les trois affreux qui s’amusaient à persécuter les automobilistes sur le parking du vieux port de Roscoff, ont été sévèrement condamnés, notamment pour avoir tenu des propos racistes à l’encontre de l’adjudant guyanais Dieumadi. Par ailleurs, le major Bottineau a été prié de prendre prématurément une retraite « bien méritée ».
Heureusement que le commissaire Fabien – un bien brave homme ! – s’est rendu compte de l’état de fatigue extrême du commandant Lester, et qu’il lui a « infligé » un mois de repos, en la sommant de ne pas remettre les pieds au commissariat avant trente jours. Ce qui n’a pas empêché cette bourrique de se lancer à corps perdu dans une nouvelle enquête où cette fois, elle s’est trouvé confrontée à de redoutables extrémistes qu’elle a, avec le concours de Gertrude Le Quintrec et Fortin, mis hors d’état de nuire.1
Elle en avait subi le contrecoup quelque temps après et le commissaire Fabien, inquiet, l’avait fait hospitaliser pour un check-up. Ce bilan de santé n’avait rien révélé de grave, sinon une grande fatigue qui aurait pu la mener au burn-out, comme on dit maintenant.
Cette fois le commissaire Fabien s’était alarmé et lui avait à nouveau infligé, je répète volontairement le terme, trente jours de repos car, sans son autorité, elle n’aurait pas dételé.
Tout le monde ignorait quelle destination elle avait prise, sauf son ami de cœur Yann Charpentier, et moi évidemment.
Je sais qu’il la retrouve dans un hôtel du golfe du Morbihan.
1Voir C’est la faute du vent… même auteur, même collection.
Chapitre 1
Ainsi que l’avait noté Amandine, Mary Lester était arrivée la veille à Arradon. Elle avait établi ses quartiers à l’hôtel « Les Vénètes », pour les jours de décrochage complet préconisés par le corps médical.
Bien entendu, il était hors de question qu’elle se complaise dans une oisiveté totale. Elle avait loué un vélo et projetait de faire des balades dans les environs lorsque le temps le permettrait.
Et il était beau, ce temps, parce que le vent soufflait de l’est, repoussant les nuages sur l’océan, ce qui par certains côtés était une bonne chose, mais qui par d’autres l’était moins.
En effet, cette bise venue des steppes de l’Asie Centrale transperçait jusqu’aux moelles les malheureux Morbihannais, peu accoutumés à ces températures sibériennes.
Donc, toute activité vélocipédique était reportée sine die, et la belle bécane à assistance électrique qu’elle avait retenue chez un loueur allait probablement rester au garage.
Mais comme, même en vacances, le commandant Lester n’avait pas pour habitude de rester les deux pieds dans le même sabot, elle avait sorti son ordinateur et repris un à un les éléments de l’enquête qu’elle avait menée à Roscoff l’année précédente, affaire dont le dénouement allait sans doute prendre encore longtemps.1 Lors du procès auquel elle avait assisté, elle avait vite compris que maître Chapelain, ses conseils et ses relations semblaient trop forts pour que le célèbre fiscaliste soit condamné comme il l’aurait mérité. Cependant les éléments que Mary avait fournis à l’avocat de Paoli, et en particulier les photos qui démontraient que maître Chapelain s’était absenté de la réception à l’heure où sa femme était morte, laissaient planer un doute sur cet alibi. Elles avaient ébranlé les certitudes du jury, qui avait déclaré Chapelain coupable en dépit d’une plaidoirie que les gens de justice s’étaient accordés à trouver brillante.
Vingt ans. Chapelain en avait pris pour vingt ans, mais il avait immédiatement fait appel du jugement.
Les médias avaient évidemment fait leurs choux gras de cette affaire. Le scandale avait été énorme, puis le soufflé médiatique étant retombé, on était passé au scandale suivant, une denrée dont on ne manquait pas en France. Paoli, le sulfureux homme de confiance, en avait pris pour vingt ans, qu’il commençait à purger en centrale. Le patron, lui, n’était pas encore condamné et s’il perdait en appel, il était probable qu’il se pourvoirait en cassation.
L’ancien légionnaire n’avait pas les ressources financières qui lui auraient permis d’échapper à la justice ; pourtant maître Chapelain redoutait plus la vindicte de son ancien chauffeur que les rigueurs de la justice.
En légiste retors, il avait plus d’un tour dans son sac et les manœuvres dilatoires n’avaient pas de secret pour lui ni pour l’aréopage de maîtres du barreau dont il s’était entouré, mais il savait qu’un Paoli en liberté n’aurait de cesse de chercher à lui loger une balle dans le crâne, avec toutes les chances d’y parvenir tant il était rompu au maniement des armes.
Et même si Paoli restait en prison, le savoir en vie gâchait la liberté surveillée dont maître Chapelain bénéficiait en attendant un verdict définitif. L’ancien légionnaire avait en effet conservé, de son passage dans ce corps d’élite, de redoutables relations.
Comme elle l’avait annoncé au commissaire Fabien, Mary avait envisagé d’écrire un roman à partir de cette histoire. Fabien avait pris cette annonce comme une rodomontade, ce en quoi il avait eu bien tort.
Un mois de vacances, n’était-ce pas l’occasion rêvée pour revenir à un exercice auquel elle s’était déjà frottée avec quelque succès ?
Elle installa donc son ordinateur dans sa chambre, transformant une coiffeuse dont elle n’avait que faire en un plan de travail tout à fait acceptable.
Poursuivant son installation, elle s’aperçut qu’en quittant un peu vite son domicile de la venelle du Pain-Cuit, elle avait oublié sa trousse de toilette. Comme il était hors de question qu’elle reparaisse à son domicile, elle décida de se rendre à Vannes pour acheter les produits qui lui manquaient.
Ses emplettes faites, elle regagnait sa voiture en sortant du centre-ville par la porte Saint-Michel lorsqu’elle s’entendit héler par un client qui prenait une bière en terrasse.
— Hep, mademoiselle…
S’il y avait une chose que Mary détestait, c’était bien d’être interpellée de la sorte.
Elle tourna un visage mécontent vers le malotru, s’apprêtant à le mettre vertement à sa place, mais son visage s’éclaira quand elle le vit. Il s’écria en se levant :
— Ma parole, mais c’est bien Mary Lester !
L’humeur maussade de Mary s’effaça immédiatement. Elle avait reconnu une vieille connaissance.
— Perrin… Frank Perrin ! Si je m’attendais ! Mais qu’est-ce que tu fiches là ?
Le dénommé Perrin était dans la petite quarantaine. Il portait, sans ostentation et d’une façon très naturelle, une veste de tweed empiècée de cuir aux coudes, un pantalon assorti et des mocassins de cuir fauve impeccablement cirés.
Mary le toisa, admirative :
— Toujours élégant à ce que je vois.
Il plaisanta avec une fatuité feinte :
— On ne peut pas se refaire !
Mary avait gardé de ce collègue le souvenir d’un sympathique dragueur impénitent :
— Tu guettes la mouche qui viendra se prendre dans ta toile ?
Avec un sourire matois, Perrin secoua la tête négativement :
— Qu’est-ce que tu vas imaginer ? Je prends un pot, tout simplement. Je peux t’inviter ?
Elle sourit :
— Pourquoi pas ?
Elle posa son sac et s’assit sur le siège qu’il lui présentait. Perrin hésita : devait-il lui tendre la main ou lui faire la bise ?
Elle lui évita un choix difficile en lui tendant une main qu’il serra avec chaleur.
Puis, l’ayant enfin lâchée il se rassit et Mary fit de même :
— Dis donc, ça fait une paye que je n’avais plus entendu parler de toi. Qu’est-ce que tu deviens ?
Il sourit d’un air satisfait qui intrigua Mary.
— Tu es toujours flic ?
— En quelque sorte. Mais plus pour la maison poulaga.
Elle parut stupéfaite :
— Sans blague, tu fais dans le privé ?
— Tout à fait. Tu as quelque chose contre ?
Elle sourit à son tour :
— Pas vraiment…
Elle se souvenait qu’à la suite d’une enquête où elle avait fait arrêter un notable plus que douteux, une promotion sanction l’avait poussée à démissionner avec fracas.2 Par la suite elle s’était reconvertie dans le journalisme d’investigation. Perrin avait-il connu les mêmes avatars ? Le mieux était de le lui demander :
— Tu as eu des problèmes avec la hiérarchie ?
— Pas plus que les autres.
Ça pouvait vouloir dire « pas moins non plus ».
— Autant que je me souvienne, tu étais bien noté à l’école de police.
— Ouais, j’étais même passé commandant.
— Alors ?
— Alors la promotion était assortie d’une mutation dans la banlieue parisienne.
Elle pouffa : en plein dedans, Mary Lester !
Perrin se rembrunit :
— Ça te fait rire ?
— Pas du tout ! J’ai connu la même mésaventure.
— Ah bon ?
Elle lui raconta à grands traits le scandale qu’elle avait provoqué en poursuivant jusqu’au bout un homme politique en dépit des mises en garde voilées de sa hiérarchie. Et elle conclut en lui demandant :
— Ça ne te plaisait pas, la banlieue ?
— Ça ne me plaisait pas, ça ne plaisait pas à ma femme, ça ne plaisait pas à mes gosses ni à mes beaux-parents.
— Si je comprends bien, il y avait unanimité.
— Unanimité totale ! confirma-t-il.
Puis il plaida son cas :
— Tu comprends, je suis un gars du golfe, moi. Si je ne sens pas la mer tous les jours, rien ne va plus.
Elle brandit son index devant elle, pour souligner la solennité du propos :
— Mon vieux Frank, s’il y a une seule personne dans toute la flicaille qui peut te comprendre, tu l’as devant toi !
— Alors… dit Perrin.
Elle le considéra avec attention : Frank Perrin n’avait certes pas été le plus costaud de sa promotion. Il mesurait environ un mètre soixante-quinze et ne devait guère faire osciller l’aiguille de la bascule au-delà des soixante-dix kilos.
Il paraissait fluet, et l’attention qu’il portait à sa toilette pouvait le faire paraître efféminé. Cependant il cachait bien son jeu car c’était un judoka confirmé (il avait été sélectionné pour les Jeux Olympiques dans l’équipe de France et avait rapporté une médaille de bronze d’Athènes en 2004) et les quelques petits durs qui l’avaient pris à la légère n’avaient pas tardé à s’en repentir. Certains en gardaient même un souvenir cuisant.
Elle demanda :
— Tu as trouvé un job dans le coin ?
— Ouais, par un oncle de ma femme, dans une société de surveillance, La Vigilante. Ça ne te dit rien ?
Elle secoua la tête négativement :
— Rien du tout.
— C’est un ancien de la BRB, le commissaire Aymar Borse, qui a monté cette boîte à Nantes. Ça s’est développé sur tout l’ouest et comme ils désiraient ouvrir une agence à Vannes…
— Tu as postulé ?
— Non, j’ai été sollicité. On m’a offert une paye de commandant (et même un peu plus avec les primes), autant te dire que je n’ai pas hésité longtemps.
Il sourit largement en s’étirant :
— Plus de hiérarchie à me casser les c…, plus d’horaires démentiels – je dispose de mon emploi du temps – une vraie indépendance… J’ai un bateau, je fais de la voile en famille, je pêche…
Elle hocha la tête :
— Bref, le paradis, quoi !
Il tempéra :
— J’ai tout de même quelques contraintes, mais rien à côté de ce que j’ai connu.
— En quoi consiste ton boulot ?
— Je gère une trentaine d’agents de sécurité qui sont déployés selon la demande dans les entreprises de la grande distribution – c’est le plus gros de la clientèle – et aussi pour les festivités estivales comme la Semaine du Golfe…
Elle fit remarquer :
— Si je me souviens bien, c’est un gros truc, cette Semaine du Golfe ! Tu ne dois pas aller loin avec ta trentaine de gaziers.
Elle se rappelait ses mésaventures au festival des Vieilles Charrues à Carhaix, une autre manifestation, terrestre celle-là, qui drainait trois cent mille personnes. Une multitude !3
— Et pour cause, fit Perrin, il y a plus de mille vieux gréements qui viennent régater dans le golfe du Morbihan. Pour la circonstance, la maison mère, à Nantes, nous détache des agents supplémentaires.
— Je vois, dit-elle, songeuse. Comment ça se passe avec les flics locaux ? En général, ils n’aiment pas les privés.
Elle avait eu affaire à un commissaire particulièrement mollasson lors d’une enquête qui l’avait menée dans la presqu’île d’Arradon.4
— Chasségnac est toujours là ?
— Toujours. Tu le connais ?
Elle éluda :
— Un peu…
— Il approche de la quille, dit Perrin.
— Ah, fit-elle surprise, on sait qui le remplace ?
— Un certain Ponchon, un commandant qui est ici en poste depuis pas mal d’années.
— Ce salopard sévit donc toujours ?
— Je vois que vous êtes copains, rigola Perrin.
— Toujours aussi visqueux ?
Perrin pouffa :
— Eh ! On dirait que tu le connais bien.
Elle remit les choses en ordre :
— Je ne le connais pas bien, j’ai eu à le subir, ce n’est pas tout à fait la même chose. Quant aux collègues, je les plains. Ils n’ont pas fini d’en baver. Autant que je me souvienne il me semble que Chasségnac était plutôt coulant.
— Ouais, même si ça n’a jamais été un foudre de guerre, ce n’est pas le mauvais cheval, reconnut Perrin.
Et il ajouta :
— Tiens, il fait son pot de départ la semaine prochaine. Si tu es dans le coin, ça te ferait peut-être plaisir de venir le saluer ?
Elle faillit pouffer :
— J’aime autant pas, je crains qu’il n’ait pas gardé un très bon souvenir de mon passage dans son commissariat. Je ne voudrais pas gâcher la cérémonie.
— Ah… dans ce cas… fit Perrin embarrassé.
— Et puis, poursuivit-elle, je n’ai aucune envie de mondanités en ce moment, je suis en congé. J’ai un peu de mal à me relever d’une affaire compliquée où j’ai failli laisser ma peau l’an dernier.5
Il s’inquiéta :
— À ce point-là ?
Elle confirma :
— À ce point-là, oui ! J’avais enchaîné sur une autre enquête6, mais je n’avais pas éliminé les séquelles de la précédente et cette fois, mon patron a exigé que je décroche un mois.
— Un mois de vacances, admira Perrin, bien joué, Lester !
Elle le regarda gravement :
— Ce n’est pas du jeu, Frank. Il paraît que je frôlais le burn-out.
Perrin siffla entre ses dents :
— À ce point-là ?
Puis il ajouta :
— Tu m’étonnes, je t’ai toujours connue avec une pêche d’enfer.
— La pêche d’enfer, c’est un voyou qui me l’a collée sur le crâne avant de me balancer dans le port de Roscoff en pleine nuit. Si mon adjoint, le capitaine Fortin, ne s’était pas jeté à l’eau pour me repêcher, je ne serais pas avec toi en train de siroter un café.
— Ce serait bien dommage, fit Perrin avec sourire complice.
Il tendit le bras vers ce port de plaisance qui venait toucher les murailles de la vieille ville.
— On n’est pas bien là ?
Elle l’approuva :
— Mieux qu’à l’hôpital en tout cas.
Perrin eut une mimique expressive :
— Je veux bien te croire. On dirait que tu en sors.
— Justement, j’en sors.
Elle n’épilogua pas et il comprit qu’elle ne voulait pas s’étendre sur le sujet.
Il murmura, songeur :
— Je suis de plus en plus persuadé que j’ai été bien inspiré en changeant de métier.
Il but une gorgée de bière et Mary une gorgée du café qu’on venait de lui servir.
Il lui tendit la perche :
— Si je comprends bien, tu n’as pas tellement envie d’en parler.
— Tu as parfaitement compris. Je ne suis venue ici que pour m’aérer. Et pas seulement les poumons…
Elle se tapota le front :
— L’esprit surtout !
Il s’inquiéta :
— Tu t’en ressens encore ?
Elle eut un mouvement de tête évasif :
— Un peu… c’est difficile à décrire.
Il y eut un silence qui se prolongea jusqu’à ce que Perrin déclare :
— Je comprends mieux…
Elle avait gardé de Perrin le souvenir d’un jeune flic dynamique, un peu casse-cou même. Elle remarqua :
— Tu ne risques pas ça, dans tes nouvelles fonctions.
— Dieu merci, non ! Mais si je m’étais laissé embarquer dans leur prétendue promotion, c’est deux fois par semaine que je risquerais bien pis.
— Je te crois, dit-elle d’un air convaincu.
Il reposa sa chope sur le marbre du guéridon et laissa tomber :
— Dommage…
1Voir Ça ne s’est pas passé comme ça, même auteur, même collection.
2Voir La régate du Saint-Philibert, même auteur, même collection.
3Voir À l’aube du troisième jour, même auteur, même collection.
4Voir Le visiteur du vendredi, même auteur, même collection.
5Voir Ça ne s’est pas passé comme ça, même auteur, même collection.
6Voir C’est la faute du vent, même auteur, même collection.
Chapitre 2
Elle s’étonna :
— Pourquoi dommage ?
Il éluda :
— Bof… pour rien.
Elle le regarda avec curiosité, si bien qu’il se crut obligé d’en dire un peu plus :
— Quelqu’un que j’aime bien risque d’avoir de sérieux ennuis…
Mary répéta :
— Il risque d’avoir de sérieux ennuis ?
Perrin rectifia :
— Elle risque d’avoir de sérieux ennuis !
— J’aurais dû me douter qu’il y avait une nana là-dessous ! s’exclama Mary.
Il se redressa, à demi vexé :
— Ce n’est pas ce que tu crois.
Elle brandit ses mains ouvertes devant elle :
— Je ne te demande rien.
— C’est la femme d’un copain qui les a, les ennuis. Lui n’en sait rien encore, mais quand ça va lui tomber sur la tête, gare ! Surtout que Chasségnac l’a dans le nez.
Mary ironisa :
— Chasségnac a quelqu’un dans le nez ? Ce n’est pas son genre.
— Disons que c’est plutôt son successeur présumé, le commandant Ponchon. Il a senti un rival potentiel en la personne d’un autre flic du commissariat, le commandant Borrigneau.
— Borrigneau, c’est le mari de ta nana ?
— Ouais ! Mais ce n’est pas ma nana. Ponchon a sur lui l’avantage de l’ancienneté et n’entend pas lui faciliter les choses.
— Rien que de très classique, nota Mary, querelle de pouvoir… Reste à savoir lequel mangera l’autre.
Perrin fit son pronostic :
— Pour le moment c’est Ponchon qui a pris l’avantage.
Il paraissait le déplorer. Mary demanda :
— Qu’a donc fait la femme de ce Borrigneau ?
— Une connerie ! Elle a piqué un manteau de fourrure dans un magasin.
Mary le regarda, intriguée :
— Tu me charries ?
— Hélas non. Un vison à cinq plaques…
Elle écarquilla les yeux :
— Cinq mille euros ?
— Comme je te le dis.
— Ben dis donc, elle ne se mouche pas du coude, ta nana !
Perrin dégagea sa responsabilité vite fait et répéta :
— Ce n’est pas ma nana, je te dis.
— Et elle s’est fait gauler ?
— Même pas ! Elle a agi à un moment opportun, quand les agents de sécurité opèrent leur rotation.
— C’est donc dans un grand magasin que le vol a eu lieu ?
— Oui, chez Spark & Menser.
Mary connaissait cette chaîne spécialisée dans les produits Old England, surtout fréquentée par une clientèle aisée.
— On peut donc piquer un manteau de fourrure chez Spark & Menser ? ironisa-t-elle. Ils doivent pourtant disposer de moyens de contrôle sophistiqués…
— En effet, confirma Perrin.
— C’est ton agence qui s’en occupe ?
Perrin hocha la tête.
— Ouais…
— Peux-tu m’expliquer comment ça se passe ?
— Tu veux dire comment est organisée la surveillance ?
— Oui…
— C’est tout ce qu’il y a de plus classique : après vingt heures, à la fermeture, un veilleur de nuit prend la garde et effectue des rondes dans les locaux. Il est relevé à six heures par deux agents de sécurité qui décrochent à treize heures, relevés à leur tour par deux autres agents qui sont sur le site jusqu’à vingt heures et qui ne quittent pas l’établissement tant que le veilleur de nuit n’est pas sur place.
— Donc la surveillance est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre…
— Tout à fait. J’ajoute qu’il y a également des caméras qui surveillent les rayons.
Mary s’étonna :
— Et personne n’a rien vu ?
— Non, c’est le chef de rayon qui nous a prévenus de la disparition de ce manteau le lendemain matin.
Mary réfléchit :
— Pour autant que je sache, dans ce genre de magasin les vêtements portent une sorte de gros badge impossible à enlever sans un outil spécial, non ?
Perrin acquiesça :
— Tu as tout à fait raison. Et si ce vêtement badgé passe à une caisse, une alarme se déclenche.
— Donc, a priori, ce manteau n’aurait jamais dû pouvoir sortir sans que la surveillance s’en aperçoive.
Perrin acquiesça une nouvelle fois :
— Et pourtant il est sorti.
Elle sourit :
— Voilà qui est bien mystérieux. Comment expliques-tu cela ?
— Entre la relève des agents, soupira Perrin, il y a toujours quelques minutes de battement. Les gars de l’équipe montante et ceux de l’équipe descendante se connaissent. Ils se retrouvent au vestiaire pour changer de tenue et, c’est humain, ils restent quelquefois discuter.
— Il y a donc un court laps de temps pendant lequel il n’y a plus aucune surveillance.
— Hors celle du personnel des caisses, évidemment.
— Il y a donc une complicité à l’intérieur de l’entreprise…
— C’est la conclusion à laquelle je suis arrivé, approuva Perrin car c’est vraiment étroit comme créneau. Il paraît difficile de s’y faufiler en se fiant au hasard.
Il leva les épaules :
— Cependant, il y a près de trois cents employés…
Dénicher le coupable c’est chercher l’aiguille dans la botte de foin. Pour ta gouverne, nous avons retrouvé le badge dans une cabine d’essayage.
— Il était endommagé ?
— Non. Pourquoi ?
— Parce qu’il aurait pu être forcé à l’aide d’une pince coupante par exemple. S’il était intact, cela indique que le ou la voleuse disposait de l’outil spécifique utilisé par les caissières pour le retirer.
— Probablement.
— Où sont planqués ces outils ?
— Il y en a un à chaque caisse.
— Ils y sont toujours ?
Le front de Perrin se plissa :
— Comment…
— Tu as vérifié s’il n’en manquait pas ?
— Non…
Mary remarqua :
— C’était la première chose à faire !
Perrin n’avait pas l’air convaincu de l’utilité de cette démarche. Mary le regardait, intriguée.
— Qu’est-ce que tu ne m’as pas dit, Frank ?
Perrin eut un sourire contraint :
— Je ne t’ai pas dit que j’avais retrouvé le manteau.
Chapitre 3
— Tu as retrouvé le manteau ? répéta-t-elle. Mais alors, où est le problème ?
Elle questionna :
— Il n’était pas endommagé ?
— Non, il était nickel.
Le soleil se couchait sur les bateaux de ce port de plaisance qui touchait au cœur de la ville. Elle contempla son camarade d’un œil critique. Il lui rendit son regard comme s’il redoutait ce qu’elle allait dire. Déjà à l’école de police, elle était connue et crainte pour sa langue acérée. Elle n’aimait pas qu’on la mène par le bout du nez. N’était-ce pas ce que Perrin venait de faire ? Sa réaction hors sujet le laissa sans voix :
— Tu as pris du poids, toi !
Il hocha la tête.
Elle précisa sa demande :
— Combien ?
Il ne comprenait pas. Elle répéta :
— Combien ? Quatre, cinq kilos ?
— Quatre kilos cinq, exactement. Tu as l’œil !
Elle posa quelques pièces de monnaie sur le guéridon mais il protesta :
— Laisse donc !
Elle ne l’écouta pas, abandonna ses pièces et ramassa ses emplettes.
— À un de ces jours, Frank !
Il se leva et lui prit ses sacs des mains :
— Mais attends… Tu es donc si pressée ?
— Pas du tout, je te l’ai dit, je suis en congé.
— Alors…
— Alors, je ne déteste pas qu’on me raconte des histoires, surtout quand elles finissent bien, comme la tienne.
— Qui te dit qu’elle finit bien ?
— Mais toi ! On a piqué un manteau hors de prix dans un magasin que tu es chargé de surveiller, et tu l’as récupéré de manière aussi mystérieuse qu’il avait disparu. Bravo ! L’affaire s’arrête là, je suppose ?
Il protesta :
— Hélas non.
Elle se rassit :
— Ah bon… Qu’est-ce que tu veux de plus ? Pour peu que tu l’aies découvert, tu veux qu’on traduise le voleur devant les assises ?
Il siffla entre ses dents, agacé :
— Surtout pas. D’ailleurs, c’est une voleuse.
— Je ne vois pas ce que ça change…
— Alors, je vais te l’expliquer. Tu reprends quelque chose ?
Sans attendre sa réponse, il commanda un autre café et une autre bière à la jeune serveuse.
La curiosité de Mary était piquée.
Elle laissa Perrin reposer ses sacs et reprit place sur son siège tandis qu’il la considérait d’un petit air ironique.
Cela l’agaça et quand ils furent servis, elle demanda un peu sèchement :
— Où veux-tu en venir ?
— Je t’ai parlé tout à l’heure d’un certain Borrigneau…
— En effet, un commandant de police de tes amis qu’un de ses collègues jaloux a dans le nez… Rien de nouveau là-dedans, mon vieux Perrin, c’est un grand classique qui se joue dans tous les commissariats, voire dans toutes les entreprises et administrations de France et de Navarre. D’abord, quelles sont les raisons de l’antagonisme entre Ponchon et ce commandant ?
— Borrigneau est un type qui ne s’en laisse pas conter… Son dernier exploit est d’avoir fait tomber un trafiquant, un jeune homme bien sous tous rapports, brillant étudiant, qui a appliqué l’excellent enseignement qui lui avait été prodigué dans une école de commerce privée et fort onéreuse, en créant un réseau de petits dealers qui sévissaient dans les écoles.
— Joli coup ! approuva Mary.
Le visage de Perrin se plissa :
— Joli coup, si on veut.
Mary attendait la suite.
— Pourquoi si on veut ?
— Parce que cet excellent garçon n’était autre que le fils de Verdurin, un influent vice-président du Conseil régional.
— Je vois… Il y a eu des pressions ?
— Et comment ! Chasségnac a essayé de faire comprendre à Borrigneau qu’il serait prudent de fermer les yeux mais, comme je te l’ai dit, ce n’est pas le genre de Borrigneau.
— C’est tout à son honneur, apprécia Mary.
— Certes, mais pas à son avantage, souffla Perrin.
— Le fils Verdurin a-t-il été jugé ?
— Pas encore. Le dossier est en instance, ses avocats font traîner l’affaire.
— Cependant il ne perd rien pour attendre, marmonna Mary, à moins… à moins qu’il n’y ait un fait nouveau…
— Exactement ! Et ce fait nouveau serait l’inculpation de la femme de Borrigneau dans un vol. Tu piges maintenant ? demanda Perrin.
Si elle pigeait ! La manœuvre déloyale dans toute sa splendeur ! On allait proposer un marché au commandant : ou tu laisses tomber tes accusations, ou les indélicatesses de ta femme seront révélées en plein tribunal.
Après un silence, Mary demanda :
— Je suppose que lorsque tu as récupéré ce fameux manteau, tu n’as pas manqué de demander quelques explications à madame Borrigneau ?
— Évidemment ! dit Perrin.
— Et que dit-elle pour sa défense ?
— Rien. Elle pleure…
— Quel est ton sentiment ?
— À mon avis, il y a quelque chose qu’elle ne veut pas ou ne peut pas dire. Quelque chose qui s’est passé il y a peu mais qu’elle ne veut même pas évoquer.
— A-t-elle des enfants ?
— Non. Il faut te dire que la différence d’âge entre Borrigneau et sa femme est importante. Il court sur les quarante ans et elle n’en a pas trente…
Mary minimisa :
— Dix ans, qu’est-ce là ? Ils sont mariés depuis longtemps ?