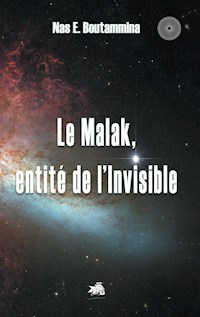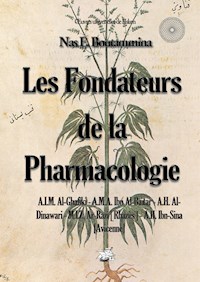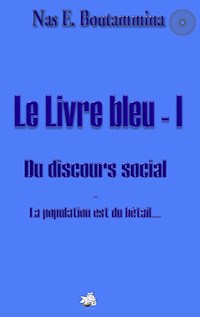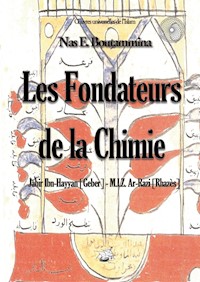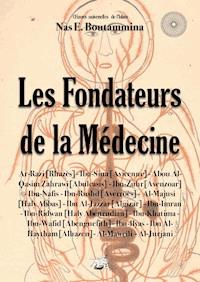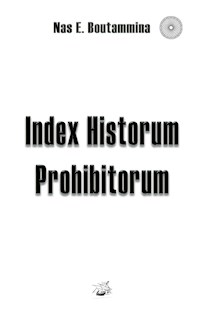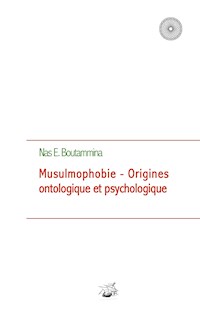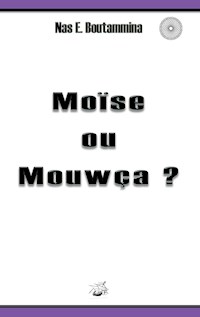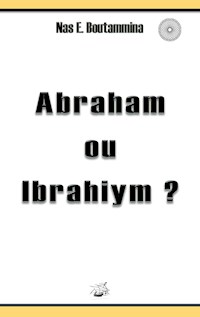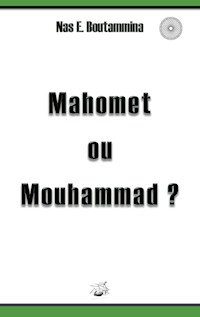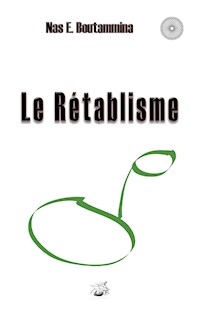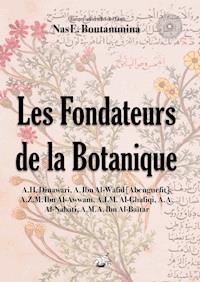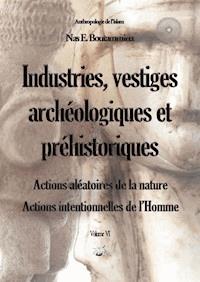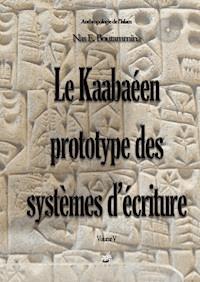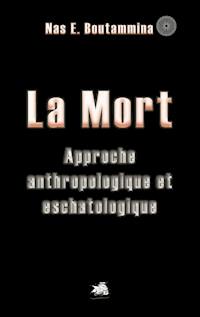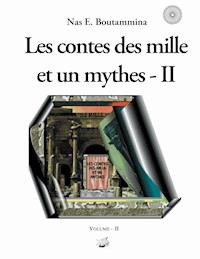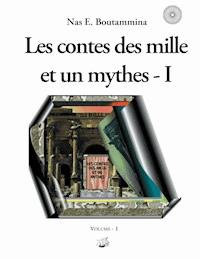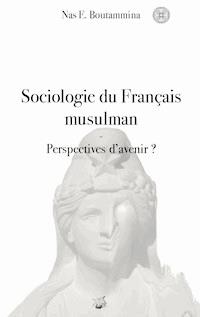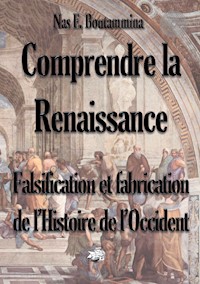
Comprendre la Renaissance - Falsification et fabrication de l'Histoire de l'Occident E-Book
Nas E. Boutammina
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Selon les dictionnaires, les encyclopédies et en somme toute la littérature, la Renaissance se définit comme « un mouvement littéraire, artistique et scientifique qui eut lieu en Europe au XVe-XVIe siècle et qui était fondé sur l’imitation de l’Antiquité gréco-romaine ». Et si la Renaissance était non pas la période de redécouverte de la Culture Antique [gréco-romaine], mais en réalité l’époque de la fabrication de ces textes, classés plus tard comme antiques, et une « volonté caractérisée de falsification de l’Histoire ». Il est évident que l'engouement effréné des notables, des humanistes, des souverains et de l’Eglise pour les manuscrits antiques pendant ces périodes du Moyen-Âge et de la Renaissance est trop surprenant, voire étrange pour qu’il soit honnête ! L’écrivain anglais George Orwell [1903-1950] déclarait : « Qui contrôle le passé contrôle le présent, qui contrôle le présent contrôle l'avenir ». Quel est donc ce passé : l’Antiquité gréco-romaine ? Et qui sont ces « penseurs grecs » ? C’est ce que cet ouvrage entreprend de dévoiler.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans les mêmes éditions
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, «Musulmophobie - Origines ontologique et psychologique », Edit. BoD, Paris [France], décembre 2009.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Jinn bâtisseurs de pyramides…? », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Jésus fils de Marie ou Hiyça ibn Māryām ? », Edit. BoD, Paris [France], décembre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Moïse ou Moūwça ? », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Abraham ou Ibrāhiym ? », Edit. BoD, Paris [France], février 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Connaissez-vous l’Islam?», Edit. BoD, Paris [France], mars 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Mahomet ou Moūhammad ? », Edit. BoD, Paris [France], mars 2010
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Jinn, créature de l’invisible », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Français musulman - Perspectives d’avenir ? », Edit. BoD, Paris [France], mai 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Judéo-Christianisme - Le mythe des mythes ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Y-a-t-il eu un temple de Salomon à Jérusalem ? », Edit. BoD, Paris [France], aout 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les ennemis de l’Islam - Le règne des Antésulmans - Avènement de l’Ignorance, de l’Obscurantisme et de l’Immobilisme », Edit. BoD, Paris [France], février 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le secret des cellules immunitaires - Théorie bouleversant l’Immunologie [The secrecy of immune cells - Theory upsetting Immunology] », Edit. BoD, Paris [France], mars 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Livre bleu-I - Dudiscours social », Edit. BoD,Paris [France], juillet 2014.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Rétablisme »,Edit. BoD, Paris [France], mars 2015. 2
e
édition.
Collection Anthropologie de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Apparition de l’Homme - Modélisation islamique - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « L’Homme, qui est-il et d’où vient-il ? - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], octobre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Classification islamique de la Préhistoire - Volume III », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Expansion de l’Homme sur la Terre depuis son origine par mouvement ondulatoire - Volume IV », Edit. BoD, Paris [France], décembre 2010.
Collection Œuvres universelles de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Médecine », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Chimie », Edit. BoD, Paris [France], octobre 2013.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Pharmacologie », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2014.
L’abbé de Cluny Pierre le Vénérable [1092-1156] déclare : «Qu’on donne à l’erreur mahométane le nom honteux d’hérésie ou celui, infâme, de paganisme, il faut agir contre elle, c’est-à-dire écrire. Mais les latins et surtout les modernes, l’antique culture périssant, suivant le mot des Juifs qui admiraient jadis les apôtres polyglottes, ne savent pas d’autre langue que celle de leur pays natal. Aussi n’ont-ils pu ni reconnaître l’énormité de cette erreur ni lui barrer la route. Aussi mon cœur s’est enflammé et un feu m’a brûlé dans ma méditation. Je me suis indigné de voir les Latins ignorer la cause d’une telle perdition et leur ignorance leur ôter le pouvoir d’y résister ; car personne ne répondait, car personne ne savait. Je suis donc allé trouver [en 1142, en Espagne] des spécialistes de la langue arabe qui a permis à ce poison mortel d’infester plus de la moitié du globe. Je les ai persuadés à force de prières et d’argent de traduire d’arabe en latin l’histoire et la doctrine de ce malheureux et sa loi même qu’on appelle Coran. Et pour que la fidélité de la traduction soit entière et qu’aucune erreur ne vienne fausser la plénitude de notre compréhension, aux traducteurs chrétiens j’en ai adjoint un Sarrasin. Voici les noms des chrétiens : Robert de Chester, Hermann le Dalmate, Pierre de Tolède ; le Sarrasin s’appelait Mahomet. Cette équipe après avoir fouillé à fond les bibliothèques de ce peuple barbare en a tiré un gros livre qu’ils ont publié pour les lecteurs latins. Ce travail a été fait l’année où je suis allé en Espagne et où j’ai eu une entrevue avec le seigneur Alphonse, empereur victorieux des Espagnes, c’est-à-dire en l’année du Seigneur 1141. »
Table des matières
Introduction
I - La Société de la Grèce antique
A - La « société » grecque
Les grandes dates selon l’occident de l’histoire des Sciences
B - La pensée anti-scientifique
C - La société gréco-romaine comme modèle civilisationnel
1 - Apports de la société grecque à l’Humanité
II - La conception gréco-romaine de l’Univers
A - Lois physiques et décrets mythologiques
B - Culture irrationnelle, magique, superstitieuse
C - Les dieux et le partage du monde - Les dieux gréco-romains « artisans de l’Univers »
III - Les «
penseurs grecs
» et leurs «
écrits
»
A - Les Grecs [et Romains] à culture exclusivement orale
B - Etude de cas : « Ecole d’Athènes »
1 - Raffaello Sanzio dit Raphaël
2 - Ecole d’Athènes observation concise
a - La représentation des arts libéraux
IV - Les erreurs des fabricants de penseurs grecs et de la culture hellénique
A - Analyse succincte de la fresque « Ecole d’Athènes »
B -Quelques traducteurs célèbres de la culture de la Civilisation de l’Islam Classique
1 - Gerbert d'Aurillac [945/950-1003]
2 - Constantin l’Africain [XIe siècle]
3 - Alfan de Salerne [1010-1085]
4 - Adélard de Bath [1080 - v. 1160]
a - La studia musulmanum
5 - Burgondio de Pise [1100-1193]
6 -Dominique Gundissalvi [1105-1181]
7 -Herman le Dalmate [1110-1154]
8 - Gérard de Crémone [1114-1187]
9 - Eugène de Sicile ou de Palerme [1130-1202]
10 - Walcher de Malvern [m. 1135]
11 -Daniel de Morley [1140-1210]
12 - Jean de Séville Hispalensis [1150-1215]
13 -Michael Scot [1175-1236]
14 - Leonardo Fibonacci [1175-1250]
15 - Robert Grossetête ou Grosseteste [1175-1253]
16 - Giles de Santarém [1185-1265]
17 - Raymond de Tolède [XIIe siècle]
18 -Marc de Tolède [XIIe siècle]
19 - Platon de Tivoli [XIIe siècle]
20 -Hugues de Santalla [XIIe siècle]
21 - Pierre de Poitiers [XIIe siècle]
22 - Alfred de Sareshel [fin XIIe-début XIIIe siècle]
23 - Roger Bacon [1214-1294]
24 - Campanus de Novare [1220-1296]
25 - Arnaud de Villeneuve [1235-1311]
26 - Jean de Capoue [1262-1269]
27 - Léon l’Africain [1488-1548]
28 - Theodor Buchmann [1504-1564]
29 - Postel Guillaume [1510-1581]
30 -Quelques traducteurs juifs
a - Petrus Alphonsi [1062-1140]
b - Jean de Séville [1090-1150]
c - Farradj Moïse ben Salem [1250-1280]
d - Ibn Tibbon famille [XIIe siècle]
○ Juda ben Saul Ibn Tibbon [1120 -1190]
○ Samuel Ibn Tibbon [1150-1230]
○ Moshe IbnTibbon [m. 1283]
e - Léon Tuscus [XIIe siècle]
C - L’Ecole de traducteurs de Tolède
1 -Histoire
2 - LeCorpus de Tolède
Les traducteurs et quelques-unes de leurs traductions
D - Compilation et confection du folklore grec
1 -Quelques idéologues et artisans de la culture populaire hellène
2 - Côme de Médicis
3 - Laurent de Médicis
E - Les scriptorium : ateliers de la copie dans la chrétienté
1 -Moine copiste
a - Art du manuscrit
2 - Quelquesmonastères ou abbayes dotés de scriptoriums
a -Monastère de Vivarium
b - Abbaye Saint-Martial de Limoges
c - Abbaye du Mont-Cassin
d - Abbaye de Fulda
e - Abbaye Royale Saint-Pierre de Corbie
f - Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire
g - Abbaye de Marchiennes
h - Abbaye de Cluny
i - Abbaye de Saint-Gall
· Bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall
j - Cathédrale Sainte-Marie de Tolède
k -Monastère de Ripoll
F - L’mprimerie : connaissance, puissance et hégémonie
1 - Imprimerie du XVe siècle
2 - Les premières imprimeries et les premiers livres en Europe
3 -Métamorphose de la pensée, de l’existence
4 - L’imprimerie dans le monde dit«musulman »
G -Qu’est-ce que la Renaissance ?
1 - Invention du terme « Renaissance »
2 - Giorgio Vasari
3 -Définition communément admise du mot « Renaissance »
V - Les «
livres
» des «
penseurs grecs
»
A - « Ecole d’Athènes » analyse succincte
B - « Ecole d’Athènes » vitrine des « penseurs » et de la « culture hellénique »
1 -Qu'est-ce qu'un livre ?
a - Support de l’écriture dans l’Antiquité
· Papyrus
· Le parchemin
· Le support de l’écriture dans la Grèce antique
2 - Le papier support par excellence de l’écriture
a - Qu’est-ce que le papier ?
b - Le papier en Chine
c - Le papier dans l’Empire musulman
· Bataille de Talas : secret du papier et de l’encre de Chine
○ Technique de la fabrication du papier
d - Le papier à la Renaissance
3 - Encre de chine
4 - LeKitãb
a - « Kītāb al-Mansuri fi al-Tibb [Liber ad regem Almansorem] »
5 - Codex et imprimerie
C - Les « livres » ou « ouvrages » grecs
1 - Paradoxe des historiens
2 - Tradition orale ou écrite ?
3 - Georges Gémiste ou Plethon [1355-1452]
4 - Œuvres de Platon par Marsile Ficin
a - Le Timée de Platon
b - Tableau récapitulatif des œuvres de « Platon » [Plethon]
Œ
UVRES ATTRIBUEES A
« P
LATON
»
5 - Structure des « livres » des penseurs grecs
a - In-folio
b - Exemple de structure d’un livre de « penseur grec »
· Une page de « Summa naturalium Aristotelis De anima liber primus »
· « Platonica theologia de immortalitate animorum » - « Opera quae extant omnia »
6 - Petit calcul arithmétique de la pagination des œuvres de Platon
a - « Opera - Platonica theologia de immortalitate animorum »
· «Timée vel de Natura Divini Platonis »
b - « Charmide ou Sur la sagesse »
c -Observations concises
D - Livres des « penseurs grecs »
a - « Livre » grec : rappel
b -Quelques observations fondamentales
c - Théorème de la pensée grecque
1 - Zénon de Citium ou Zénon d'Élée [335 av. J.- C.-262]
2 - Epicure [341 av. J.-C.-270 av. J.-C.]
3 - Boèce ou Anaximandre [vers 470 av. J.-C.-524 av. J.-C.]
4 - Pythagore [580 av. J.-C.-495 av. J.-C.]
5 -Héraclite [576 av. J.-C.-480 av. J.-C.]
6 -Hippocrate [460 av. J.-C-370 av. J.-C]
7 - Aristote [384 av. J.-C.-322 av. J.-C.]
a - Commentaires d’Aristote ?
8 - Euclide [vers 300 av. J.-C]
9 - Archimède [vers 287 av. J.-C.-212 av. J.-C.]
a -Mécanique
b - Loi de la gravitation universelle ou loi de Al-Biruni-Al-Khazini
c -Hydrodynamique : principe de Al-Biruni
10 - Eschine [vers 390 av. J.-C-322 av. J.-C]
11 - Thalès [625 av. J.-C.-547 av. J.-C.]
12 -Diophante [vers IIIe siècle]
13 - Ptolémée [vers 90-vers 160]
a - Astronomie, Géographie, Trigonométrie
b - Géographie
c - Trigonométrie
14 - Dioscoride [vers 40-vers 90]
a - Botanique et Pharmacologie
· Botanique
b - Pharmacologie
15 - Inventer un nom et fabriquer une œuvre
VI - Controverses sur l’Antiquité grecque et les «
penseurs
» grecs
A- A propos de la pensée grecque
B - Schéma - Chronologie de la Culture de la Civilisation de l’Islam Classique [CCIC] en Occident
1 -Malédiction divine
Conclusion
Index alphabétique
Table des matières
Introduction
Déjà au Moyen-Âge [du IXe au XVe siècle], la traduction en version latine des ouvrages scientifiques, théologiques, littéraires ne se présente-t-elle pas comme un phénomène stratégique systématique accompli par une armée d’exécutants à l'initiative des autorités politiques et religieuses ?
L’événement capital de l’Histoire de l’Occident chrétien a été un projet politicothéologico-financier grandiose murement réfléchi et orchestré par des Stratèges [monarques, notables, humanistes, Eglise].
Les pouvoirs fixent et financent des artistes [peintres, sculpteurs, architectes], des aventuriers de l'esprit [Humanistes] formés aux écoles spirituelles et temporelles qui fabriquent les livres et utilisent leurs compétences linguistiques, rhétoriques et un outil révolutionnaire : l’Imprimerie.
Ces érudits imaginent et créent un contenant : l’« Antiquité classique » [gré-coromaine] et bien entendu, son contenu : la « Culture gréco-romaine » ; enfin, ses auteurs : les «penseurs grecs ». Cette propagande ô combien ingénieuse et magistrale a été immortalisée sur de nombreux supports et notamment par l’Art pictural !
La fresque de Raphaël [Raffaello] Sanzio à la Renaissance [XVe-XVIe siècle], en est un exemple patent. Sous l’appellation de l’Ecole d’Athènes, cette fresque va nous servir de trame de fond afin d’analyser cette ahurissante « entreprise historique », patrimoine culturel de l’Occident. Évidemment, cette représentation est enseignée dans le programme scolaire du premier cycle des études du second degré et à l’entrée des grandes Ecoles.
« ECOLED’ATHENES » -FRESQUE
DE RAFFAELLO SANZIODITRAPHAËL
I - La Société de la Grèce antique1
Toutes les sociétés antiques et particulièrement la société grecque et romaine pataugeaient dans le bourbier de la mythologie, de la superstition et des légendes !
La Science et la mythologie sont antinomiques ; de même la magie, la fable et la Connaissance rationnelle. La mythologie se définit comme un phénomène culturel complexe composé de récits mettant des êtres surnaturels, chargés de symboles qui narrent la genèse du monde, des dieux, la création des animaux, des hommes, l'origine des traditions, des rites et de certaines formes de l'activité humaine. Ces récits sont le produit de l’Ignorance. De même, la superstition est la croyance du sentiment mythologique qui exprime une foi dans des forces invisibles et inconnues et qui peuvent être influencées par des objets et des rites [offrandes, prières].
Tirer des lois générales d'une observation des phénomènes naturels est inconcevable si la conception intellectuelle du monde est figée dans la mythologie, la superstition et les légendes !
Les croyances antiques véhiculèrent des idées d’autant plus fausses qu’elles furent de conception humaine primitive. L’Histoire [scientifique] démontre l’univers intellectuel grec et romain solidifié dans leur croyance. Incontestablement, l’Egypte et la Mésopotamie furent les maîtres culturels naturels de la Grèce et de Rome.
Maintes idées facétieuses sont transmises par l’Histoire Orthodoxe, celles, par exemple, de nous imposer à croire que la Grèce et par elle, Rome, furent les pays de prédilection de la littérature, de la culture, de la haute moralité et des sciences, qu’ils transmirent aux musulmans, simples copistes, qui, à leur tour les léguèrent à l’Occident !
La Grèce, pas plus que Rome ne connurent la science et la morale [démocratie, justice sociale, etc.] pour l’unique et simple raison : ils étaient dans l’incapacité intellectuelle de s’en faire une idée !
Pour que la recherche et la découverte de l’intimité de la matière puissent se manifester, il faut se défaire de la mythologie, de la superstition, des légendes et du culte des héros, ce qui était impossible dans la culture et le mode de vie gréco-romains. De plus, le relèvement moral et les réformes sociales en sont le prologue. Les Grecs et les Romains furent dans une indisposition d’esprit incompatible avec la recherche scientifique et son application pratique : le progrès civilisationnel !
A - La « société » grecque
Lorsque les historiens, les pédagogues, les enseignants et en fait, toute la littérature évoquent la Grèce et Rome, une atmosphère empreinte d’émotion les encourage à exposer avec fanfaronnade la culture hellénique, en particulier scientifique.
LES GRANDES DATES SELON L’OCCIDENT DE L’HISTOIRE DES SCIENCES
[*] Aucune trace, ni aucune preuve n’existe de la présence des personnages Pythagore, Thalès, Aristote, Hippocrate, Galien, Archimède, etc. De plus, il n’existe aucun indice, ni aucun témoignage prouvant leurs écrits et qu’ils sont les auteurs de ceux qu’on leur attribue !
Le tableau ci-dessus est très riche d’enseignements. On remarque qu’un vide considérable de plus de dix-sept siècles n’a pas l’air de susciter la moindre inquiétude ni des scientifiques [savants], ni des spécialistes de l’histoire, ni des chercheurs !
Dès lors, l’historiographie européocentriste du savoir se présente comme une suite d’événements historiques, une continuation entre l’Antiquité grecque et la Renaissance !
Les sciences et la culture provenant de la Grèce, les Pythagore, Thalès, Aristote, Archimède, etc. demeurent une confection semblable à celle des personnages évangéliques comme l’Eglise en virtuose sait en fabriquer. Le seul vestige culturel de la Grèce n’est rien d’autre qu’une tradition orale fortement axée sur la mythologie et les légendes agraires qu’on nomme la Philosophie ; ainsi que la statuaire2 dont les produits inondaient certains temples et les demeures hellénisées. La philosophie qui constitue la dialectique grecque a pour entité l’hédonisme et le sophisme !
1 NAS E. BOUTAMMINA, « Les contes des mille et un mythes - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2011.
B - La pensée anti-scientifique
Pour les Grecs [et toutes les sociétés antiques], la plus minime des généralisations empiriques s’exprime par une interprétation mythologique. Si les lois de la nature incarnent des divinités ou des démons, leurs observations sont vaines car la conception même de l’idée s’engageant au-delà des faits demeure inconnue. Dès lors, les théories scientifiques qui les étayent n'auraient aucune existence. Elles ne pourraient pas servir à s’informer du cours de la nature, n'auraient aucun pouvoir explicatif et en conséquence guère d'utilité.
Une société de culture mythologique et magique est une société anti-scientifique. L'image du savant parvenant à des découvertes scientifiques sur une conception mythique de l'esprit est ici complètement rejetée !
C - La société gréco-romaine comme modèle civilisationnel
L’Antiquité gréco-romaine fut admise et proclamée en Occident [France, etc.] comme étant d’excellents modèles de gouvernement, d’exemples de « République », de peuples très attachés à la liberté, au savoir, bref civilisés. Tous les écrits louent la « démocratie athénienne » sans esprit critique, ni retenue, en contradiction même à toute vérité établie par l’étude sérieuse de l’Histoire.
Chaque rédacteur de manuel analysait ses institutions dans les moindres détails, le régime des assemblées toutes-puissantes, le « contrôle » par les citoyens naturellement « vertueux » ; tout en taisant généralement, par un accord tacite, les rigueurs de l’esclavage, la citoyenneté réservée à un si petit nombre, la corruption politique et les effroyables pratiques démagogiques ; tout en ignorant l’exploitation éhontée des colonies, les razzias d’hommes et de richesses, les répressions sanglantes infligées aux rebelles désarmés et aux vaincus. Ainsi, l’hallucination de la société européenne est marquée par une vision, celle d’une période de libertés et de créations inédites représentée par cette « Antiquité classique exemplaire ». Puis, après une longue période dans un état comateux et une existence végétative, enfin, la « Renaissance » apparut miraculeusement réveillant les hommes de l’Occident qui métamorphosèrent leur attitude devant la vie et l’univers en puisant leur « culture » et leur « civilisation » dans le puits de l’Antiquité gréco-romaine.
1 - Apports de la société grecque à l’Humanité
La Grèce antique a toujours été présentée dans l’Histoire contemporaine comme ayant une importance ou des proportions culturelles ou « civilisationnelles » plus grandes qu’elles n’en ont véritablement. En réalité, la caractéristique de la société de la Grèce antique, pompeusement dénommé « civilisation », peut se résumer sans trop exagérer à :
1. la pêche à la sardine
2. l’élaboration du fromage de brebis
3. la cuillette des olives
2 La plupart des sculptures disséminées dans les avenues des villes italennes [entre autre], autour des monuments, dans les musées, etc. datent de la Renaissance.
II - La conception gréco-romaine de l’Univers
L’esprit, la pensée, la culture et la littérature qui constituent et définissent la société gré-coromaine furent limités et axés uniquement sur leurs croyances mythologiques, fondements de leurs explications de la nature et de la conception intellectuelle de l’Univers !
A - Lois physiques et décrets mythologiques
La connaissance hellénique définie par la mythologie fut une période où d’importants faits se déroulèrent où les dieux s’activèrent personnellement aux affaires humaines.
L’historiographie hellénique qui est présentée par l’Histoire orthodoxe3 demeure une compilation de chroniques légendaires comme le démontrent, par exemple, les fabulations du roi Minos et de la mise à mort du Minotaure par le héros Thésée ; en réalité, cela correspond à la lutte pour l'hégémonie en mer Egée où Mycènes occupa Cnossos.
L’expansion territoriale de Rome intégra non seulement des mœurs et des habitudes originaires des pays conquis, mais également des divinités qui héritaient des mêmes honneurs que les dieux attachés à l’Etat romain. La reconnaissance des nouvelles divinités s’ajoutait au panthéon. A mesure que l’Empire s’étendait, des sanctuaires se développaient à Rome tels que ceux de Castor, Pollux, Diane, Minerve, Hercule, Vénus, Mithra, Attis, Isis, Ahriman. Le caractère anthropomorphique, les attributs et les mythes des divinités romaines et grecques importantes s’intégraient de manière plus prononcée.
Le rituel romain distinguait une trentaine de dieux d'origine de l’Etat romain ou dii indigetes dont leurs noms et leur nature furent décrits et honorés par les prêtres et les fêtes du calendrier.
Les divinités nouvelles nommées dii novensides ou novensiles furent introduites pendant la période historique. A chaque étape de toute activité [agricole, domestique, familiale, etc.] fut l’occasion d’invoquer au cours de rituels une divinité particulière.
Les dieux auxiliaires ou associés étaient célébrés en même temps que les dieux principaux. Le culte primitif romain et grec fut le polydémonisme et non le polythéisme qui fut inclut par la suite au panthéon. Leurs noms et fonctions ou numen de l'être [pouvoir] se manifestaient de manière très spécialisée.
La fonction et le culte des dii indigetes démontrent que les Grecs et les Romains appartenaient à des peuplades agricoles qui affectionnaient la violence et la guerre. Leurs divinités dont les rites et les offrandes furent célébrés scrupuleusement incarnaient les nécessités pratiques de la vie quotidienne. Le trio Jupiter, Mars et Quirinus étaient au premier rang du panthéon romain dont leurs prêtres furent les plus élevés en grade, puis Janus et Vesta.
3Histoire orthodoxe. Histoire imaginée au Moyen-Age, compilée, écrite et diffusée pendant la Renaissance, institutionnalisée à l’époque moderne [Siècle des Lumières] et vulgarisée à l’ère contemporaine par les autorités de l’Eglise [le bras séculier et les nantis] et qui constitue l’Histoire et l’historiographie officielles de l’Occident chrétien.
B - Culture irrationnelle, magique, superstitieuse
A partir des religions primitives du peuple de Crète, émigré du Sud-Est vers 3000 av. J.C, la mythologie grecque se développa. Les croyances et pratiques rituelles mythologiques des Grecs déterminent leur culture. La mythologie grecque est un assemblage de fables et de légendes relatif aux dieux qui se développa essentiellement à partir du VIIe siècle av. J.C. Selon les historiens et les hellénistes, les poètes Hesiode [v. VIIIe-VIIe siècle av. J.C.] et Homère rassemblèrent l’ensemble de la connaissance grecque dans leurs recueils.
L’ignorance de ces peuplades leur fit croire que des esprits habitaient tous les objets naturels dont certains qu’ils nommèrent fétiches possédaient des pouvoirs magiques. Par la suite, ces croyances constituèrent un patrimoine culturel composé d’un ensemble de mythes, de superstitions et de légendes où intervenaient des objets naturels, des animaux et des dieux à forme humaine.
Si l’on croit à l’œuvre attribuée à Hésiode, celle-ci reste un document essentiel sur la connaissance, la société, les mentalités et les croyances de la Grèce qui restèrent inchangées jusqu'à la dissolution du pays dans l’oubli. Il énonce dans ses textes les mythes grecs qu’il systématise en complétant les nouvelles divinités inconnues dans les poèmes homériques. Hésiode décrit la création du monde sorti du chaos, la genèse, la généalogie et les aventures des dieux ainsi que l’ensemble des filles de Zeus, le père des dieux, nées de mères humaines.
Tous les commentateurs affirment que la composition de l'œuvre de Homère [v. IXe siècle av. J.C. ?] provient de la tradition culturelle à la lumière des connaissances de l’époque. De plus, les découvertes archéologiques notamment celles de H. Schliemann [1822-1890] indiquent que l'essentiel de la culture décrite par Homère n'était pas inventée mais véhiculée par la culture populaire. En conséquence, les épopées restent des documents illustrant ces époques.
On établit qu’Homère s’illustre comme étant le père de toute la littérature grecque [historiographie, philosophie] que toutes les générations suivantes suivirent. Les Grecs expliquèrent eux-mêmes le développement de leur mythologie qui est leur interprétation de l’Univers et de ses lois. Les historiens et les hellénistes étayent leurs écrits par d’innombrables auteurs.
Un certain Prodicos de Ceos [v. Ve siècle av. J.C.] enseigna que les dieux personnifiaient les phénomènes naturels, tels que le soleil, la lune, les vents et l'eau.
Un autre, Hérodote [v. 484-425 av. J.C.] chroniqueur grec affirmait que les rituels grecs étaient un héritage culturel des Egyptiens.
L’âge hellénistique [323 av. J.C.] ne produit aucun changement à la connaissance grecque qui demeura la philosophie des dieux et de leurs mythes !
Par la mythologie, les Grecs expliquaient la faiblesse de l’homme vis à vis des pouvoirs considérables et terrifiants de la nature. Ils certifiaient l’immortalité de leurs dieux qui contrôlaient tous les aspects de la nature. Dès lors, ils reconnaissaient que leur existence dépendait totalement de la volonté de leurs divinités.
C - Les dieux et le partage du monde - Les dieux gréco-romains « artisans de l’Univers »
Les dieux grecs et romains se caractérisent par un anthropomorphisme et des sentiments humains. La mythologie gréco-romaine est une création humaine primitive, isolée et ignorant de ce fait la révélation ou un enseignement spirituel ; l’inexistence de code écrit [livre sacré] et de structure formelle du type gouvernement religieux renforcent l’ineptie de cette croyance.
Selon le « savoir » grec, le mont Olympe, situé en Thessalie est le lieu où résidaient les dieux qui constituaient une société hiérarchisée en termes d'autorité et de pouvoir. Les dieux parcouraient de manière autonome le monde et s’associaient à l'un des éléments suivants : le ciel, la mer et la terre.
La mythologie intervenait dans tous les aspects de la vie des Grecs qui érigeaient dans chaque cité des temples où ils vénéraient un ou plusieurs dieux. L’adoration des dieux fut régulière et prenait souvent une proportion particulière lors d’importantes cérémonies supervisées par les grands prêtres.
Par l’oralité, les Grecs s’initiaient à la « Philosophie » qui est l’apprentissage de la mythologie. Ainsi, les récits des dieux que l'on transmettait, contribuaient à la pratique fervente du culte.
L’absence d’un système gouvernemental religieux officiel poussait la majorité des Grecs à vénérer des lieux sacrés tels que Dodone, Olympie qui furent dédiés à Zeus et à Delphes consacré à Apollon. Les Grecs s’informaient de leur avenir en consultant un oracle dans un temple. Chaque site sacré disposait d’un ensemble de prêtres qui furent généralement des personnalités officielles de la communauté aptes à interpréter les révélations des dieux. Certains cultes se déroulaient par des prières et des sacrifices ; d’autres furent licencieux et orgiaques.
Le surnaturel est le fondement mental, social et culturel des Grecs et des Romains qui l’appliquaient à leurs croyances et à leurs rituels jusqu'à la période où le christianisme supplanta les religions originelles de l'Empire au début du Moyen-Age. L'origine culturelle est inconnue, mais les Romains assimilèrent la majeure partie de la mythologie grecque, égyptienne, perse et de nombreuses autres croyances.
Les personnages comme M.T. Varro ou Varron [116-27 av. J.C.] et P.O. Naso ou Ovide [43 av. J.C.-v. 17], Theophraste [v. 372-287 av. J.C.], Plutarque [v. 46-v. 120], Strabon [v. 63 av. J.C. - v. 24 apr. J.C.], etc., rapportent tous ces faits dans leurs « écrits ».
L’irrationnel, la superstition et les légendes sont les éléments principiels même de ce peuple inculte foncièrement agricole [puis pêcheur] qu’est le peuple grec. Comme dans les autres sociétés, l’écriture est l’apanage des prêtres et de l’aristocratie guerrière. Si les langues grecque ou latine eurent une littérature écrite rare, en revanche, elles possèdent une culture orale traditionnelle : le folklore, les us et coutumes en témoignent.
III - Les « penseurs grecs » et leurs « écrits »
A - Les Grecs [et Romains] à culture exclusivement orale
A juste titre, la Koinè est un dialecte « social » ou « sociolecte » qui caractérise la forme de langue usitée par un groupe d’individus comme les prêtres, les notables et les officiers militaires qui formaient les Eupatrides des cités grecques [et romaines]. Les Eupatrides eurent en commun des particularités sociales telles qu'un niveau d'instruction semblable, l'appartenance à la même classe sociale ou l'exercice d'une même profession [gouverneur, chef administratif, magistrat, général des armées, etc.].
L'activité « littéraire » de la période hellénistique n’est que compilation et fixation de quelques textes [sur planche revêtue de gypse, etc.], en qui sont classés et qu’on imite servilement. Les quelques « érudits » s'adressent à un public d'auditeurs cultivés, les Eupatrides, très restreints, disséminés géographiquement mais disposant d'une langue élitiste commune, la Koinè, parmi les dialectes locaux. La quasi totalité de la population grecque est illettrée et inculte. Fidèles à leurs illustres prédécesseurs, les poètes reprennent leurs thèmes. Ainsi, la poésie hellénistique est une poésie lyrique, épique, allusive et imprégnée de récits mythiques et de légendes à transmission orale. Les écrivains de talent, issus des Eupatrides fixèrent et propagèrent ce dialecte « littéraire » standard [sur support lithique, tablette en bois, principalement].
Ainsi, le dialecte toscan, par exemple, employé par F. Petracco ou F. Pétrarque [1304- 1374], poète et humaniste italien, domina tous les autres dialectes italiens et devint la langue écrite en Italie. De même, le dialecte haut allemand, dans lequel M. Luther [1483- 1546] traduisit la Bible, s'imposa comme allemand standard. Les écrits du poète G. Chaucer [1343-1400] constituèrent le fondement de la langue anglaise.
La ligne de partage entre différents dialectes est délicate à établir, en principe, la différence du rang social liée aux mœurs et au langage demeure une séparation et l'intelligibilité mutuelle entre locuteurs est un critère. La société grecque est foncièrement illettrée. En effet, l’écriture est l’apanage des prêtres, des nobles et des « scribes » au service de l’Etat. Discriminatoire et esclavagiste, elle impose naturellement une barrière entre deux locuteurs de classes distinctes et donc de parlers différents qui ont de la peine à se comprendre et donc à échanger des idées fussent-elles primitives ou basiques. Conséquemment, le développement intellectuel qui n’a de sens qu’en ce qu’il devient un moteur au service du progrès social et aux échanges d’idées dans une égalité et un respect mutuel, avec toutes les couches sociales, reste donc dans les sociétés grecques inexistant !
La connaissance de l’Univers fut pour les Grecs et les Romains, une interprétation intellectuelle uniquement et exclusivement mythologique. Chaque dieu responsable d’un élément ou phénomène naturel détient une autorité qui explique ses pouvoirs sur l’homme et la nature !
Le concept de « civilisation » que nous dépeignent les historiens et les latino-hellénistes est diamétralement opposé à la réalité des mœurs de la société gréco-romaine !
B - Etude de cas : « Ecole d’Athènes »
1 - Raffaello Sanzio dit Raphaël
Raffaello Sanzio plus connu sous le nom de Raphaël4 [1483-1520] est nommé officiellement peintre de la papauté en 1508. Raphaël affirme des buts politiques qu'il partage avec Jules II. Il réalise la fresque entre 1509 et 1512 pour les appartements de Jules II5.
2 - Ecole d’Athènes observation concise
La fresque de Raphaël intitulée, plus tardivement au XVIIIe siècle, «l’École d’Athènes », se définie à la fois comme une œuvre d’art et comme un document historique. L'Ecole d'Athènes de Raphaël est l'une des fresques les plus connues du peintre et la plus emblématique de la Renaissance italienne. C'est une grande représentation de 7.70 mètres de longueur sur 5.00 mètres de hauteur. Scène symbolique mais qui se veut avant tout historique et propagandiste, elle regroupe les grandes figures de la pensée de la Grèce antique. La fresque date de 1510. Elle décore la « Chambre de la Signature6 » ou « Stanza » du palais du pape Jules II au Vatican à Rome, le haut-lieu du pouvoir papal. La Stanza était l'endroit où le pape recevait les Ambassades et signait ses brèves7 ainsi que ses bulles8 d'où le nom de « Chambre de la Signature » qui d’après divers historiens de l’Art faisait partie intégrante de la bibliothèque privée du pape. Sur chaque mur de la pièce Raphaël représenta une vaste synthèse sur l'idéologie antique et la pensée chrétienne de la Renaissance. La Stanza fait partie actuellement du musée du Vatican.
L'Ecole d'Athènes est, selon le peintre Raffaello [ou Raphaël], une vaste synthèse des idées de la culture hellénique et de la pensée chrétienne de la Renaissance. Selon l’artiste, la fresque symbolise la recherche du vrai, l'équilibre entre la Foi et la Raison.
La fresque réunit les figures majeures de la pensée antique dans un décor inspiré par les projets de Donato di Angelo dit Bramante [1444-1514], l'un des grands architectes de la Renaissance et concepteur de la nouvelle basilique du Vatican. La peinture comporte soixante personnages si l'on y incorpore Apollon [dieu de la poésie et de la musique] et Minerve [la déesse de l’intelligence et du savoir] dans leurs niches. Au centre de la peinture Platon et Aristote, sur les marches Diogène, à gauche Pythagore, au premier plan Héraclite. Raphaël peint les personnages de la Grèce classique et les portraits de ses contemporains. Platon prend les traits de Léonard de Vinci [1452-1519], Héraclite ceux de Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni dit Michel-Ange [1475-1564].
a - La représentation des arts libéraux
Les spécialistes de l’histoire9 de l’Art voient dans cette fresque une représentation des sept arts libéraux. A gauche, au premier plan la grammaire, l'arithmétique et la musique ; à droite la géométrie et l'astronomie. Les deux groupes au premier plan symbolisent la science des nombres sous ses deux aspects, musical et astronomique.
4 H.BOUQUET, « Raphaël, l'homme de génie ». Edition Benevent, 2008.
5 GIULIANO DELLA ROVERE [1449-1513] fut Pape de 1503 à 1513 sous le nom de JULES II. Il s’est arrogé des missions temporelles et spirituelles. Préoccupé par le Pouvoir et l'équilibre des puissances en Italie, très rusé, il use de moyens détournés pour arriver à ses fins. Il élimine tour à tour César Borgia, les Véntiens, et les Français de la Romagne et du Milanais, accroissant simultanément le territoire des États pontificaux.
6L'École d'Athènes indique la pensée grecque et la recherche du Vrai. La fresque du second mur de la Stanza symbolisait la « Dispute du Saint sacrement » qui représente la victoire de la Théologie sur la pensée antique. Le troisième mur est consacré à la « Justice » ; enfin, le quatrième symbolise la « Poésie ».
7Brève ou bref. Lettre émanant du pape ou de la Pénitencerie, plus courte que la bulle et rédigée sans préambule.
8Bulle. Décret du pape plus développé que le bref ; décision du pape sur des matières importantes et rédigée en forme solennelle.
9 A. CHASTEL, « L'Art italien », 1956. Réédit. 1995. - « Chronique de la peinture italienne à la Renaissance, 1250-1580 », 1983.
IV - Les erreurs des fabricants de penseurs grecs et de la culture hellénique
A - Analyse succincte de la fresque « Ecole d’Athènes »
L’analyse de cette fresque de Raphaël permet de dégager quelques grandes caractéristiques de la Renaissance.
Il n’est nullement question ici de faire une critique d’art [perspective, géométrie, jeux de couleurs, de lumière, notion de « trompe-l’œil », effet de scène théâtrale, etc.], ni une explication de la technique de la peinture a fresco, mais de la phénoménologie propagandiste des hauts dignitaires de l’Eglise. En effet, d’une représentation artistique mythique et symbolique, on en fit un événement historique, une composition de faits authentiques.
La représentation du temple de la science par les hommes illustres de la Grèce antique se situe dans une perspective historique magistrale10, méthodiquement reliée au présent par des correspondances entre les personnages de l'Antiquité et les contemporains de Raphaël11.
Ainsi, cet artiste-peintre en regroupant tous les « penseurs » de l'Antiquité grecque, en leur prêtant les visages de certains de ses contemporains veut marquer les esprits avec une visée politico-historique. Il s’agit là de fixer dans les consciences la continuité historique entre l’Antiquité gréco-romaine et la Renaissance occidentalo-chrétienne !
L’Ecole d’Athènes symbolise tout l'héritage revendiqué, en particulier par les penseurs et les artistes de la Renaissance italienne, puis de l’Occident chrétien en général. A Rome, le Vatican est la capitale spirituelle et temporelle et le centre culturel de toute la Chrétienté. Cette fresque est aussi un manifeste de l’Académie de Florence qui en forme de phalanstère12et de laboratoire entreprit l’imagination et la fabrication de l’héritage antique, la « culture hellénique » et de ce fait conçut la Renaissance. Celui-ci est un vaste programme de falsification, de fraude, de mystification, de dissimulation, de recel et de plagiat de la culture de l’infidèle. La République de Florence incarne la mythique République d’Athènes. Voilà ce qu’est réellement la Renaissance !
La place d’Ibn-Rushd latinisé Averroès près d’Epicure et en arrière de Pythagore, la tête inclinée, la main sur le cœur penché sur lui en lui vouant un salut révérenciel. Averroès qui se courbe devant Pythagore ne laisse aucune équivoque : il s’agit d’un signe de soumission. Le sens commun, si peu soit-il, veut qu’il soit à proximité d’Aristote dont il est supposé être le Grand Commentateur. Alors pourquoi derrière Pythagore qui examine, selon les spécialistes de l’histoire et les hellénistes, un livre qui traite, selon eux, de la musique ? Est-ce à dire que pour Raphael, Averroès symbolise un passeur oriental de la culture hellénique, un copiste musulman qui doit s’incliner devant le maître Pythagore et de là devant la culture de la Grèce antique ?
Hormis Ibn-Rushd [Averroès], « copiste » et « passeur » d’Aristote en Occident, l’absence des penseurs musulmans de la scène de la Connaissance et de la Culture est indubitable.
10 D. ARASSE, C. CASTANDET & S. GUEGAN, « Les Visions de Raphaël ». Éditions Liana Levi, Paris, 2004.
11Platon a les traits de Léonard de Vinci, Héraclite ceux de Michel-Ange, Euclide ceux de Bramante, l'enfant derrière Epicure est Federico Gonzagua [1500-1540] ; le jeune homme habillé de blanc est Francesco della Rovere [1414-1484]. Il est couronné pape en 1471 sous le nom de Sixte IV ; Zoroastre