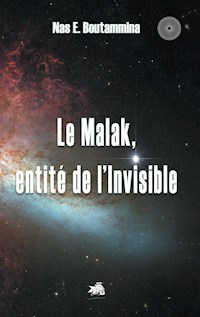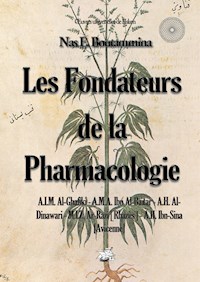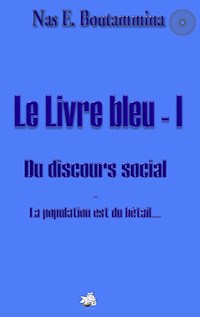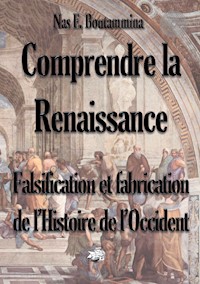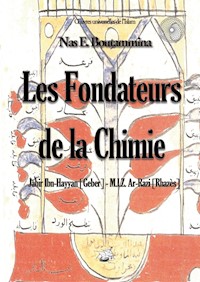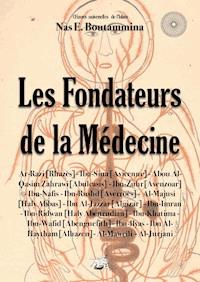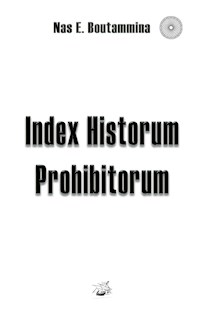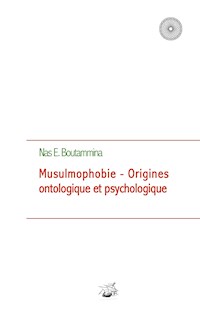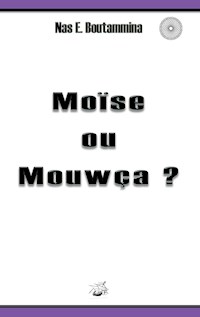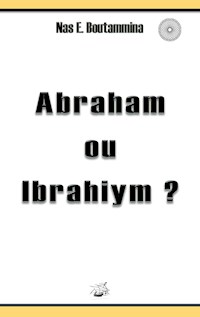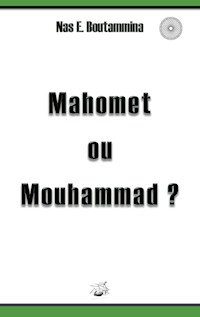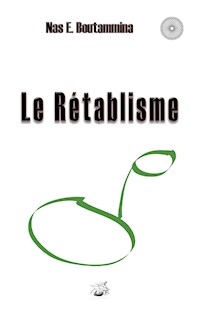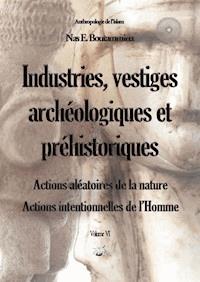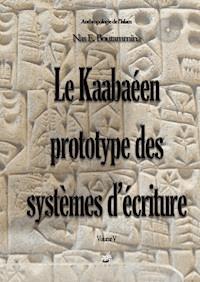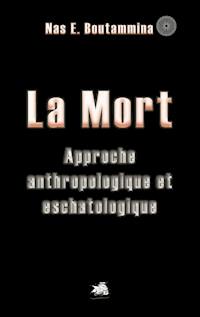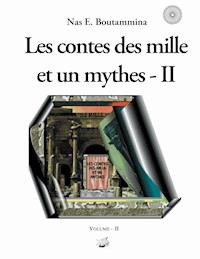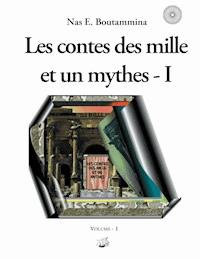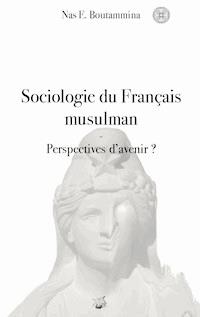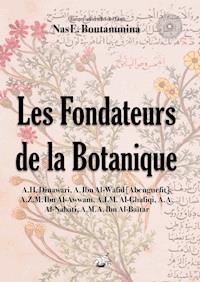
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Oeuvres Universelles de l'Islam
- Sprache: Französisch
Dès les débuts, au IXe siècle, l'idée de la botanique se trouve associée à la pensée rationnelle : rendre intelligible l'origine, la constitution et le devenir d'une plante. Cette science est née dès lors qu'il a été nécessaire de saisir le réel directement par les sens, par l'intelligence et de les confronter à l'expérimentation. Un tel résultat n'est pas obtenu en se basant sur des mythes cosmologiques, la magie ou des puissances surnaturelles, mais en postulant avant de le confirmer par l'expérience que la nature est régie par des lois constantes, que toutes les réalités obéissent à un ordre, que l'émergence ou la succession des phénomènes n'est aucunement due à l'action du hasard ou de processus d'une quelconque évolution. La botanique sous-entend, d'une part, une notion biologique, à savoir l'étude de l'ensemble de végétaux identifiés en familles, genres et espèces vivants sur un espace géographiquement délimité ; ces espèces vivent en harmonie (symbiose ou mutualisme) ou s'isolent pour constituer des types de végétation tellement variés. L'avènement des monographies botaniques traitant de groupes systématiques (famille, genre, etc.), des catalogues, énumérations commentées traitant des taxons connus sur une zone géographique ont été établis par des concepteurs géniaux tels que A.H. Dinawari, A. Ibn Al-Wafid, A.I.M. Al-Ghafiqi, A.A. Al-Nabati, A.M.A. Ibn Al-Baïtar et constituent le fondement de la botanique actuelle. En effet, le rôle et l'activité scientifiques des auteurs de cette science sont à l'origine d'ouvrages qui firent autorité durant des siècles. La botanique s'est enrichie depuis et a donné les diverses branches et travaux de floristique qui ont pris un développement considérable aujourd'hui. Dès le début du IXe siècle, paraissent des traités, des corpus, des manuels illustrés qui décrivent les espèces végétales et en incorporent d'autres exotiques grâce à l'essor des voyages d'exploration à des fins botaniques. Sur le plan pratique, les fondateurs cherchaient à rendre le contenu de la botanique le plus cohérent et le plus accessible possible. Quoi qu'il en soit, l'évolution constante de la botanique et de ses conceptions classificatoires par l'incorporation des études cytologiques, palynologiques, biochimiques et cladistiques et de l'intérêt en écologie (modifications naturelles ou provoquées par l'homme) contribue à accroître savamment notre connaissance du domaine végétal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans les mêmes éditions
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Y-a-t-il eu un temple de Salomon à Jérusalem ? », Edit. BoD, Paris [France], aout 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les ennemis de l’Islam - Le règne des Antésulmans - Avènement de l’Ignorance, de l’Obscurantisme et de l’Immobilisme », Edit. BoD, Paris [France], février 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le secret des cellules immunitaires - Théorie bouleversant l’Immunologie [The secrecy of immune cells - Theory upsetting Immunology] », Edit. BoD, Paris [France], mars 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Livre bleu - I - Du discours social », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2014.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Rétablisme », Edit. BoD, Paris [France], mars 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Comprendre la Renaissance - Falsification et fabrication de l’Histoire de l’Occident », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Connaissez-vous l’Islam ? », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Malāk, entité de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], mai 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Jésus fils de Marie ou Hiyça ibn Māryām ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Index Historum Prohibitorum », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Moïse ou Moūwça ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Mahomet ou Moūhammad ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Abraham ou Ibrāhiym ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Musulmophobie - Origines ontologique et psychologique », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Jinn bâtisseurs de pyramides… ? », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « La Mort - Approche anthropologique et eschatologique », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Jinn, créature de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Français musulman - Perspectives d’avenir ? », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Judéo-christianisme - Le mythe des mythes ? », Edit. BoD, Paris [France], mars 2017. 2
e
édition.
Collection Néo-anthropologie [Anthropologie de l’Islam]
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Apparition de l’Homme - Modélisation islamique - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « L’Homme, qui est-il et d’où vient-il ? - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Classification islamique de la Préhistoire - Volume III », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Expansion de l’Homme sur la Terre depuis son origine par mouvement ondulatoire - Volume IV », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Kaabaéen prototype des systèmes d’écriture » - Volume V », Edit. BoD, Paris [France], mai 2016.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Industries, vestiges archéologiques et préhistoriques - Action aléatoire de la nature & Action intentionnelle de l’Homme » - Volume VI », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2016.
Collection Œuvres universelles de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Chimie », Edit. BoD, Paris [France], octobre 2013.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Pharmacologie », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2014.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Médecine », Edit. BoD, Paris [France], mars 2017. 2
e
édition.
Table des matières
Avertissement
Introduction
Qu’est-ce que la Botanique ?
La botanique - Les végétaux - Les plantes
Quelques définitions
Les diverses branches de la botanique
Taxinomie végétale
Morphologie et morphologie comparée
Systématique végétale
Période antérieure à la genèse de la Botanique [avant le IXe siècle]
L’intellection des végétaux
Néolithique
Antiquité
Moyen-Âge
La Renaissance
L’époque moderne [XVIe-XVIII siècle]
L’époque contemporaine
Genèse de la Botanique
La spécialisation de la botanique
Naissance de la
botanique
La conception de la botanique par les pères fondateurs
Les Maîtres fondateurs de la Botanique
Le règne végétal dans l’esprit des savants musulmans
Botanique et écosystèmes
Synthèse de l’idée botanique
La nature, modèle des fondateurs de la botanique
Les principaux fondateurs de la Botanique
a.
A.H. Dinawari [815-895]
S
CIENCES HUMAINES
b.
A.I.M. Al-Ghafiqi [m. 1165]
c.
A. Ibn Al-Wafid [1008-1075]
d.
A.A. Al-Nabati [1116-1239]
e.
A.M.A. Ibn al-Baïtar [ou Ibn-Baytar - 1190-1248]
f.
Autres botanistes ayant grandement contribué à la botanique
Quelques traductions d’œuvres des fondateurs de la Botanique
Quelques termes d’origine arabe usités en botanique
Quelques illustrations d’œuvres en botanique
Conclusion
Index alphabétique
Avertissement
La Collection « Œuvres universelles de l’Islam » rend hommage aux savants musulmans fidèles au Message coranique : « Être au service de l’Humanité ». Pour cela, ils ont créé les Sciences, base de la Civilisation humaine, héritage de nos sociétés contemporaines.
Hélas, les savants musulmans n’ont jamais reçu la moindre marque ou témoignage d'estime et de gratitude, c’est-à-dire un honneur à l’égal de leur talent et de leur génie qu’ils léguèrent à la postérité.
Il est d’usage d’octroyer un nom [éponyme] à une rue, à un établissement public, etc. en l’honneur d’un personnage illustre ayant œuvré pour le bienfait de l’Humanité ou ayant contribué aux progrès de la Civilisation humaine [Sciences, Arts, etc.]. Le paradoxe d’une absolue aberration est qu’en ce qui concerne les savants musulmans fondateurs de la Civilisation universelle, aucune rue, aucune voie, aucune avenue, aucun boulevard ; aucun établissement scolaire [école, collège, lycée] ou public [hôpital, Centre de Recherche, etc.] ; aucune Université, aucune Faculté, aucun Institut ; aucune fondation, aucune technique, ni aucune loi scientifique n’est honorée de leurs noms !
« En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des indices [lois scientifiques] pour les doués d’intelligence, » (Coran, 3-190)
« qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, évoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre [en disant] : Ô notre Seigneur ! Tu n’as pas créé [tout] cela en vain. […] ». (Coran, 3-191)
Une correction s’impose quant à diverses appellations faussement véhiculées pa la littérature1. En voici quelques unes. La « Science arabe ». Il n’y a jamais eu de Science « arabe ». La Science expérimentale [Chimie, Mathématiques, Physique, Médecine, Astronomie, Pharmacologie, Botanique, Agronomie, Zoologie, etc.] a été crée principalement par les Musulmans d’origine berbéro-andalouse [ou Maghrebo-andalouse] et perse. Ainsi, la « Civilisation de l’Islam Classique [CIC] », héritage de nos sociétés contemporaines, a été essentiellement le fruit extraordinaire de ces deux peuples : berbéro-andalou et perse.
Les Chiffres « arabes ». Les chiffres [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] appelés inexactement « arabes » sont en réalité les chiffres du Maghrebo-andalou Abou Al-Hasan Al-Qalsadi [m. 890], monument des sciences mathématiques, qui est né à Bastan en Andalousie. Les mathématiques doivent leur clarification et leur progrès à son extraordinaire génie car il invente les chiffres à partir de règles géométriques selon la construction des angles. Ainsi, afin de rétablir la vérité les chiffres se dénomment : « chiffres d’Al-Qalsadi » ou « chiffres alqalsadiens » !
La Civilisation « arabe ». Afin de ne pas s’attarder sur la prétendue « Civilisation « arabe » », faisons une simple et concise observation. Pas plus que de Science « arabe », il n’y eut de Civilisation « arabe ». Répétons-le, la Civilisation de l’Islam classique [CIC] a été fondée par des Maghrebo-andalous et des Perses, des populations non-arabes !
« Arabe du Maghreb ou d’Afrique du Nord ». Le Maghreb a pour population originale des Berbères qui sont les premiers habitants d'Afrique du Nord. De ce fait, les Maghrébins ou Nord-africains n’ont aucune relation ni aucun lien avec les Arabes. En effet, d’un point de vue géographique, linguistique, ethnique, physique, culturel, gastronomique, etc. rien ne signale une quelconque relation avec ceux que l’on nomme les Arabes.
Lors de la conversion des Berbères à l’Islam, une grande partie d’entre eux ont opté pour la langue arabe qui n’est autre que la langue liturgique de l’Islam et donc celle du texte du Coran. Ainsi, les Berbères adoptèrent ensuite l’arabe en tenant compte de leur héritage berbère car ils demeurent toujours fidèles à leur patrimoine linguistique et culturel berbère. En effet, ils se distinguèrent même en développant leur propre langage, la langue berbèro-arabe ou berbèro-andalouse usité dans tout le Maghreb. Malheureusement, cette langue n’a pas eu toute l’attention et le soin qu’elle aurait dû avoir pour se développer sémantiquement [vocabulaire scientifique, technologique, etc.].
Finalement, les « Arabes » définissent uniquement et seulement les populations actuelles du Golfe : Koweït, Bahreïn, Qatar, Sultanat d’Oman, les Émirats Arabes Unis [E.A.U.] l’Arabie et le Yémen qui caractérisent le vrai et unique « monde arabe ». Ce ramassis de peuplades pétrodollarisés voue un mépris absolu à la Science, à la Culture, aux Arts, à l’Esthétique, au Progrès, à la Civilisation. D’un point de vue anthropologique et donc ontologique, la nature de la « société » des Arabes est essentiellement fragmentée en tribus bédouines et pirates. Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, les Arabes vouent un culte à la limite de la folie à leurs divinités l’or et l’argent qu’ils leur permettent d’acquérir aux yeux du monde qui les entoure ce qu’ils n’ont pas : prestige, gloire et considération. Ce manque de noblesse, ils s’efforcent de le combler par le recours au brigandage et aux razzias, traits culturels qui sont toujours la règle tribale. Naturellement, ils sont incapables de saisir le concept de Science. Totalement étranger à leur esprit, celui-ci est inconnu de leur mode de vie, de leur société, de leur univers. Dès lors, il leur est évidemment sans intérêt.
Ainsi, les expressions justes sont : Science islamique ou Science de l’Islam ou encore Sciences perso-berbéro-andalouses, et en aucun cas Science « arabe » ; Civilisation de l’Islam ou Civilisation perso-berbéro-andalouse et en aucune manière « Civilisation arabe » ; Chiffres alqasadiens, mais ô jamais « chiffres arabes » !
1 NAS E. BOUTAMMINA, « Les contes des mille et un mythes - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2e édition.
Introduction
C’est la recherche médicale et pharmacologique au début du IXe siècle qui a entrainé en grande partie la genèse et le développement de la botanique en tant que discipline scientifique indépendante.
La science botanique éclaire et trace la route de la connaissance végétale. La botanique libérée de la médecine fut promue comme science autonome et intronisée. Désormais, elle exerce son règne sur l'ensemble des savoirs si particuliers des plantes.
Il fallait aux fondateurs de la botanique comme A.H. Dinawari [815-895], A. Ibn Al-Wafid [1008-1075], A.I.M. Al-Ghafiqi [m. 1165], A.A. Al-Nabati [1116-1239], A.M.A. Ibn al-Baïtar [ou Ibn-Baytar - 1190-1248]] concevoir et adopter des procédures positives, associer raisonnement et expérimentation. Sachant ajuster un formalisme logique et un maniement expérimental, la preuve fut démontrée, la connaissance fut acquise.
Le meilleur atout de la botanique a été dans l'homogénéité grandissante de ses méthodes, quels que soient les champs explorés, quelle que soit l'hétérogénéité des plantes qu'elle cherchait à étudier. De cette rigueur et de cette efficacité, privilèges des concepts opératoires de ces fondateurs, la botanique a fait son chemin depuis.
La botanique, c’est aussi un état d'esprit qui peut tout imprégner, les démarches théoriques et les conduites pratiques, mais quoi qu’il en soit, elle décrète la certitude, obtient le vrai, refond, élargit ou améliore ses contenus et demeure ouverte et positive : elle rapproche modèles logiques et données objectives. La botanique s'incarne dans les comportements observables, celles-là mêmes qui lui ont donnés naissance au début du IXe siècle.
La recherche de la botanique va alors apparaître comme le moyen privilégié d’y accéder et d'organiser une stratégie de savoir et d'action [Science] telle que, tout en ne voyant directement qu'une fraction faible de la réalité [plante], l'esprit scientifique puisse avancer des hypothèses afin d’atteindre les lois de la nature et, ainsi, comprendre tout au moins un fragment de son ensemble.
I - Qu’est-ce que la Botanique ?
A - La botanique - Les végétaux - Les plantes
1 - Quelques définitions
a - Botanique
Le terme « botanique » provient de l’arabe « bostan » qui signifie « verger2 » et qui donnera par la suite « bostaniya », la science du verger, du jardin et par extension la Science des végétaux, des plantes. Terme qui fût hellénisé et latinisé au Moyen-Âge par les traducteurs-copistes latins.
La botanique est la science qui se consacre à l'étude des végétaux. Elle se rattache à diverses sciences du vivant. La botanique générale recouvre la taxinomie3, la systématique4, la morphologie végétale5, l'histologie végétale6, la physiologie végétale7, la biogéographie végétale8 et la pathologie végétale9. Citons encore la dendrologie, une autre discipline qui est spécialisée d’un sous-ensemble de végétaux. La connaissance précise des végétaux trouve des applications dans divers domaines, tels que la pharmacologie, l’agronomie : sélection et amélioration des plantes cultivées, l’agriculture ; l’horticulture10, ainsi que la sylviculture11.
2 - Les diverses branches de la botanique
Jadis science des végétaux, le vocable « botanique » indique actuellement les disciplines qui concernent la systématique, le développement, l'évolution et l'écologie des végétaux12. La biologie végétale, quant à elle, regroupe les disciplines que sont la physiologie et la génétique des plantes. Le champ d'application de la botanique s’est réduit. En effet, les champignons sont exclus du règne végétal et ont été classés parmi les animaux du point de vue « évolutif ». Ils constituent dorénavant le groupe des Mycètes ou Fungi et la science qui les étudie se nomme la mycologie. De même, à part une petite partie, les algues sont écartées de la botanique pour se placer sous la férule de la phycologie. Ainsi, la botanique aujourd'hui se concentre sur les plantes terrestres ou embryophytes qui reste un vaste groupe d'organismes réunissant toutes les espèces de mousses, fougères, gymnospermes [ou plantes à graines nues et angiospermes [ou plantes à fleurs]13.
Les progrès technologiques réalisés depuis la fin du XXe siècle particulièrement en matière d'informatique, d'imagerie et de génétique contribuent largement à la botanique, en permettant de mieux comprendre l'origine de la diversité des plantes. Ces nouveaux progrès sont intégrés dans les enseignements de la botanique ayant pour effet de la stimuler. Rôle majeur dans la connaissance de la biodiversité, la botanique au début du XXIe siècle se révèle comme une science florissante, vivante et en plein essor.
a - Botanique et systématique
La systématique est une science vaste qui a pour thème d'inventorier, de nommer, de classer et, dans sa signification moderne, de rétablir l'histoire évolutive des organismes vivants et disparus.
L'histoire de la systématique des plantes apparaît lors de la genèse de la botanique au IXe siècle. Depuis cette date, l'accumulation croissante du savoir sur la diversité des espèces végétales au fur et à mesure de l'exploration de la Terre, la recherche d'un système rationnel pour désigner et classer ces espèces a été au cœur des préoccupations des fondateurs de cette science qu’est la botanique. Quoi qu’il en soit, l'inventaire des espèces de plantes terrestres reste actuellement insuffisant14. Dès lors, un travail considérable reste à accomplir afin de connaître la biodiversité végétale à des fins de préservation ou d’exploitation [alimentaire ou médicinale]. Afin de permettre le rassemblement des organismes semblables ou ayant des propriétés analogues dans des groupes auxquels on puisse se référer par un nom, il est nécessaire de disposer d'un système de classification hiérarchique : la taxonomie. Il s’agit de la branche de la systématique qui se consacre à donner ces noms : les taxons.
La classification des plantes s’adapte à l’intérêt général de la botanique afin que tous les botanistes s’accordent sur le principe d'une classification qui reflète l'histoire évolutive d'un groupe d'organismes, c'est-à-dire sa phylogénie15 . Il est question alors de classification phylogénétique16.
La botanique systématique se trouve en pleine mutation. En effet, elle s'intègre de manière dynamique avec les autres disciplines de la biologie. La reconstruction de la phylogénie à partir de données de séquences ADN représente actuellement un outil essentiel pour répondre à de nombreuses questions scientifiques.
Au début de ce XXIe siècle, la botanique est étroitement interconnectée avec de nombreux domaines de la biologie, notamment avec la systématique [phylogénie], la biologie de l'évolution [macroévolution], la biologie du développement et l'écologie [écologie évolutive17]. Enfin, les recherches à l'interface de l'évolution et du développement ont donné lieu à une nouvelle discipline : l'évo-dévo.
2Verger. Terrain de plus ou moins grande importance planté d'arbres fruitiers d'une ou de plusieurs variétés.
3Taxinomie. Science des lois et des principes de la classification des organismes vivants. Par extension, science de la classification.
4Systématique. En sciences de la vie et en histoire naturelle, la systématique est la science pure de la classification des taxons, via un système permettant de les dénombrer et surtout de les classer en les organisant dans un certain ordre, sur la base de principes logiques.
Taxon. Un taxon correspond à une entité d’êtres vivants regroupés parce qu’ils possèdent des caractères en communs du fait de leur parenté, et permet ainsi de classifier le vivant à travers la systématique.
5Morphologie végétale. Branche de la botanique qui contribue à décrire la forme et la structure externe des plantes et de leurs organes. Le développement de cette science est en relation avec la systématique, qui a conduit à une description précise et stricte des divers organes des plantes, notamment les racines, les tiges, les feuilles et les fleurs, et a permis la constitution d’un vocabulaire botanique riche et très spécialisé. En effet, la classification des plantes en espèces, et leur identification pratique sur le terrain, s’établit d'abord sur des critères morphologiques : l'espèce.
6Histologie végétale. Branche de la biologie végétale qui étudie la structure microscopique des tissus végétaux. Elle s'appuie sur la cytologie, qui est l'étude de la cellule vivante. En effet, la plante est constituée de différents tissus aux rôles spécifiques.
7Physiologie végétale ou phytobiologie