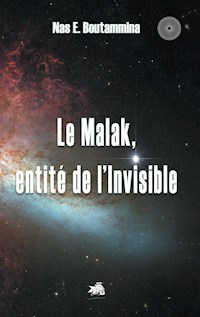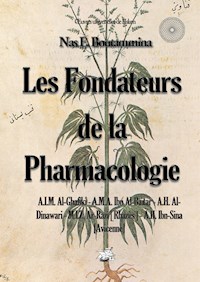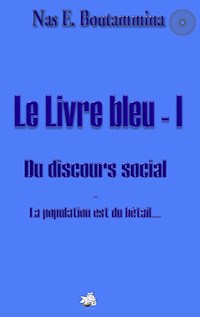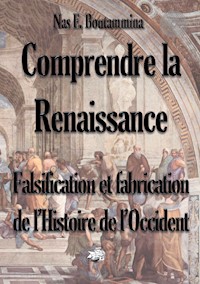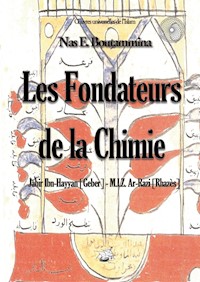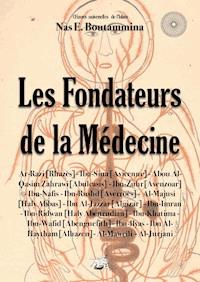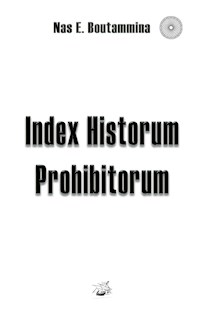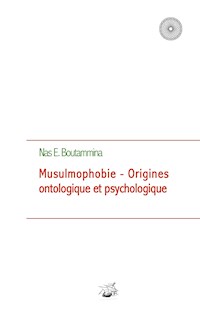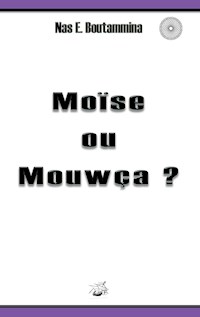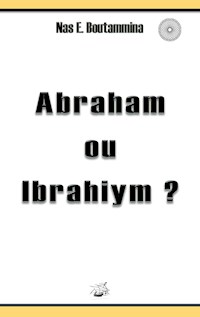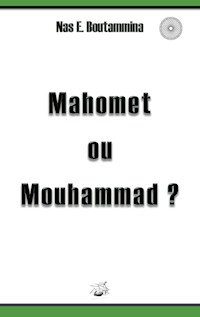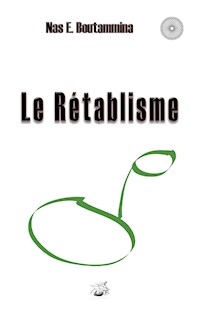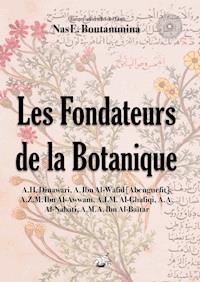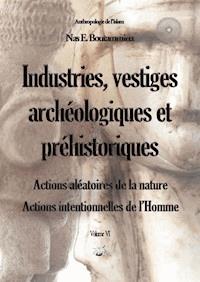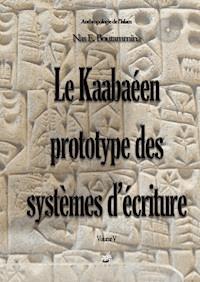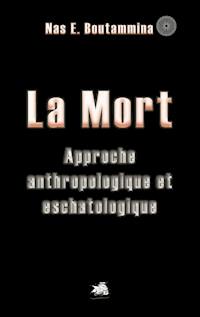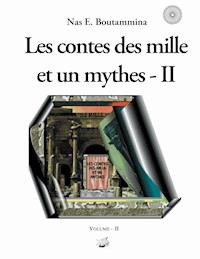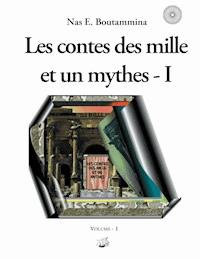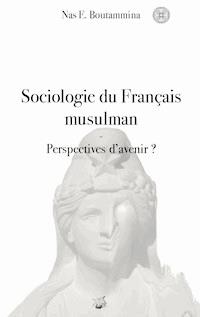Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Le Judéo-christianisme, la superstition et la mythologie peuvent être combattus par la logique et la Science. Ainsi déplacé sur le terrain du discernement par une analyse et une argumentation textuelle de ses propres écrits, le Judéo-christianisme ne s'installe-t-il pas loin de la Vérité ? Le Judéo-christianisme est-il l'oeuvre de l'imagination et de l'habitude fixée par les us et coutumes et les croyances populaires primitives ? Dans cet ouvrage, l'étude du Judéo-christianisme prend un sens épistémologique décisif où l'idée d'irréalité tend à remplacer celle de réalité au sens scientifique. En théologie, comme d'ailleurs en matière de science, il importe autant d'estimer des véracités que d'exiger des démonstrations. L'analyse, ici, consiste à ne plus conjecturer et par conséquent, à examiner scientifiquement des assemblages et des combinaisons de causes. L'idée de la probabilité que le Judéo-christianisme est de nature divine, c'est à dire "révélée", tend-il alors à être définie comme un degré de certitude ? En procédant à une critique analytique rigoureuse du Judéo-christianisme que dévoile-t-il et vers où bascule-t-il ? C'est ce que tente de révéler ce livre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Avertissement
Introduction
La croyance judaïque
La croyance judaïque
Histoire
Développement du judaïsme rabbinique
Le sectarisme juif
Le cérémonial
La tradition rabbiniques
Fondements de la croyance
Composition de la Thora
La Genèse ou Epopée de Gilgamesh
La Genèse ou cosmogonie mythologique
Les Psaumes, Isaïe ou Poème de la création « Enouma elish »
Le Talmud
La croyance du Christianisme
Genèse d’une mythologie
Le culte de l’Alliance
Les mystères de la croyance
Les promoteurs de la mythologie
Les Esséniens : ébauche du roman
Le roman-évangile de Marcion de Sinope
Le roman-évangile de Valentin
Le roman élu ou évangile agrée de Eusèbe de Césarée
Le roman-évangile ou Vulgate de Jérôme
Le partage de la Foi
Concrétisation du mythe
Etatiser la croyance
Manuscrits de la Mer Morte et de Nag Hammadi
Actes de résistance
L’ombre de la croix : l’ombre de la mort
La genèse de la Croix
Version chrétienne des fabulations perso-sumérobabyloniennes
Les mystérieux Apôtres
Recueil des Midrashim
Le Christ : mythe composé
Sol invictus
Joyeux anniversaire
Compte à rebours
La Tri-iniquité
Rituels
Devenir chrétien : allégeance à l’Eglise
Aveux au représentant divin
Gestion de l’interdit
Quand le prêtre remplace Dieu
Clergé - Institution
Exercice du pouvoir spirituel et temporel
Développement de l’Eglise
L’homo-monasticus
Les eunuques monacaux
Le diplôme ès Sanctus
Les Lumières éclairant le monde
L’Inquisition : amour chrétien
Les démons espagnols
L’Inquisition découvre l’Amérique
En perspective
L’Eglise, héritière impériale
Compilation mythologico-légendaire
Tableau de la compilation du Christianisme
Observations
Naissance du mythe
Immaculée Conception
Les rouleaux de Qumran
Etablir la vérité
Les révoltés de la science
Les Esséniens
Quelques informations « historiques » démenties par les manuscrits de Qumran
Autres découvertes de la Mer Morte
Falsification nominale
Le nom propre et le nom commun
Incorruptible, intraduisible
Tableau - Quelques noms propres
Tableau - quelques noms communs
Tableau de quelques termes corrompus en noms propres
Tableau de quelques noms propres corrompus
Conclusion
Index alphabétique
Dans les mêmes éditions
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Y-a-t-il eu un temple de Salomon à Jérusalem ? », Edit. BoD, Paris [France], aout 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les ennemis de l’Islam - Le règne des Antésulmans - Avènement de l’Ignorance, de l’Obscurantisme et de l’Immobilisme », Edit. BoD, Paris [France], février 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le secret des cellules immunitaires - Théorie bouleversant l’Immunologie [The secrecy of immune cells - Theory upsetting Immunology] », Edit. BoD, Paris [France], mars 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Livre bleu - I - Du discours social », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2014.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Rétablisme », Edit. BoD, Paris [France], mars 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Comprendre la Renaissance - Falsification et fabrication de l’Histoire de l’Occident », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Connaissez-vous l’Islam ? », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Malāk, entité de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], mai 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Jésus fils de Marie ou Hiyça ibn Māryām ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Index Historum Prohibitorum », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Moïse ou Moūwça ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Mahomet ou Moūhammad ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Abraham ou Ibrāhiym ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Musulmophobie - Origines ontologique et psychologique », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Jinn bâtisseurs de pyramides… ? », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « La Mort - Approche anthropologique et eschatologique », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2015
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Jinn, créature de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Français musulman - Perspectives d’avenir ? », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2
e
édition.
Collection Néo-anthropologie [Anthropologie de l’Islam]
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Apparition de l’Homme - Modélisation islamique -Volume I », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « L’Homme, qui est-il et d’où vient-il ? - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Classification islamique de la Préhistoire - Volume III », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Expansion de l’Homme sur la Terre depuis son origine par mouvement ondulatoire - Volume IV », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Kaabaéen prototype des systèmes d’écriture » - Volume V», Edit. BoD, Paris [France], mai 2016.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Industries, vestiges archéologiques et préhistoriques - Action aléatoire de la nature & Action intentionnelle de l’Homme » - Volume VI », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2016.
Collection Œuvres universelles de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Médecine », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Chimie », Edit. BoD, Paris [France], octobre 2013.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Pharmacologie », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2014.
Avertissement
Cet ouvrage s’inscrit dans un registre qui se situe bien audelà de celui de la polémique religieuse et sur le caractère « sentimental » du Judéo-christianisme. Nulle intention de froisser la sensibilité ou de porter atteinte à la conviction que tout un chacun prône envers cette forme religieuse.
C’est simplement qu’au terme d’une réflexion, d’un questionnement, d’un long cheminement intellectuel et suite à une quête critique sur le contenu de cette croyance que celle-ci est amenée inévitablement à s’exposer à la lumière.
L'essentiel de ce livre est constitué par la critique rationnelle [scientifique] du Judéo-christianisme et de ses dogmes fondamentaux. Cet accès au problème de la croyance judéo-chrétienne par son sens, par son contenu intellectuel [donc scientifique], et non par le sentiment ou la ferveur, permet de découvrir au cœur de cette croyance un processus qui la rend incompréhensible, tel un bloc d'irrationalité.
Introduction
Le Judéo-christianisme n’apparaît-il pas comme un recueil de croyances, en ce sens que toutes ses propositions se réclament elles-mêmes de l’invraisemblance plutôt que de la certitude et de la vérité ? Passé au crible du scepticisme, le Judéo-christianisme signifie méditation sur les limites de l’étrangeté et docilité à la tradition.
La question du caractère « raisonnable » de celui-ci se pose. Le Judéo-christianisme se révèle-t-il pas comme étant précisément la confusion qu'il importe d’éclaircir ? Est-il possible de le prendre-pour-vrai, car ne caractérise-t-il pas la transgression de la limite de validité que la critique dénonce et condamne ?
Le Judéo-christianisme est-il un univers de convictions méthodiquement élaborées sur le substrat des traditions et des croyances mythologiques antiques et révisé au cours du temps ?
Autant de questions qui doivent trouver des réponses. Là est la véritable problématique. Les Juifs ne concèdent-ils pas que très peu d’importance à la Thora ? Les Midrashim ou explications seront refondues par des procédés ingénieux d’où découle le Talmud officiel que la littérature tente de vulgariser. Le Talmud est-il le livre liturgique des Juifs ?
Les territoires gréco-romains qui vivaient jadis paisiblement d’antiques croyances mythologiques et superstitieuses allaient subir cruellement une autre croyance : le Christianisme. Ce dernier, long travail de compilation estil l’œuvre de maints personnages ? Etalé sur une longue période de plusieurs siècles, l’ouvrage est affiné selon les besoins et les polémiques des époques. Toute idée nouvelle assurant un ascendant sur les ouailles et leur maintient dans le giron de l’Eglise est une bénédiction pour le droit canonique.
De l’imbroglio du mystère, l’Eglise s’est restreinte à échafauder une révélation des textes bibliques, l’incarnation de l’Esprit en l’homme Jésus, à sa naissance d’une Vierge et à la Trinité. La compréhension du mystère est alors possible qu’en la situant au-delà de toute tentative d’explication rationnelle. La pensée grecque, fondée sur la spéculation, l’abstraction et l’irrationnel feront le reste.
A la saga de Jésus-Christ imaginé et compilé au IIe siècle, l’Eglise ne cesse d'installer son autorité et de réformer sa croyance fabuleuse en lui rajoutant des éléments toujours nouveaux.
La mise à jour de la Bible se poursuivra avec zèle pendant tout le Moyen-Age. Des thèmes relatifs à l’Islam ne sont-ils pas discrètement incorporés ?
Quoi qu’il en soit, les liens sacrés du mariage entre les missionnaires et les armées ont formé un couple qui a engendré la terreur, la destruction et la mort au nom du Judéo-christianisme, et cela, tout au long de son histoire.
I - La croyance judaïque
La superstition et la mythologie, formes archaïques de l’ignorance et de l’obscurantisme sont « normalement » combattues par la logique et le savoir. Le « Judaïsme » et principalement le Christianisme, autres formes de croyances, nous démontrent le contraire. C’est un univers de convictions méthodiquement élaborées sur le substrat des croyances mythologiques antiques où il fut perfectionné au cours du temps.
En conséquence, le Judaïsme et le Christianisme ne diffèrent presque pas des diverses croyances demeurées au stade de l’ignorance primitive ; mais leur originalité est quelles firent couler beaucoup d’encre et beaucoup de sang ; et mises à jour au cours des siècles, elles s’institutionnalisèrent.
A - La croyance judaïque
Le terme Judaïsme n'existe pas en hébreu classique. La Thora, recueil des instructions qu’on prétend divines révélées à Israël, est l’une des références des juifs qui leur imposait un mode de vie selon la Halakha, ensemble de lois, coutumes et pratiques.
Caractérisé par une règle de vie et une vision du monde, le judaïsme rabbinique classique proposait ainsi un système culturel enveloppant la totalité des activités individuelles et communautaires sous la loi de Dieu.
1 - Histoire
Les premières sources qui sont sujettes à controverses, pour l'histoire du Judaïsme furent la littérature et l'archéologie biblique. On avance que le judaïsme naquit sur le territoire de la Judée au Proche-Orient. La religion attribuée à Israël ne fût pas monothéiste mais devint Hénothéiste. Les Hébreux adoraient un Dieu en association avec d'autres dieux pour les autres nations.
On soutient que le fondateur du Judaïsme fut Abraham, avec lequel Yhweh [Jéhovah, Dieu] conclut une Alliance, symbolisée par le rite de la circoncision. On prétend qu’Abraham conçut et développa cette croyance et Moïse fut le législateur qui reçut de Dieu, sur le mont Sinaï, la Loi ou Thora. Ce dernier développa le rituel et organisa le système sacerdotal. Lorsque les Juifs [ou Hébreux] s’installèrent sur les terres de Palestine, la religion qu’ils pratiquèrent alors qu’ils étaient nomades subit une importante modification : un culte sacrificiel élaboré avec une prêtrise organisée, des fêtes, des lieux saints et des autels furent institués. Après la fondation de la Royauté, les dieux des peuples voisins entrèrent en rivalité, puis se rapprochèrent avec Jéhovah. A chaque fois, des Prophètes, hommes inspirés de Dieu, surgirent pour exhorter les Hébreux à répudier leurs erreurs et à revenir sur le chemin de Dieu.
La révolte maccabéenne de 165 à 142 av. J.C. débuta comme une guerre civile entre Juifs hellénistes et ceux qui y étaient hostiles. Elle se poursuivit par un soulèvement qui aboutit à l’indépendance politique de la Judée. Les guerres influèrent sur le développement du judaïsme : la rédaction des premiers écrits apocalyptiques marqua cette époque. Ils illustraient ces guerres comme un conflit cosmique entre les forces du Bien et du Mal, qui devait s’achever par la victoire des armées de Dieu. En conséquence, la résurrection corporelle fut, pour la première fois promise aux Juifs morts à la bataille. L'immortalité était considérée, jusqu’alors, qu'en la survie du peuple juif et de sa descendance ; l’individu ne pouvait aspirer qu’à une forme de vie post-mortem fantomatique dans le Shéol ou monde du Dessous.
L’Exil de Babylone, au VIe siècle av. J.C., marqua le début de la dispersion ou Diaspora, des Juifs. Au IIe siècle av. J. C., vint l’occupation romaine. L’intervalle compris entre le retour de la « captivité de Babylone » et le début de l’époque néotestamentaire s’illustra par la Bible judaïque ou Ancien Testament qui prit forme, que les Apocryphes virent le jour et que la Loi orale commença d’être formulée. Toute l'histoire passée d'Israël fut réinterprétée à la lumière de cette catastrophe.
a - Développement du judaïsme rabbinique
Selon les historiens, la destruction totale de la société juive et du Temple par l’armée romaine de Titus en 70 et la défaite de Bar-Kokhba en 135 fut un événement d’une importance capitale pour la vie religieuse et politique des Juifs. Elles constituèrent pour le judaïsme une catastrophe semblable à celle de la destruction du premier Temple en 586 av. J.C.
Le peuple juif avait perdu le contrôle de sa destinée politique et sa référence identitaire au Temple. A la suite de ces événements, apparut le mouvement rabbinique. Les Juifs furent obligés de développer toute leur vie spirituelle autour de la Thora et de la synagogue. L’impossibilité de sacrifier sur le mont Sion, l’ancien culte sacrificiel, fut remplacée par un service de prière dans la synagogue et par l’étude des Ecritures.
Les rabbins, héritiers des pharisiens, mirent l’accent sur la vie communautaire et spirituelle. En escomptant la Rédemption messianique aux Hébreux par Dieu, la Torah [l’étude et l'observation de ses commandements] représentait le Temple. Les rabbins établirent que, si tous les juifs se conformaient à la Torah, le Messie serait obligé de venir. La synagogue et la maison d'étude rabbinique devinrent une Institution et remplacèrent le Temple détruit.
Les centres d’études rabbiniques de Palestine et de Babylonie, la Haggadah et la Hallachach prirent forme. Elles consistaient au début, en des sentences orales sous l’égide des Soferim, ou scribes [docteurs de la Loi], mais furent, par la suite, perpétuées par écrit. La Mishnah, les Gemaras de Babylone et de Palestine, ainsi que les Midrashim compilés dans le Talmud réunirent les travaux de multiples générations de docteurs et savants. Selon certains auteurs, il existe deux Talmud, celui de Jérusalem dont la compilation aurait été achevé vers 400 et celui de Babylone rédigé vers 300 qui fait autorité. Les centres d’étude de Palestine furent supprimés, mais une intense activité intellectuelle subsista à Babylone sous la direction des Gaonim, chefs des écoles rabbiniques de Sura, Nehardea et Pumbeditha. Ainsi, le Talmud devint « accessible » à tous.
La secte des Karaïtes [« Disciples des Ecritures »] du IXe au XIIe siècle, rejeta entièrement le Talmud pour n’adhérer qu’aux doctrines littérales de la Bible. En 1040, les écoles babyloniennes furent fermées. Un développement considérable de la culture judaïque s’établit dans un nouvel asile, en Egypte, et essentiellement dans l’Espagne musulmane où Maimonide fut l’une des plus grandes figures. Cet intellectuel juif auquel les savants musulmans formèrent toute son éducation culturelle condensa la doctrine juive en une sorte de Credo où un exposé officiel des principes de la religion juive est contenu dans les Treize Articles rédigés vers 1180.
C’est là, également que fleurit le mysticisme de la Kabbale, à laquelle s’associa un messianisme qui devait s’exprimer par l’apparition de pseudo-Messies. Après cette période de prospérité, la « Reconquista » en Espagne obligea les Juifs à une nouvelle dispersion et adaptation à travers le monde.
b - Le sectarisme juif
Bien que tous les Juifs admettent théoriquement la croyance en un Dieu, l’obligation d’un culte, la mission religieuse d’Israël, ils sont divisés en plusieurs écoles et en sectes.
Les Maccabées établirent la dynastie monarchique hasmonéenne et, bien qu’étrangers à l'antique lignée sacerdotale, se proclamèrent également grands prêtres héréditaires. L’association de ce comportement à leurs pratiques de monarques hellénisés, provoqua de violentes oppositions.
La communauté de Qumran1, actuellement mieux connue grâce aux manuscrits de la Mer Morte se sépara du Temple qu’elle jugeait profané par les Hasmonéens et s'exila au désert, perçut comme un temple purifié. On admet que Qumran doit être identifié aux Esséniens que décrit le chroniqueur juif Joseph Flavius2 [37-v. 100] comme l'un des trois « partis religieux ».
Les deux autres furent les Sadducéens, prêtres aristocratiques du Temple, et les Pharisiens [Perushim, « séparés »] qui développèrent leur propre interprétation de la Torah. Les pharisiens furent les précurseurs directs du mouvement rabbinique apparu après 70 apr. J.C.
L'autorité des rabbins sur l'ensemble de la communauté juive, y compris sur les importantes Diasporas d'Europe et de la Méditerranée, s'instaura progressivement. Après le VIIe siècle, la conquête arabo-musulmane du Proche-Orient installa un judaïsme rabbinique uniforme. Disposés à proximité du khālīfa abbasside de Bagdad, les Responsables des académies [écoles] rabbiniques de Babylone [Geonim « excellence »] harmonisèrent les pratiques, les rites et la liturgie juifs au travers des avis [Responsa] qu'ils expédiaient à la demande des communautés de la Diaspora. En conséquence, le siège de l'autorité rabbinique se fixa de la Palestine à Babylone et le Talmud babylonien devint l'autorité rabbinique de référence. Les rabbins entreprirent l’étude de la logique et des sciences musulmanes et les utilisèrent à la fois pour réagir aux polémiques anti-juives lancées par des théologiens chrétiens et pour montrer aux juifs la rationalité de leur foi et de leur Loi.
S. ben Joseph de Babylone au IXe siècle et J. Halevi et particulièrement M. ben Maimon3 [Maimonide] disciple d’Ibn-Rushd [Averroès, 1126-1198] au XIIe siècle furent les intellectuels du Judaïsme les plus remarquables. L'influence de la pensée logique s'imposa également aux codifications post-talmudiques de la Loi ; la plus fameuse fut la Mishné Torah de Maimonide.
Deux cultures distinctes se profilèrent du judaïsme médiéval. La culture Séfarade dans l'Espagne andaloumusulmane ou berbéro-hispanique et Ashkénaze surtout présente dans les territoires du Saint-Empire romain. La philosophie et l'établissement de systèmes de codification de la Loi furent principalement l'affaire des séfarades, tandis que les ashkénazes s’adonnèrent à l'étude approfondie du Talmud. La grande école « rhénane » de commentaires du Talmud fut fondée par S. ben Isaac, dit Rashi, qui vécut à Troyes au XIe siècle ; elle se poursuivit avec ses élèves et ses petits-fils, les Tosaphistes, qui rédigèrent la littérature Tosaphoth, c'est-à-dire les « additions » aux commentaires de Rashi.
Le représentant de la kabbale fut Moïse de Léon4, philosophe ésotérique qui introduit des éléments gnostique et néoplatoniciens. L’auteur exposa une symbolique complexe de la Torah et des commandements. Au début, limitée à de petits cercles d'érudits et de savants, elle se transforma en un courant célèbre parmi la communauté juive à la suite de l'expulsion des Juifs d'Espagne imposée par l’Eglise catholique en 1492.
I. Louria de Safed formula une réinterprétation messianique qui conduisit à une extension de la kabbale. La kabbale lourianique énonçait un sens aux souffrances des exilés en leur proposant un rôle décisif dans le drame cosmique de la Rédemption.
Sabbatai Zevi [1626-1676], développa les idées de I. Louria de Safed. Faux messie juif, Sabbatai Zevi fut responsable de l'un des mouvements messianiques les plus marquants et les plus significatifs de l'histoire juive. Né à Smyrne [Izmir, en Turquie], il se consacra à l’étude de la Kabbale ainsi que le Talmud et reçut le titre de hakam [« sage »], titre rabbinique séraphique. Il manifesta des signes psychiques et un comportement étrange [1648] en contradiction avec la loi religieuse où il se proclama Messie. Il quitta la Turquie en 1651 et parcourra pendant de nombreuses années la Grèce, la Palestine et l’Egypte. N. de Gaza, le charismatique, le persuada [1665] de sa véritable mission et fut suivit par des adeptes qui l’accompagnèrent en Palestine et à travers le monde. Emprisonné par les autorités turques [1666], il se « convertit» à l'Islam pour échapper à la mort. Il mourut exilé à Ulcinj [Monténégro]. N. de Gaza interpréta d'après la Kabbale, ainsi que par d'autres fidèles, les événements qui jalonnèrent sa vie et le mouvement se perpétua tout au long du XIXe siècle, et bien au-delà.
I. ben Eliezer ou I. Baal Shem Tov [v. 1700-1760] [« maître du saint Nom »] ou Besht, mystique juif et fondateur du Hassidisme, un mouvement spirituel du judaïsme, à partir du XVIIIe siècle où il attira un grand nombre de disciples. Rabbin et spécialiste de la Kabbale, il insistait sur l'expérience mystique et extatique de la présence divine.
Le hassidisme moderne s’étendit ; ses paroles et les légendes répandues à son sujet, au début transmises oralement, furent transcrites.
L'opposition initiale des rabbins au hassidisme se trouva bientôt tempérée par le développement des Lumières en Europe occidentale car elles s’allieront à ce courant pour traduire, commenter et utiliser la culture musulmane héritée d’Espagne en particulier et du monde musulman en général. Le Judaïsme collabora étroitement avec les Lumières dont le degré d’influence de l’un sur l’autre n’est pas inconnu.
Le Hassidisme eut beaucoup d’influence au XVIIIe siècle. En conséquence, le début de l'émancipation civile et politique de la communauté juive débuta sur une assise des plus solides en Europe avec la Révolution française.
Moise Mendelssohn5 [1729-1786], philosophe et écrivain allemand de l'Aufklärung [philosophie des Lumières], illustra la Haskalah, le mouvement d’« Illumination ». Il fut un ardent défenseur des droits civiques des juifs. Né à Dessau, en Allemagne M. Mendelssohn fut instruit par son père et le rabbin local. Il fut engagé comme précepteur [1750], par un marchand de soie berlinois, dont il devint l'associé. Il fut présenté [1754] et se lia d’amitié au dramaturge et critique allemand G. Ephraim Lessing6 [1729-1781] qui fut un avocat passionné de l'émancipation des juifs et l'un des principaux représentants des Lumières.
M. Mendelssohn reçut le prix de l'Académie de Berlin du meilleur essai sur un sujet métaphysique [1764]. Outre ses ouvrages consacrés à la philosophie, son œuvre porte également sur le Judaïsme et la communauté juive à laquelle il offrit une traduction en allemand des cinq premiers livres de l'Ancien Testament [Pentateuque], des Psaumes et d'autres parties de la Bible.
Une des figures essentielles de la philosophie juive, M. Mendelssohn rapprocha ses pensées juives à celles de ses coreligionnaires, le métaphysicien Leibniz et du philosophe Spinoza.
Tous les Juifs acceptent les dogmes du Judaïsme sous certaines réserves qui les divisent en diverses communautés. Les Juifs Orthodoxes mettent l’accent sur l’observation rigoureuse de la Loi mosaïque et rabbinique. Ils conservent farouchement leurs coutumes ancestrales et reprochent, actuellement aux dirigeants de l’Etat juif de Palestine d’avoir fondé un Etat de type européen au lieu de la théocratie mosaïque ancestrale.
Les Juifs Progressistes, en Europe occidentale, sont divisés à leur tour en Réformés et Libéraux. Ils reconnaissent la valeur de la Tradition, donc du code mosaïque et des préceptes du Talmud, mais à un degré limité. Ils pensent que la Loi et le Talmud ne sont pas l’autorité absolue et que bon nombre de leurs stipulations n’étaient valables que dans l‘Antiquité.
Le fait le plus marquant du judaïsme au XXe siècle, fut la réussite du Sionisme, mouvement fondateur d’un Etat en Palestine.
2 - Le cérémonial
L’Alliance [Berith ou Brith] est le second concept essentiel du judaïsme entre Dieu et le peuple juif. D’après la Tradition juive, le Dieu de la création proposa son alliance au peuple hébreu sur le mont Sinaï. Le peuple admettait Dieu comme son seul roi et législateur suprême et consentait à obéir à ses lois ; en retour, Dieu reconnaît le peuple juif pour son peuple particulier sur lequel Il veillait.
Selon la tradition juive, l'Alliance fut replacée dans un contexte universel : c'est après avoir échoué à maintes reprises à établir une alliance avec l'humanité rebelle que Dieu se tourna vers une partie de cette humanité, les Juifs. « Israël » devait devenir un « royaume de prêtres » et établir un ordre social conforme aux lois divines, offrant ainsi un modèle pour tout le genre humain. Le monde se devait d’être régit par des prêtres. « Israël » se trouvait ainsi placé en gestionnaire et en médiateur entre Dieu et l'humanité.
La vision juive de l'histoire fut influencée par cette notion d'alliance. Un lien causal fut proclamé entre l'action des hommes et leur destin déterminé par Dieu. De même, la domination étrangère et l'exil forcé devaient être réparés à la fin des temps, lors de la venue du Messie [Mashiah, « oint », comme un roi], issu de la lignée de David.
Peu à peu, un lien se créa entre le messianisme et la Torah : chaque juif pouvait hâter la venue du Messie par sa responsabilité [donc à diriger], l’étude assidue et l'observation des lois.
a - La tradition rabbinique
Les racines du judaïsme plongent dans la Bible hébraïque assurée par la Torah ou Pentateuque, les Nebiim ou écrits prophétiques et les Ketubim qui réunissent les autres écrits canoniques. Il est faux d'assimiler le judaïsme à la « religion de l'Ancien Testament». Des commentaires sur des passages de la Bible ou Midrashim et des traductions de la Bible en araméen, ou Targums furent également rédigés par les rabbins.
J. ben Ephraïm Caro7 faisait autorité au XVIe siècle par sa participation à formuler la codification de la loi talmudique.
Traditionnellement, les juifs prient le matin [shaharith], l'après-midi [minhah] et le soir [arbith]. Cet horaire devait correspondre aux heures des sacrifices dans le Temple de Jérusalem : ainsi le judaïsme rabbinique poursuivit-il le culte du Temple sur un mode métaphorique.
Le rite est une série de bénédictions appelées Tefillah [prière], Amidah [« prière debout»], ou Shemoneh Esreh, parce qu'on y compta dix-huit bénédictions.
Actuellement, on en compte dix-neuf. Les hommes portent un châle de prière à franges [tallith] et des phylactères [boîtes de prière appelées tefillin], usages inspirés de divers passages de la Bible, comme l'est la tradition superstitieuse de placer une mezuzah ou boîte de prière sur le montant de la porte de sa maison. Les participants se couvrent la tête durant la prière avec un chapeau ou une calotte [kippah] par respect pour Dieu.
L'espoir messianique entretenu en exil d'un royaume judéen restauré sous l'autorité d'un descendant du roi David défini dans le Talmud se perpétue dans la croyance juive. Le Judaïsme énonce ainsi une croyance hermétique [Kabbale, Talmud, Zohar] qui est cantonnée à un peuple spécifique [« Peuple élu », « Peuple aimé de Dieu »], ethniquement ségrégationniste. Il est établi qu’aucun individu ne devient d’obédience juive par une profession de foi, mais qu’il naît Juif. La confession au Judaïsme est garantie biologiquement par une filiation matriarcale. La conversion au Judaïsme n’existe pas8.
b - Fondements de la croyance
L'esprit de Dieu s'est manifesté dans l'ordre naturel à travers la création et dans l'histoire à travers la révélation : le même Dieu qui créa le monde se révéla uniquement aux Hébreux sur le mont Sinaï. La Torah [ou « loi révélée »] a formulé cette révélation sous forme de commandements [mizvoth] qui expriment la volonté de Dieu pour les Juifs.
Marcion de Sinope [v. 85-v. 160], riche armateur est le fondateur d'une secte chrétienne hétérodoxe, les Marcionites. Né à Sinope [Turquie] fils de l'évêque de la ville. Il s'installa à Rome [140] et propagea ses idées ; accusé d'hérésie, il fut excommunié. La secte se distingua par le célibat et l’ascétisme. Les églises marcionites se développèrent rapidement et concurrencèrent en nombre celles de l’Eglise.
Marcion rejeta l'Ancien Testament et presque tout le Nouveau Testament, y compris la Nativité et la Résurrection. Il ne se basa que sur les Epîtres de saint Paul et sur une version modifiée de l’Evangile de Luc. Le marcionisme eut beaucoup d'adeptes en Occident jusqu'au IVe siècle et subsista en Orient jusqu'au