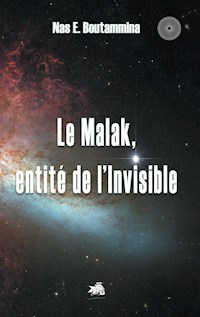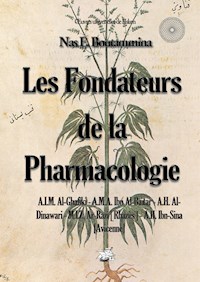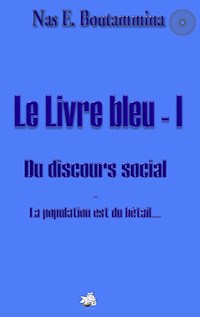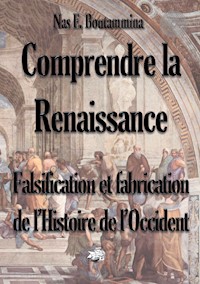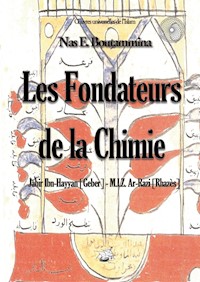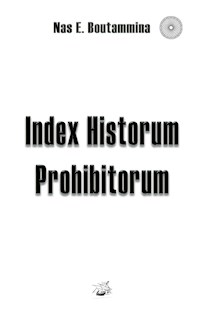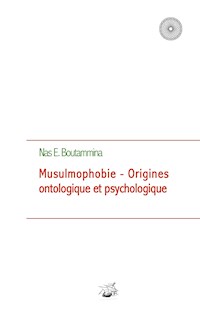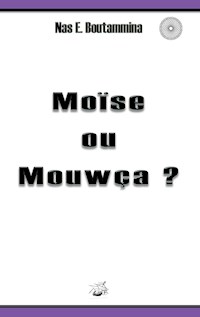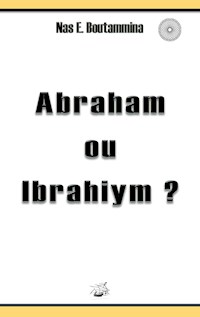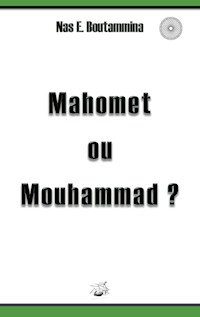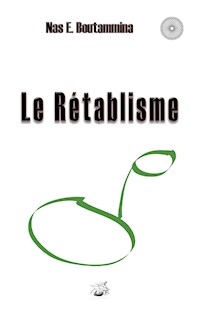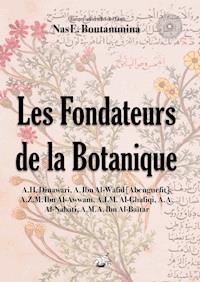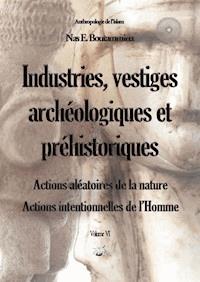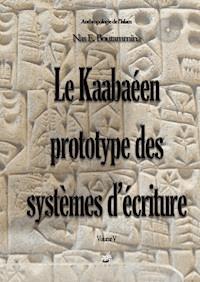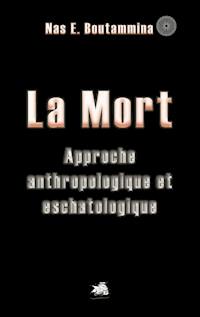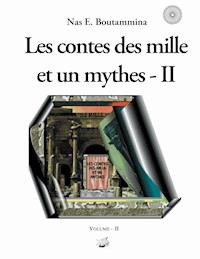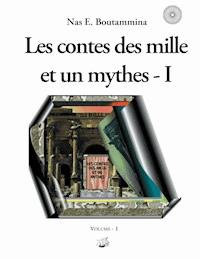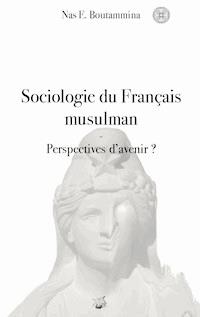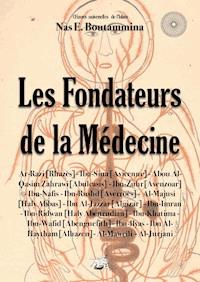
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Oeuvres Universelles de l'Islam
- Sprache: Französisch
Pendant des millénaires guérir fut l'apanage des prêtres, des sorciers et des chamans. Les pratiques magiques, les systèmes philosophiques ou métaphysiques s'efforçaient de répondre aux besoins et aux angoisses de l'homme malade avant de trouver dans le rationalisme scientifique du IXe siècle qui devait conduire aux progrès gigantesques et décisifs que sont ceux de l'époque contemporaine (essor des procédés de diagnostic et multiplication des moyens efficaces de traitement). La Médecine au sens moderne du terme date du début du IXe siècle. On ne peut dans cet ouvrage qu'esquisser à larges traits les étapes essentielles, en citant pour chacune d'elles les figures et les découvertes dominantes. En mentionnant dans ce livre les oeuvres et les grands noms des Sciences médicales, c'est faire preuve de justice et de mémoire à leur égard, eux qui ont construit l'édifice de la Médecine. Ces prodigieux artisans du progrès médical, au service de l'Humanité, ne devraient-ils pas être reconnus à leur juste mesure et ne plus demeurer dans l'anonymat ? Eux les fondateurs à juste titre des Sciences médicales !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Introduction
La « médecine » antique
La « médecine » mésopotamienne
La « médecine » égyptienne
La « médecine » juive
La « médecine » perse
La « médecine » indienne
La « médecine » grecque
Eléments incarnant les dieux gréco-romains
Hippocrate ? Le Serment d’Hippocrate ?
Observation succincte
Support de l’écriture dans l’Antiquité
La Bataille de Talas et le papier - Naissance du livre et de l’ouvrage
Technique de la fabrication du papier
Les prétendus « livres » ou « ouvrages » grecs
La « médecine » grecque au quotidien
La « médecine » grecque
La Renaissance et la Médecine
Traduction des œuvres médicales
Quelques autres termes médicaux arabes ou usités en médecine
Quelques exemples de médecine comparée
Le siècle des Lumières et la Médecine
Université ou Ecole de Médecine
Cité antique, le retour au mythe
La bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris
Quelques plagiaires
Quelques plagiaires d’ouvrages de Médecine islamique
II - Nos Maîtres musulmans fondateurs de la Médecine
Témoignages
M.I.Z. Ar-Razi [Rhazès]
Ar-Razi le clinicien
Traités de M.I.Z. Ar-Razi
« Kītāb al-Hawi fi al-Tibb » [Livre contenant toute la Médecine - Liber continentis medicina]
Autres traités médicaux de M.I.Z. Ar-Razi
A.H. Ibn-Sina [Avicenne]
Œuvre magistrale « Al-Qanun fi al-Tibb [Le Canon de la Médecine]»
A.H. Ibn-Sina - «Al-Qanun fî al-Tibb [Le Canon de la Médecine] »
Autres livres de A.H. Ibn-Sina
Abu Al-Qasim Zahrawi [Abulcasis]
Matières non exhaustive du contenu de quelques livres du «
Kītāb at-Taçrîf li-man ajiza an al-talif [La
Pratique Médicale - Antidotaire] » de A.Q. Zahrawi
Considérables apports et innovations scientifiques majeures de A.Q. Zahrawi
L’Anatomie
La Chirurgie
Quelques techniques et interventions de A.Q. Zahrawi
Odontologie
Médecine
Instruments médicaux et chirurgicaux imaginés et fabriqués par A.Q. Zahrawi
A.Q. Zahrawi un esprit moderne
A.M. Ibn-Zuhr [Avenzoar]
A.M.Ibn-Zuhr un médecin contemporain
Œuvres de A.M. Ibn-Zuhr
Ibn-Nafis
Œuvres d’Ibn-Nafis Al-Karashi
Autres livres de Ibn-Nafis Al-Karashi
Plagiat de l’œuvre d’Ibn-Nafis Al-Karashi
Tableau chronologique du plagiat de l’œuvre de Ibn-Nafis
A.W.M. Ibn-Rushd [Averroès]
Œuvres médicales de A. W.M. Ibn-Rushd
Kitab Al-Kulliyate fi al-Tibb [« Livre de Médecine générale Universelle- »]
Autres ouvrages médicaux de A.W.M. Ibn-Rushd
«
Al-Siha
[« De Sanitate - de Complexione - « Santé et Physiologie »]
« Kitab Al-Kulliyate fi al-Tibb »
« Kitab Al-Kulliyate fi al-Tibb »
A. Al-Majusi [Haly Abbas]
Kitab al-Maliki
A.J.A. Ibn Al-Jazzar [Algizar]
Œuvres de A.J.M. Ibn Al-Jazzar
A. Ibn-Ridwan [Haly Abenrudian]
O. Ibn-Imran
A.J.A. Ibn-Khatima
A.B.M. Ibn-Bajja [Avempace]
Autres œuvres de A.B.M. Ibn-Bajja
A.A. Ibn-Wafid [Abenguefith]
M. Ibn-Ilyas
Autres médecins renommés
A.B.M. Ibn-Tufayl [Abubacer]
« Kitãb taqwîn alSihha [livre de l’établissement de la Santé] »
Dessins anatomiques
Les Traditionnistes, Gardiens de l’Obscurantisme
Ophtalmologie
O. Ibn Al-Haytham [Alhazen]
A. Al-Mawçili
S.Z. Al-Jurjani
Quelques autres célèbres ophtalmologues
III - Pratique et enseignement des Sciences médicales
Déontologie médicale
Le serment d’Ibn-Sina [Serment d’Avicenne]
Dossier médical
Evaluation par les pairs
Haut Conseil médical local
L’Hôpital
Hôpital psychiatrique
La Santé publique
Cas du « Professeur » M.I.Z. Ar-Razi « chef de service et praticien hospitalier »
Personnel féminin compétent
Financement du milieu hospitalier
Pharmacie hospitalière
Ecole de Médecine ou Université de Médecine
Enseignement et diplômes
Bibliothèque universitaire
Bibliothécaire
Conclusion
Index alphabétique
Table des matières
Dans les mêmes éditions
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Y-a-t-il eu un temple de Salomon à Jérusalem ? », Edit. BoD, Paris [France], aout 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les ennemis de l’Islam - Le règne des Antésulmans -Avènement de l’Ignorance, de l’Obscurantisme et de l’Immobilisme », Edit. BoD, Paris [France], février 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le secret des cellules immunitaires - Théorie bouleversant l’Immunologie [The secrecy of immune cells - Theory upsetting Immunology] », Edit. BoD, Paris [France], mars 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Livre bleu - I - Du discours social », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2014.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, «Le Rétablisme»,Edit. BoD, Paris [France], mars 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Comprendre la Renaissance - Falsification et fabrication de l’Histoire de l’Occident », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Connaissez-vous l’Islam ? », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Malāk, entité de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], mai 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Jésus fils de Marie ou Hiyça ibn Māryām ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Index Historum Prohibitorum », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Moïse ou Moūwça ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Mahomet ou Moūhammad ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Abraham ou Ibrāhiym ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Musulmophobie - Origines ontologique et psychologique », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Jinn bâtisseurs de pyramides… ? », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « La Mort - Approche anthropologique et eschatologique », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Jinn, créature de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Français musulman - Perspectives d’avenir ? », Edit. BoD, Paris [France], février 2017. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Judéo-christianisme - Le mythe des mythes ? », Edit. BoD, Paris [France], mars 2017. 2
e
édition.
Collection Néo-anthropologie [Anthropologie de l’Islam]
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Apparition de l’Homme - Modélisation islamique -Volume I », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « L’Homme, qui est-il et d’où vient-il ? - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Classification islamique de la Préhistoire - Volume III », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Expansion de l’Homme sur la Terre depuis son origine par mouvement ondulatoire - Volume IV », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Kaabaéen prototype des systèmes d’écriture» -Volume V», Edit. BoD, Paris [France], mai 2016.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Industries, vestiges archéologiques et préhistoriques -Action aléatoire de la nature & Action intentionnelle de l’Homme » - Volume VI », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2016.
Collection Œuvres universelles de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Chimie », Edit. BoD, Paris [France], octobre 2013.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Pharmacologie », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2014.
« Être au service de l’Humanité, c’est être au service d’Allah »
NEB
Avertissement
La Collection « Œuvres universelles de l’Islam » rend hommage aux savants musulmans fidèles au Message coranique : « Être au service de l’Humanité ». Pour cela, ils ont créé les Sciences, base de la Civilisation humaine, héritage de nos sociétés contemporaines.
Hélas, les savants musulmans n’ont jamais reçu la moindre marque ou témoignage d'estime et de gratitude, c’est-à-dire un honneur à l’égal de leur talent et de leur génie qu’ils léguèrent à la postérité.
Il est d’usage d’octroyer un nom [éponyme] à une rue, à un établissement public, etc. en l’honneur d’un personnage illustre ayant œuvré pour le bienfait de l’Humanité ou ayant contribué aux progrès de la Civilisation [Sciences, Arts, etc.]. Ce qui est extraordinaire et absolument aberrant, est qu’en ce qui concerne les savants musulmans fondateurs de la Civilisation universelle, aucune rue, aucune voie, aucune avenue, aucun boulevard ; aucun établissement scolaire [école, collège, lycée] ou public [hôpital 1 , clinique, Centre de Recherche, etc.] ; aucune Université, aucune Faculté, aucun Institut ; aucune fondation, aucune technique, ni aucune loi scientifique n’est honorée de leurs noms !
« En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes [lois scientifiques] pour les doués d’intelligence, » (Coran, 3-190)
« qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, évoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre [en disant] : Ô notre Seigneur ! Tu n’as pas créé [tout] cela en vain. Gloire à Toi ! Gardenous du châtiment du Nār [Feu] ». (Coran, 3-191]
Une correction s’impose quant à l’appellation de « Science arabe ». Il n’y a jamais eu de Science « arabe ». La Science expérimentale [Chimie, Mathématiques, Physique, Médecine, Astronomie, Pharmacologie, Botanique, Agronomie, Zoologie, etc.] a été crée principalement par les Musulmans d’origine berbéro-andalouse [ou maghrébo-andalouse] et perse. Ainsi, la Civilisation de l’Islam classique héritage de nos sociétés actuelles, a été essentiellement le fruit extraordinaire de ces deux peuples : berbéro-andalous et perse. Leur génie ô combien prodigieux demeure unique dans l’Histoire de la pensée !
Les Arabes définissent uniquement et seulement les populations actuelles du Golfe : Koweït, Bahreïn, Qatar, Sultanat d’Oman, les Émirats Arabes Unis [E.A.U.] l’Arabie et le Yémen. Ce ramassis de peuplades voue un mépris absolu à la Science, à la Culture, aux Arts, à l’Esthétique, au Progrès, à la Civilisation. D’un point de vue anthropologique et donc ontologique, la nature de la « société » des Arabes est essentiellement fragmentée en tribus bédouines et pirates. Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, les Arabes vouent un culte à la limite de la folie à leurs divinités l’or et l’argent qu’ils leur permettent d’acquérir prestige, gloire et considération aux yeux du monde qui les entoure. Ce manque de noblesse, ils s’efforcent de le combler par le recours au brigandage et aux razzias, traits culturels qui sont toujours la règle tribale. Naturellement, ils sont incapables de saisir le concept de Science. Totalement étranger à leur esprit, celui-ci est inconnu de leur mode de vie, de leur société. Dès lors, il leur est évidemment sans intérêt.
Ainsi, l’expression juste est : Science islamique ou Science de l’Islam et en aucun cas Science « arabe » !
1 Hôpital Avicenne. Hôpital de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est situé à Bobigny, en Seine Saint-Denis. Inauguré le 22 mars 1935 sous l’appellation d'hôpital franco-musulman. Il était alors réservé aux patients musulmans de Paris et du département de la Seine. L'hôpital était placé sous l'autorité de la Préfecture de Police de Paris, étant rattaché au Service de Surveillance et de Protection des Indigènes Nord-Africains [SSPINA]. Cet hôpital prend le nom d’Avicenne en 1978 ! Voilà pour quelle raison, cet établissement fut nommé ainsi. Ce n’est pas par reconnaissance ou pour rendre hommage à cet imposant monument des Sciences médicales qu’est A.H. Ibn-Sina latinisé Avicenne !
Introduction
Depuis des millénaires, les maladies s’appuyaient sur des causes irrationnelles, surnaturelles, superstitieuses, mythologiques ou occultes. Ainsi, guérir fait appel à la magie, à la prière et à la divination. L’affection était vue comme une sanction surnaturelle causée à l’homme par une puissance divine ou démoniaque, incompréhensible pour lui.
De ce fait, seuls les sorciers, les prêtres, les devins, les oracles, les chamans avaient le « pouvoir » d’intervenir efficacement dans une telle situation.
Dans l’Antiquité, par exemple chez les Grecs, les Egyptiens ou les Perses, la pathologie était, en définitive, un aspect de la mythologie. Le fait de donner des « soins » provenait d’un don, d’un rare pouvoir octroyé à un « élu » des dieux afin qu’il puisse entrer en rapport avec les puissances surnaturelles. Cette conception mythologico-légendaire et arriérée demeura jusqu’au VIIe siècle.
Pendant toute la période du Moyen Âge, l'Occident végétait dans un perpétuel immobilisme, héritage culturel gréco-romain, dont il n'a commencé à s’extirper que dans les deux siècles qui ont précédé la Renaissance. Epoque où la culture de la Civilisation de l’Islam Classique commençait à l’éclairer et à chasser les ténèbres de l’Ignorance et l’Obscurantisme qui l’enveloppaient. Les Sciences médicales [et les Sciences en général] consignées par les penseurs musulmans dans leurs livres [premiers supports pratiques de la diffusion du Savoir] furent traduits par l’Eglise, la seule autorité culturelle.
Ainsi, depuis le Xe siècle une politique méthodique d’acquisition et de traduction d’ouvrages en version latine et grecque fut décrétée par les plus hauts dignitaires de l’Eglise et le bras séculier. Une armée de traducteurs s’inscrivant dans une longue tradition de copiste fut dépêchée. Ont-ils simplement traduit les œuvres des penseurs musulmans ? Une chose est sûre, l’objectif de l’Eglise qui contrôlait d’une main de fer la pensée et la conscience de ses ouailles, est une tentative scientifique d’inventer une continuité socioculturelle entre l’Antiquité grécoromaine et l’Occident chrétien.
Quoiqu’il en soit, la mentalité des sociétés chrétiennes accepta très péniblement que le monde de la maladie et l’art de guérir, c’est à dire la Médecine, sont une réalité régit par des lois. Une dizaine de siècles furent nécessaires à l’assimilation des Sciences médicales que leur léguèrent les illustres savants musulmans. Et quelle a été l’attitude de l’Occident ? A-t-elle été reconnaissante de ces legs ? A-t-elle honoré ces Médecins illustres, monuments de l’Histoire des Sciences ?
I - La « médecine » antique
A - La « médecine2 » mésopotamienne
Les Sumériens, peuple de pasteurs installés dans la basse vallée de l’Euphrate, pratiquent une « médecine » dont le principe essentiel est que le foie régule la vie. Son examen sur les animaux représente ainsi le moyen indispensable de s’informer des présages. L’intelligence selon eux se trouve dans le foie et la volonté dans l’oreille ! Toute maladie est due à la possession de l’organisme par un démon qui risque de le détruire. L’aspersion du corps du patient avec de l’eau bénite en provenance des fleuves sacrés accompagnée d’une prière incantatoire conduit à l’expulsion du démon. Les Sumériens comme tous les autres peuples antiques interprètent magiquement les rêves dont l’état du sang est responsable.
H.S. Williams3 explique à ce propos que l’on réussit à se protéger, au moins en partie, contre ces démons en se servant d’amulettes magiques, de talismans et d’autres charmes, et que des images des dieux promenées sur tout le corps, suffisent à l’ordinaire à effrayer les démons. Enfin, de petites pierres attachées à un fil fait de poils de chevrettes vierges, ont des vertus particulières et, pendues autour du cou, sont particulièrement efficaces.
R. Briffault4 note que l’on essaie de persuader le démon de quitter sa victime humaine et d’entrer dans le corps d’un animal, d’un oiseau, d’un porc ou le plus souvent d’un agneau.
Les écrits trouvés dans la bibliothèque d’Ashurbanipal contiennent, dans leur majeure partie, des formules magiques pour expulser les démons, pour échapper au mal et pour prédire l’avenir.
W. Durant5 mentionne que l’hépatoscopie [l’observation du foie des animaux] était la méthode préférée des prêtres babyloniens, et qu’elle passa ensuite en Grèce et à Rome où l’on croyait que le foie était le siège de l’intelligence chez les animaux et chez l’homme. Aucun roi ne se serait mis en campagne ou n’aurait engagé une bataille, aucun Babylonien n’aurait pris une décision grave ou ne se serait engagé dans une entreprise importante sans avoir demandé à un prêtre ou à un devin d’interpréter, pour lui, les présages.
En Mésopotamie, les sociétés babylonienne et chaldéoassyrienne succèdent à la société sumérienne. La médecine, partie intégrante de la religion, est pratiquée exclusivement par des prêtres qui luttent contre l’emprise des esprits malfaisants. La lune incarne le dieu Sin qui détient, parmi ses attributs, celui de l’art de guérir ; les Grecs l’adopteront et le personnifieront en Apollon. Le code d’Hammourabi6 [XVIIIe s. av. J.C.] doit son nom au fondateur de l’Empire babylonien dont la stèle, découverte dans les ruines de Suze et transportée au Musée du Louvre, énonce des prescriptions « médicales » assyrobabyloniennes entremêlées avec des inscriptions magiques.
B - La « médecine » égyptienne
La « médecine » égyptienne révélée par des textes trouvés à Louksor débute historiquement, selon certains auteurs, vers deux mille ans environ avant l’ère chrétienne.
La connaissance de l’anatomie que rapportent les papyrus « médicaux » n’était pas à but scientifique, mais simplement funéraire, pour l’embaumement pratiqué par les grands prêtres de la déesse Neith. La mythologie égyptienne caractérise la conception « médicale » du peuple où les dieux symbolisent le clan.
Thot, dieu de l’écriture et donc des scribes est également dieu des arts, de la magie et de la guérison miraculeuse. Il est adopté par les Grecs sous le nom d’Hermès. Schmet est la déesse de la guérison des maladies des femmes ; Imhotep qui est un homme et un guérisseur sous le règne de Zozer [IIIe millénaire av. J.C.] à Memphis est déifié et des temples lui sont dédiés.
G. Maspero7 note que le papyrus d’Ebers appartenait à l’un de ces sanctuaires où la statue d’Imhotep le représente tenant un rouleau à demi déployé, symbolisant sa science. Les Grecs l'optent et le transposent en Asklepios ou Esculape.
Les papyrus « médicaux » n’exposent aucune connaissance anatomique ou physiologique mais fournissent par contre d’importantes prescriptions. Ces remèdes thérapeutiques auxquels se joignent des recettes magiques signalent des mixtures étonnantes. Par exemple, les affections oculaires imposaient des recettes à base de sang de lézard, d’excréments d’hippopotame et de crocodile !
A. Erman explique que la médecine est le domaine des prêtres ; elle conserve donc toujours la marque de ses origines magiques. Les amulettes ont le pouvoir de prévenir et de guérir la maladie qui est considérée comme une possession diabolique devant être traitée par des incantations. Par exemple, un rhume s’exorcise par des formules magiques telles que : « Hors d’ici rhume, fils de rhume qui brise les os, détruit le crâne, endolorit les sept ouvertures de la tête…! Tombe sur le plancher, puanteur, puanteur, puanteur... ! »8
A. Erman, G. Maspero 9 , T.S. Harding 10 décrivent les médicaments qu’utilisent les guérisseurs égyptiens dont les substances sont étonnantes : du sang de lézard, des oreilles et des dents de porc, de la viande et de la graisse en putréfaction, de la cervelle de tortue, un vieux rouleau de papyrus bouilli dans de l’huile, le lait d’une femme en couches, l’urine d’une vierge ; des excréments d’homme, d’âne, de chien, de lion, de chat et jusqu’à des poux ! On traitait par exemple la calvitie en frictionnant la tête avec de la graisse animale. Ces « médicaments » sont passés des Egyptiens aux Grecs et des Grecs aux Romains.
Il est indéniable que la médecine égyptienne a considérablement influencé tout l’art pseudo-médical antique. Les Grecs en sont les principaux bénéficiaires car ils ont recueilli et incorporé les traditions de l’Egypte dans leur culture. Cette grande influence égyptienne s’affirme également en mythologie où beaucoup de divinités égyptiennes sont assimilées par les Grecs,11 ainsi qu’en art, en littérature, etc.
A juste raison, la production intellectuelle proprement grecque est insignifiante et grossière. Ainsi, l’éducation des Grecs est naturellement égyptienne. L’histoire comparée de la société grecque et égyptienne certifie que l’Egypte est la grande Ecole antique. Ainsi, la culture grecque est la copie altérée de celle de l’Egypte !
C - La « médecine » juive
La « médecine » juive demeure une partie intégrante de la religion. L’Eternel punit les créatures en leur envoyant des maux, des maladies, qui sont le résultat soit de leurs fautes personnelles, soit des péchés commis par leurs ancêtres. Les textes sacrés juifs [Talmud, Thora] citent beaucoup de références quant aux châtiments atteignant plusieurs générations. A cette conception théologique de la médecine, s’ajoutent maintes théories provenant soit des premiers âges, soit du contact avec les peuples orientaux, qui attribuent une origine maléfique ou démoniaque aux maladies. Des recettes magiques sont compilées dans le Talmud de Babylone12. Les prêtres seuls sont habilités à exercer la « médecine » dont la thérapeutique est simultanément divine, magique et naturelle : le sacrifice y occupe une place importante. Le courroux de Dieu ou Yahvé s’apaise par l’offrande d’une victime expiatoire ; sous le couteau du sacrificateur, l’animal est substitué à l’homme.
Selon les auteurs, à l’ère du « Temple de Jérusalem », le grand prêtre est chargé des sacrifices en expiation des péchés. Lors de la cérémonie, il confesse les fautes des croyants en plaçant ses mains sur un bouc qui est ensuite emporté dans la nature ou envoyé dans un précipice. Cet acte du « bouc émissaire » symbolise l’expiation et le pardon de Dieu.
La guérison des maladies doit survenir peu après. Les Juifs portent des talismans, des phylactères [du grec phulassein « garder, veiller sur »] noués au bras ou au front et qui représentent des fragments de parchemin où sont transcrits certains passages appropriés des Ecritures.
Le Talmud renferme de grossières notions anatomiques, physiologiques et pathologiques qui correspondent à celles des autres sociétés orientales aux mêmes époques, notamment celles de l’Egypte et de Babylone. Le recours aux incantations magiques pour lutter contre les esprits mauvais est aussi le corollaire de leur croyance.
D - La « médecine » perse
L’art « médical » perse s’identifie à celui de Babylone. Selon la mythologie perse [qui oppose Ormuzd, l’esprit du bien à Ahriman, l’esprit du mal], Ameratap représente la déesse de la santé qui révèle à l’Homme les plantes salutaires et les remèdes. Elle crée notamment l’arbre miraculeux qui provoque la guérison de toutes les maladies et procure l’immortalité13. De même Mithra, dieu créé par Ormuzd, dispense également la santé et procure l’immortalité.
E - La « médecine » indienne
Les textes anciens de l’Inde sont continuellement recopiés, ce qui favorise la perpétuation de l’antique « médecine » indienne [ainsi que de toute sa culture] qui demeure sans altération jusqu’à notre époque. Ce qui représente une mine d’informations anthropologiques pour les chercheurs en Sciences humaines.
A l’ère védique [des hymnes sanscrits ou Vedas] qui se prolonge jusqu’à environ 2500 av. J.C., la « médecine » [telle celle de la Chine] est exclusivement magique et superstitieuse, comme en témoignent les textes de l’Atharva-Véda. La « médecine » est l’apanage de la caste des prêtres ou brahmanes. Ainsi, cette médecine reste foncièrement magique.
F - La « médecine » grecque
Les maîtres égyptiens sont les grands dispensateurs de la culture en Grèce. Selon leur capacité et leur aptitude intellectuelle, les Grecs puisent dans le terreau de la tradition de l’Egypte et assimilent ses éléments à leur société. L’héritage égyptien s’ajoute aux mythes et aux légendes extravagantes qui sont l’essence du peuple et de la société grecques foncièrement superstitieuse.
Dès lors, la conception médicale grecque est mythologique et superstitieuse !
Le poète latin P. Ovidius Naso ou Ovide [43 av. J.C.-v. 17 apr. J.C.] rapporte des renseignements très significatifs concernant la « médecine » au sein de sa société.14 Il reprend les thèmes abordés par ses coreligionnaires représentant le savoir de sa société, et les rassemble en un classement chronologique légendaire débutant du chaos originel jusqu’au règne d’Auguste. Ainsi, toute la connaissance grecque et romaine [notamment médicale] illustre les légendes concernant les métamorphoses d’êtres humains en plantes, en animaux, en astres ou en pierres.
La vision de la mort par les Grecs témoigne de leur conception de la vie comme déroulement, altération ou perturbation. A sa mort, le défunt rejoint Hadès, le dieu des Morts, fils des titans Cronos et Rhéa, frère de Zeus et de Poséidon.
Les Romains l’appellent Pluton. Hadès règne sur le royaume des morts qui est un endroit sombre et triste, habité par des ombres et gardé par Cerbère, le chien à trois têtes et à queue de dragon.
La doctrine pythagoricienne affirme l’immortalité de l’esprit15, qui après la mort s’incarne dans le corps d’animaux d’espèces différentes, d’après une cadence migratoire définie. De ce principe, découle le végétarisme des pythagoriciens.
Les Grecs établissent qu’Apollon transmit la « médecine » à Œnone, nymphe du mont Ida, à Déiphobé et à Chiron le Centaure qui initia Héraclès [Hercule], Achille et Asklépios ou Asclépios [Esculape].
Homère fournit également des informations sur l’art médical grec qui s’allie avec la magie.16 L’action surnaturelle s’entremêle avec des mixtures naturelles qu’absorbent les héros.
L’auteur ajoute que les Egyptiens, tous descendants de Péon, sont d’habiles médecins grâce à cette ascendance. En effet, le dieu Mars blessé par Diomède et le dieu Pluton blessé par Hercule sont guéris par Péon, médecin des dieux. Péon venait, selon la tradition, d’Egypte et fut confondu par la suite avec Apollon.
J.M. Guardia 17 souligne à son tour que les Grecs sont profondément superstitieux. Innombrables sont les superstitions relatives à la santé et à la maladie, innombrables les dévotions et les pratiques chassant la maladie grâce à une intervention surnaturelle.
On lit dans les travaux de R. Dumesnil18 que l’Olympe regorge de divinités guérisseuses ; Hygeia [Hygie] est la déesse de la santé, Péon le médecin des dieux et Diane-Artémis la déesse des vierges invoquée pour guérir les enfants. Il y a encore la déesse Eilithys-Héra, confondue chez les Romains avec Junon-Egerie, déesse de l’accouchement, des femmes et des enfants. Puis la déesse Aphrodite, pour la sexualité. Quant à Esculape, A. Ruffat19 explique qu’à Epidaure il guérit par des songes divins. D’une façon générale, en « médecine » pour les Grecs, la croyance veut que chaque signe zodiacal menace la partie du corps qu’il gouverne.
Il existe des jours indifférents et des jours critiques dans le cours des maladies à cause de ces influences planétaires. Ils attachent d’ailleurs, une importance considérable au chiffre 7. Les Grecs nomment séléniaques [Séléné « la lune »] tous ceux qui sont atteints de maladies mentales ou nerveuses. Les éolithes ont des pouvoirs surnaturels et donc, sont capables de soigner les maladies20. L’influence des astres, donc des dieux, sur les pierres devait être codifiée par les lapidaires grecs.
Les phénomènes physiologiques les plus courants, les convulsions d’un enfant, les palpitations, les tics nerveux sont jugés surnaturels, observés et interprétés. Plutarque voyait ainsi le démon familier de Socrate se manifester dans ses éternuements.
Autre superstition encore : un homme ne doit pas se laver dans l’eau où s’est baignée une femme au risque de perdre sa virilité. Le vin quant à lui a un usage multiple et demeure le remède universel, particulièrement dans les maladies aiguës et dans le bâillement où il faut en consommer sans modération21 !
Concernant les nouveau-nés, ils sont observés comme des messages divins. Leur constitution donne lieu à des controverses d’augures.
Tite-Live 22, chroniqueur romain, recueille un très grand nombre d’observations concernant les naissances que les augures étudient. La malformation, par exemple, était considérée comme un signe de malheur pour la cité.
A l’annonce d’une épidémie de peste à Luni, par ordre des haruspices23, les enfants soupçonnés d’androgynie ont alors été noyés !
Les orphistes24, explique P. Boyance25, possédaient comme les pythagoriciens une grande influence. En effet, ils prétendaient par toutes sortes de conjurations et de moyens magiques guérir les maladies, asservir les dieux et la volonté du suppliant. Le médecin versé dans les arts magiques, le prêtre purificateur et les orphiques, s’inspirant de ce modèle, exercent leur activité dans tous les domaines.
Sourdille26 et W. Spiegelberg27 notent que ces emprunts sont le fait de l’Egypte qui est [nous l’avons vu] l’origine de bien des croyances et des rites de la religion grecque, introduits à diverses époques par des gens se les appropriant.
Même si aucune information précise n’existe sur la biographie d’Héraclite ou d’Empédocle, certains historiens rapportent toutefois que ces deux personnages parlent avec certitude et admiration de ce qu’ils ignorent, en se basant sur la cosmogonie. La conviction que la mythologie explique le monde et que la médecine commente le surnaturel leur fit inventer des théories et des hypothèses dont l’imagination fait tous les frais. Les quatre éléments, l’air, l’eau, le feu, la terre, personnifiant chacun une divinité, sont le fondement principal de leur conception intellectuelle du monde qui leur donne la possibilité de préparer leur culture [philosophie, « médecine », hymnes].
La cosmogonie leur permet de confectionner de nouveaux éléments et de nouvelles divinités où chaque dieu-élément joue le rôle principal. Sur ces fondations hypothétiques sont établies des conjectures imaginaires. Tout l’édifice de la « médecine » grécoromaine est supporté pendant quinze siècles par cet échafaudage mythique !
ELEMENTS INCARNANT LES DIEUX GRECO-ROMAINS
E
LEMENT
P
ERSONNIFICATION GRECQUE
P
ERSONNIFICATION ROMAINE
A
IR
Z
EUS
J
UPITER
E
AU
P
OSEIDON
N
EPTUNE
F
EU
H
EPHAÏSTOS
V
ULCAIN
T
ERRE
G
AIA
T
ERRA
1 - Hippocrate ? Le Serment d’Hippocrate ?
Hippocrate [supposé né vers le IVe s av. J.C.] reste l’un de ces célèbres et hypothétiques personnages si chers à la chrétienté qui lui donne la vie au Moyen Age, alors que son existence est aussi réelle que celle de Péon ou d’Apollon…! Les légendes de ses soidisant écrits, par exemple le Corpus qu’on lui attribue, ont en réalité été rédigées par d’autres plusieurs siècles plus tard [Moyen-âge].
J.B.J. Boulet28 à la Faculté de Médecine de Paris soutient sa Thèse de médecine ou Dissertatio medici-historica en 1804 ayant pour titre : « Dubitationes de Hippocratis vita, patria, genealogia, forsan mythologicis ; et de quibusdam ejus libris multo antiquioribus quam vulgo creditur29 ».
Dans sa thèse de Doctorat en Médecine, il démontre catégoriquement l’inexistence du personnage Hippocrate. Selon l’auteur, Hippocrate appartient au monde de la mythologie car il apparaît être lié à aucune réalité.
A. Carrel30, en parlant de Paracelse, Hahnemann, Laennec, meneurs de ce mouvement doctrinal moderne qui s’ébauche jusque parmi les officiels sous le nom de néo-hippocratisme, indique que chacun d’eux prétend avoir retrouvé la véritable « tradition » hippocratique dans sa pureté et sa force originelle. Or à considérer la diversité des hypothèses et des tendances manifestées au cours des siècles par les générations médicales successives, on pourrait se demander si la « tradition hippocratique » n’est pas une simple étiquette dont chaque théoricien se sert pour faire admettre plus facilement sa doctrine ; ou plus simplement : s’il existe vraiment une unité de la pensée hippocratique et si chaque auteur n’a pas isolé, de tout un fatras inutilisable, les textes seuls qui correspondaient à ses propres idées.
On a pu, avec de bonnes présomptions, noter que la prétendue Collection hippocratique rend compte des contradictions doctrinales qu’on y décèle ; en effet « l’auteur » de cet ensemble de textes ne saurait être un seul homme... !
R. Dumesnil décèle dans les soi-disant écrits d’Hippocrate de notables différences de style qui permettent de discerner non seulement plusieurs auteurs de ces écrits, mais plusieurs époques que E. Littre [1801-1881] divise en onze groupes !
Ces textes donnent des informations très intéressantes ; quant à celui intitulé, selon les auteurs, Le Serment, sa phrase introductive atteste de la conception surnaturelle et magique de la « médecine » grecque : « Je jure par Apollon médecin, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin... ».
Ce texte, est le prélude aux cérémonies initiatiques des candidats à la prêtrise [qui sont également guérisseurs], fonction très importante de la société grecque31.
La croyance grecque stipule que les dieux sont non seulement immortels mais contrôlent les aspects de la nature. En conséquence, l’existence dépend totalement de la volonté des dieux qui infligent aux mortels, dont le comportement est inacceptable, de sévères punitions comme les maladies, la souffrance, la mort !
Chaque divinité décrète l’oracle qui formule une ou des sentences, des prophéties et détermine le sanctuaire où elles sont exposées. Les oracles les plus connus sont ceux d’Apollon à Delphes et à Didymes. L’oracle est communiqué au moyen d’un être humain ou d’un animal sacré, ou bien découle de l’interprétation de signes divers [murmure du vent, frémissement des feuilles, bruit quelconque d’animaux, etc.].
Chacun des sites sacrés est représenté par un groupe de prêtres qui sont également des personnalités officielles de la communauté. Ces prêtres interprètent les paroles divines mais ne possèdent ni connaissances, ni pouvoirs particuliers. Ils examinent le foie d’une victime offerte en sacrifice, scrutent les astres ou cherchent au ciel les signes favorables.
En conséquence, la « médecine » grecque est indéniablement magique et sacerdotale. Les prêtres ou therapeuein [« soigner » ; thérapeutes] étaient les seuls aptes à entrer en communication avec les dieux et à recourir aux remèdes que ces derniers leur révélaient !
A juste raison, l’héritière de la société spirituelle grécoromaine qu’est l’Église continue la tradition : la médecine demeure longtemps aux mains des prêtres et des moines.
Concernant l’usage de prêter serment après une soutenance de thèse [usage qui s’est perpétué à la Faculté de Montpellier avant de se généraliser à toutes les autres], remarquons cependant que dans le prélude original du Serment, qui est faussement appelé Serment d’ « Hippocrate », la phrase du texte sacerdotal païen : « Par Apollon médecin, par Hygie et Panacée, par tous les dieux pris à témoins... » fut supprimée par l’Église. En effet, car bien qu’héritière du rituel32, celui-ci est en contradiction avec l’orthodoxie catholique [paganisme]. Dès lors, cette dernière porte son attention sur le Serment d’Ibn-Sina33 [Serment d’Avicenne].
Ainsi, l’Église se servit du Serment d’Ibn-Sina qui est actuellement en vigueur dans toutes les Facultés de Médecine sous le nom de Serment d’Hippocrate34!
L’art « médical » grec, compilation de pratiques de magie et d’occultisme trouve un formidable terreau dans le Christianisme qui le développe lors de son hégémonie à l’aide d’un apport important relatif à la démonologie, à l’exorcisme transmis par le peuple juif, perse, égyptien, et aux légendes agraires des peuples conquis en Europe.
Selon les connaissances anatomiques grecques, le corps est constitué des quatre éléments [air, feu, terre, eau] dont les parties solides et humides sont unies entre elles par le feu. Aussi, la nature est perçue comme une force aveugle, malfaisante dont seule la dévotion envers les dieux de l’Olympe protège !
Rome est par excellence la terre de la superstition et de la pratique des augures. Ajoutez à ce pays l’influence hellénique à partir du VIe siècle av. J.C., c’est-à-dire la cosmogonie, la magie et les légendes et vous obtenez une culture chimérique et fantasmagorique d’une rare exception.
Ovide35 relate que Carna, antique déesse guérisseuse de Rome protégeait les familles contre les striges36 [lat. striga, grec strigx], les vampires [ou sorcières] qui saignaient les enfants pendant la nuit. Apollon, Mars, Castor et Pollux sont les dieux de la santé. Les fièvres de la campagne romaine sont soignées par l’invocation des déesses Febris et Méphitis qui possèdent leur sanctuaire sur l’Esquilin, dans une forêt sacrée où les malades apportent leurs offrandes. A proximité, sont situés le temple de Minerve et celui de Lucine.
Priape est le dieu de la fécondité et son culte s’assimile à celui de Mytinus ou Tutinus, dieu de la fécondité féminine. Pour être fécondes, les femmes s’assoient sur un simulacre de Priape phallique. L’épidémie de peste en 293 est l’occasion d’élever dans l’île du Tibre à Rome, un temple à Esculape.
La « médecine » romaine est théurgique et magique comme sa consœur grecque. Ses théories médicales reflètent un raisonnement métaphysique confiné dans l’abstraction et la superstition !
Pline l’Ancien37 recueillit fidèlement tout ce qui se pratiquait à son époque en « médecine ». Conséquemment, il fut l’une des références usuelles des « médecins » des temps suivants. Ses écrits « médicaux » sont un témoignage réel sur la réalité de la « médecine » gréco-romaine et il fut d’ailleurs le seul de sa société à citer ses sources.
La liste des auteurs dont la biographie et les œuvres demeurent anonymes ou inconnues augmente avec les hypothétiques Dioscoride [qui fut « probablement » médecin selon certains historiens] et Galien. Sans faire preuve de sens critique comme il est nécessaire dans les études textuelles, les historiens ne s’étonnent guère que la production aussi abondante de ce énigmatique Galien, échelonnée sur des siècles, ait pu être l’œuvre d’un seul homme qui aurait mené une vie de travail si active et qui serait, de plus, plusieurs fois centenaires !