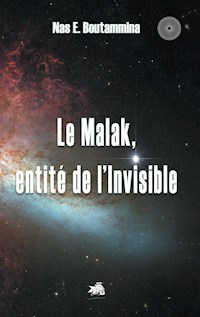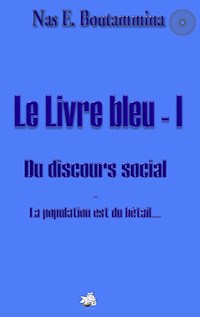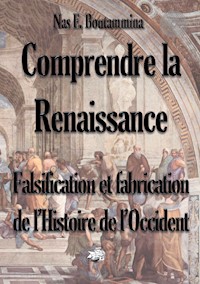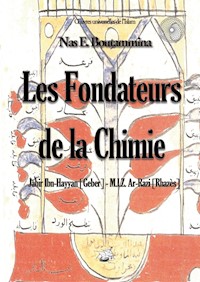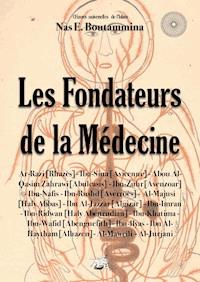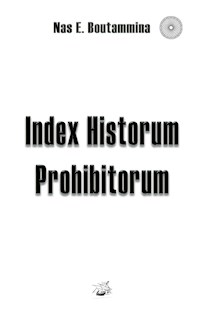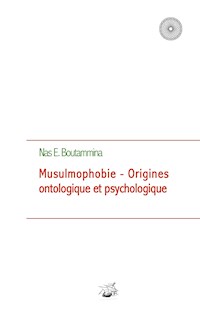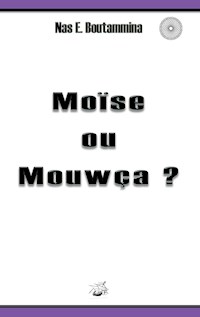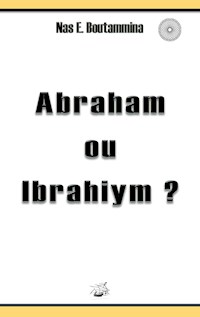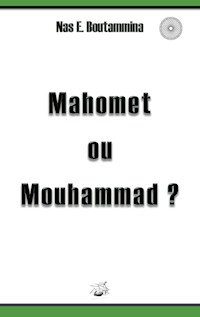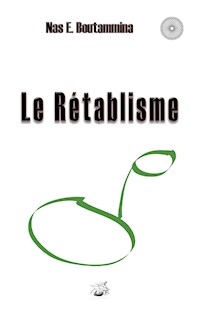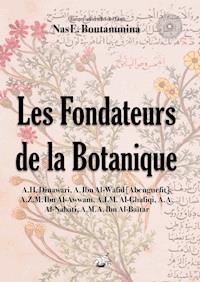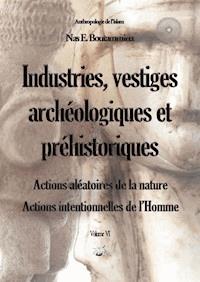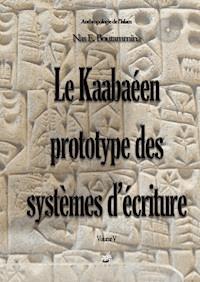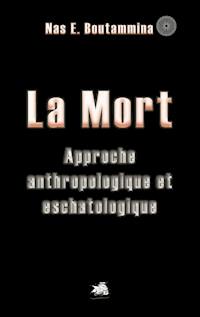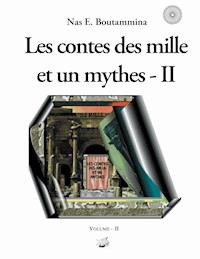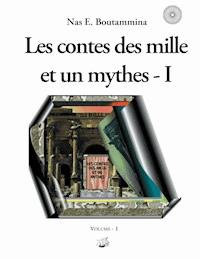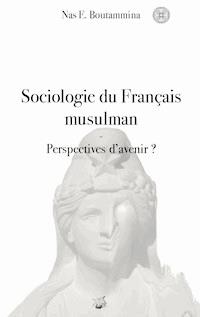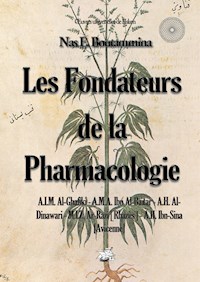
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Jadis patrimoine exclusif des mages, des sorciers, des guérisseurs, des shamans, des aruspices, des prêtres qui préparaient par un rituel et des incantations aux dieux, aux esprits, aux démons des potions, des breuvages, des drogues aussi bien pour soulager ou guérir que pour occire et cela dans une atmosphère imprégnée de mystères. C’est à partir du IXe siècle qu’apparaît la Pharmacologie en tant que Science des médicaments employés à des fins thérapeutiques loin des pratiques magiques ou religieuses. Dès l’origine, les fondateurs de la Pharmacologie se sont efforcés de mettre au point des médicaments efficaces, spécifiques en présentant le maximum de sécurité, afin de lutter contre les maux qui attaquent le corps et le psychisme de l’homme. Que de générations de pharmacologues ont suivi leur chemin au but ambitieux qui, on l’observe actuellement, a porté ses fruits, attendu que, par ses découvertes, innovations et apports continuels, la Pharmacologie a activement participé, aux côtés de la médecine et de l’hygiène, à une meilleure qualité de l’existence et à l’élévation de la durée moyenne de la vie. A ce titre, les Fondateurs de la Pharmacologie méritent bien la dénomination honorifique : « Être au service de l’Humanité ! » Le médicament moderne, dans la société actuelle est mal en point car, hélas, il est devenu un bien de consommation comme les autres, et il commence à faillir à sa mission, celle qui était pour les fondateurs de la Pharmacologie, à savoir, une protection contre la souffrance et les maladies.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans les mêmes éditions
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Musulmophobie - Origines ontologique et psychologique», Edit. BoD, Paris [France], décembre 2009.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Jinn bâtisseurs de pyramides…? », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Jésus fils de Marie ou Hiyça ibn Māryām? », Edit. BoD, Paris [France], décembre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Moïse ou Moūwça ? », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Abraham ou Ibrāhiym ? », Edit. BoD, Paris [France], février 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Connaissez-vous l’Islam? », Edit. BoD, Paris [France], mars 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Mahomet ou Moūhammad? », Edit. BoD, Paris [France], mars 2010
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Jinn, créature de l’invisible », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Français musulman - Perspectives d’avenir ? », Edit. BoD, Paris [France], mai 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, «Judéo-Christianisme - Le mythe des mythes ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume I », Edit. BoD, Paris [France],juillet 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Y-a-t-il eu un temple de Salomon à Jérusalem ? », Edit. BoD, Paris[France], aout 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les ennemis de l’Islam - Le règne des Antésulmans - Avènement de l’Ignorance, de l’Obscurantisme et de l’Immobilisme», Edit. BoD, Paris [France], février 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le secret des cellules immunitaires - Théorie bouleversant l’Immunologie [The secrecy of immune cells - Theory upsetting Immunology] », Edit. BoD, Paris [France], mars 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Comprendre la Renaissance - Fabrique de l’Histoire de l’Occident », Edit. BoD, Paris [France], août 2013.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Rétablisme », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2013.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Livre bleu I - Du discours social - La population est du bétail…», Edit. BoD, Paris [France], août 2014.
Collection Anthropologie de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Apparition de l’Homme - Modélisation islamique - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « L’Homme, qui est-il et d’où vient-il ? - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], octobre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Classification islamique de la Préhistoire - Volume III », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Expansion de l’Homme sur la Terre depuis son origine par mouvement ondulatoire - Volume IV », Edit. BoD, Paris [France], décembre 2010.
Cllection Œuvre universells de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Médecine », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Chimie », Edit. BoD, Paris [France], octobre 2013.
Table des matières
Avertissement
Introduction
I - Période avant la Pharmacologie [avant le IXe siècle]
A - Qu’est-ce que la Pharmacologie ?
1 - Quelques définitions
a - Plantes médicinales
b - Médicaments
· Définition juridique
· Les constituants
- Médicaments d’origine naturelle
° Médicaments d’origine minérale
° Médicaments d’origine animale
° Médicaments d’origine végétale
° Médicaments de synthèse
· Voies d’administration et doses
- Principes actifs
· Mécanismes d’action du médicament
c - Potion, remède, breuvage
d - Pharmacologie
e - Herboristerie, herboriste
f - Phytothérapie
g - Pharmacognosie
h - « Médecine » traditionnelle
i - Shamanisme [Chamanisme]
j - Guérisseur
B - Herboristerie ou pratiques magico-thérapeutiques
1 - La croyance aux herboristes
2 - Herboristerie et sacerdoce
3 - Dons de « mère Nature »
a - Une combinaison du savoir ésotérique
4 - Les Lois gèrent l’Univers
5 - Symbiose avec mère Nature
6 - L’herboristerie et son évolution
II - Naissance de la Pharmacologie
A - Pharmacologie - Définition
1 - Les diverses branches de la pharmacologie
a - Pharmacognosie
b - Pharmacodynamie
c - Pharmacocinétique
d - Toxicologie
e - Pharmacie
f - Pharmacothérapie
g - Chimiothérapie
B - L’esprit des fondateurs de la pharmacologie
1 - Les objectifs de la pharmacologie
2 - Activité pharmacologique médicaments dans l’organisme
a - Essais cliniques des médicaments
· Définition
· Protocole de A.H. Ibn-Sina [Avicenne]
· Ordonnance médicale : délivrance des médicaments
III - Les Maîtres fondateurs de la Pharmacologie
A - A.I.M. Al-Ghafiki [m.1165]
1 - Œuvre de A.I.M. Al-Ghafiki
a - De materia medica
· La Pharmacologie alghafikienne
- Sécrétions végétales
- Principe de propriété thérapeutique végétale
b - Pharmacologie alghafikienne et pathologie
· Objectifs et méthodes de la pharmacologie alghafikienne
B - A.M.A. Ibn Al-Baïtar [1190-1248]
1 - Œuvres de A.M.A. Ibn Al-Baïtar
2 - Pharmacologie albaïtarienne
a - Diversité des formes pharmaceutiques
b - Pharmacologie didactique et thérapeutique
C - A.H. Al-Dinawari [815-895]
1 - Pharmacologie aldinawarienne
2 - Objectif et méthode de la pharmacologie aldinawarienne
D - M.I.Z. Ar-Razi [865-925]
1 - Pharmacologie arrazienne
a - Organe-cible et activité médicamenteuse
b - Notion d’Antibiose - Antibiothérapie
E - A.Y. Al-Kindi [801-866]
1 - Pharmacologie alkindienne
F -R.Al-Biruni [973-1048]
1 - Pharmacologie albirunienne
G - A.H. Ibn-Sina [Avicenne -980-1037]
1 - Pharmacologie ibnsinaenne
a - Phases d’essai clinique du médicament1
b - Objectifs de la pharmacologie ibnsinaenne1
H - Quelques autres auteurs ayant contribué à l’essor de la pharmacologie
1 - A - A. Abbas Al-Nabati [1166-1240]1
2 - I.H. Ibn-Juljul [944-994]
3 - A.Q. Zahrawi [936-1013]1
4 - A.M. Ibn-Zuhr [1091-1162]
5 - A.I.A. Al-Majusi [m. 995]
6 - A.W.M. Ibn-Rushd [1126-1198]
7 - A.J.A. Ibn Al-Jazzar [898-980]
8 - O. Ibn Al-Haytham /965-1039]
9 - Ibn-Nafis Al-Karashi [1208-1288]
IV - Traduction d’œuvres des fondateurs de la Pharmacologie
V - Quelques termes d’origines arabes usités en pharmacologie
Quelques illustrations
Conclusion
Index alphabétique
Avertissement
La Collection « Œuvres universelles de l’Islam » rend hommage aux savants musulmans fidèles au Message coranique : « Être au service de l’Humanité ». Pour cela, il ont crée les Sciences, base de la Civilisation humaine, héritage de nos sociétés contemporaines.
Hélas, les savants musulmans n’ont jamais reçu la moindre marque ou témoignage d'estime et de gratitude, c’est-à-dire un honneur à l’égal de leur talent et de leur génie qu’ils léguèrent à la postérité.
Il est d’usage d’octroyer un nom [éponyme] à une rue, à un établissement public, etc. en l’honneur d’un personnage illustre ayant œuvré pour le bienfait de l’Humanité ou ayant contribué aux progrès de la Civilisation humaine [Sciences, Arts, etc.]. Le paradoxe d’une absolue aberration est qu’en ce qui concerne les savants musulmans fondateurs de la Civilisation universelle, aucune rue, aucune voie, aucune avenue, aucun boulevard ; aucun établissement scolaire [école, collège, lycée] ou public [hôpital, Centre de Recherche, etc.] ; aucune Université, aucune Faculté, aucun Institut ; aucune fondation, aucune technique, ni aucune loi scientifique n’est honorée de leurs noms !
« En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des indices [lois scientifiques] pour les doués d’intelligence, » (Coran [Qour’ãn], 3-190)
« qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, évoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre [en disant] : Ô notre Seigneur ! Tu n’as pas créé [tout] cela en vain. […] ». (Coran [Qour’ãn ], 3-191)
Une correction s’impose quant à diverses appellations faussement véhiculées pa la littérature1. En voici quelques unes. La « Science arabe ». Il n’y a jamais eu de Science « arabe ». La Science expérimentale [Chimie, Mathématiques, Physique, Médecine, Astronomie, Pharmacologie, Botanique, Agronomie, Zoologie, etc.] a été crée principalement par les Musulmans d’origine berbéro-andalouse [ou Maghrebo-andalouse] et perse. Ainsi, la « Civilisation de l’Islam Classique [CIC] », héritage de nos sociétés contemporaines, a été essentiellement le fruit extraordinaire de ces deux peuples : berbéro-andalou et perse.
Les Chiffres « arabes ». Les chiffres [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] appelés inexactement « arabes » sont en réalité les chiffres du Maghrebo-andalou Abou Al-Hasan Al-Qalsadi [m. 890], monument des sciences mathématiques, qui est né à Bastan en Andalousie. Les mathématiques doivent leur clarification et leur progrès à son extraordinaire génie car il invente les chiffres à partir de règles géométriques selon la construction des angles. Ainsi, afin de rétablir la vérité les chiffres se dénomment : « chiffres d’Al-Qalsadi » ou « chiffres alqalsadiens » !
La Civilisation « arabe ». Afin de ne pas s’attarder sur la prétendue « Civilisation « arabe » », faisons une simple et concise observation. Pas plus que de Science « arabe », il n’y eut de Civilisation « arabe ». Répétons-le, la Civilisation de l’Islam classique [CIC] a été fondée par des Maghrebo-andalous et des Perses, des populations non-arabes !
« Arabe du Maghreb ou d’Afrique du Nord ». Le Maghreb a pour population originale des Berbères qui sont les premiers habitants d'Afrique du Nord. De ce fait, les Maghrébins ou Nord-africains n’ont aucune relation ni aucun lien avec les Arabes. En effet, d’un point de vue géographique, linguistique, ethnique, physique, culturel, gastronomique, etc. rien ne signale une quelconque relation avec ceux que l’on nomme les Arabes.
Lors de la conversion des Berbères à l’Islam, une grande partie d’entre eux ont opté pour la langue arabe qui n’est autre que la langue liturgique de l’Islam et donc celle du texte du Coran. Ainsi, les Berbères adoptèrent ensuite l’arabe en tenant compte de leur héritage berbère car ils demeurent toujours fidèles à leur patrimoine linguistique et culturel berbère. En effet, ils se distinguèrent même en développant leur propre langage, la langue berbèro-arabe ou berbèro-andalouse usité dans tout le Maghreb. Malheureusement, cette langue n’a pas eu toute l’attention et le soin qu’elle aurait dû avoir pour se développer sémantiquement [vocabulaire scientifique, technologique, etc.].
Finalement, les « Arabes » définissent uniquement et seulement les populations actuelles du Golfe : Koweït, Bahreïn, Qatar, Sultanat d’Oman, les Émirats Arabes Unis [E.A.U.] l’Arabie et le Yémen qui caractérisent le vrai et unique « monde arabe ». Ce ramassis de peuplades pétrodollarisés voue un mépris absolu à la Science, à la Culture, aux Arts, à l’Esthétique, au Progrès, à la Civilisation. D’un point de vue anthropologique et donc ontologique, la nature de la «société » des Arabes est essentiellement fragmentée en tribus bédouines et pirates. Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, les Arabes vouent un culte à la limite de la folie à leurs divinités l’or et l’argent qu’ils leur permettent d’acquérir aux yeux du monde qui les entoure ce qu’ils n’ont pas : prestige, gloire et considération. Ce manque de noblesse, ils s’efforcent de le combler par le recours au brigandage et aux razzias, traits culturels qui sont toujours la règle tribale. Naturellement, ils sont incapables de saisir le concept de Science. Totalement étranger à leur esprit, celui-ci est inconnu de leur mode de vie, de leur société, de leur univers. Dès lors, il leur est évidemment sans intérêt.
Ainsi, les expressions justes sont : Science islamique ou Science de l’Islam ou encore Sciences perso-berbèro-andalouses, et en aucun cas Science « arabe » ; Civilisation de l’Islam ou Civilisation persoberbèro-andalouse et en aucune manière « Civilisation arabe »; Chiffres alqasadiens, mais ô jamais « chiffres arabes » !
1 NAS E. BOUTAMMINA, « Les contes des mille et un mythes-Volume II »,Edit. BoD, Paris [France], novembre 2011.
2 « Ordonnance du 23 septembre 1967 modifiée le 31 décembre 1971 et le 10 juillet 1975 ».
3Opothérapie. Traitement par des extraits bruts ou purifiés de divers tissus ou
Introduction
En étroite liaison avec les sciences médicales, la Pharmacologie connut une grande vogue chez les savants berbèro-andalous et perses. Elle fit l’objet d’ouvrages spécialisés.
La Pharmacologie était non seulement l’affaire de spécialistes comme les pères fondateurs Al-Dinawari [815-895], A.I.M. Al Ghafiki [m. 1165], M. Ibn-Al-Baïtar [1190-1248], mais également celle des médecins comme M.I.Z. Ar-Razi [864-925], A.H. Ibn-Sina [980-1037], A.M. Ibn-Zuhr [1091-1162], A. Ibn Al-Abbas Al-Majusi [m. 995] ou encore R. Al-Biruni [973-1048] pour ne citer que ceux-là, qui, par leurs recherches importantes et judicieuses à la pharmacopée enrichirent l’œuvre de leurs prédécesseurs et la complétèrent en classant [taxinomie] les médicaments par ordre alphabétique et formulèrent leur préparation et leur indication thérapeutique.
Ces savants incorporèrent la Pharmacologie comme partie intégrante de la médecine tout en lui octroyant son autonomie et en lui donnant ses lettres de noblesse. Ils la développèrent en l’enrichissant de leurs travaux et de leurs observations.
Les médecins principalement berbéro-andalous et perses dotèrent la Pharmacologie de procédés et de techniques de manière à mettre au point de nouveaux remèdes [camphre, séné, tamarin, casse purgative, myrobolans, noix de muscade, ergot de seigle, rhubarbe, racine de galanga, etc.], sans parler d’une foule d’autres médicaments actuellement toujours en usage.
I - Période avant la Pharmacologie [avant le IXe siècle]
A - Qu’est-ce que la Pharmacologie ?
1 - Quelques définitions
a - Plantes médicinales
Les plantes médicinales sont les plantes utilisées en phytothérapie pour leurs principes actifs. Certaines plantes médicinales qui sont souvent également des aromatiques [basilic, sauge, thym, menthe, etc.] sont très faciles à cultiver, puis elles sont récoltées, séchées pour être finalement consommées sous forme de préparations diverses. De l’Antiquité, à la Renaissance en passant par le Moyen-âge, dans les jardins des temples, des monastères, les prêtres, les moines prenaient grand soin d'avoir leur carré d'herbes aromatiques les « simples ».
b - Médicaments
Beaucoup de médicaments ont évolué depuis leur origine, et l’on distinguera dans cette partie leur constitution et leur action physiologique.
• Définition juridique
La définition juridique du médicament ne possède qu’une valeur relative applicable à un pays donné. Quoi qu’il en soit [en France], le médicament est soumis à une législation : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Sont notamment des médicaments les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle contenant des substances vénéneuses à des doses supérieures à celles qui ont été fixées par une liste établie par arrêté ministériel, et les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d’épreuve2 ».
• Les constituants
- Médicaments d’origine naturelle
Les médicaments d’origine naturelle proviennent des trois règnes : minéral, animal, végétal.
° Médicaments d’origine minérale
Une variété d’éléments simples ou leurs sels comme le soufre, l’arsenic, les iodures, les phosphates, les sels de fer, de calcium, de magnésium, de mercure, le charbon, le talc, etc., qui servaient autrefois comme remèdes font toujours partie de l’arsenal thérapeutique.
° Médicaments d’origine animale
L’opothérapie3 est cantonnée actuellement aux extraits de foie ou de thyroïde. Mais les organes animaux servent à préparer divers produits tels qu’hormones [insuline, hormones hypophysaires, etc.], anticoagulant [héparine], ou enzymes [pepsine, trypsine, hyaluronidase, etc.], fréquemment utilisés en thérapeutique. Les sels biliaires restent des précurseurs pour la synthèse des hormones sexuelles ou corticosurrénaliennes ; les huiles de foie de poisson, quant à elles, sont une source de vitamines A et D, etc.
° Médicaments d’origine végétale
Dès l’origine, ils sont toujours la principale source des médicaments naturels. Leur utilisation telle quelle, en nature [décoctions, poudres, etc.] est peu importante. Les formes dites « galéniques 4 » [colorants, extraits, etc.] demeurent des médicaments d’administration pratique et peu coûteuse de la plupart des principes actifs d’un végétal, l’extrait total s’avère quelquefois plus efficace que les constituants isolés.