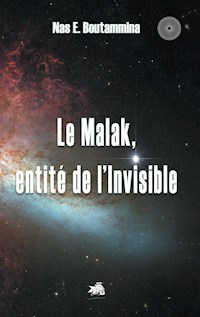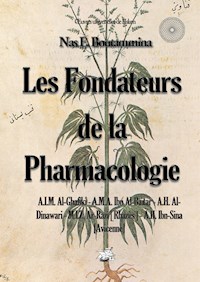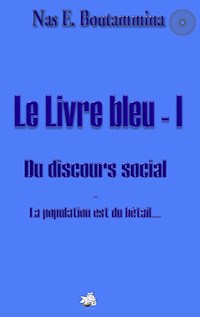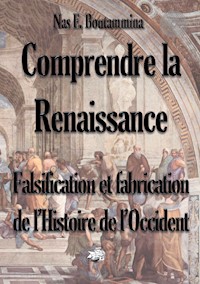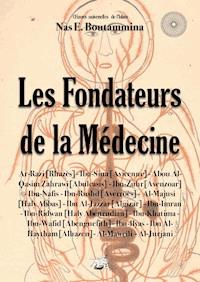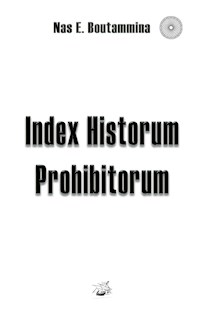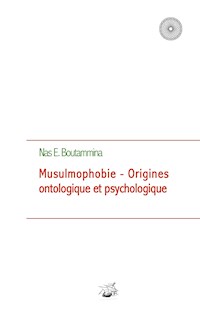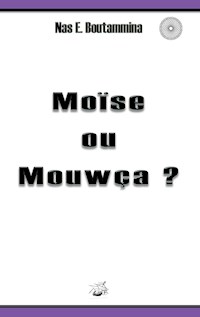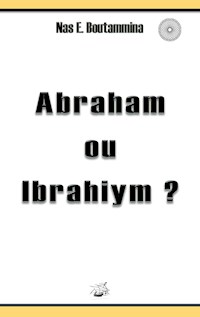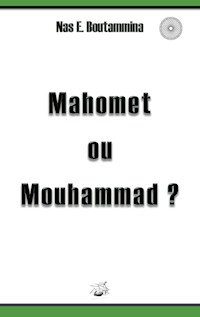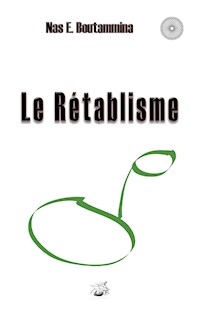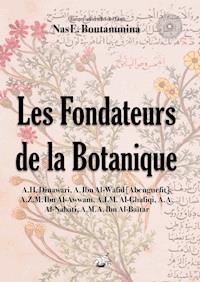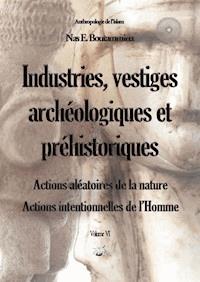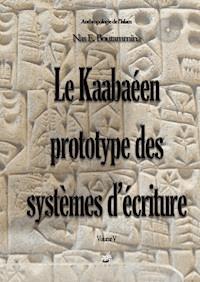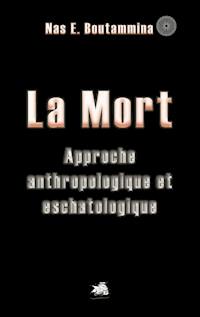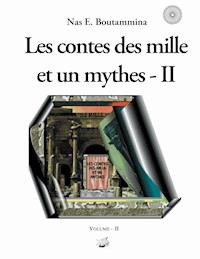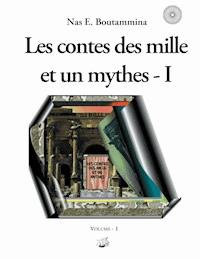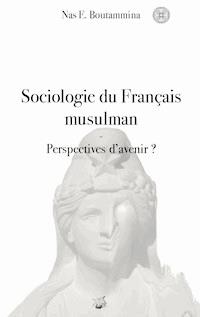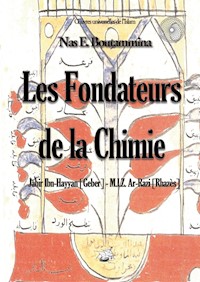
Les fondateurs de la Chimie - Jabir Ibn-Hayyan (Geber) - M.I.Z. Ar-Razi (Rhazès) E-Book
Nas E. Boutammina
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
La Chimie [Al-Kimiya] a une histoire et force est de constater que, lorsqu’il est fait allusion à elle, nous ne visons jamais d’où elle provient réellement, sa genèse, la structure intellectuelle sur laquelle elle repose, les figures principales qui l’ont établies et qui fait que la chimie est incontournable et fait partie désormais de notre vie quotidienne. Nul ne pourrait songer aujourd'hui à remettre en question l’œuvre de Geber et de Rhazès. En témoignent les applications pratiques [teinturerie, cosmétique, pharmacie, alimentation, hygiène, etc.] de la chimie sur l’existence des sociétés humaines et l’on comprend la valeur de ces savants et la portée de leur œuvre magistrale. Cet ouvrage brosse un tableau succinct de ces esprits ô combien géniaux qui ont su à merveille se mettre au « Service de l’Humanité » au nom de la quête du divin ! Finalement, ils sont les concepteurs d’un paradoxe : concilier la Théologie et la Science en créant la Chimie !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans les mêmes éditions
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Musulmophobie - Origines ontologique et psychologique », Edit. BoD, Paris [France], décembre 2009.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Jinn bâtisseurs de pyramides…? », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Jésus fils de Marie ou Hiyça ibn Māryām ? », Edit. BoD, Paris [France], décembre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Moïse ou Moūwça ? », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Abraham ou Ibrāhiym ? », Edit. BoD, Paris [France], février 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Connaissez-vous l’Islam ? », Edit. BoD, Paris [France], mars 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Mahomet ou Moūhammad ? », Edit. BoD, Paris [France], mars 2010
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Jinn, créature de l’invisible », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Français musulman - Perspectives d’avenir ? », Edit. BoD, Paris [France], mai 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Judéo-Christianisme - Le mythe des mythes ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Y-a-t-il eu un temple de Salomon à Jérusalem ? », Edit. BoD, Paris [France], aout 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les ennemis de l’Islam - Le règne des Antésulmans - Avènement de l’Ignorance, de l’Obscurantisme et de l’Immobilisme », Edit. BoD, Paris [France], février 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le secret des cellules immunitaires - Théorie bouleversant l’Immunologie [The secrecy of immune cells - Theory upsetting Immunology] », Edit. BoD, Paris [France], mars 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Comprendre la Renaissance - Fabrique de l’Histoire de l’Occident », Edit. BoD, Paris [France], août 2013.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Rétablisme », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2013.
Collection Anthropologie de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Apparition de l’Homme - Modélisation islamique - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « L’Homme, qui est-il et d’où vient-il ? - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], octobre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Classification islamique de la Préhistoire - Volume III », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Expansion de l’Homme sur la Terre depuis son origine par mouvement ondulatoire - Volume IV », Edit. BoD, Paris [France], décembre 2010.
Collection Œuvres universelles de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Médecine », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2011.
Avertissement
La Collection « Œuvres universelles de l’Islam » rend hommage aux savants musulmans fidèles au Message coranique : « Être au service de l’Humanité ». Pour cela, il ont crée les Sciences, base de la Civilisation humaine, héritage de nos sociétés contemporaines.
Hélas, les savants musulmans n’ont jamais reçu la moindre marque ou témoignage d'estime et de gratitude, c’est-à-dire un honneur à l’égal de leur talent et de leur génie qu’ils léguèrent à la postérité.
Il est d’usage d’octroyer un nom [éponyme] à une rue, à un établissement public, etc. en l’honneur d’un personnage illustre ayant œuvré pour le bienfait de l’Humanité ou ayant contribué aux progrès de la Civilisation humaine [Sciences, Arts, etc.]. Ce qui est extraordinaire et absolument aberrant, est qu’en ce qui concerne les savants musulmans fondateurs de la Civilisation universelle, aucune rue, aucune voie, aucune avenue, aucun boulevard ; aucun établissement scolaire [école, collège, lycée] ou public [hôpital, Centre de Recherche, etc.] ; aucune Université, aucune Faculté, aucun Institut ; aucune fondation, aucune technique, ni aucune loi scientifique n’est honorée de leurs noms !
« En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes [lois scientifiques] pour les doués d’intelligence, » (Qour’ãn, 3-190)
« qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, évoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre [en disant] : Ô notre Seigneur ! Tu n’as pas créé [tout] cela en vain. Gloire à Toi ! Garde-nous du châtiment du Nār [Feu] ». (Qour’ãn, 3-191)
Une correction s’impose quant à diverses appellations faussement véhiculées pa la littérature1. En voici quelques unes. La « Science arabe ». Il n’y a jamais eu de Science « arabe ». La Science expérimentale [Chimie, Mathématiques, Physique, Médecine, Astronomie, Pharmacologie, Botanique, Agronomie, Zoologie, etc.] a été crée principalement par les Musulmans d’origine berbéro-andalouse [ou maghrébo-andalouse] et perse. Ainsi, la Civilisation de l’Islam Classique [CIC], héritage de nos sociétés contemporaines, a été essentiellement le fruit extraordinaire de ces deux peuples : berbéro-andalou et perse. Leur génie unique et ô combien prodigieux demeure à jamais gravé dans l’Histoire !
Les Chiffres « arabes ». Les chiffres [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] appelés inexactement « arabes » sont en réalité les chiffres du Maghrébo-andalou Abou Al-Hasan Al-Qalsadi [m. 890], monument des sciences mathématiques, qui est né à Bastan en Andalousie. Les mathématiques doivent leur clarification et leur progrès à son extraordinaire génie car il invente les chiffres à partir de règles géométriques selon la construction des angles. Ainsi, afin de rétablir la vérité les chiffres se dénomment : « chiffres d’Al-Qalsadi » ou « chiffres al-qalsadiens » !
La Civilisation « arabe ». Afin de ne pas s’attarder sur la prétendue « Civilisation « arabe » », faisons une simple et concise observation. Pas plus que de Science « arabe », il n’y eut de Civilisation « arabe ». Répétons-le, la Civilisation de l’Islam classique [CIC] a été fondée par des Maghrébo-andalous et des Perses, des populations non-arabes !
« Arabe du Maghreb ou d’Afrique du Nord ». Le Maghreb a pour population originale des Berbères qui sont les premiers habitants d'Afrique du Nord. De ce fait, les Maghrébins ou Nord-africains n’ont aucune relation ni aucun lien avec les Arabes. En effet, géographiquement, linguistiquement, ethniquement, physiquement, culturellement, gastronomiquement, etc. rien ne signale une quelconque relation avec ceux que l’on nomme les Arabes.
Lors de la conversion des Berbères à l’Islam, une grande partie d’entre eux ont opté pour la langue arabe qui n’est autre que la langue liturgique de l’Islam et donc celle du texte du Coran. Ainsi, les Berbères adoptèrent ensuite l’arabe en tenant compte de leur héritage berbère car ils demeurent toujours fidèles à leur patrimoine linguistique et culturel berbère. En effet, ils se distinguèrent même en développant leur propre langage, le langage arabo-berbère usité dans tout le Maghreb. Malheureusement, cette langue arabo-berbère n’a pas eu toute l’attention et le soin qu’elle aurait dû avoir pour se développer sémantiquement [vocabulaire scientifique, technologique, etc.].
Les Arabes définissent uniquement et seulement les populations actuelles du Golfe : Koweït, Bahreïn, Qatar, Sultanat d’Oman, les Émirats Arabes Unis [E.A.U.] l’Arabie et le Yémen. Ce ramassis de peuplades voue un mépris absolu à la Science, à la Culture, aux Arts, à l’Esthétique, au Progrès, à la Civilisation. D’un point de vue anthropologique et donc ontologique, la nature de la « société » des Arabes est essentiellement fragmentée en tribus bédouines et pirates. Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, les Arabes vouent un culte à la limite de la folie à leurs divinités l’or et l’argent qu’ils leur permettent d’acquérir prestige, gloire et considération aux yeux du monde qui les entoure. Ce manque de noblesse, ils s’efforcent de le combler par le recours au brigandage et aux razzias, traits culturels qui sont toujours la règle tribale. Naturellement, ils sont incapables de saisir le concept de Science. Totalement étranger à leur esprit, celui-ci est inconnu de leur mode de vie, de leur société. Dès lors, il leur est évidemment sans intérêt.
Ainsi, les expressions justes sont : Science islamique ou Science de l’Islam et en aucun cas Science « arabe » ; Civilisation de l’Islam et en aucune manière « Civilisation arabe » ; Chiffres alqasadiens, mais jamais « chiffres arabes » !
1 NAS E. BOUTAMMINA, « Les contes des mille et un mythes - Volume II », Edit. BoD,
Table des matières
Introduction
I - L’idée de la «
Chimie
» de l’Antiquité jusqu’au VIIIe siècle
A - Qu’est-ce que la chimie ?
1 - Définition
2 - Histoire de la chimie
3 - Des quatre éléments naturels au concept d'élément chimique
4 - L'étude de la chimie
a - Laboratoire et matériel de chimie
5 - Conception de l’Univers, des éléments de la nature
6 - Interprétation - Question sémantique
B - Avant l’avènement de Jabir Ibn-Hayyan : l’Occultisme
1 - Spéculation intellectualiste de l’occultisme
2 - L'art et l’occultisme
3 - De l’occultisme à la chimie
a - Du Moyen-Âge occidental à la Renaissance
b - Vers une phénoménologie de l’occultisme
C - Chimie et système de classification
1 - La chimie et les Lois de l’Univers
II - Naissance de la Chimie
A - Avènement de la Chimie
1 - Chimie et discours du rationnel
2 - Chimie et modes de validation
a - Type formulation
b - Type empirico-formel
3 - La scientificité de la chimie
B - Dialectique de la Chimie
1 - Le langage chimiste
2 - La chimie intelligible
III - Les Maîtres fondateurs de la Chimie -
Al-Kimya
ou
Al-Chimya
A - Jabir Ibn-Hayyan
1 - Chimie jabirienne
a - Dialectique jabirienne
b - Le secret de la nature
2 - Le champ conceptuel de Jabir Ibn-Hayyan
a - Forme et contenu
b - Validité de l'inférence
3 - Chimie jabirienne : intuition et calcul
a - Fonctionnalité de la chimie jabirienne
b - L'induction : méthode jabirienne
4 - Quelques ouvrages de Jabir Ibn-Hayyan
B - M.I.Z. Ar-Razi [Rhazès ou Razès
]
1 - M.I.Z. Ar-Razi fondateur de la chimie moderne
a - Laboratoire de M.I.Z. Ar-Razi
· Appareillage et technique de chimie
Quelques appareils courants du laboratoire de M.I.Z. Ar-Razi
b - Classification ar-razienne des éléments
c - Atomisme ar-razien
2 - Chimie ar-razienne - Biochimie [Chimie clinique
]
a - M.I.Z. Ar-Razi innove la Biochimie
b - Epistémologie de la chimie ar-razienne
· Les étapes de la chimie ar-razienne
· La chimie ar-razienne ou biochimie
c - La chimie ar-razienne post-jabirienne
d - Structure de la chimie ar-razienne
C - Quelques autres savants ayant contribué au développement de la Chimie
1 - A.H. Ibn-Sina
2 - M.I.A. Al-Majriti
3 - A.H.M. Ibn-Arfa Raa
4 - M. Ibn-Umayl Al-Tamini
5 - A.Y. Al-Kindi
IV - Statut scientifique de la Chimie
A - Quête de la Vérité
1 - Le sens de la chimie
2 - Le critère de signification de la chimie
3 - La chimie un concept
4 - De la chimie référentielle
V - Quelques traductions latines d’ouvrages des Fondateurs de la chimie
VI - Quelques termes d’origines arabes usités en chimie
VII - Quelques illustrations
Fig. 1 - « Shudur al-Dahab » de A.H.M. Ibn-Arfa Raa [m. 1197
]
Fig. 2 - « Shudur al-Dahab » de A.H.M. Ibn-Arfa Raa [m. 1197
]
Fig. 3 - « Shudur al-Dahab » de A.H.M. Ibn-Arfa Raa [m. 1197
]
Fig. 4 - « Shudur al-Dahab » de A.H.M. Ibn-Arfa Raa [m. 1197
]
Fig. 5 - « Nukhbat al-Dahr fi hajahib al-barr wa al-bhar [Choix des merveilles du monde terrestre et maritime »
]
Fig. 6 - « Shudur al-Dahab » de A.H.M. Ibn-Arfa Raa [m. 1197
]
Fig
.
7 - Quelques instruments de laboratoire de chimie en verre
Fig. 8 - Description du procédé de distillation par alambic
Conclusion
Index alphabétique
Introduction
Construire la connaissance de la matière par un effort de raisonnement, d’observation et d’expérimentation fut un élément clé pour les fondateurs de la Chimie. En effet, la chimie contemporaine doit reconnaître l'héritage des grands empiristes des VIIIe et IXe siècles.
Ces empiristes rationnels témoignent de leur quête du savoir à l’ombre du Message théologique. En effet, leur témoignage étudié, expérimenté par une instrumentation ingénieuse et intelligible sera consigné et transmis par des ouvrages à la postérité.
L'établissement de lois scientifiques d’après l’examen des phénomènes de la nature apparaît en effet comme une étape indispensable de l'exercice de la raison, de la réflexion. Les fondateurs de la Chimie sont fidèles à cette attitude d'exiger que la description précise et l'existence de tels phénomènes soient établis en recourant à tous les moyens conceptuels et matériels, en s'entourant de toutes les précautions dont dispose dans le moment leur science, la chimie, pour fixer la compréhension des phénomènes de la matière, donc de la nature.
D'une manière plus générale, il appartient à la pensée de mettre en question le sens même de la notion de « matière » dans chaque contexte d'expérience. Problème assurément résolu dans la plupart des cas par ces pionniers de la chimie naissante.
I - L’idée de la « Chimie » de l’Antiquité jusqu’au VIIIe siècle
A - Qu’est-ce que la chimie ?
1 - Définition
Chimie est, d’un point de vue linguistique, un mot arabe qui signifie l’Agencement ou la « Subtilité » de la matière, d’un corps qui compose la nature, l’Univers, d’une chose agencée de manière subtile.
La chimie est la science relative à la constitution des corps physiques élémentaires et aux combinaisons de ces corps, au niveau atomique et moléculaire !
2 - Histoire de la chimie
Parallèlement à ceux des autres sciences [physiques, mathématiques, pharmacologie, etc.], les énoncés de la chimie ont rapidement acquis le mode de la rationalité, au VIIIe siècle, date de leur création.
L'application du rationalisme et son application à la matière fut directe et souveraine. Le savoir discursif de la chimie s’est établi et s’est développé dans l'expérience des corps matériels, les aspirations de l’observation. Aussi, l'origine de la chimie [de même que toutes les Sciences] est-elle inséparable des intentions de la réalité, donc de la Vérité : connaître Dieu à travers Sa Création. Et qu’est-ce que la Création si ce n’est de la découvrir dans son intimité, c'est-à-dire dans sa combinaison, son analyse !
Ce même esprit de raisonnement s’est illustré également en Médecine, par exemple, avec la création de l’Anatomie et la dissection du corps humain [analyse des organes donc de la matière et de son agencement].
Découvrant la matière, les fondateurs de la chimie y méditaient sur Dieu et les composants de l’Univers. Le monde, la matière, la faune, la flore, etc. Tout cela n’est pas le fruit du hasard et surtout cela n’a pas été crée en vain. De plus, le fruit de leurs découvertes sera mis au « Service de l’Humanité » ultime satisfaction pour eux car cette œuvre contribue à leur agrément divin.
Quoi qu’il en soit, ils saisissaient la puissance secrète créatrice d'une complexité ordonnée de corps qui se manifestait lorsqu’ils constituaient des éléments nouveaux et produisaient des effets inattendus. C’est grâce au rationnalisme [réalité des phénomènes] qu’ils ont su appliquer à la chimie et que cette dernière placera leur curiosité aux exigences de la vérification objective. Cependant, le désir de la connaissance demeure lié à la volonté d’être humble et de servir l’Humanité.
3 - Des quatre éléments naturels au concept d'élément chimique
Depuis les temps les plus reculés, l’homme percevait et concevait l’Univers et la nature comme une puissance mystérieuse, surnaturelle. Les seules explications qu’il pouvait leur donner étaient d’ordre magique, surnaturel, occulte, mythique. Dès lors, l'antique distinction des quatres éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu était repérée dans l'ordre sensoriel ; quatre éléments qui possédaient leur lieu naturel et qui, par leur combinaison dans l'imaginaire cosmique, suffisent à donner un sens au monde.
Mais, dans ce type de vues, il n’est nullement question de transactions effectives de matières mais des symboles de caractères sensibles, renvoyés à des actions cosmiques.
Les fondateurs de la Chimie définissaient l’élément et le rapportait à une rationalité instrumentale essentielle. Ils attribuaien la qualité