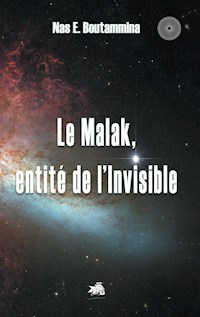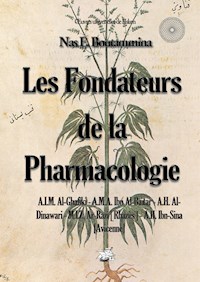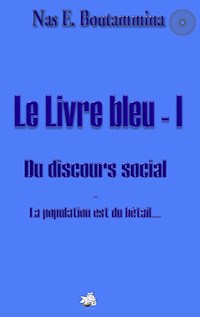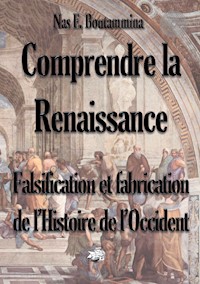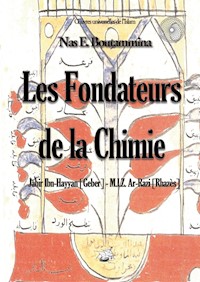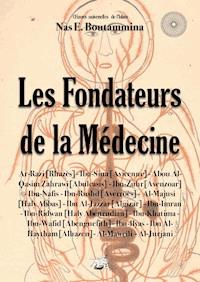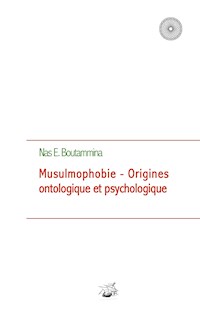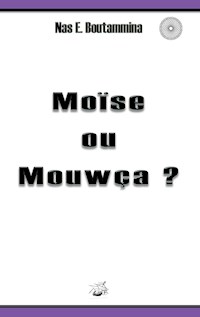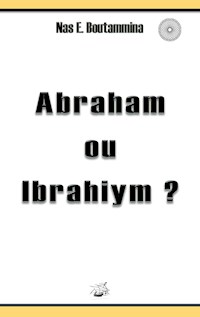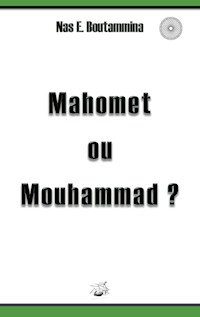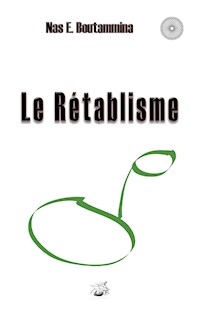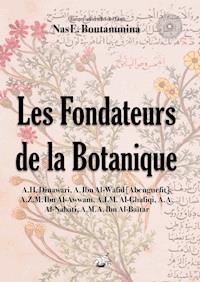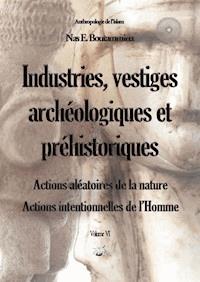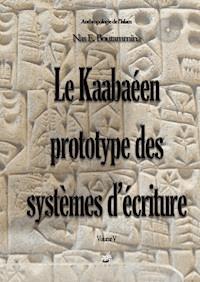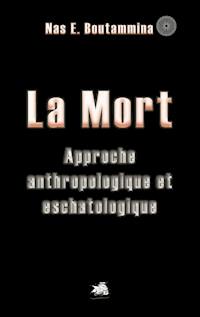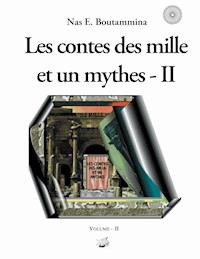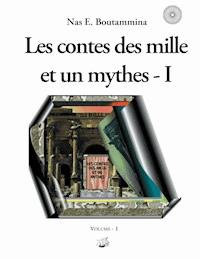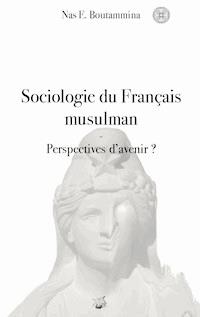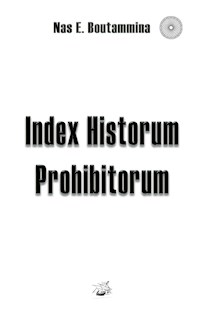
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Innombrables sont les historiens formés et diplômés dans les diverses branches de l’Histoire [Histoire de l’Antiquité -gréco-romaine-, Histoire du Moyen-Âge -médiévale-, Histoire de l’Epoque moderne, Histoire de la Renaissance, Histoire de l’Epoque contemporaine, Histoire du Siècle des Lumières, etc.]. Indénombrables sont ceux et celles qui se consacrent à l'Histoire toute spécialité confondue, qui racontent, analysent des faits, des aspects du passé, rédigent des ouvrages d'histoire, enseignent cette discipline. Rares sont les historiens, toute discipline confondue, qui risquent d’émettre une quelconque réflexion, idée, observation, allusion, remarque, suggestion ou sous-entendu à propos de l’origine textuelle évènementielle ou factuelle [sources, auteurs, etc.] de l’Histoire et de l’Historiographie. Cela est d’autant plus déconcertant, lorsqu’il s’agit, par exemple, de l’étude sur la genèse des Sciences, sur l’idée ou la pensée des auteurs qui sont à l’origine de leur fondation, et enfin, des motivations qui les ont poussées à une telle entreprise. La question fondamentale qui est posée à l’Histoire et à l’Historiographie est son historicité. Leur réalité est-elle attestée ? Comment, à partir de la temporalité d’une succession d’époques [Moyen-Âge, Epoque moderne, Renaissance, Epoque contemporaine] aux intentionnalités historiques idéologiquement fluentes, s’édifient objectivité et validité évènementielle et factuelle ? Ce sens particulier de l’historicité où temporalité, authenticité et validité objective, scientifique dirons-nous, était précisément parvenu à s’édifier dans des opérations de falsification institutionnelle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2015. NAS E. BOUTAMMINA - Design graphique Nas E. Boutammina
« L’Histoire toute entière était un palimpseste gratté et réécrit aussi souvent que c’était nécessaire. Le changement effectué, il n’aurait été possible en aucun cas de prouver qu’il y avait eu falsification. »
George Orwell, « 1984 »
Dans les mêmes Editions
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Musulmophobie - Origines ontologique et psychologique », Edit. BoD, Paris [France], décembre 2009.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Jinn bâtisseurs de pyramides…? », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Moïse ou Moūwça ? », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Abraham ou Ibrāhiym ? », Edit. BoD, Paris [France], février 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Mahomet ou Moūhammad ? », Edit. BoD, Paris [France], mars 2010
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Jinn, créature de l’invisible », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Français musulman - Perspectives d’avenir ? », Edit. BoD, Paris [France], mai 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Judéo-Christianisme - Le mythe des mythes ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume
I », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Y-a-t-il eu un temple de Salomon à Jérusalem ? », Edit. BoD, Paris [France], aout 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume
II », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les ennemis de l’Islam - Le règne des Antésulmans - Avènement de l’Ignorance, de l’Obscurantisme et de l’Immobilisme », Edit. BoD, Paris [France], février 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le secret des cellules immunitaires - Théorie bouleversant l’Immunologie [The secrecy of immune cells - Theory upsetting Immunology] », Edit. BoD, Paris [France], mars 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Rétablisme », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2013.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Livre bleu I - Du discours social - La
population est du bétail…», Edit. BoD, Paris [France], août 2014.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Comprendre la Renaissance - Falsification et fabrication de l’Histoire de l’Occident », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Connaissez-vous l’Islam ? », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Malāk, entité de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], mai 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Jésus fils de Marie ou Hiyça ibn Māryām ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
Collection Anthropologie de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Apparition de l’Homme - Modélisation islamique - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « L’Homme, qui est-il et d’où vient-il ? -Volume II », Edit. BoD, Paris [France], octobre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Classification islamique de la Préhistoire -Volume III », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Expansion de l’Homme sur la Terre depuis son origine par mouvement ondulatoire - Volume IV », Edit. BoD, Paris [France], décembre 2010.
Collection Œuvres universelles de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Médecine », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Chimie », Edit. BoD,
Paris [France], octobre 2013.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Pharmacologie », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2014.
Table des matières
Introduction
I - Qu’est-ce que l’Histoire ?
A - Généralités
1 - Définition
2 - Avant l’apparition de l’Histoire : la tradition orale
3 - Valeur et sens de l’Histoire
4 - Avènement de l’Histoire
5 - L’interprétation de l’Histoire
6 - Evolution du savoir, de l’idée d’une discipline scientifique
II - Les Sciences humaines et sociales
A - Sciences humaines
1 - Définition
2 - L’apparition des Sciences humaines en Occident
3 - Socle d’étude des humanités, des Sciences humaines
4 - Evolution des Sciences humaines et sociales
5 - Quelques disciplines des Sciences humaines
III - Orthodoxie historique et historiographique
A - Orthodoxie historique
1 - Histoire de l’orthodoxie historique
B - Index Historum Prohibitorum
1 - Ligne de conduite préétablie : protocole à suivre
2 - Les problèmes de consultation documentaire
3 - Prohibition historique ou historum prohibitorum
4 - L’Etat garante de l’Histoire officielle
5 - Historico-hérétique ou Rétabliste
IV - Casuisme historico-historiographique
A - Qu’est-ce que l’Historicité ?
1 - Les intuitions du Rétablisme
2 - La conscience historique
3 - L’école de l’Historicité
4 - Etat d’être de l’Historicité
5 - Problématique des Sciences humaines
B - Paradoxes historiques et historiographiques
1 - Premier paradoxe
2 - Second paradoxe
3 - Autres paradoxes
Conclusion
Index alphabétique
Introduction
A.R. Ibn-Khaldun 1 le fondateur des Sciences humaines définit l’Histoire : « Il faut insister sur l’examen impartial de l'ensemble des écrits ou historiographie décrivant tous les faits connus de la vie des individus et des sociétés passées. Il faut découvrir les événements antérieurs et d'en fournir un exposé exact qui implique l'influence de nombreuses disciplines auxiliaires [économie, politique, ethnologie, psychologies, etc.] et formes littéraires. L'objectif est de réunir et de rédiger tous les faits du passé des hommes afin de mettre à jour de nouveaux événements. Il faut rejeter toute information suspecte et faire preuve d’esprit critique et d’impartialité. Les phénomènes événementiels sociaux s’étudient de manière analytique et dialectique. Il faut combattre le démon du mensonge avec la lumière de la raison. »
Il est essentiel d’analyser l’Histoire et l’Historiographie avec une nette tendance à la remettre en question, à la réexpliquer afin de la corriger, de la rétablir vers son authenticité.
Elle est nécessaire et fort naturellement motivée car il faut se rappeler que leur origine est des plus suspectes, surtout dans la façon dont elle a été fabriquée ; c’est du moins ainsi que toute une tradition historico-historiographique a prit vie à l’époque médiévale, s’est révélée à la Renaissance entre conceptualisation ecclésiastique et théorisation humaniste.
L’intégrisme historique et historiographique orthodoxe a produit une masse considérable de textes, une véritable hégémonie. Cette masse documentaire provient d’une source historique d’importance, douteuse qui, en fait, n’a cessé d’être exploitée méthodiquement jusqu’à nos jours. Pour la plupart, les ouvrages dits « historiques » qui traitent ou abordent la question, par exemples, de l’apport réel de la Civilisation de l’Islam Classique [CIC] aux sociétés occidentales ou les fondateurs authentiques des Sciences expérimentales, ne sont que des pièces [lorsqu’il y en a] de la polémique, sans réelle valeur scientifique.
Dans ce type de polémique, le souci des historiens attitrés [fonctionnaires] est de montrer que leur pensée s’identifie à l’orthodoxie de leurs pairs humanistes, fondateurs de la tradition historique et historiographique orthodoxe, à l’encontre de toutes les novations historico-historiographiques hétérodoxes jugées par eux « apocryphes » ou « non-européocentriques ».
Au sens le plus général, le dogmatisme historique et historiographique orthodoxe est devenu le synonyme d'intolérance, d'absolutisme, d’étroitesse d’esprit et de raideur. Il s’insurge contre quiconque [rétabliste] remet en question l’acquis historico-historiographique ancestral.
Le problème étant ainsi replacé à son véritable niveau, qui est celui de la Vérité, il est donc nécessaire, pour le décrire d’évoquer le courant de pensée du Rétablisme qui s’attache par ses actions intellectuelles notamment, à établir la remise en question de l’Orthodoxie historique [Histoire orthodoxe]. Tel est le nœud du problème de l’Histoire actuelle.
Au delà même du contenu de l’Histoire et de l’Historiographie, c’est la phénoménologie de l’historicité qui demande à être réévaluée par une critique radicale. Il s’agit de l’éthique des valeurs ce celle-ci du point de vue de son sens qui doit aider à éclaircir et à fonder phénoménologiquement le problème ou l’objet de l’Histoire. En se rattachant à l’idée de la phénoménologie considérée comme recherche a priori de l’essences de l’historicité, il s’agit de la valeur historique, en tant qu’authenticité [Vérité], sans éluder la question des rapports de cette dernière avec le système à priori réel et concret, des valeurs aux expériences historiques.
1 A.R. IBN-KHALDUN, « Muqaddima, [« Les Prolégomènes »] » - « Kitâb al-Ibar [« Livre des considérations sur l’histoire universelle »] »
I - Qu’est-ce que l’Histoire ?
A - Généralités
1 - Définition
L’histoire est la recherche, connaissance, reconstruction du passé de l'Humanité sous son aspect général ou sous des aspects particuliers, selon le lieu, l'époque, le point de vue choisi ; ensemble des faits, déroulement de ce passé.
a - Historien
L’historien est celui qui se consacre à l'Histoire, qui raconte, analyse des faits, des aspects du passé, rédige des ouvrages d'histoire, enseigne cette discipline.
b - Historiographie
L’historiographie est l’activité de celui qui écrit l'histoire de son temps ou des époques antérieures. Ouvrage, ensemble d'ouvrages résultant de cette activité.
2 - Avant l’apparition de l’Histoire : la tradition orale
Toutes les sociétés humaines se sont développées sans autres procédés de transmission de l’information que la parole humaine et sans autre technique de stockage que celle de la mémoire. Il s’agit de la « tradition orale ». Cette dernière concerne des systèmes socioculturels très variés quant aux modalités de communication et de mémorisation.
En insistant sur la sphère culturelle européenne, le phénomène de l’oralité caractérise donc un domaine immense tels que les phénomènes aussi hétéroclites que la littérature orale, les généalogies, les rituels, les us et coutumes, les métiers et les arts, les formules, etc., légués par les générations antérieures qui renvoient au passé des sociétés européennes, et notamment celles de la Rome et la Grèce antique. Dans l’Antiquité [Egypte, Perse, Mésopotamie, Rome, Grèce, etc.] le peu d’écriture qui constitue une matière peu abondante pour ne pas dire pratiquement insignifiante étant l’apanage de l’aristocratie guerrière et du clergé qui rédigeaient des chroniques, des épopées, des rites religieux, des prières sacrées qu’ils diffusaient entre eux. Quant aux populations qui étaient à leur service [artisans, marchands, agriculteurs, esclaves, etc.] elles vivaient sans autre moyen de communication que la parole. Elles étaient plongées dans l’oralité la plus totale.
La tradition orale est le processus qui transmet les informations et les usages, mais aussi comme l’ensemble des énoncés de portée générale comme les mythes de fondation de société, les légendes ou encore les chroniques locales ou dynastiques, contes, rites et coutumes. Ceux-ci forment un héritage oral intégré dans la culture sociale dans laquelle toute distinction réelle ou fictive apparaît inextricable. Ainsi, les spécialistes qui formulent des théories universelles sur des phénomènes historiques n’ont pas cessé de les relier systématiquement à la transmission écrite des récits. C’est pourquoi bien des hypothèses se réduisent à énumérer certaines propriétés récurrentes de l’historiographie sans en proposer ni explication, ni preuve.
a - Le témoignage oral : authenticité et pertinence
Les cultures à tradition orale, c’est à dire les sociétés de l’Antiquité et la plupart de celles du Moyen-Âge, sont soumises à un paradoxe caractéristique. La mémoire [individuelle ou de groupe] présente un moyen de stockage des informations évidemment limité. Exclusivement utilisé, celui-ci est abandonné à lui-même [absence de contrôle, corruption de l’exactitude, etc.] ce qui engendre d’autant plus maintes erreurs. Ainsi, l’accent mis sur l’immuabilité de la tradition orale, sur sa fidélité quant à la chaîne de transmission qui débouche sur la version actuelle reste inconcevable, voire chimérique. Il n’existe pas dans la culture au format oral de version originale d’un récit ou d’un rituel, mais un foisonnement de versions prétendantes à la légitimité traditionnelle.
Les paroles ou les dires de la tradition orale s’évaluent généralement en termes d’exactitude, de fidélité dans la restitution des données du passé. Certes, le critère le plus simple pour considérer ces derniers est le fonctionnement cognitif de la mémoire. Celle-ci ne peut se comparer aux divers supports graphiques [ou informatiques] de stockage de l’information. Son caractère [exercice de la mémoire] ne comporte pas uniquement en un stockage, mais notamment en une opération de traitement des informations. En effet, percevant des informations variées d’origine sensorielle et conceptuelle, la mémoire doit ordonner, coordonner, écarter, modifier continuellement, sous peine de saturation définitive. Le traitement mnémonique des informations est un processus intégrant des caractéristiques psychologiques. Ces dernières ont des effets sérieux pour l'exercice de la transmission traditionnelle. Elles provoquent la mémorisation des événements particulièrement marquants ou pertinents comme la récitation de mythes, l'exécution d’un rituel, etc. Quand le récit ou l’histoire est mémorisée, c’est qu’on y est arrivé en réunissant certaines idées, en les classant, en y adjoignant diverses indications conceptuelles, etc. Ce traitement ou arrangement de l’évènement [récit, histoire] en mémoire comporte un éventail de sélection ou d’options plus ou moins automatiques et inconscients dans l'accommodement des données. Aussi, les évènements ou versions des évènements renfermant le plus d’effets sur le système de figurations et de croyances du sujet disposent sûrement plus de chances d’être protégés et sauvegardés dans la mémoire que les événements ou versions ne comprenant que peu de suites de cet ordre.
Pour les historiens attitrés [fonctionnaires], le document oral est d’autant plus captivant ou pertinent qu’on peut le supposer exact, transmis à l’identique à travers les générations. Dans les processus mnémoniques, le lien entre pertinence et authenticité se confond forcément. Un évènement [mythe, rituel, etc.] peut procurer une certaine dimension psychologique de par ses effets cognitifs et, notamment, il semble parfois révéler des messages pertinents ou des vérités élémentaires. Plus généralement, il se distingue dans la masse des actes [comportements, agissements, opérations, etc.] et discours perçus. De ce fait, les auditeurs auront tendance à le percevoir comme authentique, à le croire transmis depuis des générations. Conséquemment, l’historien trouve ce type de documents dignes d’intérêts dans la mesure où ils sont fidèles. On trouve l’expression la plus claire de ce désordre dans l’étude des textes ou documents prétendument historiques mais qui sont, en réalité, de traditions orales ; certains spécialistes soucieux d’utiliser ces matériaux ont bâti l’Histoire et échafauder l’Historiographie sur la base de ces sources orales sans aucune critique.
Ce genre d’attitude conduit à ne plus être vigilant et à ne plus accorder de nuance objective à la valeur et aux critères du document oral, bien souvent considérés comme des témoignages des faits, utilisables par l’historien [attitré] lorsqu’ils portent sur les événements passés. Il est essentiel de préjuger de la transparence et de la traçabilité des données orales, supposées refléter l’histoire [représentations et croyances].
b - La « littérature » orale
Les expressions « littérature orale » ou « production littéraire orale » traditionnelle rencontrent d’emblée une problématique essentielle, celle du contenu de leurs objets qui vont des mythes d’origine aux aventures épiques ou à la poésie lyrique, les dictons, les énigmes, les formules gnomiques, les incantations magiques ou surnaturelles.
Tout cela a en commun que leur production est justement ni fixée, ni transmise à l’aide de lettres ou autres