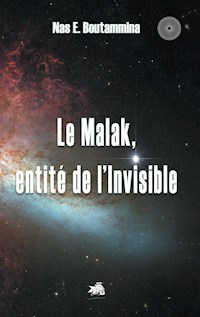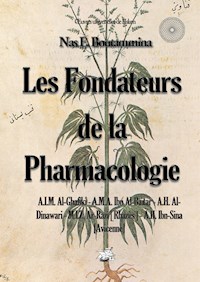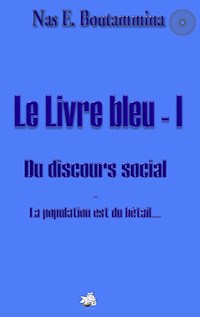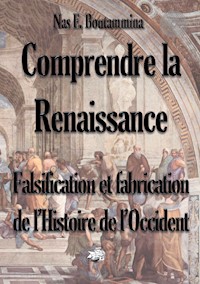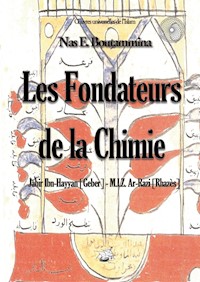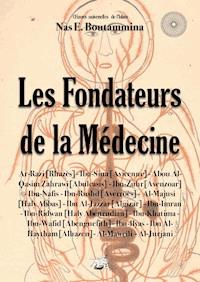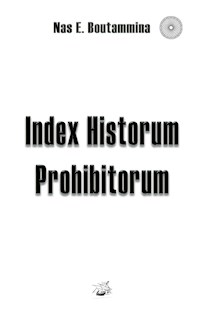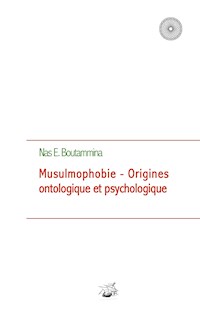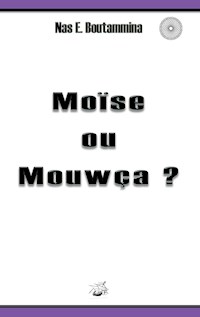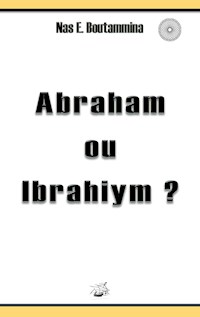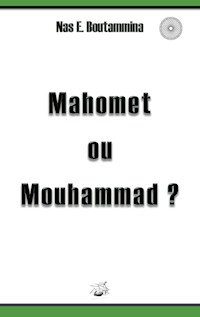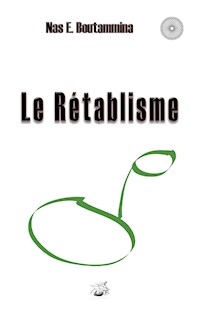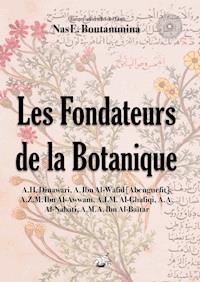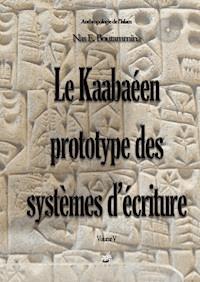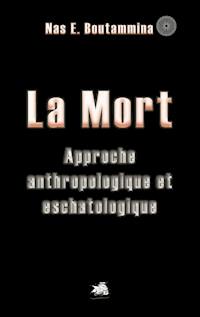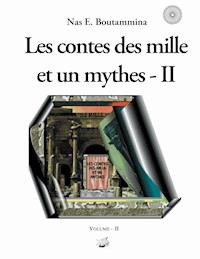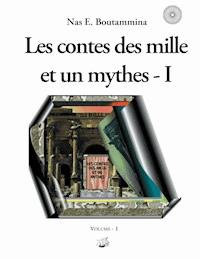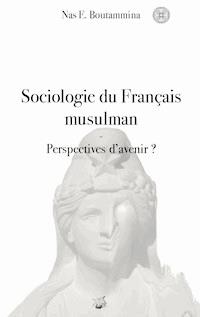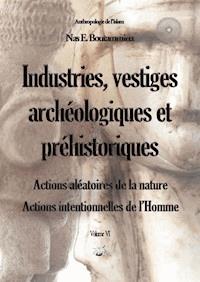
Industries, vestiges archéologiques et préhistoriques - Action aléatoire de la nature & Action intentionnelle de l’Homme - Volume VI E-Book
Nas E. Boutammina
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Anthropologie de l'Islam (Néo-anthropologie)
- Sprache: Französisch
Ethologiquement Homo sapiens [« homme savant »], généralement désigné par « homme moderne », « homme », « homme anatomiquement moderne », « humain » ou encore « être humain » est, par excellence, une créature unique en son genre dans le règne animal. Les interprétations automatiques de la part des spécialistes [archéologues, préhistoriens, paléoanthropologues, etc.] concernant les temps anciens [Préhistoire] suscitent une insatisfaction intellectuelle. Dès lors, cette dernière pousse à revoir, à soumettre à une nouvelle approche les démarches, les conclusions, les dogmes habituels de l’archéologie, de la préhistoire, de la paléoanthropologie et de l’anthropologie en posant, par exemple, le rôle heuristique central de l’industrie lithique. Cette dernière, lorsqu’elle est vraiment constatée, ne relève-t-elle pas d’une chronologie beaucoup plus récente, celle de la « Protohistoire » et intéressant une aire de distribution géographique nouvellement colonisée par l’Homo sapiens comme l’Afrique, l’Europe, une grande partie de l’Asie et le continent américain ? Avant les cinquante derniers millénaires, quelle que soit la nature des gisements en archéologie préhistorique, nous ne connaissons pour eux rien de l'industrie et des matériaux caractéristiques humains [outils, instruments métalliques, d'os ou d'ivoire, céramique, etc.]. En dehors de ce que les spécialistes [archéologues, préhistoriens, paléoanthropologues, etc.] nomment « matériel de pierre » ou « matériel lithique » rien n'est parvenu jusqu'à nous. Dès lors, la réalité des Hominidés [famille de Primates supérieurs comprenant l'homme moderne et ses « cousins » et ancêtres fossiles : Australopithèques, Paranthropes, Pithécanthropes et Homo] est des plus hypothétiques. Leur inexistence ne paraît-elle pas s’établir d’elle-même et de manière des plus évidentes ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A ma femme, mes enfants, ma famille, mes amis…
Dans les mêmes Editions
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Jinn, créature de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Français musulman - Perspectives d’avenir ? », Edit. BoD, Paris [France], mai 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Judéo-Christianisme - Le mythe des mythes ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Y-a-t-il eu un temple de Salomon à Jérusalem ? », Edit. BoD, Paris [France], aout 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les ennemis de l’Islam - Le règne des Antésulmans - Avènement de l’Ignorance, de l’Obscurantisme et de l’Immobilisme », Edit. BoD, Paris [France], février 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le secret des cellules immunitaires - Théorie bouleversant l’Immunologie [The secrecy of immune cells - Theory upsetting Immunology] », Edit. BoD, Paris [France], mars 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Livre bleu - I - Du discours social », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2014.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Rétablisme », Edit. BoD, Paris [France], mars 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Comprendre la Renaissance - Falsification et fabrication de l’Histoire de l’Occident », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Connaissez-vous l’Islam ? », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Malāk, entité de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], mai 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Jésus fils de Marie ou Hiyça ibn Māryām ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Index Historum Prohibitorum », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Moïse ou Moūwça ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Mahomet ou Moūhammad ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Abraham ou Ibrāhiym ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Musulmophobie - Origines ontologique et psychologique », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Jinn bâtisseurs de pyramides…? », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « La Mort - Approche anthropologique et eschatologique », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2015.
Collection Anthropologie de l’Islam [néo-anthropologie]
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Apparition de l’Homme - Modélisation islamique - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « L’Homme, qui est-il et d’où vient-il ? - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Classification islamique de la Préhistoire - Volume III », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Expansion de l’Homme sur la Terre depuis son origine par mouvement ondulatoire - Volume IV », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Kaabaéen prototype des systèmes d’écriture » - Volume V », Edit. BoD, Paris [France], mai 2016.
Collection Œuvres universelles de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Médecine », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Chimie », Edit. BoD, Paris [France], octobre 2013.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Pharmacologie », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2014.
Table des matières
Introduction
I - Industries, vestiges archéologiques, préhistoriques et paléoanthropologiques
A - Recherche historique
1 - Normaliser
2 - But méthodique
II - Industries, vestiges lithiques
A - Origine naturelle de l’industrie lithique
1 - Actions thermiques
a - Actions mécaniques
III - Action aléatoire de la nature
A - Quelques définitions
B - Modification ou altération naturelle d’un corps [roche]
1 - Nature et phénomènes d’altération
2 - Spécificités générales de l'altération
3 - Types principaux d'altération - Étude géochimique et cristallochimique
4 - Facteurs de l'altération
a - Phénomène d’érosion
· Mécanismes d'altération et d'érosion chimiques
- Oxydation
- Hydratation
- Décarbonatation
- Hydrolyse
· Erosion mécanique - Mécanismes et facteurs
- L’eau
° Précipitations - Ruissellement de surface
° Les cours d'eau
b - Rôle des organismes dans l’altération de la roche
C - Erosion naturelle des roches - Silex « taillés »
D - Exemples de silex taillés naturels [éolithes]
IV - Action intentionnelle de l’Homme
A - Intention - Intentionnel - Intentionnalité - Définition concise
B - L’Homme cet inventeur [intentionneur]
1. Phénoménologie de l’invention humaine
a - L’inventeur et son environnement
b-L’ inventeur et son œuvre
c - Capacité d’invention humaine
· Don divin
C - Acte intentionnel et réfléchi
1 - Les industries humaines
a - Produits d’origine animale
· L’os
· La corne
· L’ivoire
b - Matériel caractéristique
· La céramique
- Procédé de la poterie
- Façonnage de l'argile
- Séchage et cuisson
- Décoration
- La poterie : industrie humaine par excellence
c - Aire de distribution de la céramique
· Birr égyptien
· Birr mésopotamien
· Birr perse
· Birr Perse Inférieur ou Birr chinois
- Birr Perse Supérieur ou Birr mexicain
d - Tissage
· Le tissage du Birr égyptien
· Le tissage du Birr mésopotamien
· Le tissage du Birr perse
· Le tissage en Asie : Birr chinois
· Le tissage du Birr abyssin
e - La métallurgie
· Les divers métaux
- Le bronze
- Le cuivre
- Le plomb
- L'étain
- Le fer
· L’art du métal
f - L’agriculture
· Plantes
· Exemple de parcourt
· L’élevage ou domestication
g - Indices de la domestication
· Principaux animaux
· Animaux de trait
· Autres animaux
- Volaille
h - La roue
i - L’habitat
j - L’art ou la création artistique
· Création artistique - Spécificité humaine
- Intérêt pratique
° Objectif ergonomique quotidien [outils, ustensiles, armes]
- Objectif esthétique
k - L'art ahtilalique dans son contexte géographique et paléoclimatique
· Art figuratif
- Art figuratif et fonction sociale
- Art figuratif, langage et écriture
· Relief
- Bas-relief
· Les peintures pariétales
- Interprétations de l'art pariétal
Quelques exemples de travail intentionnel de l’Homme
Conclusion
Index alphabétique
Introduction
Les migrations humaines sont le moyen le plus efficace et exclusive de l’universalisation non seulement des industries humaines mais également de leur matériel caractéristique dont l’agriculture et l’élevage sont les fondements.
L’Homme se caractérise par la complexité de ses relations sociales, l'emploi d'un langage articulé sophistiqué transmis par l'apprentissage, l’élaboration d'outils, le port de vêtements, la domestication de nombreuses espèces végétales et animales, la disposition de son système cognitif à l'abstraction, l'introspection, la spiritualité, la religiosité, etc. Finalement, il se différencie de toute autre espèce animale par la profusion et la complexification de ses réalisations techniques et artistiques, mais également par les transformations qu'il opère sur les écosystèmes. Dès lors, l’industrie humaine et son matériel caractéristique [agriculture, élevage, pêche, chasse, etc.] définissent le champ des témoignages que l'homme donne à sa présence sur Terre.
Sous le nom d'éolithes, les spécialistes [archéologues, préhistoriens] caractérisaient le matériel en pierre [silex]. Ce matériel primitif censé avoir été taillé intentionnellement présente d’étonnantes similitudes avec celui issu de l’action des forces de la nature. Une problématique de taille n’apparaît-elle pas ?
L’homme développe les thèmes de ses activités qui donnent un caractère concret à son histoire, à son origine ; et surtout qui confèrent une signification essentielle à sa société et à sa culture proprement humaine à l’exclusion de tout autre aspect animal. Son essence intérieure, don divin, le pousse à manifester et à valoriser extérieurement sa créativité dégagée du joug de l’instinct, c’est à dire de ce mouvement intérieur, qui chez l'animal, pousse le sujet à exécuter des actes adaptés à un but dont il n'a pas conscience.
Dans cette mesure, la notion de consommation de produits de la nature [notion animale] tend à s'effacer au profit de celle d’invention, de fabrication, de production, qui renvoie plus directement aux processus féconds de la créativité humaine inhérents à sa nature, à ses structures sociales et métaphysiques.
I - Industries, vestiges archéologiques, préhistoriques et paléoanthropologiques
A - Recherche historique
Les disciplines complémentaires de l’histoire procurent des matériaux bruts que l’histoire, ultérieurement, se charge d’interpréter. L’expérience démontre en effet que les explications grossissent les interprétations sans que l’historien puisse contrôler cet agrégat informe et accablant. D’autre part, il est très difficile de soutenir que les documents archéologiques viennent appuyer d’autres documents. En conséquence, la présence de textes ne renseigne pas plus sur le bon reflet de la réalité.
Les documents archéologiques viennent nuancer ou contredire, sans qu’on puisse les suspecter de déformation intentionnelle. Enfin, ces documents alimentent la plupart des champs de la recherche historique. Outre l’histoire de l’art et celle des techniques, mais également celle de l’économie, de la société, de la religion, de la pensée. Tandis que l’histoire se sert de toutes les catégories de documents, l’archéologie exploite un tout autre type de source : les éléments matériels laissés par l’Homme à la surface de la terre.
Quand ces documents sont les seuls, tels est le cas pour la préhistoire, l'accès archéologique est une chasse gardée. L’existence d’autres supports [textes, images, enregistrements sonores, etc.] associe une approche qui s’accorde avec les autres pour négocier une recherche historique.
La nature même des informations utilisées impose de terribles entraves. L’archéologue, le préhistorien ou l’historien doit penser, en premier lieu, que l’existence d’un témoin quelconque [habitat, vase, outil, arme, etc.] découle d’une suite de causes qui se substituent, se contredisent ou s’aménagent en une chaîne dont la complexité est infinie.
Ainsi, la construction d’habitats par un groupe humain qui à première vue est une cause immanente peut être liée à une nécessité économique qui résulte d’une pression démographique qui à son tour découle de circonstances sociologiques. Cet enchaînement ne procure aucune trace.
Conséquemment, l’archéologue doit s’appliquer, sous peine de faillir à ses engagements, de relier le témoin à ses causes, erre dans les ténèbres. Les indices demeurent généralement invisibles. Plus rare encore est la cause unique qui rend compte de la présence d’un témoin. Si le cas daigne se produire, il ne s’agit souvent que d’un développement automatique, tels celui qui relie, sans autre raisonnement qu’une piètre vraisemblance, les ornements préhistoriques aux causes religieuses. Il existe maintes interprétations.
D’autres types d’embarras sont associés au principe même des témoins dont la signification est extrêmement variée. Le cas le plus élémentaire est que le témoin est un produit fabriqué [arme, outil, jarre, bijou, habitation, stèle, etc.]. Dès lors, l’Homme a travaillé un matériau brut et l’a modifié en un objet ayant une forme et des propriétés déterminées. Le témoin est donc la conséquence d’une intention réfléchie. Mais d’autres éventualités subsistent. On retrouve une importante catégorie de témoins composée de déchets de fabrication qui proviennent de confection d’objets [copeaux de bois, scories de métal, etc.] qui demeurent inutilisables scientifiquement.
Une autre catégorie est celle des traces qui présente des témoins plus éphémères. Il s’agit de marques de fabrication [retouches, empreintes, stries, etc.] et traces d’altération [dissolution, détérioration, oxydation, combustion, etc.].
La catégorie qui établit des rapports entre les témoins matériels est la relation spatio-temporelle dont la spéculation chronologique est couramment usitée. Quant aux relations d’association qui sont primordiales pour l’interprétation des vestiges, elles sont rarement mises en évidence. La trace reste le reflet d’un acte ou celui d’un phénomène physico-chimique. Elle doit s’étudier objectivement car elle est porteuse d’informations et elle appelle des méthodes différentes. Les relations de cause à effet méritent une attention toute particulière car, mal interprétées, ce qui est généralement le cas, elles offrent aux objets une signification principale et véhiculer un grand pouvoir informatif faussé. C’est cette rupture qui prive tant d’objets de musée de l’essentiel de ce pouvoir.
Une évolution importante se produit entre la période d’abandon d’un objet et celui de sa trouvaille qui résulte du matériau constituant l’objet. Diverses matières [os, pierre, coquille, ivoire, terre cuite, etc.] se conservent assez longtemps malgré leur altération. Certains [métaux, terre cuite, etc.] se conservent aussi, mais perdent leur aspect, et leur identification est donc ardue, voire impossible.
Enfin, d’autres sont éphémères [fibres végétales, bois peaux, tissus, papiers, etc.] ne laissant que d’exceptionnelles traces [hydratation, dessiccation complète, carbonisation, etc.]. De plus, l’action du milieu [érosion, sédimentation, action de la végétation, activité des animaux, des micro-organismes, etc.] et surtout celle résultant de l’activité humaine telle que la culture, le nivellement des sols, les constructions démesurées [ports, aéroports, autoroutes, bâtiments, barrages, usines, etc.]. Les vestiges sont détruits, généralement déplacés. En conséquence, les spécialistes [archéologues, préhistoriens, paléoanthropologues] se préoccupent d’inventer l’état originel des vestiges et de spéculer sur les objets qui ont disparu, donc de retoucher et de parachever ce reflet doublement déformé que les vestiges lui présentent à la fouille. Par le déroulement même de l’imaginaire, des résultats sont obtenus et mieux encore, ces derniers sont véhiculés comme des conditions du progrès.
N. Pigeot1 écrit : « […] Un simple regard sur le siècle d'une discipline [Préhistoire] si jeune finalement, et l'on se prend à ressentir un découragement, presque désespéré, devant un savoir qui se dérobe au fur et à mesure qu'on croit le voir se construire... Depuis que l'idée de la Préhistoire de l'homme a bouleversé les convictions religieuses et le confort existentiel, nous voilà devant un vide presque vertigineux : des milliers puis des millions d'années d'une histoire « essentielle », car la nôtre, et presque rien pour imaginer l'inimaginable. C'est bien sûr sans paradoxe que nous évoquons l'imagination dans le cadre d'une recherche d'ordre scientifique, et d'autant plus une science humaine où aucune interprétation ne peut naître en dehors des associations et des références nourries par l'imaginaire : comprendre l'Homme, c'est toujours le comprendre par rapport aux autres hommes, et voilà l'achoppement du préhistorien, ou du moins du paléolithicien […]. »
L’auteur rajoute : « Pour un même acte, une même technique, l'ethnologie semblerait montrer une multitude de significations, voire même diamétralement opposées. Et il est vrai que le préhistorien, quand il ne se contente pas de décrire la culture matérielle des hommes qu'il étudie, extrapole alors les données d'aujourd'hui à celles d'hier. Dans la trajectoire historique de l'Homme, seule l'arrivée est assurément connue. Le point de départ paraît l'être également puisque nous partons d'un primate qui ressemblerait comme un frère aux singes actuels ; d'ailleurs, là aussi, même si l'extrapolation nous dérange moins, elle est tout aussi réelle. »
1 - Normaliser
Les typologies qui sont nécessaires pour mettre de l’ordre en archéologie afin de la manipuler, posent des problèmes. Normalement, comme pour les autres sciences, elles doivent s’appuyer sur un matériel suffisant. Un classement assuré sur un matériel trop restreint, ce qui est généralement le cas, reflète surtout les hasards de la recherche ou de s’avérer impropre à l’étude d’un autre matériel.
Ainsi, il est nécessaire, dès le départ, de se baser sur des objets nombreux et divers qui indiquent l’éventail des variantes connues. Il est impératif de ne voir dans les typologies autre chose que des outils. Souvent, les spécialistes supposent que l’ordre logique qu’elles exposent représente un ordre chronologique.
Des objets apparemment simples sont catalogués comme anciens et ceux plus complexes sont classés récents. Ces théories encore très répandues subissent des échecs cuisants : toute coïncidence d’un ordre logique avec un ordre chronologique doit être démontrée.
Classer les objets selon le matériau dans lequel ils ont été fabriqués : argile, os, pierre, verre, métal, tissu, coquille, etc., est commode, mais il dissocie des séries d’objets [outils, armes, récipients, objets de parure, etc.] fonctionnels et réunit des objets divers d’après leur matière [vases, pesons de fuseau, figurines, éléments d’architecture, etc.], sans profit pour la recherche.
En prenant l’exemple de la céramique, les décors, les formes et les techniques se discernent facilement et ne peuvent pas être analysés dans le même cadre. Généralement, les décors se lient à un système décoratif dont les éléments sont retrouvés sur bien d’autres produits [bijoux, statuettes, armes, peintures murales, outils, etc.], mais leur distribution géographique et leur durée sont souvent limitées.
Dès lors, ils doivent s’étudier dans un domaine plus étendu que celui de la seule céramique. Les aspects des récipients en terre cuite se perçoivent dans d’autres objets [récipients de pierre, de bois, d’écorce, de métal, de vannerie, etc.], utilisés par une ethnie, mais leur répartition et leur durée sont supérieures à celles des décors. En effet, ils doivent être étudiés dans un cadre nettement important que celui des seuls vases en céramique et dans un espace géographique et historique plus étendu. Le nombre limité de procédés pour fabriquer la céramique fait qu’elle est beaucoup plus amplement diffusée que les formes et plus permanente dans le temps. Leur étude doit être envisagée dans un domaine géographique et historique très large. Cet exemple, montre que l’outillage « lithique », la métallurgie, l’habitat, etc., doivent être étudiés de plusieurs points de vue et ainsi le cadre de l’étude peut être différent.
2 - But méthodique
Souvent recueillir le plus d’informations possibles sur le plus grand nombre de sujets possibles est le but de la Préhistoire et de l’Histoire. Le résultat est que la masse infinie des données submerge le chercheur, déborde ses possibilités d’enregistrement et dépasse son pouvoir de synthèse. Cela conduit naturellement à un effet de saturation qui engendre la paralysie de la recherche. De plus, une part importante de ces données est dénuée de signification et donc d’intérêt.
A quoi sert, par exemple, la connaissance précise de toutes les couleurs d’un débris de céramique si elles découlent de phénomènes aléatoires ? Les capacités de concentration de l’esprit humain sont limitées, comme le confirment les portées des prospections, qui augmentent avant tout le nombre des sites connus pour les périodes auxquelles les prospecteurs se captivent et très peu celui des sites d’autres époques.
En revanche, quand la recherche conduit vers des objectifs limités et quand elle privilégie, dans la gamme des directions éventuelles, une ou plusieurs d’entre elles, elle profite du nombre de données qui se réduit. La précision est nettement variable et leur manipulation devient plus commode car les données qui ne sont pas significatives sont écartées et surtout l’attention se porte sur les objectifs retenus. Ainsi, les bénéfices d’une certaine préparation intellectuelle sont recueillis. En effet dans la recherche scientifique comme dans toute autre quête, on ne découvre d’abord que ce qu’on cherche.
Le choix des objectifs suppose bien entendu la présence d’un corps de connaissances provenant d’observations antérieures et représentant, pour le pays et les thèmes étudiés, l’état des interrogations en un moment précis. Tout chercheur doit évidemment gérer cet ensemble qui comprend déjà des lacunes et qui concordent aux problèmes non élucidés.
A ceci vont encore s’ajouter des observations inédites ou inopinées. Elles peuvent être imperceptibles ou éparpillées et tout se passe comme si elles étaient inexistantes. Elles n’attirent l’attention que lorsqu’elles se reproduisent ou quand elles présentent une certaine cohérence. Aussitôt, elles installent d’elles-mêmes une interrogation : comment comprendre ces évènements récents qualifiés d’aberrants en fonction des connaissances premières ?
Ce mouvement intellectuel parvient à l’étape primaire de la méthode expérimentale qui est commune à toute science. Les observations inédites doivent passer des faits aux concepts, des examens aux propositions qui les légitiment, des traces aux intuitions qui les développent.
Pour un problème nouveau, le professionnel de l’Histoire doit franchement vérifier que celui-ci relève de sa compétence, c’est-à-dire dispose-t-il des documents essentiels présentant un intérêt suffisant [ni trop banal ni trop limité] ? Ceci revêt une haute importance parce que les documents archéologiques sont chargés de multiples limitations et que la recherche qui s’y appuie est singulièrement interminable et très complexe.
La recherche de la vérification présume d’abord que l’hypothèse s’énonce de la manière la plus précise possible. Cela consiste en règle générale à déployer les résultats de l’hypothèse et à envisager leur traduction dans les vestiges archéologiques car uniquement cette explication sera susceptible d’être évaluée.
L’importance du raisonnement est d’autant plus décisive qu’il s’agit de vérifier si dans les notions observables, l’expression des conséquences prévues est retrouvée. En effet, un procédé est nécessaire afin d'aménager un ensemble de démarches qui souscrit au contrôle souhaité et procure des résultats compréhensibles. Pour chaque cas, la démarche doit être la mieux adaptée à l’objectif poursuivi et la plus avantageuse selon le degré du problème posé.
Si le postulat au terme du processus est contesté, il doit être modifié et à nouveau comparé à l’observation. S’il est confirmé, il faut le transformer en certitude et lui accorder le statut de fait avéré. L’archéologie et la préhistoire qui se targuent d’être scientifiques ne doivent pas se distinguer des autres sciences. Ce sont plus les idées que les faits qui produisent la valeur des méthodes qu’elle utilise.
Le savoir des mathématiques et de l’archéo-préhistoire diffère profondément par les caractères des thématiques étudiés, les procédés de raisonnement et la nature des conclusions. A la rigueur de l’immuabilité des axiomes et règles absolues, des mathématiques s’oppose l'observation de l'Homme où priment l'intuition et l'hypothèse, laquelle n'arrive pas souvent à l'induction. Ainsi va l’archéo-préhistoire où formation et tendances de leurs adeptes vont infléchir sur la valeur donnée à tel ou tel document ou fait selon l'appréciation de chacun [esprit critique, finesse, intuition, les impondérables -facteur, événement, cause morale ou psychologique-]. La certitude rigoureuse [mathématique] n'existe pas en Préhistoire et cela malgré les apports qui lui sont fournis par d'autres sciences utilisant les mathématiques.
1 N. PIGEOT, « Réflexions sur l'histoire technique de l'Homme : de l'évolution cognitive à l'évolution culturelle », In : Paléo, n° 3, 1991. pp. 167-200.
II - Industries, vestiges lithiques
La préhistoire reste tributaire de la bonne conservation des vestiges et ne dispose, habituellement, que des seuls objets lithiques, d’où leur intérêt accru !
L’industrie lithique2 est définie par une industrie de la pierre [du grec lithos, pierre]3. Considérant les silex comme forts anciens, les premiers auteurs leurs donnent le nom d’éolithes. Toute une littérature leur est consacrée4.
Selon la définition du Larousse : «