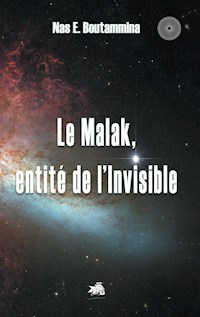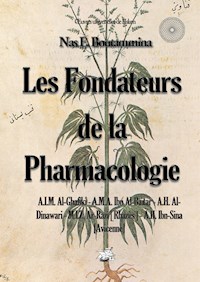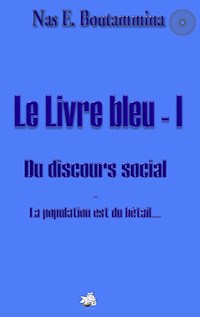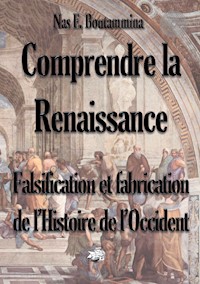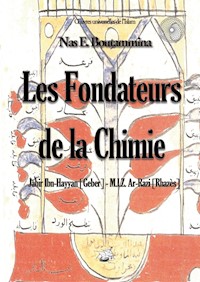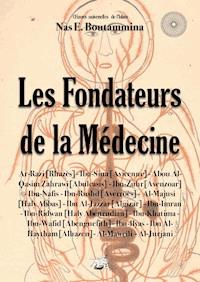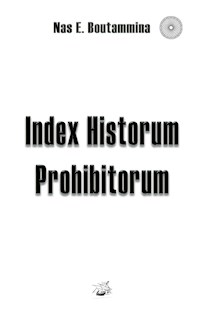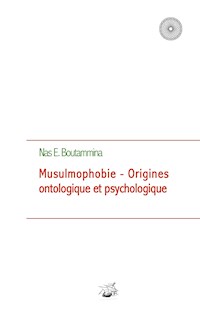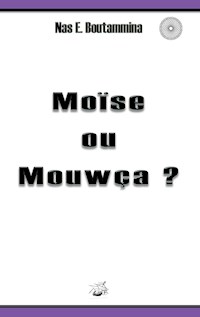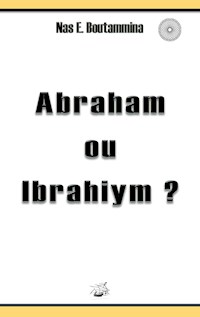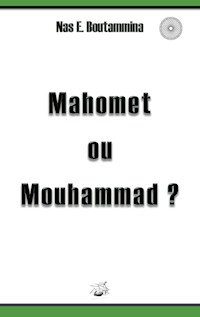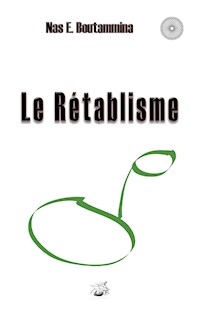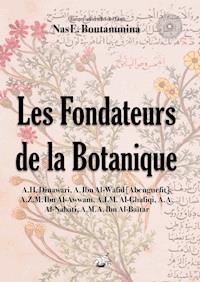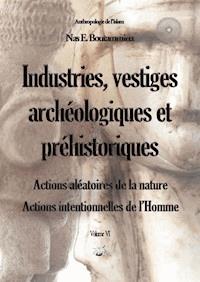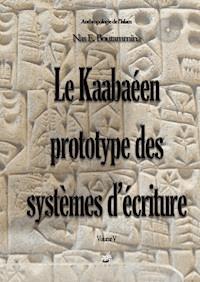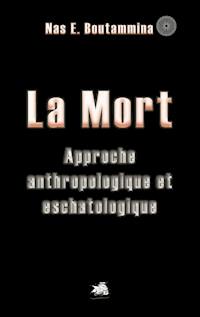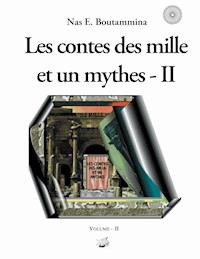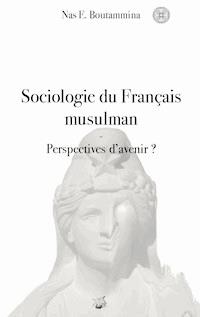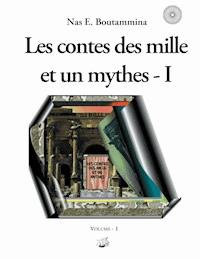
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Durant des millénaires, l'Humanité sombrait inéluctablement vers les abysses ténébreux moraux et spirituels. Le monde confiné dans des systèmes politiques et socioéconomiques infâmes édifiés par quelques individus établis en dynasties (la noblesse, le clergé, les généraux) et qui se maintenaient au pouvoir par de sanglantes rivalités. Quelle valeur humaine pourrait éclore d'une telle tyrannie, d'une telle inhumanité ? Que pouvait-on attendre des sociétés baignées dans des croyances magiques, superstitieuses et mythologiques ? Les sociétés humaines étaient coincées dans l'étau étroit des Ténèbres de l'Ignorance et de l'Obscurantisme. Dès lors,la Science (Connaissance) fruit de la réflexion humaine qui établit que l'Univers est crée selon des Lois rigoureuses par un Dieu Unique, Vivant, Omniscient, Omniprésent et distinct du monde était non seulement inconnue, mais ne pouvait même pas se concevoir par ces sociétés jusqu'au VIe siècle. Les directives des Messagers divins furent recouvertes d'une épaisse couche de légendes et de fables. C'est alors que de gré ou de force, les sociétés humaines s'accommodaient, par habitude, des religions confectionnées à partir d'une superposition de mythes, de fictions et sans cesse remaniées au cours du temps. La classe dirigeante se déifiait, enivrée par les privilèges et captivée par le culte du pouvoir et de la puissance. Le pillage, le massacre et l'esclavage furent les seules institutions estimables. Les Empires se créaient et périssaient au gré des conflits. Pour échapper à ce monde de ravages et de barbarie, certains hommes rassemblés en communauté se sont cloîtrés dans des monastères et des temples dans un total replis du monde. Avant l'avènement de l'Islam, toutes les sociétés en général et la société gréco-romaine en particulier, se mouvaient dans le bourbier de la mythologie, de la superstition et d'une barbarie sophistiquée. Dès lors, comment ces dernières peuvent-elles prétendre être les pays de prédilection des sciences, de la littérature, des arts et de la haute moralité ? Le contenu de cet ouvrage, par sa logique et son raisonnement, met en lumière avec les outils des Sciences humaines ces périodes plongées dans une profonde obscurité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans les mêmes éditions
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Jinn, créature de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Français musulman - Perspectives d’avenir ? », Edit. BoD, Paris [France], mai 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Judéo-Christianisme - Le mythe des mythes ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Y-a-t-il eu un temple de Salomon à Jérusalem ? », Edit. BoD, Paris [France], aout 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les ennemis de l’Islam - Le règne des Antésulmans - Avènement de l’Ignorance, de l’Obscurantisme et de l’Immobilisme », Edit. BoD, Paris [France], février 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le secret des cellules immunitaires - Théorie bouleversant l’Immunologie [The secrecy of immune cells - Theory upsetting Immunology] », Edit. BoD, Paris [France], mars 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Livre bleu - I - Du discours social », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2014.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Rétablisme », Edit. BoD, Paris [France], mars 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Comprendre la Renaissance - Falsification et fabrication de l’Histoire de l’Occident », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Connaissez-vous l’Islam ? », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Malāk, entité de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], mai 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Jésus fils de Marie ou Hiyça ibn Māryām ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Index Historum Prohibitorum », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Moïse ou Moūwça ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Mahomet ou Moūhammad ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Abraham ou Ibrāhiym ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Musulmophobie - Origines ontologique et psychologique », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Jinn bâtisseurs de pyramides…? », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « La Mort - Approche anthropologique et eschatologique », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2015.
Collection Anthropologie de l’Islam - Néo-anthropologie
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Apparition de l’Homme - Modélisation islamique - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « L’Homme, qui est-il et d’où vient-il ? - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Classification islamique de la Préhistoire - Volume III », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Expansion de l’Homme sur la Terre depuis son origine par mouvement ondulatoire - Volume IV », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Kaabaéen prototype des systèmes d’écriture » - Volume V », Edit. BoD, Paris [France], mai 2016.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Industries, vestiges archéologiques et préhistoriques - Action aléatoire de la nature & Action intentionnelle de l’Homme » - Volume VI », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2016.
Collection Œuvres universelles de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Médecine », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Chimie », Edit. BoD, Paris [France], octobre 2013.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Pharmacologie », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2014.
Avertissement
La version de l’ouvrage « Les Contes des mille et un mythes » de la première édition a été épuisée, elle est donc rééditée en deux volumes, sans aucune modification effective de son contenu, afin d’être accessible à un plus large public.
Le Volume I étudie les thèmes qui se rapportent pour l’essentiel à l’histoire des sociétés antiques et du Moyen-âge avant l’apparition de l’Islam, à l’avènement de l’Islam et son rapport avec l’Eglise, à la théologie comparée.
Quant au Volume II, il analyse l’histoire du Savoir à l’époque préislamique, la genèse de la Science à l’avènement de l’Islam, la Civilisation de l’Islam classique et son rayonnement dans la chrétienté ; enfin, le plagiat et la tautologie du Savoir islamique pendant la Renaissance et le siècle des Lumières.
Introduction
« Vis-à-vis de nos amis, la Science est une parure, elle est un bouclier contre nos ennemis »
A.H. Ibn-Sina [Avicenne, 980-1037]1
Pendant des millénaires, l’humanité sombrait dans un chaos moral et une ruine spirituelle. Le monde était confiné dans une culture primitive magique, que contrôlait une société martiale et inhumaine. La certitude établissant la croyance en un Dieu unique, vivant, omniscient, omniprésent et distinct du monde qu'Il a créé et qu’Il régit par des Lois fut inexistante dans les sociétés humaines jusqu’au Moyen-Age.
La quête des conditions qui aboutissent à l'acquisition ou à la découverte du savoir distinct de l'opinion et de la croyance ne pouvait même pas se concevoir par ces sociétés antiques. En conséquence, la connaissance fruit de la pensée humaine était inconnue.
Depuis des milliers d’années, toutes les sociétés antiques se traînaient dramatiquement vers un abysse. L’Homme était dépossédé de toute attache, de tout repère et son corollaire de toute qualité humaine. Les directives des Prophètes furent oubliées. La barbarie, la cruauté et le crime demeuraient les nouveaux traits du caractère. Des systèmes politiques et économiques ignobles institués par quelques individus se maintenaient par de sanglantes rivalités. Les valeurs humaines les plus élémentaires se piétinaient par le poids adipeux de la noblesse, du clergé, des notables et des généraux. Les privilèges politiques et les honneurs demeuraient au sein de la classe dirigeante envoûtée par le culte du pouvoir et de la puissance. Le pillage, le massacre et l’esclavage furent des institutions recommandables. Les Empires se créaient et périssaient au gré des conflits. Comme échappatoire à ce monde de ravages, certains hommes se sont cloîtrés dans des monastères et des temples dans une totale solitude. Ce refus du monde produisit l’inertie et un caractère farouche.
La superstition et la mythologie qui demeurent les fondements archaïques de l’ignorance et de l’obscurantisme constituent les croyances des sociétés antiques qui, bientôt, seront absorbées par une nouvelle religion. Cette dernière compile judicieusement toutes les autres croyances du monde connu sous sa nouvelle bannière qu’elle érigera à Rome. C’est un univers de convictions que leurs auteurs pensaient être minutieusement élaborées, sur le substrat de la mythologie antique. Ce recueil, superposition de mythes, ne cessât pourtant d’être modifié au cours du temps. Il fut imposé par la ruse et par la flamme à d’innombrables sociétés. Il est protégé de manière impitoyable même lorsque certains rouleaux découverts dans la région de la Mer Morte témoignent de son illégitimité. A ce recueil de fabulations fut également adjointe l’invention de l’Histoire Orthodoxe qui la garantit et qui fut embellie pendant des siècles. Elle connut son âge d’or à la Renaissance et au siècle des Lumières pour enfin demeurer une institution contemporaine.
1 IBN ABI-UÇAYBIYA [Historien, 1202-1270], « Uyûn al-Anba fi tâbâkât al-Atibba »
Table des Matières
Les sociétés de l’Antiquité au Moyen-âge
L’Arabie
Géographie
Les terres et les ressources
Histoire
Les anciens royaumes
Des Nabatéens aux Perses
Egypte
Relief et hydrographie
Climat
Histoire
L’Egypte des pharaons
L'Ancien Empire [IIIe-VIe dynasties]
Le Moyen Empire [XIe-XIVe dynasties]
Le Nouvel Empire [XVIIIe-XXe dynasties]
La Basse Epoque
La Perse
Histoire
Le premier Empire
Les Sassanides
La Mésopotamie
Premiers Etats mésopotamiens
Empires assyrien et chaldéen
Domination perse
La Chine
Grandes régions géographiques
Hydrographie
Climat
Histoire
Les premières dynasties
Naissance de l'empire
L’Inde
Relief et hydrographie
Climat
Histoire
Période védique
Système « castéral »
Fondement « spirituel »
Byzance
La Grèce
Relief et hydrographie
Histoire
La période archaïque
Les guerres médiques
La guerre du Péloponnèse
La période hellénistique
Rome
Histoire
Les grandes invasions - La chute de l’Empire romain
Le Moyen-Age
Emiettement de l'autorité
L’Eglise
Aux portes de l’abîme
Le concept de religion
Difficulté d'approche
Religions traditionnelles
Ambiance spirituelle
Le cérémonial
La religion, garante des conventions
Théisme
L’incroyance
La Connaissance
Le problème de la connaissance dans la pensée grecque
La connaissance dans la pensée musulmane
La connaissance dans la pensée contemporaine
La pensée scientifique
Origine de la science
Science au Moyen Age et à la Renaissance
Science moderne
Communication scientifique
Diversification de la science
La civilisation
Civilisation et culture
Les processus civilisateurs
Ignorance et Obscurantisme
A - Ontologie et Connaissance
Racine plantée en profondeur
B - Mythe et connaissance
Le mythe eschatologique
Structure linguistique du mythe
Diverses explications
C - Connaissance et croyance aux pays du soleil couchant
D - Le pouvoir de la légende
Assise de la peur
E - L’art d’interpréter l’invisible
E - Attributs divins
F- Ascendant puissant
G - Dialectique eschatologique
H -Etat-major des dieux
Conditionnement
I - Iconothéisme
J - Les croyances philosophiques et cosmologiques
K - Origine des croyances asiatiques
L - La « voie de libération » en Asie
M - Sacrifice superstitieux au dieu Ignorance
Les différentes thèses
Le mythe des mythes
La croyance judaïque
Histoire
Développement du judaïsme rabbinique
Le sectarisme juif
Le cérémonial
La tradition rabbinique
Fondements de la croyance
Composition de la Thora
La Genèse ou Epopée de Gilgamesh
La Genèse ou cosmogonie mythologique
Les Psaumes, Isaïe ou Poème de la création « Enouma elish »
Le Talmud
La croyance du Christianisme
Genèse d’une mythologie
Le culte de l’Alliance
Les mystères de la croyance
Les promoteurs de la mythologie
Les Esséniens : ébauche du roman
Le roman-évangile de Marcion de Sinope
Le roman-évangile de Valentin
Le roman élu ou évangile agrée de Eusèbe de Césarée
Le roman-évangile ou Vulgate de Jérôme
Le partage de la Foi
Concrétisation du mythe
Etatiser la croyance
Manuscrits de la Mer Morte et de Nag Hammadi
Actes de résistance
L’ombre de la mort : l’ombre de la croix
La genèse de la Croix
Version chrétienne des fabulations perso-suméro-babyloniennes
Les mystérieux Apôtres
Recueil des Midrashim
Le Christ : mythe composé
Sol invictus
Compte à rebours
La Tri-iniquité
Rituels
Devenir chrétien : allégeance à l’Eglise
Aveux au représentant divin
Gestion de l’interdit
Quand le prêtre remplace Dieu
Clergé - Institution
Exercice du pouvoir spirituel et temporel
Développement de l’Eglise
La monarchie cléricale
L’homo-monasticus
Les eunuques monacaux
Le diplôme ès Sanctus
Les Lumières éclairant le monde
L’Inquisition : amour chrétien
Les démons espagnols
L’Inquisition découvre l’Amérique
En perspective
T
ABLEAU DES PROMOTEURS DE LA CROYANCE CHRETIENNE
L’Eglise, héritière impériale
Compilation mythologico-légendaire
T
ABLEAU DE LA COMPILATION DU
C
HRISTIANISME
1 - Observations
2 - Naissance du mythe
3 - Immaculée Conception
Les rouleaux de Qumran
Etablir la vérité
Les révoltés de la science
Les Esséniens
Q
UELQUES INFORMATIONS « HISTORIQUES » DEMENTIES PAR LES MANUSCRITS DE
Q
UMRAN
Autres découvertes de la Mer Morte
Falsification nominale
Le nom propre et le nom commun
Incorruptible, intraduisible
T
ABLEAU -
Q
UELQUES NOMS PROPRES
T
ABLEAU - QUELQUES NOMS COMMUNS
T
ABLEAU DE QUELQUES TERMES CORROMPUS EN NOMS PROPRES
T
ABLEAU DE QUELQUES NOMS PROPRES CORROMPUS
La Mort et la Renaissance
Apologie de l’Histoire Orthodoxe
L
ES GRANDES DATES SELON L
’O
CCIDENT DE L
’H
ISTOIRE DES
S
CIENCES
1 - La vérité historique occultée
L
ES GRANDES DATES DE L
’
HISTOIRE REELLE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE
2 - La Bibliographie : carte d’identité
3 - Les véhicules des préjugés
4 - Les Instituts de l’Ingratitude et de l’Aversion
5 - Institution de la Censure et du Dépôt Légal
Le pouvoir de l’Eglise
L’évêque
L’Université et la Faculté
Le pouvoir Politique ou Civil
La censure d'Etat
Types de permissions
Les Privilèges
Permissions Tacites
Dépôt obligatoire
La ligne continue
La censure de nos jours
Les ouvrages imprimés
T
ABLEAU DES IMPRIMES
Les adeptes zélés de l’Histoire Orthodoxe
Norme à suivre
Les Croisades ou Espace vital de l’Eglise
La prise de Jérusalem
Salah Eddine [Saladin] et la troisième Croisade
Frédéric II de Hohenstaufen
Dernier essai
Résultats des Croisades
Déclarations
Les Croisades en Espagne
Monde réel
Spirituel pétrifié
Sciences et techniques
Politique
Théologie
Déplacement et monopole de la Connaissance
L’Espagne musulmane
Mesures et démesures
Les Juifs à la conquête de l'Europe
Désacralisation
Une législation sur commande
« Echange culturel »
Le code « Napoléon »
Science de l’asservissement - Histoire Orthodoxe
Ultimes Croisades
L’Algérie et le siècle des Ténèbres
Dédain général
Revendications
Hégémonie
L’Institut d’Egypte : genèse de l’Orientalisme
Où est le patrimoine culturel musulman ?
Dissémination du patrimoine culturel musulman
Espagne
France
Angleterre
Etats-Unis
Antiquités du Moyen-Orient
Art islamique
Art médiéval
Art égyptien
Armes et armures
Institut du costume
Dessins, gravures et photographies
Italie
Vatican
Allemagne
Q
UELQUES AUTRES ETABLISSEMENTS
Monopole scientifique et technologique depuis la fin du XVe siècle
La Science et le « khālīfa » ottoman
Technologie actuelle
Accélération de la cadence d'innovations
Avantages et réalisations techniques
Tels que vous êtes, tels que vous serez gouvernés
Les dirigeants éclairés
Ruine des Musulmans
Les causes de la ruine des musulmans
Dilution de la foi
Point de non-retour
Les partisans de Ali, les Alides succombent
Tragédie des guerres civiles
Pouvoir dynastique
La dynastie des Omeyades
La dynastie des Abbassides
Manœuvres de la ruine : le monstre se retourne contre son créateur
Les prétoriens nomment les empereurs
Les musulmans ne se rétabliront plus
Abus de confiance
Les Dhimmis
Les Croisades
T
ABLEAU DES PRINCIPALES DYNASTIES
Héritage complet
C
AUSES DE LA
R
UINE DES MUSULMANS
- G
RAPHIQUE
Etat des lieux
Des traditions perpétuelles
Savoir et avoir
Usages préconçus
Business is business
Etudes et stratagèmes
Etre ou naître
Archaïsme
Cas psychiatriques
Pseudo-culture livresque
L’hymne gré
Principautés et sphère d’influence
Idée préconçue
Conception faustienne du monde
Le culte de la déesse Science
Mouvement vers l’origine : retour préislamique
Du pain et de l’eau
Les prêtres de la Science
L’envoûtement de la déesse
Les mystères de la déesse
La malédiction de la déesse
Les substances toxiques
Le nucléaire
Exploitation irraisonnée des terres
Les besoins en eau
Mytho-mania
Conclusion
Index alphabétique
I - Les sociétés de l’Antiquité au Moyen-âge
A - L’Arabie
1 - Géographie
L’Arabie est une grande péninsule en majeure partie désertique située à l'extrémité de l'Asie du sud-ouest. Limitée au nord par la Jordanie et l'Irak, à l'est par le golfe arabo-persique, au sud par la mer d’Oman et par le golfe d’Aden ; enfin, à l’ouest par la mer Rouge. Avec une superficie d'environs trois millions de km2. L’Arabie située entre l’Afrique et l’Asie forme un sous-continent. Elle a une longueur du nord au sud de deux mille kilomètres et de l’est à l’ouest de mille deux cent kilomètres. Le Tropique du Cancer coupe l’Arabie entre Médine et la Mecque.
a - Les terres et les ressources
Pour l'essentiel, la péninsule est un vaste plateau, qui est bordé par des montagnes à l'ouest, le Hedjaz et l'Asir et au sud l'Hadramaout, et qui descend doucement à l'est vers le golfe arabo-persique. Elle contient certains des plus grands déserts de sable au monde, en particulier le Rub-al-Khali [« le croissant vide »] au sud-est et le Néfoud au nord-ouest. Le climat est très aride : peu d'endroits reçoivent plus de 180 mm d'eau par an, et il n'existe pas de cours d'eau permanent. Les températures estivales peuvent atteindre plus de 50°C.
2 - Histoire
Jusqu'à une époque assez récente, la connaissance de l'Arabie se limitait aux écrits des premiers géographes musulmans et de récits souvent farfelus de quelques anciens grecs et romains, mais la majeure partie de ces informations n'était pas fiable. Rares sont les recherches archéologiques effectuées dans ce pays qui reste fermé à toute prospection scientifique.
Les migrations depuis la péninsule vers les régions avoisinantes sont les premiers faits connus de l'histoire de l'Arabie. Des millénaires2 av. J.C., des populations de langue sémitique et d'origine arabe émigrèrent dans les vallées du Tigre et de l'Euphrate en Mésopotamie, et supplantèrent les Sumériens3. Ces populations sont maintenant connues sous le nom d'Assyro-Babyloniens. Un autre groupe de Sémites4 quitta l'Arabie vers quelques millénaires av. J.C. et s'installa le long du rivage oriental de la Méditerranée. Certains de ces immigrants devinrent les Amorites 5 et les Cananéens des époques ultérieures.
a - Les anciens royaumes
Les régions plus élevées et mieux irriguées de l'extrémité sud-ouest de la péninsule furent occupées à une époque reculée par trois royaumes. Le premier, le royaume minéen6, se situait dans les régions intérieures du Yémen actuel, mais il occupait probablement presque tout le sud de l'Arabie. Bien qu'une datation soit difficile, les historiens admettent généralement que le royaume minéen a existé de 1200 à 650 av. J.C. Selon les historiens, on trouve ensuite le royaume des Sabéens7, qui fut fondé vers 930 av. J.C. et dura jusqu'à environ 115 av. J.C. ; il supplanta probablement le royaume minéen et occupa pour l'essentiel le même territoire. La capitale et la principale ville du royaume était Marib, qui eut sans doute un rayonnement supérieur à celui de toutes les autres villes de l'ancienne Arabie, d'une part parce qu'un grand barrage voisin fournissait de l'eau pour l'irrigation ; et, d'autre part, parce que sa position lui permettait de contrôler les routes des caravanes qui reliaient les ports de la Méditerranée à la région productrice d’encens de Hadramaout. D’après les historiens, le royaume des Sabéens est très souvent désigné par le terme Saba, et la reine de Saba, référence à la femme qui rendit visite au roi Salomon à Jérusalem présumée au Xe siècle av. J.C. Les Himyarites supplantèrent les Sabéens dans le sud de l'Arabie. Le royaume de Himyar dura environ de 115 av. J.C. jusque vers 525 apr. J.C. En 24 av. J.C., l'empereur romain Auguste envoya le préfet d’Egypte, A. Gallus, lutter contre les Himyarites, mais son armée de dix mille hommes revint en Egypte, sans avoir réussi à vaincre l'ennemi. Les Himyarites prospérèrent dans le commerce des épices, de la myrrhe et de l'encens.
• Des Nabatéens aux Perses
Plusieurs Etats ont existé au nord de l'Arabie au Ier siècle apr. J.C. et dans la période qui a précédé. Le royaume des Nabatéens, qui s'étendit vers le nord jusqu'à Damas, pendant une brève période [de 9 av. J.C. jusqu'à 40 apr. J.C.]. Les ruines de Pétra, la capitale des Nabatéens, situées dans le sud-ouest de la Jordanie actuelle, attestent d'un certain degré de culture. Au IIIe siècle, les Abyssins du royaume d’Aksoum dans l’Ethiopie actuelle [Abyssinie] qui s'étaient convertis au christianisme de type monophysite se répandirent en Arabie dans la région du sud-ouest. Le judaïsme fut également introduit dans la région. Ces deux religions ne réussirent jamais à s'implanter et à remplacer les croyances de l'époque, qui s'appuyaient sur le polythéisme et principalement sur l'astrologie et l'occultisme. Au cours du siècle suivant, la Perse envahit, sous le règne des Assanides, une partie de l'Arabie, et en particulier la région occupée par le Yémen actuel.
B - Egypte
L’Egypte est situé à la charnière de l'Afrique et de l’Asie. Il est ouvert sur la mer Méditerranée au nord et sur la mer Rouge à l'est. Bordé à l'ouest par la Libye et au sud par le Soudan, l’Egypte s'étend à l'extrémité orientale de l'Afrique du Nord et se prolonge sur le continent asiatique par le Sinaï. L’Egypte couvre une superficie d’environs un million de km2.
1 - Relief et hydrographie
Moins de 10% du territoire de l’Egypte sont habités et cultivés. Il s'agit de la vallée et du delta du Nil, auxquels s'ajoutent les oasis occidentales. Le reste du pays est constitué de zones désertiques. A l'ouest s'étend, sur les deux tiers du pays, le désert de Libye, prolongeant le Sahara. Formé de plateaux de faible altitude et couvert de dunes de sable hautes de 300 à 400 mètres, il serait totalement inhospitalier s'il n'était creusé de dépressions dont la plus profonde est Kattara, au nord se situant à cent trente quatre mètres au-dessous du niveau de la mer et couvre dix huit mille km2. Les sources qui affleurent au fond de ces dépressions, et qu'alimente une nappe souterraine, ont permis la naissance d'oasis [Ouadi Natroum, Fayoum, Baharieh]. Sur la rive orientale du Nil, le désert arabique est disposé sur un fragment de la plaque continentale africaine relevé en bordure de la mer Rouge et du golfe de Suez par le jeu de la tectonique des plaques. Il s'élève depuis la vallée du Nil jusqu'à une altitude de six cent dix mètres à l'est et se hérisse, le long de la côte de la mer Rouge, de pics abrupts et déchiquetés culminant à 2 135 m d’altitude.
A l'extrême sud, le long de la frontière avec le Soudan, le désert de Nubie est une vaste région de dunes et de plaines de sable. Le Sinaï, encadré par les fossés tectoniques de Suez et d'Akaba et rattaché au désert Arabique par l'isthme de Suez ; il est constitué, dans sa partie septentrionale, d'une étendue sablonneuse, qui se prolonge par un plateau central. La pointe de la péninsule est dominée par des montagnes rocailleuses, dont le mont Sinaï qui culmine à plus de 2 000 m et Jabal Katharina à 2 642 m. Le Nil, dont les crues régulières ont fertilisé les terres égyptiennes depuis des millénaires et permis le peuplement de cette région désertique, pénètre en Egypte par le Soudan et remonte vers le nord sur 1 280 km pour se jeter dans la Méditerranée. Sur toute sa longueur, depuis la frontière sud jusqu'au Caire, il a creusé une étroite vallée, bordée de falaises. Au sud de la ville de Edfou, la vallée du Nil dépasse rarement 3 000 m de large. De Edfou en remontant vers Le Caire, sa largeur moyenne est de 23 km, et les terres arables se situent essentiellement sur la rive occidentale. Le fleuve se ramifie ensuite pour former un vaste delta de 24 000 km2, plaine en forme d'éventail, sur 250 km jusqu'à la côte méditerranéenne. Le limon, déposé par le Nil de Rosette [Rashid], le Nil de Damiette [Dumyat] et les autres bras du fleuve, a fait de cette région, appelée Basse-Egypte, la plus fertile du pays. Si l’Egypte possède quelque 2 900 km de côtes, dont les deux tiers sur la mer Rouge, les échancrures pouvant abriter des ports se limitent à la côte du delta.
2 - Climat
A l'exception de la bordure littorale qui s'inscrit dans la zone climatique méditerranéenne, l’Egypte est soumise au climat tropical aride, caractérisé par une saison chaude, de mai à septembre, et une saison fraîche, de novembre à mars. Dans la région côtière, les températures varient d'un maximum de 37,2° à un minimum de 13,9°. Le contraste thermique entre le jour et la nuit est particulièrement marqué dans les régions désertiques [maximum diurne de 45,6° ; minimum nocturne de 5,6° ; l'hiver, la température diurne peut tomber à 0°]. La région la plus humide se trouve le long de la côte méditerranéenne où les précipitations annuelles moyennes atteignent 200 mm. Ce chiffre diminue rapidement vers le sud puisque Le Caire ne reçoit que 28 mm par an tandis que, dans certaines parties désertiques, il peut ne pleuvoir que tous les cinq ou dix ans.
3 - Histoire
La préhistoire et l’histoire de l'ancienne civilisation égyptienne 8 se révèlent progressivement, mais les périodes les plus reculées demeurent mal connues, et le resteront probablement. L'information reste lacunaire. Elle est essentiellement fondée sur les inscriptions en hiéroglyphes gravées sur les monuments. Les papyrus et rouleaux de cuir sur lesquels écrivaient les Egyptiens de l'Antiquité ont été en grande partie perdus. Manéthon9, prêtre du IIIe siècle av. J.C., établi des documents dont ont été conservés que des résumés. Ceux-ci mentionnent la liste des souverains égyptiens et des trente dynasties qui se succédèrent durant trois mille ans. Les historiens10 s'accordent à diviser l'histoire de l’Egypte, en trois empires ; l'Ancien, le Moyen et le Nouvel Empire, avec des périodes intermédiaires, qui furent suivies par la basse Epoque et la période dite « ptolémaïque ». Cependant, la chronologie et la généalogie sont affinées continuellement à la lumière des nouvelles découvertes et à l'aide de techniques de datation.
a - L’Egypte des pharaons
Originaire de l’Est, le peuple développa dans la vallée creusée par le Nil, fleuve nourricier, la civilisation égyptienne11, sur un territoire essentiellement hostile à l'homme. Cependant, le Nil, pour qu'il fût source de prospérité, devait être maîtrisé en amont et en aval. L’Egypte ne pouvait être forte et unifiée qu’avec une stabilité politique placée sous l'autorité d'un souverain absolu. Que le pouvoir s'affaiblît, et l'éclatement survenait, accompagné d'une cohorte de fléaux, invasions, misère. L'histoire de l’Egypte antique est ainsi marquée par une alternance de périodes théoriquement prospères et de périodes dites « intermédiaires » ; toutefois, prévaut la continuité.
Au Ve millénaire, apparaît la première « civilisation » identifiable, la civilisation nilotique, sur les sites de Badari et el-Amrah. Les populations chassées de l’Est par l'assèchement du climat s'étaient établies dans la vallée où une vie sociale s'organisa dans les villages. Les cultures badarienne et amratienne correspondent au développement d’un héritage agricole [culture de l'orge et du blé] et de rites funéraires. Plus tard, un autre peuple sémitique, les Guerzéens12, vint se mêler aux populations du Nil dans la région du Fayoum. La civilisation guerzéenne étendit son influence depuis la Nubie jusqu'au Delta. Elle se caractérise par l’importation de méthodes dans l’art et certaines techniques tels par exemple, la céramique peinte au trait blanc sur fond lisse rosé, des outils et des armes. Les cités qui se constituèrent dans la vallée se regroupèrent progressivement, durant la seconde moitié du IVe millénaire, en deux royaumes, celui de Bouto, en Basse-Égypte, et celui de Hiéraconpolis, en Haute-Égypte.
Namer identifié à Ménès, originaire de Hiéraconpolis, réalisa l'unification des deux régions pour incarner le « double pays », auquel il donna pour capitale This. Les recherches archéologiques portant sur les nécropoles d'Abydos et de Saqqarah permettent de penser que les deux dynasties thinites jetèrent les bases de la monarchie de droit divin et de l'administration centrale. Les terres furent mises en valeur grâce à l'irrigation.
b - L'Ancien Empire [IIIe-VIe dynasties]
Vers 2750, la capitale fut transférée à Memphis, ville nouvelle située à la jonction entre la Haute et la Basse-Égypte. L'Ancien Empire fut marqué par l'apparition d'une architecture colossale. Le roi Djoser avait pour ministre Imhotep, qui édifia, pour la première fois à Saqqarah, un tombeau royal élevé vers le ciel par sept rangées de pierres formant autant de paliers. Ce tombeau monumental avait pour fonction de préserver l'immortalité du roi, qui, après sa vie terrestre, continuait de protéger son peuple. Les noms de Kheops, Khephren et Mykérinos nous sont ainsi parvenus par les grandes pyramides de Gizeh [ou Guizèh], d’après les études des Egyptologues.
L’Ancien Empire13 affirme le pouvoir du roi, incarnation d'Horus et d’Osiris sur la terre, dont il est le maître absolu. Le Pharaon exerçait son contrôle sur le pays grâce à une administration et un despotisme dont l'importance ne cessait de croître. A partir du règne de Snefrou, le souverain fut secondé par un vizir pour la gestion des affaires du pays. Celui-ci prospéra, durant l'Ancien Empire, grâce à l'exploitation des mines du Sinaï et aux échanges commerciaux avec la Phénicie, d'où venait le bois du Liban employé dans les sarcophages. L’Egypte établi sa domination sur Chypre, la Crète ainsi que la Nubie qui fournissait l'ivoire et l'ébène.
La position prépondérante du dieu solaire Rê [Râ] s'imposa probablement vers la fin de la Ve dynastie, sous l'influence du clergé d'Héliopolis. Rê s’imposa au Panthéon et les dieux dynastiques durent accepter l’aspect solaire. Le pharaon fut désormais considéré comme le fils de Rê. L'extension territoriale et l’essor économique favorisèrent la création d'une oligarchie de hauts fonctionnaires centraux et provinciaux, dont la puissance devint une menace pour les souverains. Les nomarques, gouverneurs des nomes 14 [districts] affirmèrent leur autonomie. Les inscriptions gravées sur les murs des tombeaux royaux de la VIe dynastie attestent de l'affaiblissement du pouvoir pharaonique et de nombreuses conspirations15.
La VIIe dynastie [2400 environ à 2160 av. J.C] marqua le territoire qui se morcela. Des raids étrangers et la famine apparurent tandis que se multipliaient des mouvements de révolte, coïncidant avec la diffusion du culte d'Osiris 16 qui semble témoigner d'une aspiration populaire à l'immortalité. Sous les IXe et Xe dynasties, la monarchie ne contrôlait plus que les deux tiers du pays. Un pouvoir rival était établi en Haute-Égypte, où allait naître le Moyen Empire.
c - Le Moyen Empire [XIe-XIVe dynasties]
Mentouhotep Ier acheva la reconquête du territoire sous la XIe dynastie. Sous son règne, s'affirma la primauté du dieu thébain Amon17. La volonté de renforcer l'unité nationale s'exprima, durant la XIIe dynastie, par le compromis religieux passé avec les clergés thébain et héliopolitain, par lequel Amon s’associe à Rê. Intercesseur entre Amon-Rê et les hommes, le pharaon renforça son pouvoir en abaissant celui de la féodalité provinciale et en assurant, de son vivant, la succession au trône. Dans le même temps, l'immortalité n'était plus l'apanage du souverain. Tous pouvaient désormais y accéder, dans les limites imposées par un rituel très strict.
Les règnes des Amménémès et des Sésostris, marquèrent la naissance d’une classe intermédiaire entre le peuple et les hauts dignitaires, constituée par les scribes dont l'influence allait croissant et par les artisans. La période fut celle d'une évolution culturelle mythique [poèmes lyriques, traités magiques écrits sur papyrus, architecture, art et orfèvrerie].
L'unité égyptienne fut ébranlée par l'afflux des populations sémites d'Asie intérieure. Ces Hyksos, établis dans le nord-est du Delta, profitèrent de l'affaiblissement du pouvoir des pharaons des XIIIe et XIVe dynasties pour conquérir toute la Basse-Égypte. Ils maîtrisaient l'art de la guerre, avaient apporté en Egypte chevaux et chars. Le sud, cependant, avait résisté aux conquérants dont Amosis Ier, vers 1570 av. J.-C. les soumit et réunifia le pays.
d - Le Nouvel Empire [XVIIIe-XXe dynasties]
Le Nouvel Empire18, qui dura cinq siècles, de 1580 à 1080 av. J.C., avait pour capitale Thèbes. Ses souverains19, les Aménophis et les Ramsès portèrent à leur apogée la grandeur et la puissance de l’Egypte. Les souverains du Nouvel Empire avaient tiré les leçons de la période précédente. Ils dotèrent le pays d'une puissante armée. Pour parer à la menace que constituaient les Etats du Proche-Orient, ils menèrent une politique impérialiste [Touthmosis III conquit la Syrie vers 1472, l’Ethiopie, la Nubie]. Les territoires placés sous protectorat payaient leur tribut en contingents militaires, en esclaves pour les grands travaux et en céréales. Les Hittites refoulèrent les Egyptiens de Syrie en 1375.
Le clergé thébain prétendait à un rôle toujours plus important au sein du système politico-religieux. Le grand prêtre d'Amon devint même le second personnage de l’Etat. Aménophis IV voulut réformer la religion égyptienne. Il tenta d'abolir le culte d'Amon pour imposer la croyance en un dieu central : Aton, représentant le Soleil dans sa totalité. Il prit pour nom Akhenaton20 [celui qui plaît à Aton] et déplaça la capitale. Le culte d'Aton fut cependant abandonné vers la fin de son règne et son gendre, Toutankhamon remis la capitale à Thèbes. L’Egypte21 connut une longue période de prospérité, sous la conduite de Ramsès II qui exerça le pouvoir sept décennies. Il érigea les constructions22 de Louksor et de Karnak, ainsi que les temples creusés dans la falaise d'Abou Simbel.
Le déclin du Nouvel Empire débuta après la mort de Ramsès III, le deuxième souverain de la XXe dynastie. L’Etat, ruiné et assailli par les Assyriens et les Libyens, fut la proie de la domination du clergé d'Amon, dont Heritor, le grand prêtre prit le pouvoir en Haute-Égypte.
e - La Basse Epoque
L’Egypte23, scindée en deux entités, fut soumise durant toute la Basse Epoque aux invasions étrangères. Au nord, Smendes établit la XXIe dynastie à Tanis et au sud, régnaient les rois-pontifes issus du clergé. Les règnes des souverains de la XXVIe dynastie freinèrent plus qu'ils n'interrompirent le processus de décadence. La XXVIIe dynastie fut achéménide ; le roi de perse Cambise s'empara vers 525 de toute l’Egypte. Les Perses furent chassés, mais vers 341, le pays retourna sous domination perse.
Selon les historiens, l’hypothétique Alexandre le Grand, dont les troupes occupèrent l’Egypte [332 av. J.C] quitta le pays [331], fonda Alexandrie. Il s'assura surtout l'appui du clergé en se rendant dans le temple d'Amon, où il fit reconnaître sa filiation divine. Le pays fut gouverné par ses généraux qui désignèrent un notable surnommé Ptolémée24 comme gouverneur d’Egypte à la mort du présumé Alexandre [323]. Ptolémée se proclama roi en 305, et régna dès lors comme un pharaon.
Durant un siècle et demi, la dynastie lagide fit de l’Egypte 25 l'une des grandes puissances du monde. L'empire ptolémaïque26 dominait une grande partie de la Syrie, la Cilicie, Chypre, etc. Cependant, la richesse de l’Etat était fondée sur l'exploitation de la paysannerie égyptienne, lourdement imposée sur les produits issus de terres entièrement en possession du souverain. L'administration était aux mains des satrapes et seuls les membres des minorités perses ou juives pouvaient espérer accéder aux charges importantes. Les émeutes populaires se multiplièrent à partir du règne de Ptolémée IV27. Les révoltes prirent d'autant plus d'ampleur que les intrigues de palais fragilisaient le pouvoir. Antiochos IV [168] attaqua Alexandrie, qui allait tomber lorsqu'elle fut sauvée par une intervention romaine dont le poids de Rome dans les affaires égyptiennes ne cessa de s'alourdir. L’Egypte28 demeura une province romaine durant près de sept siècles. Source de richesses pour Rome, elle fut maintenue sous un régime d'administration proche de celui qui existait sous les Lagides. Durant la période romaine, les Egyptiens demeurèrent d'ailleurs exclus de la citoyenneté romaine jusqu'à l'édit pris par l'empereur Caracalla en 212. Les empereurs romains, afin de se concilier le clergé, protégèrent la religion ancienne, achevèrent ou embellirent les temples commencés sous les Ptolémée. Les cultes égyptiens d'Isis et de Sérapis s'étendirent dans tout le monde gréco-romain.
Dans le même temps, le christianisme se diffusa au sein de la population égyptienne, qui manifestait ainsi son opposition à l'exploitation romaine. L’Egypte chrétienne adopta sa propre langue, le copte. Le monachisme chrétien naquit dans les déserts égyptiens. Alexandrie fut le berceau de l'arianisme. Lorsque, après le partage de l'Empire romain [395], l’Egypte devint byzantine, le patriarche d'Alexandrie avait acquis une grande puissance au sein de l’Eglise chrétienne et il bénéficia du soutien du pape contre son rival de Constantinople. Saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie [412 à 444], obtint la condamnation pour hérétisme de Nestorius, patriarche de Constantinople. Mais le pouvoir du patriarcat alexandrin devenait menaçant pour la papauté elle-même.
C - La Perse
La Perse est un pays du sud-ouest de l'Asie, entre la mer Caspienne et le golfe persique, aujourd'hui appelé Iran. La Perse englobe tout le plateau iranien. Depuis longtemps, les Iraniens eux-mêmes appelaient leur pays Iran, ce qui signifie « pays des Aryens ».
2 Toute la datation qui va suivre dans ce chapitre et établie par les historiens n’est qu’une approximation parfois exagérée, parfois minimisée par certains auteurs.
3 C. L. WOOLLEY, « Les Sumériens »
4 W. R. SMITH, « The Religion of the Semites »
5 E. PITTARD, « Les Races et l’Histoire »
6 J. LUBBOCK, « The Origin of Civilization »
7 L. FEBVRE, « La Terre et l’Évolution humaine »
8 A. ERMAN, « Life in Ancient Egypt »
9 MANETHON, « Aiguptiaka »
10 G. ELLIOT, « Ancient Egyptians
11 G. MASPERO, « L’Aube de la Civilisation : « Egypte et Chaldée » »
12 G. BRUNTON & MISS G. CATON-THOMPSON, « The Badarian Civilization »
13 J.H. BREASTED, « Development of Religion and Thought in Ancient Egypt »
14Nome. Division administrative de l’ancienne Egypte
15 Pharaon Pepi Ier qui régna vers 2395-2360 av. J.C., dans laquelle était impliquée la propre femme du souverain.
16 S. REINACH, « Orpheus. Histoire générale des religions, des Origines à nos jours »
17 J. CAPART, « Thèbes, la gloire d’un grand passé »
18 E. SMITH, « Ancient Egyptians »
19 J. VANDIER, « Manuel d’Archéologie égyptienne »
20 A. WEIGALL, « Le Pharaon Akh-en-aton et son époque »
21 J. DE MORGAN, « Recherches sur les origines de l’Egypte »
22 J. CAPART, « L’Art égyptien »
23 R.P. CHARLES, « Essai sur la chronologie des civilisations prédynastiques d’Egypte »
24 A. BERTHELOT, « L’Asie ancienne d’après Ptolémée »
25 A.J. ARKELL & P.J. UCKO, « Review of Predynastic Development in the Nile Valley »
26 J.H. BREASTED, « A History of Egypt »
27 A. BORCHARDT & H. Ricke, « Egypt »
28 J.H. BREASTED, « Ancient Records of Egypt »
1 - Histoire
a - Le premier Empire
Le plateau iranien fut occupé à l’époque pré-antique par des immigrants venus du Sud-Ouest. Les Mèdes29 occupèrent vers - 1500 la partie Nord-Ouest, et les Parsa [Perses], émigrés de Parsua, un pays situé à l'Ouest du lac d'Ourmia, installés dans la partie Sud du plateau, qu'ils appelaient Parsamash ou Parsumash. Le premier chef important des Perses30 fut le chef guerrier Achemenes qui vécut vers 681 av. J.C. Les Perses furent dominés par les Mèdes jusqu'à l'accession au trône, en 558 av. J.C., de Cyrus le Grand, un Achéménide. Cyrus renversa les dirigeants mèdes, conquit le royaume de Lydie en 546 av. J.C. et celui de Babylonie en 539 av. J.C., faisant ainsi de l'Empire perse31 la première puissance de la région. Son fils et successeur, Cambyse II étendit encore le territoire en conquérant l’Egypte en 525 av. J.C. ; Darius Ier qui monta sur le trône en 521 av. J.C., recula la frontière Est jusqu'à l'Indus, fit construire un canal entre le Nil et la mer Rouge et réorganisa tout l'Empire, ce qui lui valut le surnom de Darius le Grand.
Entre 499 et 493 av. J.C., Darius écrasa une révolte des Grecs Ioniens sous contrôle perse le long des côtes ouest de l'Asie Mineure, puis lança une campagne punitive contre la Grèce pour avoir soutenu les rebelles. Selon les historiens, les Perses furent vaincus à la bataille de Marathon en 490 av. J.C. et Darius mourut, alors qu'il préparait une nouvelle expédition. Son fils et successeur Xerxès Ier tentèrent également d'envahir la Grèce mais sans résultat. Les expéditions de Xerxès furent les dernières tentatives d'envergure menées en vue d'étendre l'Empire perse. Le règne de Artaxerxès Ier, deuxième fils de Xerxès, marqua le début du déclin de l'Empire perse. Au IVe siècle, l'Empire fut déchiré par de nombreuses révoltes ; Alexandre le Grand fut vainqueur des troupes de Darius III entre 334 et 331 av. J.C. A sa mort en 323 av. J.C., ses généraux se disputèrent longuement le trône de Perse. Le vainqueur fut finalement Seleucos Ier qui, après avoir conquis le royaume de Babylone en 312 av. J.C., annexa le reste de l'ancien Empire perse jusqu'à l'Indus, ainsi que la Syrie et l'Asie Mineure. La Perse fut renversée par les Parthes au IIe siècle av. J.C.
b - Les Sassanides
En 226 de notre ère, un roi perse vassalisé, Ardacher Ier, se rebella contre les Parthes, fut victorieux à la bataille d'Ormuz [224] et fonda une nouvelle dynastie perse, les Sassanides32. Il conquit les royaumes voisins, envahit l'Inde dont les chefs du Panjab payèrent un lourd tribut et conquit l'Arménie. Il fit du zoroastrisme la religion officielle de la Perse.
Son fils Shahpuhr Ier remplaça Ardacher en 240 et livra deux guerres à l'Empire romain, conquérant des territoires en Mésopotamie et en Syrie ainsi qu'une grande partie de l'Asie Mineure. Le souverain perdit ses conquêtes entre 260 et 263 au profit de Odenah, un prince de Palmyre allié à Rome. La guerre avec Rome fut relancée par Narses dont l'armée fut anéantie par les troupes romaines en 297. Narses conclut un traité de paix qui déplaçait la frontière occidentale de la Perse de l'Euphrate au Tigre, et la Perse perdit d'autres territoires. Shahpuhr II monarque de 309 à 379 récupéra les territoires perdus en trois guerres victorieuses contre les Romains.
Yazdgard Ier régna en paix de 399 à 420. Bien qu'ayant, dans un premier temps, octroyé la liberté de culte aux Perses chrétiens et pendant quatre ans les persécuta sans pitié. Son fils et successeur, Bahram V poursuivit cette persécution et déclara la guerre à Rome en 420. Les Romains battirent Bahram en 422 et promettaient dans le traité de paix la tolérance des zoroastristes dans tout l'Empire à condition que les chrétiens bénéficient d'un traitement similaire en Perse. En 424, les Perses chrétiens proclamèrent leur indépendance de l’Eglise occidentale.
A la fin du Ve siècle, les troupes barbares des Hephtalites ou Huns attaquèrent la Perse, battirent le roi Firuz II en 483 et levèrent un lourd tribut pendant quelques années. La même année, le nestorianisme devint la doctrine officielle des Perses chrétiens. Kavadh Ier favorisa les enseignements de Mazdak [Ve siècle], un grand prêtre zoroastrien qui chercha la mise en commun de terres. Il mena deux guerres infructueuses contre Rome et, en 523, cessa de défendre Mazdak et ordonna le massacre de ses adeptes.
Le fils et successeur du souverain, Khosro Ier Anocharvan réussit ses guerres contre l'empereur byzantin Justinien Ier et étendit son pouvoir jusqu'à la mer Noire et au Caucase, devenant ainsi le plus puissant de tous les rois sassanides. Il marqua la réforme de l'administration de l'Empire et rétablit le zoroastrisme comme religion d'Etat. Son petit-fils Khosro II Abharvez entrepris des guerres contre l'Empire byzantin en 602 et avait, en 616, conquis la plupart des territoires du sud-ouest de l'Asie Mineure et d’Egypte. Sous le règne du dernier des rois sassanides Yazdgard III [632-641], les Arabes envahirent la Perse, brisèrent toute résistance, remplacèrent progressivement le zoroastrisme par l'Islam et intégrèrent la Perse dans le khālīfa.
29 J. DENIKER, « Les races et les peuples de la Terre »
30 G. MASPERO, « Le Déclin des Empires »
31 T.J. ARNE, « The Swedish Archaeological Expedition to Iran »
32 J.H. BREASTED, « The Conquest of Civilization »
D - La Mésopotamie
La Mésopotamie33 [en grec, « le pays entre les deux fleuves »], considérée comme l'un des hauts lieux de la civilisation urbaine, correspondant à l'Irak et à la Syrie actuels, entre le Tigre et l’Euphrate. Le Tigre et l'Euphrate se trouvent à environ 400 km l'un de l'autre lorsqu'ils quittent la Turquie vers le sud. L'Euphrate coule sur 1 300 km et le Tigre sur 885 km avant de se rejoindre, pour se jeter dans le Chatt al-Arab. Les vallées et les plaines de Mésopotamie, irriguées par les deux fleuves et leurs affluents, sont encadrées par les montagnes, au nord et à l'est ; le désert d'Arabie et la steppe de Syrie, à l'ouest.
La richesse naturelle de la Mésopotamie34 a toujours présenté un grand attrait pour les habitants des régions voisines plus pauvres, ce qui atteste pourquoi son histoire est faite de migrations et d'invasions continuelles. Les précipitations sont peu abondantes dans la région, mais l'utilisation de canaux pour irriguer le sol fertile permet d'obtenir des récoltes abondantes. La culture des dattiers dans le sud procure en abondance de la nourriture, des fibres, du bois et du fourrage. Les deux fleuves contiennent du poisson, et les marais du Sud une faune sauvage.
1 - Premiers Etats mésopotamiens
Le besoin de protection et d'irrigation incita les anciens Mésopotamiens35 à s'organiser et à construire des canaux et des sites protégés par de hautes murailles. Il est établi qu’après 6000 av. J.C., les sites grandirent, devenant des villes au IVe millénaire av. J.C. Le premier site de la région est probablement Eridu, mais le plus bel exemple est Uruk [Erech de la Bible] dans le Sud, où des temples en briques de torchis étaient décorés de plaques de métal façonné et de sculptures en pierre. Le développement d'une administration favorisa également l’essor de l'écriture, cunéiforme. Les Sumériens36 héritèrent de cette culture urbaine précoce qui s'étendit vers le nord en remontant l'Euphrate. Les autres sites importants de Sumer furent, entre autres, Adab, Kish, Nippur, El-Obeid et Ur.
La région fut conquise aux environs de 2330 av. J.C. par les Akkadiens, une peuplade sémitique de Mésopotamie centrale. La dynastie d'Akkad fut fondée par le roi Sargon Ier dit le Grand [de 2335 à 2279 av. J.C.] et l'assyrien se mis à supplanter le sumérien. Une tribu des montagnes de l'Est, les Goutéens, met fin à la souveraineté akkadienne en 2218 av. J.C. La IIIe dynastie d'Ur37 de tradition sumérienne gouverna la majeure partie de la Mésopotamie. Vers 2000 av. J.C., des envahisseurs venus du royaume septentrional d'Elam anéantirent la cité d'Ur. Sous leur domination aucune cité ne prospéra sur les autres avant le milieu du XVIIIe siècle av. J.C., quand Hammourabi38 de Babylone unifia le pays à la fin de son règne. Les Amorites prirent le pouvoir à Babylone et à Assur. Les Hittites39 conduisirent des incursions en 1595 av. J.C. contre Babylone qui passa peu après sous la domination des Kassites. Babylone connut la prospérité pendant quatre siècles. Ses rois furent les égaux des pharaons d’Egypte et sa population commerçait intensément. Assur passa au Mitanni, un Etat fondé par des Hourrites venus du Caucase et qui s’installèrent en Mésopotamie depuis des siècles ; ils se répandirent en grand nombre après 1700 av. J.C dans tout le nord et en Anatolie.
a - Empires assyrien et chaldéen
Le royaume mésopotamien40 septentrional d'Assyrie s'affirma vers 1350 av. J.C. par deux siècles d’expansion. Ses armées battirent le Mitanni, s'emparèrent un temps de Babylone [1225 av. J.C.] et atteignirent la Méditerranée [1100 av. J.C.]. Les tribus araméennes du désert de Syrie et, à l'aide de tribus chaldéennes, mirent fin à cet impérialisme et envahirent Babylone. L'Assyrie41 reprit ses conquêtes [730-650 av. J.C.]. L'Empire assyrien était maître du Moyen-Orient, de l’Egypte au golfe arabo-persique. Les régions conquises furent sous protectorats et administrées par des rois vassaux ou, en cas de troubles, annexées.
Les révoltés nombreux étaient déportés à travers l'empire. Les fréquentes rebellions exigeaient une machine de guerre puissante, mais elle ne pouvait soumettre longtemps un royaume aussi vaste. Des pressions internes, des guerres intestines et des attaques menées par les peuplades de Médie et les Chaldéens à Babylone chutèrent l'Assyrie 42 en 612 av. J.C. Le pays montagneux était acquis aux Mèdes, tandis que la Mésopotamie aux Chaldéens de Nabuchodonosor II43. La Mésopotamie était sous le règne des Chaldéens jusqu'en 539 av. J.C., jusqu'à ce que Cyrus le Grand, de Perse, qui avait conquis la Médie, s’empare de Babylone.
33 L. DELAPORTE, « La Mésopoptamie et Civilisation chaldéo-assyrienne »
34 A. PARROT, « Protohistoire mésopotamienne »
35 A. VARAGNAC, « L’Homme avant l’écriture »
36 R. LABAT, « La Mésopotamie in Histoire générale des sciences »
37 L. WOOLEY, « Ur en Chaldée »
38 G. CONTENAU, « Préface des Tablettes babyloniennes de E. CHIERA »
39 G. CONTENAU, « La civilisation des Hittites et des Hurrites du Mitanni »
40 V. GORDON-CHILDE, « L’aube de la civilisation européenne »
41 G. MASPERO, « La Lutte des Nations : Egypte, Syrie et Assyrie »
42 A.T. OLMSTEAD, « History of Assyria »
43 G.R. TABOUIS, Nabuchodonosor »
b - Domination perse
La Mésopotamie44 fut divisée sous le règne des Perses entre les satrapes de Babylone et d'Assur45. L'araméen très répandu, fut adopté comme la langue commune et la mise en place d'un gouvernement impérial stabilisa la région. En se montrant trop oppressif, le régime provoqua le déclin de la prospérité de la Mésopotamie. La conquête éphémère de l'Asie Mineure par Alexandre le Grand46 [331 av. J.C.] établit la dynastie de Seleucos Ier en Mésopotamie. Des cités furent fondées telle Seleucie du Tigre qui fut la plus importante. Vers 250 av. J.C., les Arsacides ravirent la Mésopotamie aux Séleucides et organisèrent leur empire de manière à développer plusieurs Etats vassaux autonomes. Après avoir repoussé des attaques romaines, les Arsacides furent vaincus [226 av. J.C.] devant les Sassanides de Perse, dont l'empire s'étendait de l'Euphrate à l'actuel Afghanistan. Ils constituèrent un gouvernement bureaucratique efficace basé sur des fonctionnaires hiérarchisés et développèrent l'irrigation et le drainage. Des conflits éclatèrent dans les régions du Nord-Ouest avec la province romaine de Syrie, qui fut annexée plus tard à l'Empire byzantin [395]. La frontière du désert entraîna la destruction de l'Empire sassanide en 635 par les musulmans [égyptiens, assyriens, mésopotamiens, etc.], qui amenèrent avec eux la religion islamique.
E - La Chine
La Chine est un pays d'Asie orientale bordée au nord par la Mongolie et la Russie, au nord-est par la Russie et la Corée du Nord, à l'est par la mer Jaune et la mer de Chine orientale ; au sud par la mer de Chine méridionale, le Viêt-Nam, le Laos, la Birmanie, l'Inde, le Bhoutan et le Népal ; puis à l'ouest par le Pakistan, l'Afghanistan et le Tadjikistan, et enfin, au nord-ouest par le Kirghizistan et le Kazakhstan. La Chine comporte plus de 3 400 îles, dont Hainan, en mer de Chine méridionale, est la plus importante.
La superficie totale du pays est d'environ 9 571 300 km2. La Chine possède une grande diversité de paysages de ressources naturelles. Les reliefs les plus hauts se situent dans la partie occidentale où se trouvent des chaînes montagneuses les plus hautes du monde. Les montagnes occupent environ 43 % de la surface, les plateaux montagneux 26% et les bassins, accidentés sont situés principalement dans les régions arides, environ 19%. Les plaines n'occupent que 12 % du territoire.
44 G. ELLIOT, « Human History »
45 G. CONTENAU, « La Civilisation d’Assur et de Babylone »
46 J. WIESNER, « L’Orient ancien. Histoire de l’Art »
1 - Grandes régions géographiques
La Chine peut être divisée en six régions naturelles d'une grande diversité géomorphologique et topographique.
La Chine du Nord-Ouest est une région aride ou désertique, qui comprend deux bassins Djoungarie au nord et Tarim au sud. Le bassin du Tarim contient l'immense désert de sable du Taklamakan, qui est le désert le plus sec de toute l'Asie. Le bassin de Djoungarie constitué de zones sableuses ou rocailleuses, désertiques ; elle est surtout une région de steppes propice à une agriculture irriguée.
La Chine du Nord-Est correspond à la Mandchourie, au massif du Grand Hinggan qui se prolonge à l'ouest par les collines du Re-he offre des ports naturels. Au centre de cet ensemble se situent les plaines de Mandchourie et les hautes terres qui la bordent. Ces plaines [350 000 km2] ont des sols fertiles, sols noirs de prairie dans le centre, tchernoziom au nord de Harbin. La taïga est le paysage végétal dominant, cédant la place à la steppe arborée sur les bas versants. Changbai shan, est un ensemble de massifs qui séparent les plaines du nord-est de la Corée. C'est une région à la végétation riche et variée, peuplée par des agriculteurs coréens qui ont essaimés dans les vallées [Mudan jiang, Tumen jiang et Yalu jiang].
La Chine du Nord comprend plusieurs secteurs géographiques distincts. La région est aménagée en terrasses et cultivée dans sa plus grande partie. La Grande Plaine du nord, qui correspond à la plus grande plaine de la Chine présente des sols fertiles : loess sensibles à l'érosion et limons apportés par les fleuves. A l'est, les hautes terres de la péninsule du Shandong comprennent deux zones montagneuses qui culminent à 1 532 m au Tai shan, l'une des montagnes sacrées de la Chine.
La Chine du Sud comprend la vallée du Chang Jiang qui est une suite de bassins aux sols alluviaux fertiles. Ces terres basses sont coupées de cours d'eau naturels et artificiels et parsemées de lacs, comme dans le Hubei. C'est une région de riziculture. Les plateaux de la Chine du Sud s'étendent du plateau du Tibet à l'ouest jusqu'à la mer à l'est. Les nombreux autres fleuves de la région constituent des vallées alluviales fertiles. Le large delta du Zhu Jiang est appelé delta de Canton.
2 - Hydrographie
La Chine possède cinq mille fleuves et rivières, dont l'aire de drainage est supérieure à 100 km2 et 95 000 km de voies navigables. La quasi totalité du réseau est soumise à la mousson, ce qui pose des problèmes d'utilisation de l'eau. Des fleuves importants coulent vers le Pacifique et vers l'océan indien.
3 - Climat
La Chine recouvre plusieurs aires climatiques en raison de sa superficie, avec une constante : le monde chinois appartient à l'Asie des moussons. En hiver, l'anticyclone de Sibérie centrale amène des vents froids et secs qui refroidissent toutes les régions au nord du Chang Jiang et assèchent la plus grande partie du pays. En été, les masses d'air chaud et humide en provenance du Pacifique parcourent l'intérieur des terres et amènent des précipitations sous forme de cyclones.
4 - Histoire
Les témoignages de la préhistoire sont encore rares mais l’Homme indique sa présence en Chine47 entre le dixième et le quinzième millénaire. C'est par étapes que les peuples de langue et de culture chinoises se fixèrent sur le territoire de l'actuelle Chine. On retrouve des traces selon certains auteurs vers le VIIe millénaire av. J.C. avec la riziculture et la domestication du buffle qui étaient acquises et des sociétés agricoles se développaient dans le bassin du Huang He. La culture du Yangshao et la culture de Longshan dont la chronologie ne peut être établie est localisée respectivement dans l'ouest [Gansu, Shaanxi, Henan, etc.], et à l'est [Henan, Hebei, Shandong, etc.] de la Chine. Elles sont connues toutes deux par des céramiques 48. La tradition chinoise indique que des souverains légendaires, tel Pangu, régnèrent sur la Chine49, faisant place par la suite à des dynasties semi-mythiques, celle des Xia [2205-1767 ou 1989-1558] dans le Shanxi, ensuite celle des Shang, où l'écriture se développa.
a - Les premières dynasties
La dynastie Shang50 [1766-1027 av. J.C.] régna sur les provinces actuelles du Henan, de Hubei, de Shandong ainsi que le nord de l'Anhui. L'économie était agricole : le mil, le blé, l'orge et le riz. Des armes, des outils et de la vaisselle de bronze ont été retrouvés, montrant l'existence d'une métallurgie. La Chine des Shang était une société fondée sur une noblesse d'épée que le roi gouvernait. Les seigneurs tenaient du roi leurs provinces et se devaient de l'assister dans ses entreprises militaires. Entre cette classe noble et le peuple, des lettrés dirigeaient l'administration, le gouvernement et pratiquaient la divination. Les rois Shang rendaient un culte à leurs ancêtres royaux et à une multitude de dieux, dont le principal était Shangdi, le Seigneur « d'en-haut ».
La dynastie Zhou, au XIe siècle, succéda aux Shang. Les nouveaux dirigeants qui étaient originaires de la vallée de la Wei étendirent leur domination à la moitié Nord de la Chine. L'étendue du royaume et l'état primitif des communications ne permettaient pas aux Zhou d'exercer et de centraliser leur pouvoir. Au Xe siècle des mutations d'ordre social et politique se mirent en place. Le pouvoir royal ne joua plus qu'un rôle d'arbitre entre des principautés que contrôlait une noblesse héréditaire. La société Zhou restait une société rurale. La répartition de la terre se faisait en parcelles, carrées divisées neuf fois pour former une grille équilatérale. Les huit parcelles extérieures étaient attribuées à huit familles paysannes, qui unifiaient leurs efforts et leurs ressources pour cultiver la parcelle centrale, dont la récolte était destinée à la noblesse. Il fut considéré par les dynasties qui suivirent comme le mode de répartition le plus juste des terres arables. Les pratiques religieuses reflétaient la hiérarchie du système social. Les Zhou croyaient que le ciel accordait au souverain un mandat lui conférant son autorité politique. Les rois Zhou offraient des sacrifices au Seigneur « d'en-haut », dont le nom était devenu Tian [« Ciel »], ainsi qu'à leurs ancêtres.
Les souverains Zhou gardèrent le contrôle effectif de leur territoire jusqu'en 770 av. J.C., quand, chassés par des tribus non chinoises, ils établirent une nouvelle capitale dans l'Est, à Luoyang [Henan]. Ainsi, protégés des attaques barbares, les Zhou orientaux n’exercèrent plus une grande autorité politique ou militaire sur les Etats vassaux, dont bon nombre s'étaient agrandis au point de devenir plus puissants qu'eux. Détenteurs du mandat du ciel, les Zhou continuèrent à investir les seigneurs du pouvoir de gouverner leurs terres et demeurèrent ainsi souverains en titre jusqu'au IIIe siècle av. J.C.
L'intégration économique permit aux souverains locaux de contrôler de plus grandes étendues de territoire. Les Etats, situés aux marges du monde chinois, s'étendirent aux dépens de leurs voisins non chinois, et profitèrent de cette expansion pour enrichir et diversifier leur propre culture. Avec le déclin de l'autorité politique de la dynastie Zhou et l'émergence de nouveaux Etats à la périphérie de la Chine, les relations devinrent de plus en plus instables. A la fin du Ve siècle av. J.C., la Chine des Zhou fut plongée dans une période de guerre continue entre les Etats, c’est la période des Royaumes combattants [403-221 av. J.C.].
Le premier et de loin le plus influent des philosophes de cette période est Kongfuzi, connu sous le nom de Confucius51. Il représentait la classe naissante des gestionnaires et des conseillers de cour dont l'aristocratie au pouvoir avait besoin pour mieux affronter les problèmes complexes d'administration intérieure et de relations inter-Etats. Confucius proposait essentiellement une restauration des institutions sociales et politiques des premiers Zhou. Il pensait que les sages souverains de cette période avaient œuvré à créer une société idéale par l’exemple de leur vertu personnelle. Pour cette raison, il cherchait à créer une classe de gentilshommes vertueux et cultivés pouvant prendre en charge les fonctions les plus hautes du gouvernement et diriger le peuple en se donnant en exemple.
Les « Légistes » [Shang Yang, Li Si et Han Fei], partisans d'une centralisation poussée à l'extrême entendaient substituer aux coutumes et aux droits hérités du passé une réglementation pénale uniforme pour chaque aspect de l'activité humaine. Ils souhaitaient l’établissement d'un Etat puissant et riche, avec une autorité incontestée du souverain. Ils demandaient la socialisation du capital, l'établissement de monopoles d'Etat et d'autres mesures économiques destinées à enrichir l’Etat ; renforcer sa puissance militaire et centraliser le pouvoir administratif. A l'opposé des moralistes confucéens et des légistes se situaient les taoïstes. Pour Lao-Tseu 52 [Laozi] le fondateur taoïste, chaque progrès technique ne pouvait être qu'une étape de plus dans la perte des vertus naturelles de l'homme et toute institution un progrès de l'asservissement de l'être humain.
b - Naissance de l'empire
La dynastie Qin53 [221-206 av. J.C.] dont le roi Qin se proclama Qin Shi Huangdi, ou « premier empereur de la dynastie Qin