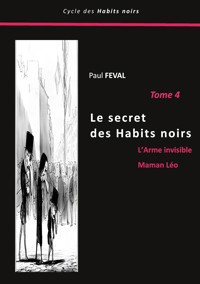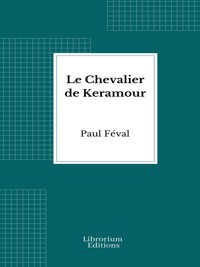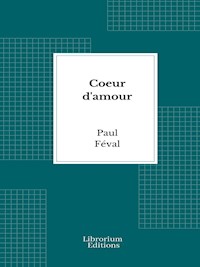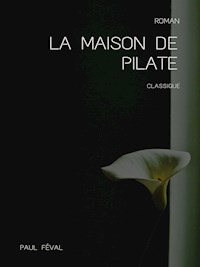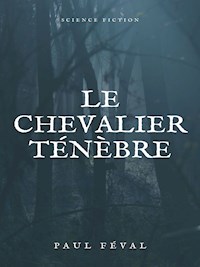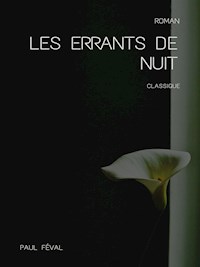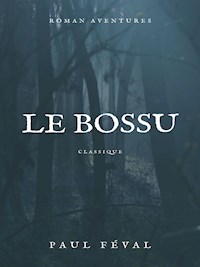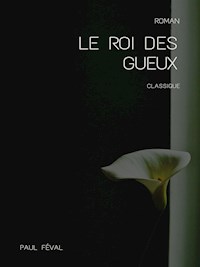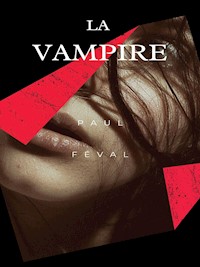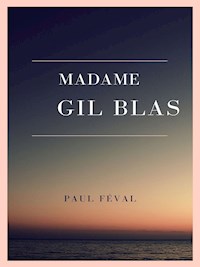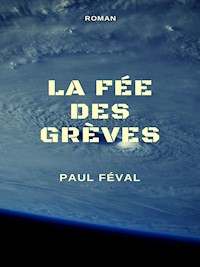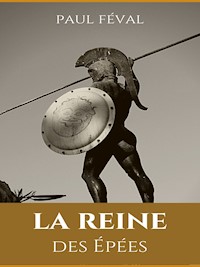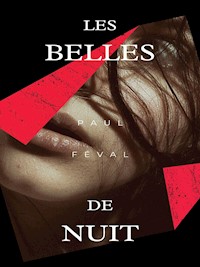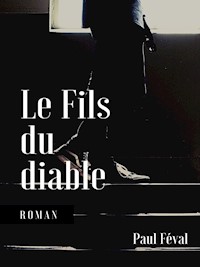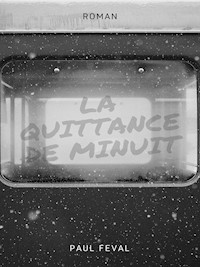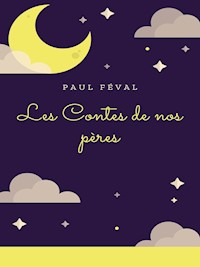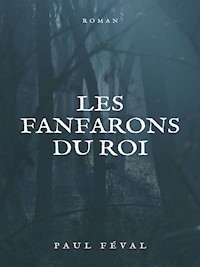0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
J’avais un frère aîné qui était un saint ici-bas. Il marchait doux et ferme dans la vie. Dieu lui avait donné d’amères tristesses. Il adorait la volonté de Dieu. Que de fois pourtant je vis sa tête, chauve avant l’âge, s’incliner sous le poids des découragements mystérieux !
J’étais enfant lorsqu’il pensait déjà, c’est-à-dire, hélas ! alors qu’il souffrait. Je m’étonnais de voir la gaîté vive succéder en lui brusquement à de longs silences où son regard distrait s’était baigné dans le vide. Il riait de si grand cœur ! Un homme peut-il être triste et gai ? heureux et à la fois malheureux ? Pauvre frère ! ami si cher ! la mort l’a pris et je ne l’ai pas vu à sa dernière heure.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Paul Féval
L’HOMME DE FER
© 2025 Librorium Editions
ISBN : 9782385748609
Tables des Matières
LA CHATELAINE
I LA RANCE
II LA QUINTAINE
III FIER-À-BRAS L’ARAIGNOIRE
IV LE DÎNER
V OÙ FIER-À-BRAS L’ARAIGNOIRE TIENT LE DÉ DE LA CONVERSATION
VI OÙ FIER-À-BRAS CONTINUE D’ÊTRE UN NAIN D’IMPORTANCE
VII L’ÉGLISE ET LE CIMETIÈRE
VIII COMPÈRE GILLOT
IX CHARLES ET ANNE
X COMME QUOI FRÈRE BRUNO TROUVA DES NOMS MACÉDONIENS POUR LE CHIEN DU JOUEUR DE FLÛTE ET DIFFÉRENTS AUTRES PERSONNAGES
XI OÙ LE NAIN SIFFLE MIEUX QU’UN MERLE
XII OÙ FIER-À-BRAS SE MONTRE GOURMAND
XIII OÙ LE FAUX PIERRE GILLOT CONFESSE QU’IL N’EST PAS UN VÉRITABLE OLIVIER LE DAIN
À LA PLUS BELLE
XIV LE LOGIS DE BERTHE
XV À LA PLUS BELLE !
XVI RIVALES
XVII LA CAVALCADE
XVIII LA FÊTE
XIX OÙ L’ON COMMENCE À TIRER LA GRENOUILLE
XX OÙ L’ON CONTINUE À TIRER LA GRENOUILLE
XXI OÙ L’ON ACHÈVE DE TIRER LA GRENOUILLE
XXII MESSIRE OLIVIER
XXIII TEUFELGAU
XXIV LE SEIGNEUR DES ÎLES
XXV L’INCENDIE
XXVI LE RENDEZ-VOUS
XXVII LE LUTIN
LA CITÉ FANTÔME
XXVIII DEUX JEUNES FILLES
XXIX LE RÉVEIL
XXX LA PROMENADE
XXXI CONSEIL DUCAL
XXXII CONSEIL ROYAL
XXXIII LA SALIÈRE DU ROI
XXXIV OÙ LE FAUCON DE DAME JOSÈPHE MONTRE QU’ON PEUT FAILLIR À TOUT ÂGE
XXXV AVANT LA PASSE D’ARMES
XXXVI COURONNE PARTAGÉE
XXXVII COMMENT FINIT LA PASSE D’ARMES DE SAINT-SULPICE
XXXVIII LA COURSE
XXXIX FRÈRE TOURIER
XXXX PORTE OUVERTE
XXXXI LES CHEVALIERS DE SAINT-MICHEL
XXXXII LE CAVEAU
XXXXIII L’ERMITE
XXXXIV L’ÉCHAFAUD
LA CHATELAINE
ILA RANCE
J’avais un frère aîné qui était un saint ici-bas. Il marchait doux et ferme dans la vie. Dieu lui avait donné d’amères tristesses. Il adorait la volonté de Dieu. Que de fois pourtant je vis sa tête, chauve avant l’âge, s’incliner sous le poids des découragements mystérieux !
J’étais enfant lorsqu’il pensait déjà, c’est-à-dire, hélas ! alors qu’il souffrait. Je m’étonnais de voir la gaîté vive succéder en lui brusquement à de longs silences où son regard distrait s’était baigné dans le vide. Il riait de si grand cœur ! Un homme peut-il être triste et gai ? heureux et à la fois malheureux ? Pauvre frère ! ami si cher ! la mort l’a pris et je ne l’ai pas vu à sa dernière heure.
Je vins, une nuit d’hiver, à Saint-Malo, la ville lugubre et parcimonieuse où pas une goutte d’huile{1} n’est dépensée à éclairer le passant qui s’égare : je vins, cherchant dans les ténèbres la maison de mon frère. Jadis, quand j’arrivais, savais-je si la ville avare et marchande était ou non éclairée ?mon frère était là qui m’attendait et qui me conduisait au logis.
Cette fois personne !
Et je pense que j’étais complice du hasard qui m’égarait dans les rues. Je fuyais d’instinct la maison où il n’était plus.
Oh ! notre mère en larmes, mes sœurs pâles et les pauvres enfants habillés de deuil ! Dans le salon, quand on me vit, ce fut un grand gémissement.
Auguste, notre pauvre ami ! notre frère bien-aimé ! l’honneur et la joie de la famille !... Ma mère m’embrassa et me montra le Ciel.
Sur les bords de la Rance, la rivière enchantée, nous allions tous deux bien souvent. C’était un marcheur intrépide. Il aimait la grande route, et je ne le vis jamais si heureux que les matinées de voyage, quand nous tournions le dos à Saint-Malo, ce lourd paquet de maisons marchandes où manquent l’eau douce et l’air libre.
La Rance et les grèves du mont Saint-Michel, la route de Châteauneuf et la digue de Dol, c’étaient ses amours. Quand il était là, tête nue, les souliers poudreux, la sueur au front, il revivait. Sa gaîté revenait toute jeune.
Ces pages, inspirées par les lieux qu’il aimait : les belles rives de la Rance, le splendide horizon des grèves ; ces pages où passeront les impressions qui nous étaient communes, sont à lui plus qu’à moi.
C’est pour cela que son nom chéri est tombé malgré moi de ma plume sur la première de ces pages.
La rivière de Rance à sa source vers le bourg de Saint-Jacut-en-Terre, dans les Côtes-du-Nord. Au-dessus de Dinan, ce n’est guère qu’un ruisseau. Au-dessous de Dinan, elle s’élargit brusquement. À la plaine de Saint-Suliac, elle devient si grande, que la Loire et la Seine passeraient ensemble dans son lit sans trop se coudoyer.
Il est vrai de dire que la plaine de Saint-Suliac est déjà plutôt une grève qu’une rivière, car la marée s’y fait sentir comme en rade.
À mer haute, c’est un beau lac entouré de collines harmonieuses, et dont les vagues viennent baigner les baies blanches du rivage. Du côté de l’IIle-et-Vilaine, la rive s’encaisse et se festonne, creusant au fleuve des réduits profonds que surplombent les falaises rocheuses.
Il n’est pas rare de trouver sous ces hautes murailles calcaires des habitations, grises comme la coquille d’une huître, qui se collent au roc, derrière l’abri d’une petite jetée en pierres sèches. On ne les aperçoit point des bords de la falaise, mais le feu de tourbe et de bois charrié qui brûle lentement dans l’âtre envoie sa noire fumée et révèle l’existence de ces amphibies humains.
Çà et là un moulin, aménagé pour tourner aux flux et retourner au reflux, chante ses trois notes plaintives. Dans le petit parc marneux qui l’entoure, des oies fouillent la fange et laissent leurs restes aux canards, ces parias de la race palmipède.
Au milieu de la rivière, il y a une île verte habitée par les alouettes de mer. Cette île, jolie comme une jolie page de Bernardin de Saint-Pierre, donne raison à la poésie du XVIIIe siècle. Néanmoins il y manque les chers peupliers, la grotte et le tombeau d’un sage, ami de l’être suprême, mais ne connaissant pas le bon Dieu.
De nos jours, cette belle et sereine rivière est sillonnée de mille embarcations. Les gabares des riverains, sortes de barges à quille non pontées, mettent leur voile brune au vent dès qu’il y a une corde de bois, trois douzaines d’œufs et un couple de poulets à la ferme. Les bateaux de plaisance louvoient et jouent ; les barques de pêcheurs traînent le lourd chalut au fond de l’eau ; enfin, par un gai soleil, le paquebot le Dinannais déroule les longs anneaux de sa fumée sombre ou bleue, agite ses deux nageoires dans l’écume, et glisse, rapide comme une flèche, emportant pleine cargaison d’Anglais ennuyés. Là-bas, à l’arrière, voici miss Anna, la poétique enfant, qui trempe son quatorzième biscuit dans son huitième verre de madère. Encore préfère-t-elle le sherry, cette diaphane et frêle créature !
Au temps où va se passer notre récit, il n’y avait sur la Rance ni bateaux à vapeur, ni Anglais. Quant à miss Anna, elle n’était pas encore poitrinaire. Miss anna n’est poitrinaire que depuis l’époque où John Jonhson deJohnson-House, son daddy, (papa) a cessé de labourer la terre ou de porter la balle, pour gagner une douzaine de millions à fabriquer des petits couteaux.
John Johnson, esq., sa fille Anna, son fils sir John Johnson, M. P. lady Bridget Johnson, femme de sir John, et l’honorable Johnnie Johnson, leur enfant de quatre ans, tout cela sent le Strand à plein nez, le Strand moderne, le gaz, la houille, la vapeur, l’apoplexie, le thé-panacée, le caoutchouc, le spleen, ‘horrible odeur de Londres au XIXe siècle.
La Rance est la rivière des Anglais. Depuis Saint-Servan jusqu’à Dinan, vous ne voyez que blancs cottages où Johnson, esq., Davidson, esq., Stevenson, esq., Anderson, esq., etc., engraissent, rougissent et dorment auprès de miss Anna, qui maigrit et pâlit.
J’ai vu inscrit sur la porte d’un cabaret ce brutal témoignage de la conquête : INGLICHE SPAUQUIRE(English spoken here).
Miss Anna donne des bibles presbytériennes aux petits enfants. John Johnson, esq., a appris au postillon de Châteauneuf ces contorsions bizarres de l’écuyer anglais qui semble souffrir de la colique incurable. Lady Margaret Fitfullikankrie, du château de Screw, auprès de Clackgmannan, trouvant ce nom de Châteauneuf trop difficile à prononcer, l’appelle Tchêtiouniou, et sourit comme savent sourire les Anglaises qui avaient toutes leurs dents lors de la jeunesse du dieu Wellington.
La Rance est une rivière perdue.
En !469, la Rance était une rivière bretonne de la source à l’embouchure. Elle était aussi belle qu’aujourd’hui, avec les grandes forêts de ses coteaux, les manoirs sombres, demi-cachés derrière les chênes et les flottilles qui glissaient au reflux pour approvisionner le marché de Saint-Malo.
Le manoir du Roz était situé à l’extrême sommet de la montagne qui suit immédiatement Châteauneuf dans la petite chaîne formant comme l’arête des côtes bretonnes. Cette colline est plus haute que celle de Châteauneuf. Sa croupe méridionale descend à la Rance. Du côté du nord-est, son autre pente ondule au loin et va rejoindre le marais de Dol, au-dessus de la mare Saint-Coulman.
Au XVe siècle, depuis le sommet de la montagne jusqu’au pays plat, c’était comme une forêt, tant les arbres de haute venue abondaient alentour. Le manoir s’élevait au centre d’une esplanade découverte, terrain de lande, formant une pelouse maigre et rase comme un tapis.
Le manoir était une grande maison de structure irrégulière, basse d’étage, avec des toits énormes. Le corps de logis se flanquait de deux ailes inégales, dont l’angle rentrant était armé de deux tourillons symétriques, placés comme des gonds à l’articulation d’une porte. Trois autres petites tours, une à droite, deux à gauche, terminaient la saillie des ailes.
Cette disposition pittoresque et en quelque sorte fanfaronne, exagérait, de loin, l’importance du manoir du Roz, et lui donnait une physionomie de place forte. Mais, en réalité, à part les murs de la cour et les meurtrières de parades percées aux flancs des tourillons, il n’y avait aucun moyen de défense. L’esplanade, presque circulaire, était fermée par une haie de houx taillés qui valait trois fois la meilleure des grilles. Elle s’étendait surtout vers le nord, ou son plan fléchissait en une sorte de ravin pierreux et nu.
De ce côté, au-delà de houx robustes qui formaient la haie centenaire, c’était un pêle-mêle d’arbres de toute taille et de toutes essences, venus là comme le hasard les avait semés. Le pin agitait ses branches poilues au vent vif de la rivière, entre les chênes tordus et les magnifiques châtaigniers. Le hêtre arrondissait ses attaches fermes, dont les contours réveillent l’idée de la beauté humaine, parmi les troncs flexibles des frênes. L’écorce blanche des bouleaux tranchait çà et là dans l’ombre. Le tremble frissonnait comme un vieillard frileux dont les cheveux grisonnent. Le charme au feuillage opulent cachait ses branches cagneuses sous sa verdure et jetait un brillant manteau de feuillée sous ses pousses difformes. Tout cela était riche, vigoureux, prodigue.
En tournant vers l’est, on trouvait des guérets qui descendaient du vallon de Châteauneuf. Au sud, une autre forêt, coupée de champs et de prairies, étageait ses groupes d’arbres qui se détachaient vivement et semblaient bondir sur la pente. À l’ouest, enfin, s’étendait la lande montueuse où passe maintenant la route de Saint-Malo.
La vue était libre aux quatre aires de vent. Rien ne la bornait, sinon la ligne lointaine et parfaitement circulaire de l’horizon, ce qui est rare en Bretagne, où les aspects tendent partout à se concentrer. On voyait le cours de la Rance avec ses îles riantes et la dentelle capricieuse de ses rives ; on voyait Dinan, la ville charmante, et Châteauneuf, le site qui n’a pas son pareil à dix lieues à la ronde. Saint-Jouan des Guérets montrait à l’opposite sa flèche lourde. Du côté du Marais on découvrait Saint-Méloir des Ondes, l’Islemer, Dol, Pleines-Fougères, vingt autres bourgs et villages, le profil de Cancale, et, à perte de vue, derrière les vapeurs légères, le fantôme voilé du mont Saint-Michel.
En cette année !469, François II régnait en Bretagne, Louis XI gouvernait la France, Édouard IV tenait le trône d’Angleterre, et Charles le Téméraire avait succédé depuis deux ans à son père Philippe, duc de Bourgogne. Il y avait huit ans que Louis XI était roi : les premiers obstacles de son règne glorieux à force d’être laborieux étaient surmontés. Louis XI avait brisé la ligue du Bien public ; Louis XI était sorti sain et sauf du château de Péronne, où la lourde main du Bourguignon avait pesé un instant sur son épaule ; Louis XI avait réduit à l’obéissance le duc de Berry, le comte de Charolais et le duc de Bourbon ; Dunois, vieillard, cherchait un refuge à la cour de Bretagne ; Édouard IV, payé, restait en paix ; la Castille et l’Aragon envoyaient à Paris des gages d’alliance ; l’Allemagne, occupée à ses discordes intestines, restait neutre.
Louis XI respirait. Son repos n’était pas un sommeil. Louis XI, en reprenant haleine, taillait de la besogne à ses voisins. Il regardait à l’est la Bourgogne, à l’ouest la Bretagne, deux nobles contrées, et il se disait :« Tout cela est à moi, parce que tout cela est la France ».
Le duc de Bourgogne était un prince de méchante humeur, qui rendait trois coups de massue pour un coup de gaule : Louis XI le laissa de côté jusqu’à voir ; François de Bretagne, au contraire, avait un tempérament pacifique, Louis XI se tourna un matin vers le Mont Saint-Michel, cette abbaye-forteresse qui domine la côte de Bretagne ; il se souvint à propos d’une grande dévotion qu’il gardait depuis son enfance à l’archange vainqueur du dragon, et d’un vœu qu’il avait pu faire autrefois.
Il dit à maître le Dain, son barbier, au château du Plessis, où il faisait sa résidence :
— Je partirai demain pour le pays normand. La renommée affirme qu’on voit chaque année cent mille pèlerins agenouillés devant l’image de saint Michel archange ; le roi de France en veut grossir le nombre.
Le roi de France voulait surtout regarder de plus près la Bretagne. Le roi de France avait aussi l’idée de placer sous l’invocation de saint Michel son nouvel ordre de chevalerie, une machine de guerre qu’il avait inventée pour serrer le mors aux vassaux trop fougueux.
Laissons le roi Louis XI quitter les bords enchantés de la Loire et chevaucher le long des guérets normands. Allons l’attendre en Bretagne, en ce bon manoir du Roz, qui avait une si belle vue et qui faisait face au mont Saint-Michel.
C’était au mois d’août. Le cadran solaire aux lignes presque effacées, qui présentait son triangle pointu au midi du manoir, marquait dix heures. Au beau milieu de l’esplanade se dressait une quintaine ou mannequin de bois, tournant sur un pivot. Cette quintaine figurait grossièrement un Anglais qui tenait à la main un fort bâton de cormier. Le bois du mannequin était lourd et massif ; le pivot, fraîchement huilé, jouait le mieux du monde, en sorte que le moindre effort faisait tourner la quintaine, qui lançait à l’aveugle de beaux coups de bâton.
Deux cavaliers étaient là qui s’escrimaient contre elle : un soldat qui avait atteint l’âge viril, et un adolescent dont la lèvre s’ombrageait à peine de ce duvet follet, précurseur de la moustache.
L’adolescent était gracieux de visage et de corps. Sa taille souple et un peu frêle ondulait aux bonds du généreux cheval de guerre qu’il montait. Il portait déjà l’armure comme il faut ; des bords de son casque s’échappait une abondante chevelure brune à reflets châtains ; ses grands yeux bleus pétillaient d’audace et de gaieté.
L’homme d’armes qui semblait diriger ses exercices était remarquablement beau ; il paraissait avoir trente et quelques années ; son teint était brun, ses cheveux blonds, presque aussi épais que ceux de l’enfant, se frisaient en boucles plus courtes. Une moustache blonde aussi et fine comme de la soie rabattait ses deux longues mèches en passant par-dessus la mentonnière du casque.
Quand l’or efféminé de ces molles chevelures encadre un visage mâle bruni par le soleil des batailles, c’est un effet imprévu, un contraste étrange : cela produit une beauté riche et fière qui fait rêver aux récits chevaleresques. Grave et un peu triste qu’elle était, la figure de l’homme d’armes exprimait une franchise naïve, une bonté sans bornes et cette simplicité loyale qui accompagne, bien plutôt qu’elle n’exclut la véritable intelligence.
Il était plus grand que l’adolescent. Sous l’armure, tous ses mouvements avaient une si merveilleuse aisance, que le fer de ses brassards semblait élastique et doux comme la moelleuse étoffe du vêtement des châtelaines. Il s’asseyait d’aplomb sur son robuste cheval, trouvant la grâce sans la chercher, et offrant à son insu, peut-être, le plus admirable type de ces superbes combattants que le canon naissant et déjà vainqueur allait réduire à l’impuissance.
Les exercices de l’adolescent et de l’homme d’armes avaient deux spectateurs, quatre spectateurs, dirions-nous, s’il est permis d’appliquer ce substantif à de nobles animaux comme Ferragus et Dame-Loyse, lévriers de race.
Ferragus et Dame-Loyse gambadaient sur le tertre, le lévrier était fauve, avec une croix blanche entre les deux oreilles : la levrette était noire, sans tache ; elle avait un père illustre, Maître-Loys, lévrier noir du pays de Saint-Brieuc, qui avait fait autrefois l’admiration de la cour de Bretagne.
Les deux autres spectateurs, ou mieux spectatrices, n’étaient point sur l’esplanade. À la façade du château qui regardait cette partie du tertre et que le soleil ne frappait point encore, on voyait deux fenêtres ouvertes. À chacune de ces fenêtres une femme se tenait.
La posture d’une femme n’est jamais un détail indifférent. C’est en général quelque chose d’éloquent, à ce point que dix pages d’explications n’en pourraient dire si long qu’un simple croquis. La première et la plus âgée de ces femmes était franchement accoudée sur le petit balcon de fer qui défendait la croisée principale ; celle-là n’avait rien à cacher. Mais l’autre femme, femme tout au plus, enfant plutôt, et jolie ! se reculait dans l’ombre de son embrasure et donnait toute son attention à une belle broderie de liane à fils d’or, qu’elle avait sur le métier.
La dame du balcon était jeune encore et charmante : un visage doux, fier et mélancolique; mais les cheveux abondants qui tombaient en bandeaux renflés à la berthe, le long de ses joues un peu amaigries, étaient tout blancs. On disait que les beaux cheveux de madame Reine avaient ainsi blanchi en une seule nuit, la nuit où elle reçut la nouvelle de la mort de messire Aubry de Kergariou, son chevalier.
La jeune fille à la broderie avait au contraire des cheveux de jais sur un front blanc comme le col des cygnes.
Madame Reine contemplait l’adolescent de tous ses yeux et souriait de ce sourire à la fois triste et heureux des mères veuves.
Jeannine, la gentille brunette, s’occupait bien sagement de sa broderie, et c’était d’un œil sournois et malin qu’elle regardait le bel adolescent chevauchant sur la pelouse.
IILA QUINTAINE
L’homme d’armes et son élève avaient déjà fait nombre de passes, car les cheveux de l’adolescent étaient baignés de sueur.
— Allons, messire Aubry, dit l’homme d’armes, voici madame Reine qui vous regarde ! N’avez-vous point de honte ? vous n’avez touché l’Anglais que deux fois… encore l’Anglais vous a-t-il appliqué deux bons coups de gaule !
Messire Aubry rougit un peu. Il envoya de la main un baiser tendre et respectueux à sa mère, qui lui souriait et qui était trop loin pour entendre ce que l’homme d’armes disait à voix basse.
Jeannine, la brunette, devint toute rose.
Je ne sais comment le baiser respectueux et tendre s’était divisé en chemin, mais Jeannine la brunette baissa vivement sa jolie tête sur sa broderie, comme si elle en eût reçu la moitié.
— Mon ami Jeannin, répliqua Aubry d’un ton presque aussi obéissant que s’il eût parlé à son père, quand vous aviez dix-huit ans, vous valiez déjà mieux que moi, j’en ferais la gageure ; mais vous ne portiez pas la lance comme aujourd’hui. J’ai idée, d’ailleurs, que si ce coquin était un Anglais de chair et d’os, je serais moins maladroit de beaucoup.
Ils revenaient au pas, côte à côte, pour prendre du champ. Jeannin, l’homme d’armes, se prit à rire.
— Quand j’avais dix-huit ans, messire Aubry, dit-il, je ne portais point de lance. J’avais un long bâton avec une corne de bœuf au bout pour pêcher dans les sables du mont Saint-Michel. Au lieu de cuirasse, j’avais une peau de mouton pelée et un petit bissac : on disait que j’étais plus poltron que les poules !... et je ne devins brave que le jour où Simonnette, ma femme, qui est une sainte au paradis maintenant, me dit : Jeannin, je t’aimerai si tu deviens un homme de cœur !
À la dérobée, messire Aubry jeta un regard vers la fenêtre où était la brodeuse.
— Donc, ajouta Jeannin sérieusement, ne vous réglez pas sur moi qui suis un vassal, mon jeune sire ; vous avez d’autres exemples à suivre. À dix-huit ans, le chevalier Aubry de Kergariou, votre cher et digne père, était déjà la meilleure lance de Porhoët : voilà ce qu’il ne faut point oublier.
La figure du jeune homme se rembrunit. Il fit volte-face brusquement au bout de la carrière et mit sa lance en arrêt.
— Gronde-moi, Jeannin, gronde-moi, murmura-t-il ; je suis un homme par la taille et j’ai des bras d’enfant ! II faudra bien pourtant que mon père soit vengé !
Ses talons s’écartèrent pour piquer. Jeannin l’arrêta.
— Messire, dit-il, vous avez le cœur et le bras d’un gentilhomme ; mais Dieu vous a donné un pauvre instituteur.
— Qui ? toi, Jeannin ? s’écria Aubry en le regardant avec ses yeux brillants ; un pauvre instituteur ! Sur mon Dieu ! Je t’ai vu à la besogne, ami, et je ne connais pas un chevalier, tu m’entends bien, un chevalier ! que je voulusse prendre pour maître à ta place !
Il parlait avec chaleur.
— Ta main, mon ami Jeannin ! reprit-il. Gronde-moi va, gronde-moi, mais ne me dis plus que j’ai en toi un pauvre instituteur, car je me fâcherais !
L’homme d’armes serra avec émotion la main qu’on lui tendait.
Aux fenêtres, madame Reine et la fillette aux cheveux noirs regardaient curieusement cette scène. Madame Reine agita son mouchoir.
— Ferme sur les étriers ! commanda Jeannin ; tenez la lance lâche jusqu’à ce qu’elle ait pris l’équilibre, et serrez au moment de l’attaque. Faites bien attention que le coup baisse toujours et tourne en dehors par le mouvement de la hanche. Visez au col pour la poitrine et au sein gauche pour le creux de l’estomac… Allez, messire !
Aubry piqua des deux. Pendant que son cheval prenait le galop, madame Reine souriait et l’admirait ; car il avait, en vérité, belle mine. Jeannine avait quitté sa broderie et se haussait un peu pour mieux voir.
Aubry avait la lance couchée, la tête inclinée sur la crinière de son cheval, la main gauche à la bride, les jambes roidies sur les étriers.
— Allez ! allez ! criait Jeannin qui suivait au trot ; préparez-vous à volter, car vous allez manquer votre coup !
— Et pourquoi manquerait-il son coup, le cher enfant ? se disait madame Reine. Jeannin est trop sévère !
L’Anglais va lui donner un maître coup de gaule ! pensait la brunette. Pauvre messire Aubry !
La quintaine renversait légèrement son pivot en arrière, afin de rendre possible ce beau coup de lance, qui consistait à enlever le mannequin à la course et à le jeter hors des gonds comme un chevalier désarçonné. Cette inclinaison faisait que les coups de bâton portaient généralement à la tête du coureur ; le casque, en ces occasions, n’était pas inutile.
Sur la peinture sombre du mannequin, une ligne blanche était tracée qui partait du front, suivait le nez et descendait jusqu’au bas du torse en coupant partout le centre de gravité. Si la lance du coureur touchait cette ligne blanche, le mannequin restait immobile. Mais si la lance portait à droite ou à gauche de la ligne, le mannequin virait tout naturellement avec d’autant plus de force que le coup s’écartait davantage de la ligne et pesait sur un levier plus long.
Au dernier commandement de Jeannin, Aubry retint la bride d’instinct et trop tôt. Son cheval obéit au mors et dévia. La lance d’Aubry vint frapper la quintaine en dedans. La quintaine vira, et la gaule sonna sur l’acier de son casque.
Aubry chancela, tout étourdi, tant le coup était bien appliqué.
— Es-tu blessé ? cria madame Reine qui trembla.
La brunette reprit sa broderie en haussant les épaules. Aubry la vit et ce fut un grand crève-cœur, car il devint tout pâle.
— Non, non, ma mère, répondit-il, je ne suis pas blessé. Ce n’est pas le coup de bâton de l’Anglais qui m’a fait le plus de mal !
— Qu’est-ce donc, enfant ? dit madame Reine.
Aubry ne répondit pas cette fois. Son regard rencontra l’œil noir de Jeannine qui se levait sur lui furtif et repentant.
— Allons ! messire ! s’écria l’homme d’armes ; prenez du champ et fournissez une autre course !
Aubry était piqué vivement. Il lui fallait sa revanche. Certes, son grand désir de toucher juste lui venait en partie de la présence de sa mère. Mais une bonne moitié de ce désir, soyons franc, les trois quarts et peut-être un peu plus, se rapportaient à la gentille brodeuse.
Une moqueuse pourtant, qui avait haussé les épaules sans pitié !
Une sournoise, qui se cachait, pour rire, derrière l’épais rideau de laine drapé au coin de la croisée !
Oh ! que messire Aubry la détestait !
— Jeannin, mon ami, dit madame Reine à sa fenêtre, songez je vous prie, que mon fils relève des fièvres, et ne le fatiguez pas.
— Je suis à vos ordres, noble dame, répliqua l’homme d’armes en saluant ; quand vous me direz : Assez ! nous finirons.
— Eh ! Jeannin, mon ami ! s’écria la châtelaine avec un mouvement d’impatience, nous savons bien que vous ne donnez point ces leçons à messire Aubry pour votre plaisir !
Jeannin la regarda étonné.
— Vous vous trompez, noble dame, dit-il avec respect ; c’est bien pour mon plaisir que je suis à cheval auprès du fils de mon maître !
Il salua une seconde fois et rejoignit l’adolescent qui était déjà loin.
Madame Reine était toute pensive.
Reine de Maurever, veuve de messire Aubry de Kergariou, chevalier, seigneur du Roz, de l’Aumône et de Saint-Jean des Grèves, n’était point une tête légère tournant à tous vents et ne pouvant donner aux petits mystères de sa conduite d’autre explication que sa fantaisie. C’était un excellent et digne cœur. Elle avait été le modèle des épouses ; elle était la meilleure des mères.
Dix-huit ans auparavant, au temps où le duc François de Bretagne expiait par la mort le meurtre de son frère Gilles, Reine de Maurever avait au front tout ce que la poésie et la beauté peuvent mettre de couronnes. La jeunesse de Reine avait été un roman hardi et pieux ; son père et son fiancé, proscrits tous deux, lui avaient dû tous deux leur salut. Elle allait, dans ce temps, aimante et bien-aimée, du cachot où languissait son fiancé au rocher désert où le vieux chevalier Hue de Maurever avait faim. Les bonnes gens du mont, la voyant seule contre tous braver la mer, les sables mouvants des tangues et les hommes d’armes qui faisaient la chasse humaine avec des lévriers cruels, les bonnes gens disaient qu’elle glissait, la nuit, sur un rayon de lune, comme la Fée des Grèves, dont ils lui avaient donné le nom.
Reine avait alors seize ans, elle était plus vaillante encore que jolie.
Plus tard, elle devint dame de Kergariou, et quel charme nouveau lui apporta le sourire des jeunes mères !
Maintenant, le fils de Reine porte la lance. Reine est jeune encore ; elle est toujours jolie, et cette neige légère qui couronne son front sans rides adoucit l’azur foncé de ses yeux. Est-ce bien cependant la Reine d’autrefois ?
On dit que dans les pays du soleil certains arbres portent en même temps leur fleur naissante et leur fruit mûr, mais rien de pareil ne se voit en notre Bretagne. On y est fleur ou fruit.
Quand Reine eut suivi un instant de l’œil la retraite de Jeannin, le beau et vaillant soldat, son regard se tourna rapide, presque méchant, vers la partie de la façade où s’ouvrait cette seconde croisée, la croisée de la brodeuse aux yeux noirs.
On ne la voyait nullement, la gentille Jeannine. Elle était bien cachée pour madame Reine. Mais madame Reine la devinait à travers l’épaisse saillie de pierre. Et les sourcils délicats de madame Reine se fronçaient malgré elle, parce que le fils unique du chevalier Aubry ne pouvait pas épouser une vassale.
Voilà pourquoi Mme Reine avait parfois des mouvements d’impatience lorsqu’elle parlait à ce bon, à ce loyal, à ce brave Jeannin.
Jeannin, qui s’appelait alors le petit Jeannin, pêcheur de coques dans les sables, avait été le bras droit de Reine au temps où elle était la Fée des Grèves, Jeannin avait aidé messire Aubry de Kergariou, le père, à vivre et à mourir. Depuis lors, Jeannin veillait sur l’orphelin comme une seconde providence. Mme Reine savait tout cela ; elle n’était point ingrate. Elle aimait Jeannin ; elle aimait aussi Jeannine, la gentille fillette. Mais elle était mère et vous ne trouverez point de femme qui garde ce facile cœur de seize ans après sa trentième année.
Saurait-on, cependant, assez excuser et chérir ces femmes esclaves de leur admirable devoir, qui sont mères jusqu’au bout des ongles et s’isolent dans l’égoïsme du sentiment maternel ? Nous les suivons dans la vie, d’un œil attendri ; elles ont en effet tout oublié, excepté la grande passion de la famille ; elles sont mortes au moi humain, pour s’incarner en autrui ; elles veillent, exagérant le zèle, prenant tout caillou pour une montagne, toute fondrière pour un abîme, au-devant des pas de l’enfant trop aimé.
Ne sont-elles pas, ces femmes, ces mères, l’expression la plus touchante de la providence de Dieu ?
Seulement la pauvre Jeannine n’en pouvait mais. II faut être juste envers chacun. Avoir seize ans n’est pas non plus un crime.
Ces mères veuves, à qui la mort a imposé la plus sérieuse de toutes les responsabilités, dépassent le but parfois. Jeannine n’était pas cause d’être belle.
Ce que Mme Reine avait deviné par la puissance de sa seconde vue maternelle, Jeannine n’en savait trop rien. Messire Aubry ne s’en doutait guère non plus.
Et Jeannin, ce bon Jeannin, le plus innocent de tous, et le plus malmené par Mme Reine, Jeannin fût tombé de son haut si on lui en avait dit seulement le premier mot !
Le vrai, c’est que les mères sont sorcières !
Cette fois, messire Aubry, notre jeune gentilhomme, se disait en prenant du champ :
— Scélérat d’Anglais ! tu vas voir si je te manque !
Le sourire moqueur de Jeannine ! chose terrible ! et l’effroi humiliant de Mme Reine ! Le traitait-on assez comme un enfant ! On avait peur pour lui du bâton du mannequin !
— C’est la main gauche qui a fait des siennes, messire Aubry, dit Jeannin avec douceur ; il ne faut jamais serrer la bride au dernier moment... Si Mlle Berthe de Maurever, votre noble cousine, vient au manoir, comme on le dit, elle voudra voir votre adresse…
— Ah par exemple ! s’écria Aubry, je m’embarrasse bien de mademoiselle Berthe de Maurever !
Jeannin sourit malignement.
— C’était donc le soleil qui vous faisait rougir l’autre matin, quand nous passions sous ses balcons, en la ville de Dol, messire Aubry ?
Bon Jeannin ! ce n’était pas le soleil, non. Mais vis-à-vis de l’hôtel habité par messire Morin de Maurever et sa fille Berthe, il y avait une boutique de mercière, tenue par dame Fanchon le Priol. Dame Fanchon le Priol était la grand’mère de Jeannine, qui allait la voir de temps en temps. Ce jour-là, Jeannine avait été voir dame Fanchon le Priol, et Aubry avait aperçu la gentille brunette à travers les carreaux de la boutique.
Madame Reine savait bien, elle, que si son fils Aubry, pâlissait ou rougissait parfois à l’improviste, Berthe de Maurever ni le soleil n’avaient rien à faire là-dedans. Elle eût donné beaucoup pour qu’il n’en fût point ainsi.
— J’ai fait bien des lieues à pied et a cheval dans notre Bretagne, reprit Jeannin, mais je n’ai vu nulle part une demoiselle qui soit plus noble et plus avenante que Berthe de Maurever. À votre âge, il est permis de chérir sa dame. Ne vous défendez point : personne ne songe à vous blâmer.
Aubry fit présent d’un double coup d’éperon à son beau cheval. Le cheval piqué à l’improviste, bondit sur place, puis se lança. Ferragus et Dame-Loyse, éveillés tout à coup par ce mouvement, au milieu de leurs ébats paresseux, détalèrent à la suite du cheval. On eût dit, à voir cette course soudainement précitée, que le jeu s’était changé en furieuse bataille.
Par le fait, le choc fut rude, mais la victoire demeura encore au scélérat d’Anglais. Messire Aubry qui, sans doute, était un peu distrait par la réflexion inopportune du bon Jeannin, donna de sa lance à tour de bras dans l’épaule gauche de la quintaine, qui vira et lui rendit par derrière un coup de bâton généreux. Si généreux, qu’Aubry passa par-dessus la tête de son cheval et mordit la poussière.
Mme Reine joignit les mains ; sa voix s’arrêta dans son gosier. Jeannine laissa tomber sa broderie et poussa un cri de terreur.
Derrière la haie de houx, un éclat de rire aigre se fit entendre et une voix qui n’avait rien d’humain lança joyeusement ces mots :
— Voilà messire Aubry qui s’est cassé le cou !... ah ! ah ! ah !
En même temps, parmi le vert sombre du feuillage, une figure étrange se montra presque au ras de terre.
IIIFIER-À-BRAS L’ARAIGNOIRE
Le bizarre personnage qui avait semblé applaudir à la chute de messire Aubry ne montrait encore que sa tête. Sa tête seule était assez remarquable pour mériter une description particulière.
Il faut se figurer une boule parfaitement ronde dans laquelle on aurait sculpté mollement un visage, suivant les règles élémentaires et naïves qui servent aux enfants pour dessiner sur leurs cerfs-volants monsieur le Soleil ou madame la Lune. Le nez ne saillait point. La bouche était une fente droite. Les yeux, à fleur de crâne, ressemblaient aux deux moitiés d’une fève. Les sourcils, fauves et très touffus, étaient plantés sur le front.
De nos jours, quand une maison se bâtit et que les murailles encore humides étalent au soleil la splendeur sans tache de leur plâtre tout neuf, Panotet, gamin de Paris, vient avec un charbon. La blanche robe de l’édifice adolescent a une tache. Panotet, ami des arts, trace un profil caricatural et muni d’une pipe sous lequel il écrit le nom d’un ennemi qu’il a, et puis il s’en va, léger de cœur, à ses affaires.
Cet étrange visage qui se montrait dans la haie de houx, ressemblait aux œuvres de Panotet. Seulement, le personnage à qui appartenaient ces rudiments de traits n’avait pas de pipe. On n’avait encore inventé que la poudre.
Sa chevelure était la partie la plus importante de son individu. À cette chevelure il devait probablement ce sobriquet de l’Araignoire, qui s’ajoutait à son surnom de Fier-à-Bras.
Le mot araignoire ne se trouve point dans le dictionnaire de l’Académie. Il désigne !a brosse hémisphérique et emmanchée de long, à l’aide de laquelle on détruit les toiles d’araignée. Fier-à-Bras était une araignoire emmanchée de court.
Le poil qui couvrait sa tête ronde était dru, roide, crépu, rouge comme du feu. Cette nuance ardente faisait ressortir la pâleur bouffie de sa face, qu’on aurait prise pour une ébauche mal réussie et jetée au rebut.
Et pourtant, sur cette pauvre face qui semblait être un oubli du Créateur ou une raillerie du hasard, il y avait de l’intelligence, bien plus, de la volonté. Dans quel trait résidait l’éclair latent qui donnait la lumière à ces difformités ? on ne savait. Mais la lumière était là.
La tête rouge de Fier-à-Bras s’agita comme si son torse, embarrassé dans la haie, eût fait effort pour en sortir. Ce torse devait être celui d’un géant, si on en jugeait d’après le volume de la tête chevelue. Mais Fier-à-bras était véritablement un être fantastique. Sa tête, que nous avons montrée au ras de terre, se trouvait là dans sa position naturelle et normale. Fier-à-Bras était un nain de l’espèce la plus exiguë. Il n’avait que trois pieds de haut.
Son costume était celui d’un gentilhomme. Il portait les couleurs de Coëtquen, son seigneur, et un petit écusson, brodé sur son pourpoint, donnait ses propres armoiries, qui étaient d’or au dindon de gueules.
Comme on voit, Fier-à-Bras était dans les idées de Louis XI, roi de France. Il se moquait volontiers de la noblesse.
Et vraiment on le laissait faire, en ce pays de Bretagne, où la noblesse fut toujours si grande et si respectée. Pourquoi empêcher les nains de rire ?
— En quel siècle voulut-on comprendre que le rire des nains est justement la chose qui tue ?
Si toute grandeur a sa décadence en ce monde, si tout est menacé tour à tour, c’est que les nains rient. Chaque fois que les nains rient, quelque grande chose tombe.
Fier-à-Bras l’Araignoire sortit de la haie au moment où le jeune sire Aubry de Kergariou touchait rudement le sol. Il se secoua et rajusta son costume, dérangé par les piquants du houx.
— Hé! hé! dit-il, j’arrive bien. Ce gentilhomme de bois vaut mieux qu’un fils de preux en chair et en os, à ce qu’il paraît. Bonjour, Ferragus ! bonjour, Dame-Loyse !... bonjour, les autres !
Les autres, c’étaient Mme Reine de Kergariou, Aubry, Jeannin et Jeannine. Fier-à-Bras ne daignait nommer que les chiens.
Jeannin lui fit un signe de tête amical. Mme Reine, rassurée sur le sort d’Aubry, lui envoya gaiement le bonjour, et Aubry lui-même inclina sa lance en cérémonie.
S’il restait quelque inquiétude à Mme Reine, cette inquiétude n’avait plus trait à la chute de son fils. Une petite voix, bien douce pourtant, lui demeurait dans l’oreille comme la piqûre importune d’un insecte. Quand elle avait crié, un autre cri de frayeur avait répondu au sien. Jeannine était là ; Reine le savait.
Soit malice, soit étourderie, le nain se chargea d’envenimer la piqûre.
— Comme vous voilà pâlotte ce matin, derrière votre rideau, ma belle demoiselle Jeannine ! s’écria-t-il, messire Aubry, dites-lui donc que vous n’avez pas eu de mal !
Le jeune homme rougit ; Jeannine détourna la tête. Reine se mordit la lèvre.
Jeannin eut un bon rire franc et naïf.
— Tiens ! tiens ! dit-il ; tu étais là, toi, fillette ?
— Eh bien ! ajouta-t-il en se tournant vers Aubry ; représentez-vous à la place de Jeannine qui n’est point de conséquence, votre belle cousine, Berthe de Maurever, et voyez quelle figure vous auriez faite, messire !
Cette fois Jeannine baissa la tête et Aubry regarda son ami Jeannin de travers.
Mme Reine se disait, l’excellente mère et la femme injuste :
— Voyez comme ce Jeannin cache son jeu !
Le brave homme d’armes ne cachait assurément rien du tout.
— Qu’avons-nous donc ? reprit Fier-à-Bras jouissant de l’embarras qu’il avait fait naître ; sommes-nous à l’enterrement ? II n’y a de gaillard ici que moi et messire l’Anglais… Soyez tranquille, Kergariou, avant qu’il soit un mois vous coucherez votre lance devant des quintaines de chair et d’os, car le roi de France est en colère !
— Tu sais des nouvelles, enfant ? demanda vivement Mme Reine.
II faut vous dire que Fier-à-bras avait bien une quarantaine d’années. Mais, ceci est encore un trait de caractère, Mme Reine, la charmante femme, ne riait jamais et s’entourait d’un haut rempart de dignité un peu empesée. Appeler le nain Fier-à-Bras ou l’Araignoire, c’eût été déroger à sa gravité, c’eût été presque rire.
Mme Reine avait si grande frayeur de tomber dans le péché de frivolité, que l’ennui suintait autour d’elle comme l’humidité glacée aux parois d’une cave. Elle appelait cela tenir son rang.
La chose terrible, il faudra bien vous le dire une fois ou l’autre, la chose terrible, c’est que Jeannin, le pauvre bon Jeannin, était beau comme Apollon. Mme Reine avait des yeux, des yeux charmants, même sous ses cheveux blanchis en nuit de torture.
Des yeux perçants surtout, des yeux jaloux ! Elle regardait sans cesse autour d’elle pour voir si quelqu’un pouvait éclipser son fils Aubry.
Or, Jeannin était trop beau ; il faisait tort à messire Aubry. Auprès de Jeannin, messire Aubry ne brillait pas assez. Qui ne connaît la coquetterie des mères ?
D’un autre côté, ce Jeannin avait une fille qui était aussi trop belle pour le repos et l’intérêt du même messire Aubry, vous sentez que cela devenait intolérable !
Encore, si on avait pu se débarrasser de ce Jeannin et de sa fille ! Mais ce Jeannin, derrière sa douce modestie, était un homme important dans le pays. Plus d’un chevalier eût envié l’estime où le tenait François II, duc de Bretagne. D’ailleurs, c’était un si vieil ami ! Jeannin avait vu naître l’héritier de Kergariou, Jeannin avait eu le dernier soupir de messire Aubry, qui avait laissé autrefois à sa garde Mme Reine et son enfant.
Jeannin aimait Mme Reine à la fois comme sa suzeraine et comme sa sœur. Pour elle et pour l’héritier de Kergariou, il eût donné mille fois sa vie. S’il avait su que sa fille était un danger pour Aubry, il eût pris sa fille en croupe et se fût enfui avec elle au bout du monde.
Mme Reine ne voulait pas voir cela. Elle se défiait. Elle était mécontente d’elle-même et mécontente d’autrui. II lui fallait des victimes.
— Oh ! oh ! dit le nain, vous me demandez des nouvelles, noble dame ? II est bientôt onze heures et j’aimerais mieux dîner… Des nouvelles ! saint Jésus ! Il en manque bien des nouvelles ! Ne savez-vous pas que le mangeur d’enfants a volé les deux filles d’Haynet Beaulieu, du bourg de la Rive ?
— Est-il possible ! s’écria Mme Reine : deux pauvres anges qui n’avaient pas dix ans !
Jeannine avait quitté sa broderie pour écouter. Le nain s’était approché jusque sous le balcon où s’accoudait la châtelaine.
— Dix ans, onze ans, ça va jusqu’à douze ans, reprit-il ; mais il enlève aussi les demoiselles de dix-huit ans, ajouta-t-il tout à coup en se tournant vers la fenêtre de Jeannine ; c’est un ogre à marier… gare à celles qu’il épouse !
— L’as-tu vu, toi, enfant, ce monstre abominable ? demanda Mme Reine.
— Oui, oui, répliqua le nain ; c’est un beau cavalier… grand et fort, qui est noble comme vous et moi. Il a nom le comte Otto Béringhem ; il est venu d’Allemagne avec les pèlerins du mont. Si je connais l’Homme de Fer ! Dieu merci ! je connais tout le monde !... Holà ! reprit-il en s’interrompant, voilà maître Jeannin qui va montrer à messire Aubry comment on pique un Anglais de droit fil ! Voyez, voyez. noble dame, quel homme d’armes fait ce Jeannin ! Vous iriez à Paris, la grande ville, avant de trouver son pareil !
Mme Reine fronça le sourcil et tourna la tête.
Jeannin avait pris, en effet, du champ et venait au galop sur la quintaine. Il était incliné sur le garrot de son cheval, et tenait sa lance de manière a frapper le mannequin de bas en haut, afin de faire ce beau coup qui consistait à enlever l’Anglais, le Sarrasin, ou tout autre coquin de son pivot et à le lancer sur le sable.
Messire Aubry suivait, attentif.
Fier-à-bras avait raison, il était impossible de voir un cavalier plus parfait que Jeannin : force, grâce, adresse tout était en lui. Son corps souple suivait les mouvements du cheval, comme si les quatre jambes du vigoureux destrier eussent été la base naturelle de ce torse harmonieux et robuste.
Le vent de la course prenait ses cheveux blonds, dont les anneaux se jouaient sur l’acier étincelant du casque.
Mme Reine avait la tête tournée en sens inverse, mais, néanmoins, elle voyait tout cela. Personne n’ignore que le regard des dames se moque de toutes les lois de l’optique. Mme Reine haussa les épaules.
En ce moment, la lance de Jeannin toucha la quintaine sous le menton, juste au centre de gravité, l’enleva à dix pieds du sol et la jeta au loin.
— Bravo ! cria Fier-à-Bras.
— Bravo ! cria Aubry.
Jeannine frappa ses deux petites mains blanches l’une contre l’autre.
— Merci Dieu ! dit Mme Reine avec impatience ; voici un bel exploit, maître Jeannin ! Vous sied-il bien à votre âge de faire montre de votre force pour humilier mon pauvre fils Aubry !
Jeannin ne répliqua point, mais il changea de visage.
Fier-à-Bras leva sa houssine, et se prit à fustiger d’importance l’Anglais renversé.
— Tiens, scélérat, tiens ! s’écria-t-il ; tiens ! tiens ! tiens !... tiens encore !
Il frappait à tour de bras et de si grand cœur qu’il en perdait haleine. Il s’arrêta quand le souffle lui manqua tout à fait, et dit en essuyant son front baigné de sueur :
— Maugrebleu ! voilà comme nous sommes, moi et Mme Reine ! Nous frappons sur les gens qui ne nous le rendent point !
IVLE DÎNER
Fier-à-Bras l’Araignoire était un nabot de beaucoup d’esprit. En frappant l’Anglais à terre, il faisait la critique sanglante des colères folles de Mme Reine. Mais Jeannin ne l’entendait point, le pauvre Jeannin. Il se désolait de tout son cœur et se disait comme toujours :
Qu’ai-je donc fait à Mme Reine pour qu’elle me déteste ainsi maintenant.
Et il ne se révoltait pas plus que l’Anglais de bois contre les coups de houssine de Fier-à-Bras.
Le cadran solaire marquait onze heures. Dans la campagne, derrière les futaies et parmi les clairières qui descendaient à la Rance, on entendit des huchées. Les routes montant au manoir s’emplirent de bestiaux et de pastours. C’était une belle et bonne terre que le Roz. À l’heure du dîner il y avait bien trente gars et servantes autour de la table de la cuisine.
La cloche tinta. Le nain fit une pirouette à cet appel de bon augure.
Au nord, au sud, à l’orient, au couchant, ces refrains monotones et mélancoliques qui se ressemblent tous et qui sont comme l’éternelle chanson de la campagne bretonne, se répondaient et alternaient. C’était un concert. Tantôt le vent mêlait tous les couplets ; tantôt une voix rauque et gémissante s’élevait en solo parmi le mugissement des vaches grasses et le bêlement des brebis qui faisaient orchestre.
Pelo le bouvier chantait à tue-tête :
Perrine, ma Perrine,
Lon li lan la,
La deri deri dera !
Perrine, ma Perrine,
Où sont tes veaux allés ?
Où sont tes veaux allés ? (bis)
Y sont dans la grand’prée,
Lon li lan la,
La deri deri dera...
Et la petite Jouanne, qui gardait les oies, lui répondait en fausset suraigu :
L’mien en bel équipaige
Venait me voir au jour
O’ tous ses biaux atours.
Si les chiens du villaige
No l’auriont point connu,
L’auriont, ma fâ, mordu !
Qu’il a d’un’ chemisettte
Marquetée d’au pougnais,
D’un vestaquin d’drougnais,
Des ganaches grisettes,
Gilet o’ des ribans,
Li pendant par davant{2}.
À quoi Mathelin, le pasteur des gorets, répliquait, racontant ses premières aventures :
Da, mâ, d’auprès ed’ma cocotte
J’tas point bâ!ant
Je li faisâs de toute sorte
De qu’mpl mens,
Sapergouenne !
Je li faisâs de toute sorte
De qu’mpl mens !
Je li parlas de nos chairettes
Et de nos bœufs
Et j’li jurâs que nos poulettes
Pôna’nt des œufs,
Sapergouenne{3} ! etc.
Tous ces chants, dont les paroles sont si moqueuses, si gaies, se disent sur des airs modulés en mineur, rythmés selon la coupe lente et triste, particulière à la Bretagne, et finissent sur une cadence pleurarde, toujours la même.
Peu à peu bestiaux et valets envahirent la plate-forme. Les valets venaient prendre leur repas ; les bestiaux allaient passer les heures du grand soleil à l’étable.
Les maîtres étaient déjà dans la salle à manger.
La salle à manger du Roz était une grande pièce pavée en ardoises plates, froide malgré l’ardent soleil du dehors, et montrant à ses murailles nues l’humidité qui incessamment perlait. Un énorme buffet de chêne noir ouvré, formé de deux bahuts superposés, tenait tout le fond de la salle, dans le sens de sa longueur. Vis-à-vis du buffet, un dressoir où les assiettes de terre brune se mêlaient fraternellement aux plats d’argent, allait du sol à trois pieds du plafond.
Au-dessus de la porte d’entrée, un artiste indigène avait peint des pommes horriblement rouges et des raisins dont le renard se serait privé avec plaisir. Au beau milieu de cette œuvre d’art, les écussons de Maurever et de Kergariou, accolés sous le même cimier de chevalier, unissaient leurs émaux amis. Çà et là aux murailles pendaient des andouillers de cerf.
C’était tout.
Ajoutez une énorme table, pliant sous le poids du bœuf, du porc et de la venaison, des chaises de bois sculptées et un paillasson, épais de quatre doigts, pour la châtelaine, vous aurez une idée parfaitement exacte de la salle à manger du Roz.
Il y avait eu là de nobles festins, du temps de M. Hue de Maurever, et encore du temps de feu messire Aubry de Kergariou. Mais ils étaient morts tous les deux, et les festins ne vont pas bien sous le toit d’une veuve.
Mme Reine n’était, croyez-le, ni avare ni insociable. Seulement, elle se tenait à sa place.
Personne dans le pays n’était plus honoré qu’elle. À tous égards, elle le méritait, la bonne dame. Les défauts qu’elle avait ne nuisent point aux étrangers indifférents. Ses jolis ongles griffus n’écorchaient que les proches et les dévoués.
Longtemps, la Bretagne avait gardé ces belles mœurs des aïeux insulaires que Walter Scott a si souvent et si magnifiquement décrites ; longtemps, maîtres et serviteurs s’étaient assis à la même table, dans la commune hospitalité du manoir.
Au XXe siècle, il n’en était plus ainsi. La table des maîtres n’appartenait qu’aux hôtes nobles et à ces pensionnaires privilégiés qui s’appelaient la maison.
Chez les grands seigneurs, la maison était composée de gentilshommes.
Chez les simples nobles, la maison formait une classe intermédiaire qui prenait au-dehors le pas sur la bourgeoisie, et qui, en réalité, empruntait quelque importance aux armes qu’elle portait.
C’étaient l’écuyer, le page ou les pages, les hommes d’armes.
C’étaient encore l’intendant, l’aumônier, parfois le maître veneur.
Au manoir du Roz, il n’y avait point d’hommes d’armes à demeure. Toute la maison, fors dom Sidoine, le chapelain, prenait, à l’occasion, l’épieu ou l’épée. Jeannin faisait office d’écuyer. Il y avait un petit farfadet nommé Marcou de Saint-Laurent, qui était page. L’intendant avait nom maître Bellamy ; il cumulait cet office avec celui de majordome.
Ces divers officiers, avec Jeannine, fille de l’écuyer qui était en même temps chargé de l’éducation militaire du jeune Aubry avaient seuls le droit de s’asseoir à table.
Dom Sidoine servait de précepteur à Aubry.
Fier-à-Bras avait sa petite table particulière auprès de Mme Reine, qui conciliait ainsi sa gravité un peu vaniteuse et le faible qu’elle avait pour le nain.
On prit place.
Marcou de Saint-Laurent le page, laid petit coquin, fort peu semblable à ces enfants ennuyeux et langoureux qui lèvent leurs yeux blancs vers le ciel sur la couverture de nos romances, Marcou trouva moyen de frotter les cheveux rouges à Fier-à-Bras. Il avait quinze ans, ce Marcou ; il tirait la langue à Jeannine et ne se doutait pas que le XIXe siècle ferait sur lui soixante mille couplets idiots, mais romantiques, avec accompagnement de piano.
Il n’aimait guère que le brelan, le vin nantais, qui n’est pourtant pas nectar, et le noble jeu de la grenouille, dont il sera parlé plus tard.
Fier-à-Bras lui rendit sa politesse en lui pinçant le mollet, qu’il avait maigre, jusqu’au sang.
Sur ces entrefaites, chacun se recueillit, et dom Sidoine prononça le Benedicite.
— Amen dit Fier-à-bras, qui pinça le mollet du page Marcou de Saint-Laurent, pour la seconde fois.
Le page voulut lui rendre son espièglerie, mais Mme Reine toussa sec et dit à Jeannine :
— Je vous prie de tenir votre croisée close le matin, ma fille… le soleil d’août est malfaisant.
— Il suffit, madame, répondit Jeannine.
— Non, ma fille, cela ne suffit pas ! à votre croisée close, vous voudrez bien attacher des rideaux et les tenir fermés.
— Je le ferai, madame.
— Oh ! oh ! se dit Marcou, messire Aubry ne courra plus si souvent la quintaine !
Aubry regardait Jeannin à la dérobée pour voir s’il manifesterait de la surprise ou du mécontentement, mais Jeannin était à cent lieues de deviner les motifs de Mme Reine en prononçant ces mots : « le soleil d’août est malfaisant ; » et l’idée des rideaux lui sembla une attention délicate.
D’ailleurs le bon Jeannin avait gagné grand appétit en courant la quintaine. Il mangeait sérieusement une honnête tranche de bœuf entrelardée, et ne cherchait point malice en ce qui se disait à l’entour.
— Je le connais, le soleil d’août ! s’écria le nain ; tout à l’heure je chevauchais sur les grèves, et le soleil d’août s’amusait à me gâter le teint…
— Tu chevauchais, toi, l’Araignoire ? interrompit Marcou.
— Pourquoi non, sire fainéant ?
— M’est avis que pour chevaucher il faut des jambes.
— Ou des pattes, maître fallot, puisque les singes et toi vous enfourchez la selle ! moi, il ne me faut ni jambes ni pattes ; Huguet l’homme d’armes, m’assied sur le pommeau de la selle, ou bien Catiolle, la maréyeuse, me met dans un des paniers de sa bourrique… Ah ! maître Marcou, voilà une bête encore plus paresseuse que toi, la bourrique de Catiolle !
Le page chercha en vain une réplique, fit la grimace et regarda son assiette. Chacun avait envie de rire, mais personne ne riait, à cause de la jolie Mme Reine, qui faisait à elle seule un effet plus dolent que cinquante aunes de serge noire semée de larmes d’argent.
Fier-à-Bras, vainqueur, but rasade d’un air satisfait.
— Donc, noble dame, reprit-il, puisque votre page veut bien donner la paix aux hommes raisonnables, je vais vous dire ce que j’ai appris là-bas de l’autre côté du Couesnon sur les choses de l’État. Le sire de Coëtquen, mon seigneur, auprès de qui je tiens charge noble, étant à la cour de François II de Bretagne, j’ai du bon temps que j’occupe à mes affaires et à mes amours.
Cette fois Marcou éclata, et tout le monde l’imita, sauf Mme Reine et la pauvre Jeannine, qui était rose depuis le front jusqu’aux épaules de la semonce détournée qu’on lui avait faite.
— Et quelles sont tes amours, Fier-à-Bras, mon mignon ? demanda messire Aubry.
— S’il vous plaît, mon cher sire, répliqua le nain, ce sont les tourtes d’Ardevon, au bord de la grève normande. Dame Lequien, la boulangère, y met des raisins de Gascogne, des fleurs d’oranger, du miel et bien d’autres douceurs. Je suis fidèle de cœur et constant comme un vrai chevalier doit l’être. Depuis que je porte l’épée, j’aime les tourtes d’Ardevon. Quoi qu’il arrive, je fais serment sur mon blason de les adorer toujours !
— La gourmandise est un péché mortel, fit observer dom Sidoine.
— Et je te prie, enfant, ajouta Mme Reine, choisis ailleurs tes sujets de plaisanterie. À ma table, tout ce qui regarde la noblesse et l’honneur des chevaliers doit être respecté.
Fier-à-Bras s’inclina d’un air confus et répondit :
— Il sera fait suivant votre volonté, noble dame. Je vais vous parler sans rire de l’Homme de Fer, le comte Otto Béringhem, qui ouvre l’estomac des petits enfants par curiosité scientifique et sans songer à mal.
— Prends garde !... commença madame Reine.
— Vous ne voulez pas? répliqua encore le nain, exagérant l’humilité de sa posture. Eh bien ! je vais vous entretenir du premier chevalier qui soit en cet univers, du roi Louis de France lequel fait dessein d’envoyer un mortel maléfice à son cher cousin, François de Bretagne, notre seigneur.
Toutes les têtes se dressèrent attentives.
Le nain, cachant son sourire narquois, feignit de se méprendre.
— Vous ne voulez pas ? ajouta-t-il pour la troisième fois, alors je vais boire, manger et me taire.