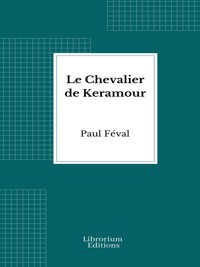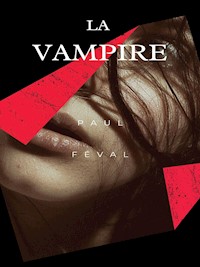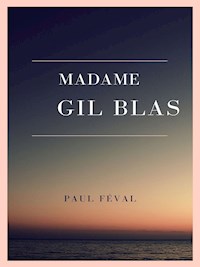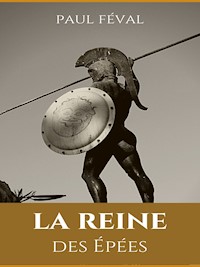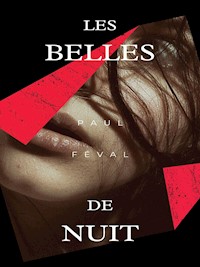Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
1832, dans les Ardennes, du côté de Sedan. La famille Legagneur, d'origine belge, passe pour être très riche, mais jouit de peu de considération car mêlée à quelques affaires peu nettes. Antoine Legagneur, officier de l'armée française, s'arrange pour faire accuser de rébellion le maréchal des logis Hector qui ne sait pas qui sont ses parents. Sauf miracle, ce dernier sera fusillé. Le but de la manoeuvre est de faire disparaître l'héritier d'une très grosse fortune cachée qui alors reviendra à Honorine de Blamont, Antoine ayant réussi à obtenir que cette dernière l'épouse. Le fabuleux trésor de l'abbaye d'Orval détruite lors de la révolution française est caché avec la fortune précitée. Beaucoup de gens cherchent, fouillent, creusent pour les retrouver. Le dernier abbé de l'abbaye vient de mourir, mais il a eu le temps de donner des indications à Jean Guern, ami de la famille d'Hector. Hector s'en sortira-t-il?...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Errants de nuit
Les Errants de nuitPREMIÈRE PARTIE. LE CONDAMNÉ À MORTDEUXIÈME PARTIE. LES RUINES D’ORVALPage de copyrightLes Errants de nuit
Paul Féval
PREMIÈRE PARTIE. LE CONDAMNÉ À MORT
I LES SAUDEURS
Ce sont des paysages magnifiques et variés à l’infini : de grandes forêts, des rivières, des montagnes. Cela s’appelle les Ardennes ; c’est plein de souvenirs. Et nul ne saurait dire pourquoi la poésie s’est retirée de ces admirables campagnes.
Est-ce l’odeur des moulins à foulons, ou la fumée noire des cheminées de la fabrique ? Cette charmante rivière, la Meuse, coule tout doucement et sans jamais faire de folies parmi les belles prairies un peu fades. On voit bien déjà qu’elle est prédestinée à baigner les fanges grasses de la pacifique Hollande.
Ce n’est pas la Loire, celle-là, riante aussi, mais si fière ! Ce n’est pas le Rhône, ce dieu fougueux ! Ce n’est pas la Seine, l’élégante, la française, qui baigne tant de palais et tant de cathédrales !
C’est bien la France encore, mais une France à part. La poésie n’est pas là comme en d’autres campagnes de notre pays, moins pittoresques, assurément, ni comme en d’autres villes moins riches. Le caractère manque ici parce que la ville a envahi la campagne, et la campagne la ville par la porte de la fabrique. Autant le paysan était beau sous son brave costume et même sous la blouse de travail, autant il est, gauche et lourd sous la farauderie de sa terrible redingote mal faite.
Et pourtant, c’était le comté de Champagne. La forêt des Ardennes est parsemée des pages de notre histoire.
Et d’autres souvenirs plus lointains encore abondent : c’était le rendez-vous de la chevalerie. Là-haut, vers Francheval, le fier coursier des quatre fils Aymon n’a-t-il pas laissé l’empreinte de son sabot ? Voici Château-Renaud ! voici la Roche-Aymon ! Les noms sont une mémoire obstinée.
Ce fameux Pied terrier, dont la reliure avait été estimée trois cent vingt rixdales ou deux mille livres, monnaie française, c’est-à-dire plus de dix mille francs, eu égard aux accroissements successifs de la valeur représentative, ce livre des biens fonciers de la communauté était un immense in-folio de sept cent quarante pages, où se déroulait la liste des terres, prés, pâturages, bruyères, étangs, moulins, brasseries, maisons, châteaux, métairies, mines, ardoisières, carrières, chasses, pêches, dîmes, cens, péages de tourniquets ou de ponts, possédés ou fructrués par le monastère d’Orval.
On ne peut évaluer à moins d’un milliard le capital foncier de ce prodigieux domaine, réparti sur le territoire de trois cents paroisses, villes, villages ou hameaux.
La mainmise des religieux d’Orval s’étendait sur l’ancien comté de Chiny, berceau de l’établissement, sur le pays de Carignan, sur les prévôtés de Chauvency, de Mouzon, de Montmédy, de Marville, de Merles, de Mangienne, de Dun, d’Arrancy, de Conflans, de Jarnisy, de Longuyon, de Birey, de Longwy, dans le pays Messin, dans les bailliages de Virton et d’Erlon, dans le duché de Luxembourg, dans le Liégeois, dans le Brabant, dans le comté de Namur.
C’était un monde. Et savez-vous ce que les bons moines avaient écrit en tête de leur grand livre d’achats ? L’épigraphe mérite assurément d’être transcrite et traduite. La voici textuellement :
« Ignorantia notariorum, et multo mugis malitia, messis est advocatorum. Clausulas ambiguas et problematicè dis-putabiles instrumentis inserendo, notarii ponunt ova, quæ magno partium sumptui excubantur ab advocatis et procu-ratoribus. »
« L’ignorance des notaires, et surtout leur perversité, est la moisson des avocats. Les notaires, en glissant dans les actes des clauses ambiguës et sujettes à discussions, pondent des œufs qui sont couvés, au grand détriment des parties, par les avocats et les procureurs. »
L’enseignement est bon ; l’image est charmante. Ces excellents moines, qui avaient tant d’esprit, sont morts ; mais les notaires, les avoués et les avocats continuent, les uns de couver, les autres de pondre. Et le monde ne s’en porte pas mieux.
Giovan Battaglia avait renversé sa tête sur le dossier de sa chaise. Il fermait les yeux. Il souriait. Son visage peignait le ravissement. Ce fantastique dénombrement d’objets précieux produisait sur lui l’effet du plus attrayant des poèmes.
Il écoutait encore, et il dormait déjà. Ou plutôt il se baignait, bercé par des milliers de vagues dorées, dans cet océan d’opulence. De l’or, de l’argent, des rubis, des émeraudes, des pluies de perles, des fleuves de diamants !
Nerea continuait sa lecture. On frappa à la porte. Giovan Battaglia ne bougea pas.
– Faut-il ouvrir, mon père ? demanda Nerea.
On frappa un peu plus fort et d’une façon particulière. Nerea fit de l’ongle un signe consciencieux sur la page commencée, puis elle gagna la porte et ouvrit.
L’homme qui entra avait la pipe à la bouche et la casquette sur la tête. Il ne se découvrit point et ne cessa pas de fumer. Son regard fit le tour de la chambre.
– Je croyais que vous étiez en compagnie, la fille, dit-il d’un ton brusque ; emplissez la cruche : j’ai gagné de quoi boire cette nuit, je paierai.
XII LA BONNE AVENTURE
Ce nouveau venu était un gaillard de grande taille, au costume débraillé, à la démarche dégingandée. Par tous pays, les mauvais sujets ont la même tournure. Celui-ci était bien connu dans la ville : c’était Nicolas Souquet, dit le Cloqueur, à cause des nombreux chômages qu’il avait provoqués dans les fabriques de drap, au temps où il était ouvrier tondeur. Nous l’avons vu déjà cette nuit à la tête de la bande des saudeurs soudoyés pour proclamer les fiançailles du major. Nous l’avons vu encore pénétrer dans la maison du mort après le départ de Jean Guern et de sa femme.
Depuis la révolution de Juillet, Nicolas Souquet ne travaillait plus de son état. Il mangeait mieux qu’auparavant et buvait davantage. On disait dans la ville qu’il était avec les Errants de nuit. Mais on disait cela volontiers de tous ceux qui n’avaient pas au grand jour leurs moyens d’existence.
Nicolas Souquet pouvait avoir trente ans. Sa figure n’avait d’autre expression qu’une brutale effronterie. Il vint s’asseoir à la place occupée naguère par Nerea, pendant que celle-ci allait chercher de la bière. Quand elle revint, il lui dit :
– Verse !
Et tandis qu’elle versait :
– Te souviens-tu, la fille, de m’avoir fait cette marque-là ?
Il montrait une petite cicatrice qui allait du coin de l’œil à la tempe.
– Oui, répondit Nerea, je m’en souviens.
– Tu n’aimes pas les bons garçons, toi, reprit Nicolas.
Il but et ajouta, en essuyant sa moustache du revers de sa main :
– Aussi, quand je vas être riche, du diable si je te prends pour ménagère !
– Vous allez donc être riche, monsieur Nicolas ? demanda Nerea, dont la lèvre se releva avec dédain.
Le Cloqueur frappa un grand coup de poing sur la page qui énumérait les trésors d’Orval.
– Ce bouquin-là, dit-il, c’est des bêtises. Mais il y a quelque chose, et c’est moi qui l’aurai. Cela me met en belle humeur. Veux-tu venir avec moi voir fusiller le maréchal des logis ?
Nerea ne répondit point. Le Cloqueur fit un pas vers elle, mais une voix flûtée se mit à parler derrière lui.
– Zo ne dors pas, cer ami, prononça doucement le père Bataille.
– Tiens ! tiens ! fit Nicolas en tressaillant, vous écoutiez ?
– Cer ami, zo ne dors zamais que d’une oreille, la ragaze a son aiguillon pour se défendre, vous en portez la marque, méfiez-vous.
Il roula son vieux fauteuil jusqu’auprès du Cloqueur et reprit tout bas :
– Nous avons quelque çoze de nouveau !
– Oui, papa, repartit Nicolas Souquet ; quelque chose qui vaut mieux que votre baguette de coudrier. Je suis sur la piste de six cent mille écus !
Giovan Battaglia essaya de sourire, mais il était tout pâle.
– Cer ami, dit-il, très-cer ami Nicolas, demande à la ragaze si zo ne lui dit pas touzours que tu ferais la perle des maris !
– Oh ! répliqua brutalement le Cloqueur, bien obligé, papa pour se marier nous avons du temps devant nous.
– Nicolas Souquet, prononça lentement Nerea qui jouait avec les tarots, savez-vous combien vous avez de temps devant vous ?
– Mon père est mort à quatre-vingt-deux ans, et je suis plus solide que mon père.
Nerea comptait sur ses doigts.
– Quatorze jours, murmura-t-elle.
La face du Cloqueur devint écarlate, mais il se remit aussitôt, disant :
– Tout cela, c’est parce que je ne veux pas l’épouser.
– Si vous avez idée de ne pas vous en aller sans confession, Nicolas, reprit la jeune fille, faites vos affaires, et n’attendez pas.
Elle tourna le dos, ajoutant à demi-voix :
– Celui qui devait mourir ce matin vivra plus vieux que pas un de nous !
– La paix, ragaze, la paix ! fit Giovan.
– Vous feriez mieux de me dire : Parle, mon père, car voilà que je vois les six cent mille écus comme s’ils étaient là sur le carreau.
Le vieux Bataille et le Cloqueur échangèrent un regard rapide. La figure de Nerea avait pris l’expression qu’on prête aux pythonisses.
– Parlez ! s’écria Nicolas Souquet.
– Zo ne veux pas que tu parles ! ordonna au contraire l’Italien.
– L’or est dans un lieu qu’on appelle la Tombe, acheva Nerea comme malgré elle ; malheur à qui pénétrera en ce lieu !
On frappa.
– Cachez-vous, Nicolas ! dit précipitamment Giovan ; voici M. le major.
– Je serai bientôt plus riche que le major ! répliqua le Cloqueur fièrement : pourquoi me cacherais-je pour un marchand de laines !
Nerea se dirigea vers la porte en disant :
– Ce n’est pas le major Legagneur.
Elle ouvrit et s’effaça pour laisser passer un gros petit vieillard, frais et rose, qui portait un bonnet de soie noire sur sa tête chauve et son chapeau sous le bras.
– Monsu le baron ! s’écria Giovan Battàglia, zo suis bien le serviteur de la Vostre Excellence ! Avance le fauteuil, ragaze. Éteignez votre pipe, Nicolas !
Comme le Cloqueur n’obéissait pas assez vite, Giovan lui arracha sa pipe et en plongea le fourneau ardent dans la chope à demi pleine. Ce que voyant, Nicolas Souquet ôta sa casquette en grondant :
– Je vous salue et votre compagnie, monsieur Legagneur.
Le baron Michel entra d’un air humble et doux. Il était impossible de voir un petit millionnaire plus avenant et plus affable.
– Bonjour, Bataille, dit-il, car nous sommes au matin. Bonjour, Nicolas, toujours un peu mauvais sujet, je parie. Jeunesse se passe, nous mettrons de l’eau dans notre vin. Bonjour, chère enfant ! On lui trouvera un mari, si vous voulez, père Bataille. Ça ! ça ! fit-il sans s’arrêter, mais en soufflant un peu pour s’asseoir ; vous voilà bien étonnés de me voir à pareille heure, n’ayez pas de crainte ; je ne viens pas chercher mes loyers… je viens…
Il s’interrompit pour cligner de l’œil en regardant le Cloqueur.
– Dans quelle fabrique êtes-vous, maintenant, mon brave ! demanda-t-il.
– Dans celle qui ne va que la nuit, répondit Nicolas.
Et Giovan Bataille, en se frottant les mains.
– Vous pouvez parler la bouce ouverte, monsu le baron. Il travaille avec moi, le cer garçon. Vos neveux lui doivent bien, à l’heure qu’il est, une douzaine de pièces de six livres.
– Ah ! soupira Michel Legagneur, j’en ai donné de l’argent pour tout cela, de l’argent ! de l’argent !
Il soupira gros et leva les yeux au ciel.
– Mais tout sera payé ! reprit-il précipitamment ; la maison Legagneur trouverait un million d’ici à demain midi, si on le lui demandait.
– Tiens ! tiens ! fit le Cloqueur entre haut et bas ; pourquoi nous chante-t-il cet air-là ? Est-ce que sa boutique branlerait dans le manche ?
Il était placé derrière le baron Michel, qui se vantait d’être un peu sourd.
– Vos neveux sont de zolis zeunes zens, reprit Bataille ; mais leur caisse est souvent vide, c’est de leur âze.
Second soupir de Michel Legagneur, qui fit du doigt un petit signe paternel à Nerea.
– Ma mignonne, dit-il, le bruit court que vous avez commerce avec les esprits. Je ne pouvais pas dormir cette nuit. J’ai pensé, à part moi : Si j’allais du côté de la Gassine, cette belle petite me tirerait mon horoscope.
– Ça fait passer le temps, dit Nicolas, qui riait dans sa barbe.
– Zo ne dis pas cela à tout le monde, fit Giovan en s’approchant du baron Michel pour lui parler à l’oreille, mais la ragaze elle voit l’avenir comme vous pouvez connaître le présent et le passé. Ah ! si vous aviez entendu sa mère, ma défunte femme !
Sur un second signe du chef de la maison Legagneur, Nerea s’approcha.
– Tout à l’heure, continuait cependant le père Bataille, nous ne vous attendions pas, monsu le baron. Eh bien ! zo ne voudrais pas vous mentir, elle s’est écriée : « Voilà monsu Legagneur qu’il tourne le coin de la rue ! »
Nerea était venue se placer devant le baron Michel.
– Je n’ai pas dit cela, prononça-t-elle distinctement, quoique d’un ton très-bas ; mais que cet homme m’interroge et il verra !
Le baron Michel leva sur elle ses petits yeux gris débonnaires. Il les baissa tout aussitôt sous le regard ferme et froid qu’elle fixait sur lui.
– Mignonne, balbutia-t-il, sauriez-vous me dire pour quelle raison j’ai eu fantaisie de vous interroger ?
– Parce que vous avez eu peur, répondit Nerea sans hésiter.
– Peur de quoi, bon Dieu, ma pauvre fille !
– Peur de celui dont vous venez de prononcer le nom, peur de Dieu !
– Zo ne souffrirai pas, interrompit ici Giovan Bataille que tu parles ainsi à notre maître !
Mais Nerea dit : « Je n’ai pas de maître ! »
Puis, prenant tout à coup la main de M. Legagneur :
– Vous ne pouviez pas dormir cette nuit, poursuivit-elle en changeant de ton ; cela vous arrive bien souvent, parce que vous êtes moins méchant et moins résolu que les autres. Comment seriez-vous maître, vous qui obéissez comme un esclave ?
– Quant à ça, fit Nicolas, le major tient le bon bout !
– Silence ! ordonna Nerea.
Et le père Bataille siffla un long : chut ! Michel Legagneur avait la tête baissée. Ses bras pendaient. Ses yeux battaient comme s’il eût été sur le point de pleurer.
– Je suis trop vieux pour tous ces embarras, dit-il du ton d’un enfant qui se plaint, j’en mourrai !
Nerea répéta : « Vous en mourrez ! »
Le baron se souleva à demi sur son siège, la face livide la bouche convulsivement béante.
– Bataille ! Bataille ! prononça-t-il paisiblement, on dit que votre fille est folle ! Est-elle folle ?
– Zo répondrai comme vous voulez, mon bon monsu Legagneur, repartit Giovan ; la ragaze a bien étudié, mais on peut se tromper.
Michel passa ses deux mains sur son front, qui dégouttait de sueur. Nicolas le couvrait d’un regard de dédain.
– Y en aurait qui riraient bien, dit-il, s’ils savaient que le baron Michel est ici en train d’étouffer de peur, parce que la fille à Bataille lui conte des fanfreluches !
– Elle ment, n’est-ce pas, elle ment ! s’écria M. Legagneur en se tournant vers lui, ces gens-là ne savent que mentir !
– Ah ! monsu Legagneur, répliqua Giovan, zo ne mens zamais ; Nicolas que voici peut vous le dire, sans moi, les Errants auraient déjà découvert cent fois l’or et l’argent qui est sous la terre. Zo vous le garde.
Le baron retomba sur son siège.
– L’or ? l’argent ! balbutia-t-il ; que m’importe cela ! Achète-t-on le sommeil ! Achète-t-on la vie ?
Son regard rencontra celui de Nerea. Il demeura comme fasciné.
– L’or et l’argent sont vos dieux quand il fait jour, dit-elle, le jour vous cessez de trembler. N’avez-vous pas vendu pour de l’or le sang du fils de votre bienfaiteur ?
– Ils me tueraient, répondit Michel, si je leur résistais. Ce n’est pas moi qui ai voulu cela, non ! ce n’est pas moi !
– Et pourtant, dit tout bas Nerea, c’est un spectre nouveau qui vous a poursuivi cette nuit.
Le baron Michel ne répondit point. Nicolas écoutait, pris par une curiosité étonnée, mais son étonnement n’était rien auprès de celui du père Bataille.
Figurez-vous un alchimiste menteur et charlatan, qui trouverait tout à coup un lingot véritable au fond de son creuset ! C’était un sceptique que ce père Bataille. Il était payé pour ne rien croire. Depuis cinquante ans, il gagnait sa vie à tromper. Et voilà que son vieux péché de mensonge devenait tout à coup vérité ! sa fille, son élève, cette enfant qui ne savait rien que par lui, parlait comme un prophète et semblait posséder un pouvoir surnaturel !
Y avait-il donc quelque chose de réel, sous cette momerie qui était son métier ?
– L’enfant en sait plus long que nous, dit-il tout bas au Cloqueur.
Celui-ci mit sa main sur la poche de sa veste.
– Si tu es vraiment une sorcière, la fille, s’écria-t-il, dis-moi ce que j’ai là dedans.
– La moitié du secret d’un mort, qui n’est pas encore enterré, repartit Nerea.
Nicolas Souquet faillit tomber à la renverse, tant il se recula vivement.
– Est-ce que c’est vrai ? balbutia Giovan.
– C’est vrai, fit le Cloqueur, et je ne donnerais pas cette moitié de secret-là pour mon pesant d’argent blanc !
Le baron demanda :
– Qui donc est mort ?
– Celui que vous cherchiez cette nuit, répondit Nerea.
– Le moine d’Orval ? fit Michel tout tremblant.
– Oui, le moine d’Orval.
– Et où est-il mort ?
– À votre porte.
– Ça y est ! s’écria le Cloqueur, parole sacrée, ça y est ! Elle a un démon, c’est sûr et certain, dans son corps.
– Le moine d’Orval est mort ! pensa tout haut Michel Legagneur ; à ma porte ! et l’enfant va mourir !
Il appuya ses deux coudes sur ta table et mit sa tête entre ses mains. Des pas se firent entendre dans la rue. C’étaient des gens qui allaient tranquillement, riant et causant. Une fois que ce bruit eut commencé, il ne s’arrêta plus. Vous eussiez dit le matin d’un jour de foire. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants. On s’entretenait gaillardement. Les mêmes mots revenaient à chaque instant dans les différents groupes : Sauderies, Champ de Mars, sept heures, fusillé.
Quelques sociétés, plus gaies, chantaient. Il y avait des dames.
Tout ce joyeux monde allait voir mourir le bel Hector, maréchal des logis aux chasseurs de Vauguyon… Pauvre jeune homme ! c’était une triste histoire. Mais il y avait si longtemps qu’on n’avait vu une exécution à mort à Sedan !
À ce bruit qui venait du dehors, et qui le rassurait, le baron Legagneur parut tout à coup se réveiller d’un sommeil et jeta autour de lui un regard cauteleux.
– Est-elle à vendre, ta moitié de secret ? demanda-t-il au Cloqueur tout surpris.
Il avait maintenant la voix ferme et l’accent viril. Nicolas Souquet répondit :
– Elle est à vendre, mais j’en veux ma fortune.
– Qu’appelles-tu ta fortune ?
– Dix mille francs ! fit Nicolas, rouge de désir.
– Tope là ! je te les donne.
– Non, vingt mille !
Le baron Michel, qui avait déjà tiré son portefeuille, le remit dans sa poche. Nerea prêtait l’oreille aux bruits de la rue. Elle ne donnait plus aucune attention à ce qui se passait autour d’elle. Tout à coup elle frappa sur l’épaule du Cloqueur.
– Je sais quelqu’un qui t’en donnera le double et le triple ! dit-elle.
– De qui parles-tu, ragaze ? demanda Giovan d’un air menaçant.
En deux bonds Nerea avait gagné la porte. Un homme passait à cheval. Il s’arrêta en face du seuil.
– Garde ton secret, Nicolas Souquet ! cria Nerea qui déjà était dehors, et ne te trouve pas sur le chemin de Jean Guern du village de Bazeille !
Elle sauta en croupe derrière le cavalier, qui prit le galop aussitôt. Nicolas Souquet s’était élancé pour la retenir. M. Legagneur mit un doigt sur sa bouche et glissa deux pièces d’or dans la main de Giovan.
– Fais-le boire, dit-il à voix basse ; si tu apportes le papier, tu auras les dix mille francs que je lui offrais.
Le Cloqueur rentra en ce moment et n’eut pas le temps de fermer la porte, parce qu’un nouvel arrivant le poussa et entra avec lui. Deux autres suivaient celui-ci. Ils étaient tous les trois enveloppés de longs manteaux.
– Il y a du nouveau, notre oncle, dit l’un d’eux.
Un autre s’écria.
– Quand je vous disais que le vieux fou était à se faire tirer les cartes !
– En route ! en route ! ajouta le troisième ; il faut que nous ayons passé la frontière avant le jour !
Ils s’emparèrent du baron Michel, qui se laissa faire comme un enfant surpris à la maraude, et l’instant d’après on entendit une voiture rouler sur le pavé de la rue.
– Le major Antoine et les deux neveux ! grommela le Cloqueur. Au chêne creux de Blamont, l’autre nuit, combien le major t’a-t-il donné pour nous détourner du vrai chemin ?
– Deux louis, cer ami.
– Et combien le baron t’a-t-il donné pour me voler le papier du moine ?
– Deux louis.
– Plus dix mille francs quand tu le lui porteras… Écoute, vieux Giovan, ta fille me plaît parce, qu’elle a le diable au corps. Veux-tu mêler et que je sois ton gendre ?
Le père Bataille lui tendit la main aussitôt.
– Montre le papier, dit-il.
Le Cloqueur ouvrit sa veste et étendit sur la table le chiffon qu’il avait ramassé dans la chambre du mort, après le départ de Jean Guern et sa femme, au rez-de-chaussée de cette pauvre maison qui faisait face à l’hôtel Legagneur. Ils se penchèrent tous deux. Les yeux de Giovan brillèrent.
– As-tu tué quelquefois, cer ami ? demanda-t-il tout bas.
– Pas encore, repartit le Cloqueur.
Il y eut un silence, puis l’Italien reprit :
– Jean Guern et sa femme voyazent souvent seuls la nuit, très souvent. Viens au Çamp de Mars, mon zendre : nous causerons en route.
XIII LE CHAMP DE MARS
Il n’y a pas à dire, ce fut un joyeux quart d’heure. Le champ de Mars était tout noir. La nuit avait cette opaque profondeur des instants qui précèdent le point du jour. Dans ces ténèbres, la cohue curieuse et impatiente grouillait. On ne voyait rien, sinon un mouvement d’ombres.
Mais on entendait partout un grand murmure fait de mille chuchotements. Par-dessus ce bruit confus s’élevait çà et là le gros rire idiot des farceurs. Les gens sages parlaient tranquillement de leurs affaires. Les bonnes femmes épuisaient ce sujet décourageant et pourtant bien-aimé, la cherté des vivres. Les enfants pleuraient, les chiens grondaient. Quelques orateurs élevaient la voix pour dire des sottises politiques.
De temps en temps une lueur subite se faisait. C’était un vieux tisseur qui allumait sa pipe ou un tondeur qui mettait le feu à son cigare. Les tisseurs sont du sénat, les tondeurs, au contraire, brillent parmi la « jeunesse. »
L’espiègle M. Jean-Marie était tondeur, M. Joreau était laineur, M. Chamoin était tisseur. La dame de M. Joreau était époutisseuse, c’est-à-dire chargée de faire la chasse aux nœuds dans les pièces revenant du brossage ; mission de haute confiance. La dame de M. Chamoin était cardeuse. Marion, la demoiselle de M. Battut, était empointeuse.
Or, on causait de choses sérieuses dans ce groupe présidé par M. Battut, tisseur.
– Pour être durs, dit cet honnête homme, résumant une série de lamentations, les temps sont durs !
– Ah ! mais oui ! repartit M. Chamoin, fileur ; n’est-ce pas vrai, Mame Chamoin ?
– Ah ! ah ! fit M. Battut, quant à ça, l’hiver a été rude !
– Celui de l’an passé n’était pas déjà trop doux, repartit madame Chamoin, cardeuse, et les pieds dans la boue comme nous les avons, on pourrait gagner un gros rhume.
– Ah ! mais oui ! approuva le fileur Chamoin ; et quand on l’a, on l’a.
– Dans ces cas-là, fit observer le laveur Martin Louveau, ça ne fait que croître et embellir !
M. Battut conclut :
– Rien n’empêche !
– Vous verrez, vous verrez ! criait le fils Chamoin, dans un petit tas de jeunesse, de ce que je m’ai fait nommer sergent, j’ai le bras long ! N’y aura pas de maire ni de curé qui tienne ! À la Noël, on dansera passé minuit, ou je me fâche contre le gouvernement !
– Comptons, disait-on dans un groupe de boutiquier, depuis la banqueroute des Maillard…
– Ah ! les coquins ! gronda aussitôt le chœur.
– Avec leurs salons dorés !
– Avec leurs domestiques habillés comme des colonels !
– Pour aller mal dans la fabrique, ça va mal, dit M. Battut en s’approchant ; bonsoir, messieurs et toute votre compagnie.
– Ah ! mais oui, ça va mal ! fit Chamoin père.
– Et ça ne fera que croître et embellir ! ajouta Martin Louveau.
– Comptons ! reprit paisiblement M. Battut en arrangeant ses doigts pour cela ; nous avons eu Lacombe et fils.
Le boutiquier, qui avait émis le premier cette idée de compter, repartit aigrement :
– Tout cela, c’est de l’histoire ancienne ! Nous ne parlons que depuis la Révolution de Belgique.
– Comme vous voudrez, répondit M. Battut ; recommençons. Vous avez les Morin et les Jamboux aîné… Les Premyot, les Duhautcourt, les Monterel…
– Parbleu ! s’écria le boutiquier, nous savons tout cela aussi bien que vous, l’homme !
– L’homme vous-même, dites donc, vous ! repartit M. Battut en se redressant ; est-ce parce que vous vendez des boutons de culotte que vous m’appelez l’homme ?
– Viens-toi-z’en, monsieur Chamoin ! s’écria sa femme, on va avoir des raisons ici !
– Les hommes, c’est drôle, dit madame Joreau ; ça ne veut pas qu’on les appelle des hommes !
M. Joreau et M. Chamoin retenaient M. Battut prêt à s’élancer sur le boutiquier.
– Pour aller mal, ça va mal, reprit le tisseur, et je voudrais bien connaître le malin qui m’empêcherait de le dire ! Nous avons eu la faillite Baralle la semaine passée. Cette semaine, les Bouillet-Persenet ont déposé. Sans les Legagneur, qui soutiennent la main-d’œuvre…
– En voilà une maison ! s’écria aussitôt le chœur.
– Des bordereaux de deux cent mille francs tous les lundis !
– Une caisse ouverte à toute heure !
– Jamais une heure de retard !
– Et savez-vous ce qu’ils dépensent par an, rien que pour leur plaisir ?
– La chasse au loup qu’ils ont donnée là-bas, devers Francheval, leur a coûté soixante mille francs.
– Si ceux-là tombaient, le commerce de Sedan serait à vau-lau.
– Mais c’est solide comme les piliers de la cathédrale !
– On dit pourtant… insinua le boutiquier.
– Tiens ! fit Martin Louveau, ça m’est revenu aussi !
– Quoi donc ! demanda-t-on de toutes parts.
Il n’y eut pas précisément de réponse à cette question, mais de toutes parts aussi les demi-mots se croisèrent.
– Comme les choses se savent !
– J’en ai ouï causer par-dessus les haies.
– Dame ! écoutez donc ! des dépenses pareilles !
– Soixante mille francs pour tuer trois loups ?
– Comme on dit quelquefois : « Tant va la cruche à l’eau… »
– On parle que M. Michel veut vendre le château de Bazeille.
– Et qu’il va se faire tirer les cartes chez le père Bataille, de la porte de la Cassine.
– Quand la glissade commence…
– Ah ! s’écria Martin Louveau, laveur, ça ne fait que croître et embellir.
– Et au bout du fossé… commença madame Chamoin.
– La culbute, acheva madame Joreau.
M. Battut secoua la tête et dit avec conviction :
– Rien n’empêche !
Cela fait deux gammes, l’une montée jusqu’en haut, l’autre jusqu’en bas descendue. À la fin de la première, on eût vendu Sedan aux Legagneur avec des facilités pour le payement. À la fin de la seconde, le boutiquier, adversaire de M. Battut, ne leur eût pas donné à crédit un bouton de culotte.
Le petit jour paraissait. Il faisait un froid piquant, avivé par un bon vent de giboulées. La cohue piétinait la terre mouillée du Champ de Mars pour se réchauffer un peu. L’impatience venait à mesure que l’heure du spectacle approchait. Les forgerons, les commis, les petits bourgeois et les ouvriers de la fabrique de draps, mettaient de côté les sujets d’entretien choisis pour tuer le temps, et ramenaient leur attention vers le drame qui allait se jouer gratis devant eux.
Les gens commençaient à se reconnaître. Il y avait de bruyants saluts échangés par-dessus les têtes. Quelques plaisanteries hasardées se croisaient entre gais lurons, membres influents de la jeunesse. Quelques horions même étaient communiqués et rendus de bon cœur.
Ma foi, on se divertissait, voilà ! Honni soit qui mal y pense ! Pour une fois que Sedan et sa banlieue avaient occasion de voir tuer un homme, faut-il se montrer sévère ?
– C’est drôle tout de même qu’on ne fait pas les préparatifs, dit M. Battut, tisseur, en se levant sur ses pointes.
M. Joreau, laineur, repartit :
– Ça n’est pas long, les préparatifs. Y a chez nous une image qui représente la fusiliation du maréchal Ney. Ça se fait à même la terre : l’homme d’un côté, qu’a les mains attachées derrière son dos, et les soldats de l’autre.
– Est-ce vrai qu’il saute en l’air quand il reçoit les balles dans le corps ? demanda M. Jean-Marie, sergent de la jeunesse de Bazeille.
– On ne voit pas ça sur l’image.
Mademoiselle Marion demanda à son tour :
– Ça le fait-il crier ?
– Voilà que le temps me paraît long ! dit madame Joreau en bâillant.
Et madame Chamoin ajouta :
– C’est moi qui mangerais bien ma soupe !
Un son de trompette retentit derrière les murailles du château. Ce fut comme un frémissement qui parcourut le Champ de Mars tout entier.
– Il va venir ! il va venir !
– Je suis trop petite ! je ne vas voir que sa tête.
– Hausse-moi, monsieur Chamoin !
Et cent voix à la fois :
– C’est trop tôt ; on ne va pas bien voir !
Je vous le dis, ce sont des spectacles.
Mais la porte du château ne s’ouvrait point. C’était une fausse alerte. Cependant, la fièvre naissait dans cette cohue à têtes chaudes et à pieds froids. On ne s’occupa plus que du condamné. Des bruits singuliers se répandirent. Ceux qui habitaient de l’autre côté du terre-plein, vis-à-vis du château, avaient été éveillés cette nuit par une aubade bien surprenante. Des voix retentissantes avaient saudé le condamné à mort avec mademoiselle Honorine de Blamont, la fiancée d’Antoine Legagneur.
Ils étaient plus de vingt qui avaient entendu cela. Quelques-uns prétendaient que la belle Honorine était là cachée dans la foule. Y avait-il une histoire ? L’héritière de Blamont connaissait-elle vraiment le jeune maréchal des logis ? Du moment qu’il y a une histoire, l’intérêt naît. Voilà que, tout à coup, les trois quarts de la foule se mirent à espérer je ne sais quoi ; un événement, une péripétie, quelque chose d’inattendu : peut-être une bataille. On ne savait pas. Mais on parlait déjà des Errants de nuit qui allaient peut-être venir.
Depuis quelques minutes, un sourd mouvement se devinait derrière les murailles du château. Il y eut un roulement de tambour. La foule ondula comme une mer. Puis tout se calma. La porte restait close. Cette vieille forteresse, sphinx colossal, ne disait point son secret.
– Il y a donc, dit M. Jean-Marie, de la jeunesse, autour de qui on se pressait, qu’on a vu arriver, sur les quatre à cinq heures du matin, une voiture derrière le château, tout contre la poterne…
– Une voiture ! se récria-t-on ; une charrette, tu veux dire, pour emmener le condamné.
– Je dis une voiture… une voiture que vous connaissez bien… la berline de voyage du major Antoine Legagneur.
– Pas possible !
– Et que venait-elle faire là ?
– Y avait-il quelqu’un dedans ?
– Il y avait, répondit le sergent de la jeunesse de Bazeille, dont le jour naissant permettait d’admirer maintenant les joues violettes et les cheveux rouges, il y avait le major, les deux neveux et le baron Michel.
– Ah bah ! Ils étaient venus voir la chose tous les quatre ?
– Attendez donc !… il en a venu d’autres… un homme et une femme, montés sur le même cheval…
– Mademoiselle Honorine de Blamont, peut-être !
– Et l’homme ?
– Quant à la demoiselle, reprit Jean-Marie, je ne sais pas, mais l’homme était un Errant de nuit, pour sûr.
– Le chef de la bande ?
– Alors, la bande n’est pas loin…
Le cercle grossissait et se resserrait autour de Jean-Marie, qui prenait conscience de son succès. Il regardait les gens en clignant de l’œil, il parlait plus lourdement ; il avait, si la chose peut passer pour vraisemblable, l’air encore plus nigaud qu’à l’ordinaire, et plus gonflé.
– Je ne peux vous dire que ce que je sais, reprit-il ; la demoiselle et l’homme ont venu ensemble par la porte de la Cassine ; ils se sont cachés derrière les buissons. Vous le connaissez bien, l’homme ; il venait assez souvent chez M. Guern, avec sa bête, et à Sedan aussi, chez le moine d’Orval.
– Mathieu Sudre ! s’écria-t-on.
– Mathieu l’assassineur !
– L’homme au loup !
– Oui, oui… l’homme au loup, poursuivit Jean-Marie ils ont donc commencé par s’affronter, à ce qu’on croit, le major et Mathieu, car il faisait encore nuit, et on n’osait pas s’approcher d’eux, rapport à ce que M. Antoine n’est pas gêné pour se servir de ses pistolets, et dans le noir on peut attraper un mauvais coup. On a bien cru entendre aussi la voix de Nicolas Souquet, le Cloqueur, et du père Bataille… En voilà un qui se mêle de ceci et de cela. N’importe, s’il y a eu des taloches, on n’en sait rien. Mais ils ont parlé de Blamont et de chercher les trésors avec la baguette de coudre. Et le Cloqueur a dit aux Legagneur : « Vous en tenez dans l’aile ! Vous allez faire une mauvaise fin ! vous êtes sur la route de Belgique ! »
– De Belgique ! répétèrent vingt fois stupéfaites. Les Legagneur.
Puis les commentaires :
– Que disions-nous ?
– Ceux-là vont donc aussi faire le plongeon ?
– Des gens si orgueilleux ! À qui se fier !
Ainsi parlaient ceux qui ne perdaient rien dans la faillite annoncée. Ceux qui perdaient s’attachaient aux habits de M. Jean-Marie en poussant des cris de créanciers. Ils voulaient savoir, savoir au juste, savoir tout, et le bruit vrai ou faux de la faillite Legagneur se propageant de groupe en groupe avec une vélocité magique, faisait déjà le tour du Champ de Mars.
Dans sa course, cette rumeur se heurtait à d’autres rumeurs plus nouvelles ou plus précises, et ces mots s’entendirent bientôt de tous côtés :
– Ils ont troué la lune !
– On sait cela.
– C’est de l’histoire ancienne.
– Ils sont loin, s’ils courent encore !
Et des lamentations ! et des gémissements ! et des menaces !
– Ils sont donc partis ! vraiment partis ! partis tout à fait !
– Ah ! s’écria M. Joreau, dans quel temps vivons-nous ! Des gens si durs ! et qui partent !
– À qui se fier ? répéta M. Chamoin : des gens qui n’avaient ni cœur ni âme !
– Tout le monde sont donc sujet à s’évaporer, appuya madame Joreau, même les plus voleurs.
– Le fait est, dit madame Chamoin, que tous les jours on en voit de plus drôles.
– Et ça ne fera que croître et embellir ! décida le laveur Martin Louveau.
À quoi M. Battut, riposta :
– Rien n’empêche.
– Mais l’homme au loup ? demanda la jeunesse, et la demoiselle qu’il menait en croupe ?
– Voilà ! répondit Jean-Marie, on ne sait pas. La poterne du château s’a ouverte vers les cinq heures et demie…
– Ah ! ah ! fit-on.
Ceci était curieux, à ce qu’il paraît.
– Il est sorti quelqu’un, continua M. Jean-Marie. Le major a dit dans la nuit : « Bonsoir, ami Larchal. »
– C’était donc le geôlier qui sortait ?… Jean-Marie n’eut pas le temps de répondre ; la foule se prit à subir de grandes ondulations. Les portes du château venaient de s’ouvrir. Les troupes sortaient, infanterie et cavalerie ; mais au lieu de se ranger en bataille, comme il l’eût fallu pour protéger l’exécution, elles s’avançaient au petit pas, refoulant la cohue. Et dans le tumulte croissant, de nouvelles rumeurs allaient :
– Il n’y aura pas d’exécution !
– On fait évacuer le Champ de Mars.
– Larchal a été assassiné cette nuit, et le condamné s’est évadé sous sa veste de geôlier, par la grand-porte…
La presse devenait terrible. Les groupes se mêlaient. Les enfants effrayés poussaient des cris : les femmes hurlaient, étouffées. La force armée, calme et digne, rétablissait l’ordre avec intelligence, poussant tout ce troupeau humain dans le même trou. Un quart d’heure, après toute l’étendue du Champ de Mars était jonchée de queues d’habits et de lambeaux de coiffes. Sedan s’était amusé pour une fois.
Vers ce même instant, aux premiers rayons de l’aube, devant la porte de la maison Legagneur, qui était fermée et paraissait déserte, un prêtre, un choriste et quatre porteurs passèrent. Ils entrèrent dans la masure qui faisait face au palais au baron Michel. Ils venaient lever le corps de Dom Arsène Scholtus, dernier survivant des moines de l’abbaye d’Orval, et mort cette nuit-là même dans la paix de Dieu.
XIV LA LUTTE
Revenons à la prison où nous avons laissé notre Hector tapi derrière la porte de son cachot et serrant sa barre de fer. Larchal, le geôlier, arrivait à pas de loup, de l’autre côté des épais battants. La prison dormait comme la ville. Aucun bruit ne venait du dedans ni du dehors. C’était pourtant l’heure où les curieux s’éveillaient songeant à retenir leurs places au Champ de Mars. Déjà tous les chemins qui rayonnent autour de Sedan devaient être pleins. Les jeunesses de Bazeille, de la Moncelle et de Balan, les forgerons de Givonne, les métiers de Torcy, de Prenoy, de Vadelincourt ne pouvaient manquer une occasion pareille.
Hector entendait très-bien Larchal, parlant tout seul et se disant :
– Voyons si le pauvre diable a tenu sa promesse.
Pour s’assurer de cela, il suffisait de remonter la corde. La bourse et le diamant devaient être au bout.
Il serait malaisé de définir exactement ce qui se passait dans l’esprit d’Hector. C’était un enfant doux et généreux. L’idée de tuer ne pouvait pas naître en lui directement, même au milieu de circonstances si extrêmes. Dans une mêlée, il aurait assommé autant d’hommes qu’on aurait voulu. Mais là, de sang-froid, non. Au bruit de la porte qui s’ouvrait, il resta immobile. Sa main ne leva point la barre de fer. Le geôlier entra et jeta un coup d’œil cauteleux tout autour de la chambre. Hector était caché pour lui par la porte entr’ouverte ; la cellule semblait vide. Larchal, qui était entré tout blême, eut un court frémissement, puis un sourire.
– Il a sauté le pas ! grommela-t-il : va bien !
Hector ne sentit en lui aucun mouvement de colère. Il était las ; il s’appuya au mur. Larchal posa sa lanterne sur le billot. Il avait l’oreille aux aguets, le moindre bruit le faisait sauter brusquement ; mais le sourire ne quittait point ses lèvres, et il se frottait les mains tout doucement.
– Au fait, murmura-t-il, je ne pouvais pas savoir que la grâce serait venue !
– La grâce, répéta Hector en lui-même, comme s’il avait eu peine à saisir la signification de ce mot : la grâce !
Larchal était monté sur le billot : il cherchait la corde. Par un hasard singulier, la corde n’était point tombée au dehors, quand Hector l’avait dégagée de la barre de fer qui la maintenait. Le nœud coulant avait pris le chicot du barreau scié. C’était un appui solide ; la corde pendait comme auparavant. Larchal pensa tout haut :
– C’est le cas de dire : voilà un barreau scié proprement. Mais que diable a-t-il fait du morceau de fer ? Ces marmailles n’ont pas de soin !
Il se mit à haler la corde.
– Quand on pense, fit-il entre ses dents, que tout à l’heure il y avait un homme au bout !… Savoir ce qu’on va dire quand on le trouvera escarbouillé dans le fossé.
Un feu monta au visage d’Hector, mais il ne bougea pas. Larchal ramenait toujours sa corde et continuait de causer.
– Ces Legagneur sont si riches ! disait-il ; est-ce assez de cinq cents livres de rentes ? La vie d’un homme vaut mieux que cela. Qu’est-ce que c’est qu’un capital de vingt mille francs pour les Legagneur ? Peut-être bien que, plus d’une fois, je verrai le blanc-bec en rêve. Écoutez donc, c’est le cas de le dire : ça se paye. On aime à dormir tranquille.
Pour le coup, un mouvement d’indignation secoua la torpeur d’Hector. C’était le major Legagneur qui l’avait assassiné.
– J’aurais dû le deviner plus tôt, se dit-il.
Puis une autre pensée lui vint :
– Mais qui suis-je donc, pour que cet homme joue si gros jeu contre moi ?
À cette question, Hector ne se fit pas de réponse ; mais l’idée le frappa. Il se redressa. Si le major eût été là, à la place de Larchal, il y aurait eu une tête cassée.
Larchal, cependant, arrivait au bout de la corde, où il n’y avait rien, sinon le nœud qui la terminait.
– C’est le cas de le dire ! s’écria-t-il avec une sincère indignation. Le blanc-bec m’avait menti. Ah ! le propre à rien ! Et moi qui le regrettais presque !
Il était rouge de colère. Tout en pelotonnant la corde, il continuait :
– Il m’a fait tort ! Il s’en va en état de péché mortel ! Voleur ! filou ! canaille ! fripouille !
Ce dernier mot, qui est du pays, exprime le superlatif de l’injure. Hector avait maintenant envie de rire.
Mais tout à coup, il tressaillit de la tête aux pieds, tandis que le geôlier éclatait de rire à son tour. Il faisait toujours nuit noire ; les deux sentinelles du rempart et celle de la courtine lancèrent à la fois leurs trois qui-vive ? Et l’on entendit les crosses de leurs fusils résonner sur les dalles.
Hector prêtait l’oreille avidement. Ce qui avait occasionné le rire du geôlier, l’alerte des sentinelles et la subite émotion du prisonnier, le voici :
Une voix s’était élevée de l’autre côté des fortifications, à peu près à l’endroit où Hector avait entendu, le soir précédent, ce cri si longtemps espéré, ce cri qui avait fiancé son nom au nom d’Honorine de Blamont. C’était encore un cri cette fois, mais qui était poussé par une voix de femme et qui ne disait qu’un nom : Hector ! Ce nom fut prononcé trois fois. Le geôlier pouffait de rire.
– Ah ! grommelait-il dans sa rancune : c’est le cas de le dire : tu peux t’égosiller, ma fille ! Appelle ! appelle ! jusqu’à ce qu’il te réponde ! Le filou ! qui n’a rien mis au bout de la corde !
– Hector ! Hector ! Hector ! appela de nouveau la voix de la jeune fille.
Il y a d’étranges illusions. Hector eût juré ses grands dieux que c’était Honorine elle-même. Le geôlier implacable, tourné vers la fenêtre, répétait :
– Appelle ! appelle ! ne te gêne pas !
Il poussa un cri étouffé. Quelque chose venait de toucher son épaule. En se retournant brusquement et en voyant la porte qu’il avait oublié de refermer, il crut d’abord à quelque plaisanterie d’un employé de la prison ; mais il regarda mieux, et ses jambes flageolèrent sous le poids de son corps. La lumière de la lanterne éclairait d’en bas le visage d’Hector.
Hector tenait d’une main une bourse et la bague. Cette main-là était ouverte et tendue. De l’autre, il s’appuyait sur son barreau de fer. Les dents de l’Auvergnat claquaient. Ses yeux roulaient, et le souffle s’arrêtait dans sa gorge. Il recula jusqu’à ce que sa tête, rejetée en arrière, vînt choquer la muraille au-dessous de la fenêtre.
– Ah ! ah ! fit-il, sans savoir qu’il parlait : vous voilà, monsieur Hector ! C’est le cas de le dire : je vous croyais bien loin !
Il essaya de rire, mais les muscles bouleversés de sa figure n’obtinrent qu’une hideuse grimace. Il faut bien dire l’idée qui dominait en lui, au milieu de son trouble et de sa terreur. On ne la devinerait pas. Cette idée était : vingt mille francs de perdus, sans compter sa place, car Antoine Legagneur allait se venger. Tout à l’heure, Hector ne lui avait volé que cinquante louis et la bague. Maintenant Hector le ruinait de fond en comble. Hector ne parlait point.
– Vous n’avez donc pas osé descendre ? balbutia Larchal, qui essayait de se donner le change à lui-même.
Et, par le fait, il y avait apparence. On ne suppose pas un tour de force comme celui qu’Hector venait d’accomplir. Mais celui-ci prit la lanterne sur le billot et promena la lumière le long de son corps. Larchal vit ses habits en lambeaux et ses mains qui n’étaient plus qu’une plaie. Il détourna la tête.
– La corde était pourtant bonne ! dit-il au hasard.
– La corde était trop courte, répondit Hector, et vous le savez bien… Vous avez parlé tout à l’heure, pendant que vous croyiez être seul.
– J’ai parlé !… répéta Larchal, dont le regard s’éloignait toujours d’Hector ; c’est le cas de le dire : je ne m’en souviens plus.
Si notre jeune prisonnier avait été dans une situation d’esprit à observer attentivement les traits de l’Auvergnat, il aurait vu changer peu à peu l’expression de sa physionomie. Une idée germait dans cette épaisse cervelle de coquin. Larchal se disait :
– Il y a la corde que je peux rattacher. Il y a le barreau coupé. Je suis dans, mon droit. On me devra une récompense, et le major ne pourra me filer dans la manche !
Larchal n’était pas un homme brave, mais il avait le sang-froid flamand, et quand sa cupidité auvergnate était en jeu, il pouvait payer de sa personne. Il était solidement bâti. Sa carrure annonçait un hercule. Il se disait encore :
– Ses mains n’ont plus de cuir sur la chair… ça ne doit pas tenir bien dur !
– Vous avez voulu m’assassiner, reprit cependant le jeune prisonnier ; ne niez pas : je n’ai pas l’intention de me venger de vous. Je sais à qui je dois m’en prendre. Laissons donc de côté cette dette, dont je n’exige pas le payement. Le marché tient toujours, si vous voulez. Voici la bourse et voici la bague.
– Et que faut-il faire ? demanda Larchal.
– Me donner votre pantalon, votre veste, votre casquette et votre lanterne.
– Et ma tête avec, n’est-ce pas ?
– Vous direz que je vous ai terrassé… vous direz…
Larchal semblait réfléchir.
– Ce que je demande, ajouta Hector, il me le faut… et sur-le-champ ! Si vous ne voulez pas me le donner, je vais le prendre !
Il fit un pas en avant. Larchal feignit de vouloir reculer encore. Son regard sournois interrogea de nouveau la main droite du prisonnier, qui n’était qu’une sanglante meurtrissure. Pour la seconde fois, il se dit :
– Ça ne doit pas serrer bien dur, une main pareille. En tournant la barre, je mettrai la chair à vif ; il lâchera !…
– Ne me faites pas de mal, monsieur Hector ! supplia-t-il d’une voix dolente. C’est le cas de le dire : Vous frapperiez sur un innocent.
– Une fois ! dit Hector, qui avait remis la lanterne sur le billot ; si je vais jusqu’à trois, tant pis pour vous… Deux fois !
Larchal se prit à déboutonner à deux mains sa grosse veste poilue.
– C’est le cas de le dire, grommela-t-il, vous ne donnez pas le temps de la réflexion, vous !
Ceci fut prononcé d’un accent si bourru, que le prisonnier n’eut pas de soupçons. Mais Larchal jouait la comédie. Au lieu de se dépouiller de sa veste, il prit, sous le revers, un long couteau à manche et bondit en avant. Le premier coup qu’il porta toucha Hector en pleine poitrine.
Larchal poussa un grognement de joie en sentant la lame pénétrer dans la chair. Il jeta son couteau et voulut saisir la barre. Hector avait chancelé. Un jet de sang rougissait déjà sa chemise.
Il évita néanmoins le second choc du geôlier en se portant de côté. La bourse et la bague tombèrent. Il lui fallait sa main gauche pour presser sa poitrine.
Larchal mit ses deux mains sur ses genoux et plia les jarrets. Il avait l’air d’un tigre qui va s’élancer.
Ses yeux rouges, que recouvraient presque entièrement les touffes de ses sourcils, dardaient un regard d’hyène sur sa victime. Il guettait le premier spasme, car la blessure, à son compte, devait être bonne.
En effet, le sang abandonnait le visage d’Hector. Une ligne bistrée estompait le dessous de ses paupières, et sa bouche avait des contractions.
– C’est le cas de le dire, gronda Larchal, dont les lèvres retrouvèrent un brutal sourire : Tu m’as fait une fameuse souleur, blanc-bec.
Il ramassa son couteau tout humide, sans oublier la bourse et le diamant. Hector, haletant déjà, s’était reculé jusqu’à la porte. Il s’appuyait au montant.
– N’est-ce pas que tu n’en vaux pas six ? demanda Larchal.
Il prit le billot de la main gauche, et, tenant son couteau de la droite, il s’avança crânement. À moitié route, il changea d’idée. Il saisit le billot à deux mains pour assommer Hector, et il le souleva. Un instant, le billot fut entre lui et le jeune prisonnier.
Cet instant suffit.
Le lion mourant broie son ennemi dans sa suprême convulsion. Hector avait bondi à son tour avec un râle arraché par la souffrance.
La main droite du geôlier, brisée au poignet, pendit.
Le billot tomba. La barre de fer frappa un second coup.
Le geôlier se coucha auprès du billot, la tête horriblement fracassée. Il ne bougea plus.
Hector s’assit sur le billot. Il prit sa tête à deux mains. Le sang remontait jusqu’à ses lèvres.
Mais la voix plus lointaine, la voix de jeune fille, arriva encore apportée par le vent. Elle disait :
– Hector ! Hector !
Hector mit son mouchoir en bouchon et le pressa sur sa blessure. Son gilet boutonné maintint ce grossier appareil. Les larmes lui venaient aux yeux et il murmurait :
– Honorine ! c’est Honorine ! aurai-je le temps d’arriver jusqu’à elle pour lui dire mon dernier adieu ?
Assurément, cette idée était invraisemblable et folle. Mlle de Blamont ! oser un acte pareil ! Mais à cette heure, sa tête était perdue.
Et s’il ne l’avait pas eue, cette idée extravagante, s’il n’avait pas entendu en rêve cette noble et chère voix qui l’appelait, il fût resté là inerte, accablé sous son mal physique et sous l’émotion terrible du meurtre qu’il venait de commettre.
Sortir de la prison, telle était désormais la seule pensée qui se formait en lui. Il se souvenait vaguement de tout ce qu’il avait arrangé pour son évasion. Il coordonnait ses idées acquises par un effort instinctif, mais plein de fatigue. Il ne discutait rien.
Il exécutait ses résolutions comme on obéit à un ordre, parce qu’il sentait bien que son être amoindri avait momentanément perdu sa vaillance. Il se voyait dans le passé comme un géant.
La grosse veste de Larchal fut dépouillée, et avec quelle peine ! Chaque fois que la position du corps présentait un obstacle, Hector pressant d’une main sa poitrine et s’efforçant de l’autre, laissait échapper de rauques gémissements.
Le geôlier devait être bien mort, car son corps se manœuvrait comme une masse. Après la veste, Hector prit le pantalon.
Quand ce fut fait, Hector tâta le cœur du geôlier qui ne battait plus.
Il s’agissait maintenant de se vêtir. Hector étancha son front inondé de sueur glacée. Le souffle lui manquait à chaque instant. Sa jeune et vigoureuse nature fléchissait de plus en plus. Il sentait sur sa poitrine un poids froid. C’était le mouchoir, alourdi et gonflé de sang comme une éponge.
Il réussit pourtant à passer le pantalon, puis le gros paletot-veste. Au moment où il se baissait pour prendre la casquette, des voix se firent entendre dans le corridor. Elles parlaient de Larchal.
– On l’a vu monter ! disait-on.
– Il doit être chez le maréchal des logis.
Et des pas pressés résonnaient sur le carreau, Hector, se coiffa précipitamment de la casquette. Il saisit la lanterne d’une main, de l’autre le trousseau de clefs.
– Geôlier, cria une des voix.
Et l’autre :
– Monsieur Larchal !
C’étaient deux guichetiers qui arrivaient ensemble à la porte. Hector, heureusement, était déjà sorti à moitié.
Il les poussa du dos avec rudesse et ferma la porte à double tour.
– Vous êtes tout de même un bonhomme au fond, monsieur Larchal, dit un des deux guichetiers ; vous avez voulu lui annoncer le premier la nouvelle.
– Qu’a-t-il dit, demanda le second, quand il a su qu’il avait sa grâce ?
Hector, au lieu répondre, se mit à marcher lourdement, imitant de son mieux l’allure empâtée de l’Auvergnat greffé sur pied belge. À chaque pas qu’il faisait, il avait grand’peine à retenir un gémissement. Les deux guichetiers le suivaient.
Arrivé au bout du corridor, qui était par bonheur fort obscur, et où les lanternes, qui toutes trois lançaient leurs rayons en avant, ne répandaient point de lumière, Hector saisit brusquement un des employés par le cou et s’appuya sur lui.
– Bien, bien, monsieur Larchal, dit le second, qui aussitôt le soutint de l’autre côté, que ne disiez-vous que vous aviez un coup de trop ?
Hector grommela :
– C’est le cas de le dire.
Puis il fit entendre un grognement confus. C’étaient bien les manières de l’Auvergnat. Les deux guichetiers n’avaient pas l’ombre d’un soupçon. On s’éveillait au quartier de la prison militaire. La porte de la cellule du père Gavaux, située au bas de l’escalier, était grande ouverte, et il y avait une lampe allumée derrière son grillage ; mais le bon vieux commis-greffier était absent.
Les gens de service allaient et venaient déjà par les corridors. Tout le monde parlait, et tout le monde parlait d’Hector. Il entendait ces paroles, qui étaient autour de ses oreilles comme un bourdonnement confus. Plus il allait, plus ses forces diminuaient. Le pas qu’il faisait lui semblait toujours être le dernier. Il ne connaissait pas bien l’intérieur de la prison. Ses yeux voilés distinguaient à peine les objets sur son passage. Il rassembla toute son énergie et balbutia en grossissant sa voix :
– C’est le cas de le dire : je ne sais pas où je suis !
Les deux guichetiers eurent un grand éclat de rire. Hector reprit :
– C’est de l’air que je voudrais, savez-vous.
Son esprit était présent, du moins quant à l’idée de sortir ; mais une fois dehors, que comptait-il faire, incapable qu’il était de se mouvoir ?
Là s’arrêtait son raisonnement.
– Vous allez en avoir, de l’air, monsieur Larchal, repartit un des servants, et de la bonne ! Il fait frisquet, ce matin, et comme le vent vient du sud-est, vous l’aurez en plein, là-bas, à la poterne.
Hector eut un mouvement de joie irréfléchie. Il lui sembla qu’il était sauvé, puisqu’on le conduisait à la poterne.
Mais le servant ajouta :
– Je ne sais pas ce que le major Antoine veut vous dire, mais il avait l’air diantrement pressé de vous voir !
C’était donc le major Antoine Legagneur qui attendait à la poterne ! Hector frissonna.
XV LA POTERNE
Le Champ de Mars de Sedan, borné vers l’ouest et le nord par le château, touche à la campagne vers l’est et le sud. Ce sont de grandes cultures ou coutures, comme on dit dans le pays, qui vont rejoindre la route de Bazeille et celle de Givonne.
Le Champ de Mars est de forme à peu près régulière ; mais à l’époque où se passe notre histoire, le bastion Savary s’avançait avec ses ouvrages à cornes et faisait enclave dans le terrain de manœuvres. Derrière le bastion était un recoin désert qui donnait passage pour rejoindre les routes de Givonne et de la Virée. Une poterne ouverte au revers du bastion, et connue sous le nom de poterne de l’Est, desservait les appartements des fonctionnaires du château.
Elle n’avait ni concierge ni sentinelle.
Pendant que les événements racontés au précédent chapitre avaient lieu, le Champ de Mars s’emplissait, comme nous l’avons dit, et la foule s’y amassait, de plus en plus compacte. Mais, comme chacun était là pour voir, personne ne songeait à tourner le bastion pour se mettre à l’aise. L’emplacement situé devant la poterne de l’Est était complètement solitaire.
Vers cinq heures et demie du matin, au milieu de l’obscurité la plus profonde, une voiture s’y engagea et quatre hommes en descendirent. Le cocher s’accula à un bouquet d’ormes rabougris qui bordait les coutures.
Il y avait deux jeunes gens, un homme entre deux âges, dont l’apparence était presque herculéenne, et un petit vieillard. De l’endroit où ils étaient, on entendait le bruit de la cohue voisine, semblable aux grands bourdonnements d’une mer houleuse. Ces gens étaient les deux neveux Legagneur, le major Antoine et le baron Michel. Ils se disputaient entre eux, tout en descendant de voiture, et les deux neveux, ivres aux trois quarts, parlaient haut à leur vieil oncle, qu’ils traitaient avec le dernier mépris.
La haute société marchande de Sedan était accoutumée à voir dans le baron Michel une sorte de lama, entouré de vénération ; mais il arrive souvent que les patriarches de parade servant d’enseignes à certaines industries, payent bien cher le respect mensonger dont on les entoure en public. Ils ressemblent à ces reines de théâtre qui descendent de leur trône pour être tutoyées dans la coulisse.
– Tais-toi, mon oncle, disait François, l’aîné des neveux ; vous devriez avoir honte. C’est vous qui avez tué la maison avec vos manies de trembleur !
– Et je ne sais pas pourquoi nous prenons la peine de t’emmener, ajoutait Étienne, l’autre neveu.
C’étaient, comme nous l’avons dit, les deux fils de Jean Legagneur, second frère du baron, qui possédait un établissement de banque en Belgique.
– Vous m’avez ruiné ! gémissait le vieillard, vous m’avez perdu ! vous m’avez déshonoré !
Les neveux se mirent à rire.
– Allons ! la paix ! fit rudement le major. Tu nous assommes !
Le baron Michel se prit la tête à deux mains et geignit plus fort.
Antoine s’était éloigné. Il frappa doucement à la poterne du bastion. Le chien de garde hurla dans la cour intérieure. Ce fut tout. Antoine redoubla.
Comme il n’obtenait point encore de réponse, il murmura : « Larchal est en retard ! »
Le neveu Étienne avait cependant saisi Michel Legagneur par le bras.
– Entends-tu, mon oncle ? lui dit-il ; ne te vante pas trop haut d’être ruiné : toutes les pies de Sedan et des environs sont là, de l’autre côté de ce mur, et jacassent…
Le neveu François était allé en éclaireur jusqu’à l’angle du bastion. Il revint en même temps qu’Antoine, qui dit :
– Michel, tu fais le fou. Que perds-tu de plus que nous ?
– Mon nom, mes biens, mon honneur…
– Ton nom, c’est le nôtre, Michel. Tes biens étaient à nous ; tu n’as pas d’honneur… Veux-tu que je te dise ? Je suis sûr que tu as caché de l’argent dans quelque trou !
– Sur ma part de paradis !… commença le baron…
– Tu n’as pas de paradis ; mais laissons cela. Assurément, il aurait mieux valu rester sur notre terrain ; j’aurais gardé, moi, mon grade de major, et toi ta considération commerciale, qui nous a coûté si cher ; mais la faute est à toi, tu as mal tenu nos cartes.
– Voilà tout, dit François.
Et Étienne répéta :
– Voilà tout !
Le baron Michel se mit à pleurer et dit :
– Vous outragez mes cheveux blancs !
Ceux qui connaissaient le mieux M. le baron Legagneur, n’auraient point su dire au juste s’il était en enfance ou s’il jouait la comédie. Il y avait d’ailleurs du vrai dans les deux opinions. C’était une ruine de comédien.
Sa diplomatie fuyait comme un vase fêlé. Il continuait sa mise en scène, lors même qu’il n’y avait plus personne à tromper. Antoine poursuivit :
– Nous t’avions doré comme une châsse, morbleu ! nous t’avions paré comme une idole ! Et tu as fini par te prendre au sérieux comme l’âne qui portait des reliques ! Nous avions besoin d’une enseigne ; tu as été notre enseigne. Console-toi ! Tu seras le baron Michel en Belgique comme en France. Notre faillite n’est qu’un déménagement.
Le baron prit son foulard et le mit sur ses yeux.
– À mon âge, déclama-t-il, s’exiler ! mourir loin de sa patrie !
– Tu n’as pas de patrie. Nous passons la frontière, parce que notre fortune est là, de l’autre côté, une fortune immense qui ne peut nous échapper.
Tout en parlant, Antoine n’avait cessé de prêter l’oreille en guettant la poterne. Quand il vit que rien ne venait, il dit avec colère :
– Larchal me le payera ! En attendant, nous ne pouvons rester ici ; ce qui s’est passé cette nuit derrière ces murailles est notre œuvre commune…
– Je le nie ! s’écria le baron.
– Nous l’acceptons ! dirent les deux neveux Legagneur.
– Tu le nies, répéta Antoine ; mais tu partageras, tu es fait comme cela, mon vertueux frère ; ennemi du combat, ami du butin.
Il se rapprocha subitement et se prit à parler à voix basse.
– J’ai tout sacrifié, moi, dit-il ; il fallait jouer franc jeu : entre nous et ce trésor de Soleuvre, qui nous rendra maîtres d’autres trésors incalculables, ceux-là, il y avait un héritier ; j’ai fait disparaître l’héritier… J’épouse la fille de l’homme qui a la clef du trésor… Est-ce toi qui es le chef ou est-ce moi, mon frère Michel ?
Le baron étendit la main comme pour le repousser.
– S’il faut mériter cette suprématie par un meurtre, déclama-t-il, je m’y refuse avec horreur ! Le sang de ce malheureux jeune homme…
Il n’acheva pas. Par un signe, le neveu François lui ferma la bouche, tandis qu’Antoine, lui serrant le bras convulsivement, disait à son oreille :
– La chose est faite, tu es complice. Si tu veux rester en France, nous ne t’emmènerons pas de force !
Michel courba la tête et se tut. Dans le silence, on entendit mieux les impatients murmures de la foule qui emplissait le Champ de Mars. Le major Antoine gagna de nouveau la poterne et frappa plus fort que la première fois. Le chien de garde aboya. Une voix se fit entendre presque aussitôt après à l’intérieur.
– Qui va là ? demanda-t-elle.
– Ce n’est pas Larchal ! gronda le major, qui ne reconnaissait pas cette voix.
Il hésita. La crainte le prenait.
– Qui va là ? répéta la voix.
– Et bien ! fit le neveu François, qui s’était rapproché : Est-ce qu’on va partir sans savoir ?
Et, comme son oncle tardait à répondre, il se chargea de dire lui-même :
– C’est moi, le major Legagneur.
La clef tourna dans la serrure aussitôt.
Le bon vieux père Gavaux, commis greffier près les conseils de guerre, montra sa taille maigre et cassée en deux, à la porte.
– Comme ça se trouve ! dit-il ; salue bien, major ! Je sortais pour aller chez vous ; c’est de bonne heure, pas vrai ? Mais le colonel Poncelet a passé la nuit au château, nous avons des dépêches de Paris, et j’allais vous les porter.
– Donnez, monsieur Gavaux, donnez !
Le vieil employé lui mit dans la main un large pli. Le neveu François et les deux autres se tenaient immobiles dans l’ombre du fossé. Il ne fallait pas songer à voir ce qu’il y avait dans l’enveloppe cachetée. La nuit était toujours aussi noire.
– Voici le port, monsieur Gavaux, dit Antoine Legagneur, cherchant la main du vieillard pour y glisser un gros écu de cinq francs.
Celui-ci déclara, selon l’usage, qu’il se garderait bien de rien prendre, mais il empocha l’écu et dit :
– Voulez-vous entrer pour lire un peu la chose ?
– Non, je voudrais seulement voir Larchal, répondit le major.
M. Gavaux appela un guichetier qui passait dans le préau, et dit à haute voix :
– Prévenez M. Larchal que le major Legagneur l’attend ici.
Le guichetier obéit. M. Gavaux continua :
– On a travaillé toute la nuit, le colonel n’a pas fermé l’œil, mais il ne s’en plaint pas, non, car c’est un brave cœur, et quand il a reçu la grâce, il a lampé une choppe pleine de vin à la santé du ministre !
– Ah ! fit Antoine, la grâce est arrivée !
– Sur le minuit, pas avant, il était temps. L’exprès a eu du retard en chemin.
– Et, dit le major, le condamné ?