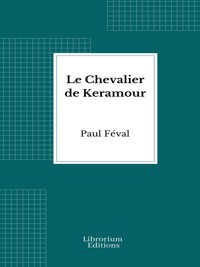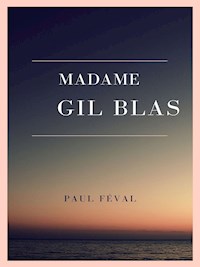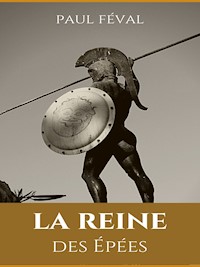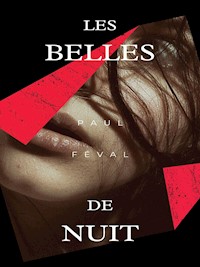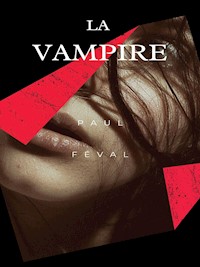
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Février 1804, dans les rues de Paris, la rumeur grandit. Une vampire aurait pris ses quartiers en bord de Seine et serait déjà responsable de la disparition d'une centaine de jeunes gens fortunés. C'est que cette vampire-là semble autant intéressée par l'or que par le sang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Vampire
La VampireAVANT-PROPOSI. LA PECHE MIRACULEUSEII. SAINT-LOUIS-EN-L'ILEIII. GERMAIN PATOUIV. LE COEUR D'ORV. LA BORNEVI. LA MAISON ISOLÉEVII. L'AFFUTVIII. LE NARCOTIQUEIX. ENTRE DEUX AMOURSX. TÊTE-A-TÊTEXI. LE COMTE MARCIAN GREGORYIXII. LA CHAMBRE SANS FENÊTREXIII. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRALXIV. LA LEÇON D'ARMES DU CITOYEN BONAPARTEXV. LA RUE DE LA LANTERNEXVI. LES TROIS ALLEMANDSXVIII. UNE NUIT SUR LA SEINEXVIII. LA COMTESSE MARCIAN GREGORYIXIX. DERNIÈRE NUITXX. MAISON VIDEXXI. PAUVRE ANGÈLE !XXII. SIMILIA SIMILIBUS CURANTURXXIII. LE RÉVEILXXIV. LA RUE SAINT HYACINTHE SAINT MICHELXXV. L'EMBARRAS DE VOITURESXXVI. MAISON NEUVEXXVII. ADDHÉMAPage de copyrightLa Vampire
Paul Féval
AVANT-PROPOS
Ceci est une étrange histoire dont le fond, rigoureusement authentique, nous a été fourni comme les neuf dixièmes des matériaux qui composent ce livre, par le manuscrit du « papa Sévérin ».
Mais le hasard, ici, est venu ajouter, aux renseignements exacts donnés par l'excellent homme, d'autres renseignements qui nous ont permis d'expliquer certains faits que notre héroïque bonne d'enfants des Tuileries regardait comme franchement surnaturels.
Ces éclaircissements, grâce auxquels ce drame fantastique va passer sous les yeux du lecteur dans sa bizarre et sombre réalité, sont puisés à deux sources : une page inédite de la correspondance du duc de Rovigo, qui eut, comme on sait, la confiance intime de l'empereur et qui fut chargé, pendant la retraite de Fouché (1802-1804), de contrôler militairement la police générale, dont les bureaux étaient administrativement réunis au département de la justice, dirigé par le grand-juge Régnier, duc de Massa.
Ceci est la première source. La seconde, tout orale, consiste en de nombreuses conversations avec le respectable M.G., ancien secrétaire particulier du comte Dubois, préfet de police à la même époque.
Nous nous occuperons peu des événements politiques, intérieurs, qui tourmentèrent cette période, précédant immédiatement le couronnement de Napoléon. Saint-Rejant, Pichegru, Moreau, la machine infernale n'entrent point dans notre sujet et c'est à peine si nous verrons passer ce gros homme, Bru, tus de la royauté, audacieux et solide comme un conjuré antique : Georges Cadoudal.
Les guerres étrangères nous prendront encore moins de place. On n'entendait en 1804 que le lointain canon de l'Angleterre.
Nous avons à raconter un épisode, historique il est vrai, mais bourgeois, et qui n'a aucun trait ni à l'intrigue du cabinet ni aux victoires et conquêtes.
C'est tout bonnement une page de la biographie secrète de ce géant qu'on nomme Paris et qui, en sa vie, eut tant d'aventures !
Laissons donc de côté les cinq cents volumes de mémoires diffus qui disent le blanc et le noir sur cette grande crise de notre Révolution, et tournant le dos au château où la main crochue de ce bon M. Bourrienne griffonne quelques vérités parmi des monceaux de mensonges bien payés, plongeons-nous de parti pris dans le fourré le plus profond de la forêt parisienne.
Nous avons l'espoir que le lecteur n'aura pas oublié cette touchante et sereine figure qui traverse les pages de notre introduction. Il n'y a que des récits dans ce livre : notre préface elle-même était encore un récit, dont le héros se nommait le « papa Sévérin ».
Nous avons la certitude que le lecteur se souvient d'une autre physionomie, tendre et bonne aussi, mais d'une autre manière, moins austère et plus mâle, plus tourmentée, moins pacifique surtout : le chantre de Saint-Sulpice, le prévôt d'armes qui, dans la Chambre des Amours, enseigna si rudement ce beau coup droit, dégagé main sur main, à M. le baron de Guitry, gentilhomme de la chambre du roi Louis XVI.
Un Sévérin aussi : Sévérin, dit Gâteloup.
Ce Gâteloup, presque vieillard, et papa Sévérin presque enfant, vont avoir des rôles dans cette histoire.
L'un était le père de l'autre.
Et s'il m'était permis de descendre encore plus avant dans nos communs souvenirs, je vous rappellerais cette chère petite famille, composée de cinq enfants qui ne se ressemblaient point, et dont papa Sévérin était la bonne aux Tuileries : Eugénie, Angèle et Jean qui avaient le même âge, Louis et Julien, des bambins.
Ces cinq êtres, abandonnés, orphelins, mais à qui Dieu clément avait rendu le meilleur des pères, reviendront tous et chacun sous notre plume. Ils forment à eux cinq, dans la personne de leurs parents, la légende lamentable du suicide.
Papa Sévérin avait dit en montrant Angèle, la plus jolie de ces petites filles, et celle dont la précoce pâleur nous frappa comme un signe de fatalité :
– Celle-ci tient à ma famille par trois liens.
Il avait ajouté ce jour où la fillette jetait ses regards avides à travers les glaces de la Morgue :
– Elle a déjà l'idée…
Car papa Sévérin croyait à la transmission d'un héritage fatal.
Notre histoire va montrer la première des trois Angèle.
Notre histoire va montrer aussi les tables de marbre toutes neuves et vierges encore de tout contact mortel. Nous y verrons quelle fut l'étrenne de la Morgue du Marché-Neuf.
Tout cela à propos d'un adorable et impur démon qui ressuscita un instant, au beau milieu de Paris et près du berceau de notre « siècle des lumières », les plus noires superstitions du moyen âge.
I. LA PECHE MIRACULEUSE
Le commencement du siècle où nous sommes fut beaucoup plus légendaire qu'on ne le croit généralement. Et je ne parle pas ici de cette immense légende de nos gloires militaires, dont le sang républicain écrivit les premières pages au bruit triomphant de la fanfare marseillaise, qui déroula ses chants à travers l'éblouissement de l'empire et noya sa dernière strophe – un cri splendide – dans le grand deuil de Waterloo.
Je parle de la légende des conteurs, des récits qui endorment ou passionnent la veillée, des choses poétiques, bizarres, surnaturelles, dont le scepticisme du dix-huitième siècle avait essayé de faire table nette.
Souvenons-nous que l'empereur Napoléon Ier aimait à la folie les brouillards rêveurs d'Ossian, passés par M. Baour au tamis académique. C'est la légende guindée, roidie par l'empois ; mais c'est toujours la légende.
Et souvenons-nous aussi que le roi légitime des pays légendaires, Walter Scott, avait trente ans quand le siècle naquit.
Anne Radcliffe, la sombre mère de tant de mystères et de tant de terreurs, était alors dans tout l'éclat de cette vogue qui donna le frisson à l'Europe. On courait après la peur, on recherchait le ténébreux. Tel livre sans queue ni tête obtenait un frénétique succès rien que par la description d'une oubliette à ressort, d'un cimetière peuplé de fantômes à l'heure « où l'airain sonne douze fois » ou d'un confessionnal à double fond bourré d'impossibilités horribles et lubriques.
C'était la mode ; on faisait à ces fadaises une toilette de grands mots, appartenant spécialement à cette époque solennelle ; on mettait le tout comme une purée sous le héros, cuit à point, qui était un « cœur vertueux », une « âme sensible », daignant croire au « souverain maître de l'univers » et aimant à voir lever l'aurore.
Le contraste de ces confitures philosophiques et de ces sépulcrales abominations formait un plat hybride, peu comestible, mais d'un goût étrange qui plaisait à ces jolies dames, vêtues si drôlement, avec des bagues aux orteils, la ceinture au-dessus du sein, la hanche dans un fourreau de parapluie et la tête sous une gigantesque feuille de chicorée.
Paris a toujours adoré d'ailleurs les contes à dormir debout, qui lui procurent la délicieuse sensation de la chair de poule. Quand Paris était encore tout petit, il avait déjà nombre d'histoires à faire frémir, depuis la coupable association formée entre le barbier et le pâtissier de la rue des Marmousets, pour le débit des vol-au-vent de gentilshommes, jusqu'à la boucherie galante de la maison du cul-de-sac Saint-Benoît, dont les murs démolis avaient plus d'ossements humains que de pierres.
Et depuis si longtemps, à cet égard, Paris a peu changé. Aux premiers mois de l'année 1804, il y avait dans Paris une vague et lugubre rumeur, née de ce fait que des pêches miraculeuses avaient lieu depuis quelque temps à la pointe orientale de l'Île Saint-Louis, en tournant un peu vers le sud-est, non loin de l'endroit où les bains Petit réunissent aujourd'hui, dans les mois d'été, l'élite des tritons parisiens.
C'est chose rare qu'un banc de poisson dans Paris. Tant d'hameçons, tant de nasses, tant d'engins divers sont cachés sous l'eau entre Bercy et Grenelle, que les goujons seuls, d'ordinaire, et les imprudents barbillons se hasardent dans ce parcours semé de périls. Vous n'y trouveriez ni une carpe, ni une tanche, ni une perche, et si parfois un brochet s'y engage, c'est que ce requin d'eau douce a le caractère tout particulièrement aventureux.
Aussi la gent pêcheuse faisait-elle grand bruit de l'aubaine envoyée par la Providence aux citoyens amateurs de la ligne, de l'épervier et du carrelet. Sur un parcours d'une centaine de pas depuis l'égout de Bretonvilliers jusqu'au quai de la Tournelle, tout le long du quai de Béthune, vous auriez vu, tant que le jour durant, une file de vrais croyants, immobiles et silencieux, tenant la ligne et suivant d'un œil inquiet le bouchon flottant au fil de l'eau.
Dire que tout le monde emplissait son panier serait une imposture. Les bancs de poisson, à Paris, ne ressemblent à ceux de nos côtes ; mais il est certain que ça et là un heureux gaillard piquait un gros brochet ou un barbillon de taille inusitée. Les goujons abondaient, les chevaignes tournoyaient à fleur d'eau, et l'on voyait glisser dans l'onde trouble ces reflets pourprés qui annoncent la présence du gardon.
Ceci, en plein hiver et alors que d'habitude les poissons parisiens, frileux comme des marmottes, semblent déserter la Seine pour aller se chauffer on ne sait où.
En apparence, il y a loin de cette joie des pêcheurs et de cette folie du poisson à la rumeur lugubre dont nous avons annoncé la naissance. Mais Paris est un raisonneur de première force ; il remonte volontiers de l'effet à la cause, et Dieu sait qu'il invente parfois de bien drôles de causes pour les plus vulgaires effets.
D'ailleurs, nous n'avons pas tout dit. Ce n'était pas exclusivement pour pêcher du poisson que tant de lignes suspendaient l'amorce le long du quai de Béthune. Parmi les pêcheurs de profession ou d'habitude qui venaient là chaque jour, il y avait nombre de profanes, gens d'aventures et d'imagination, qui visaient à une tout autre proie.
Le Pérou était passé de mode et l'on n'avait pas encore inventé la Californie. Les pauvres diables qui courent après la fortune ne savaient trop où donner de la tête et cherchaient leur vie au hasard.
L'Europe ingrate ne sait pas le service que lui rendent ces féeriques vésicatoires qui se nomment sur la carte du monde San Francisco, Monterey, Sydney ou Melbourne.
Il y avait bien la guerre, en ce temps-là, mais à la guerre on gagne plus de horions que d'écus, et les aventuriers modèles, les « vrais chercheurs d'or » font rarement les bons soldats de la bataille rangée.
Il y avait là, sous le quai de Béthune, des poètes déclassés, des inventeurs vaincus, d'anciens don Juan, banqueroutiers de l'industrie d'amour qui s'étaient cassé bras et jambes en voulant grimper à l'échelle des femme, des hommes politiques dont l'ambition avait pris racine dans le ruisseau, des artistes souffletés par la renommée, – cette cruelle ! – des comédiens honnis, des philanthropes maladroits, des génies persécutés, et ce notaire qui est partout, même au bagne, pour avoir accompli son sacerdoce avec trop de ferveur.
Nous le répétons, de nos jours, tous ces braves eussent été dans la Sonore ou en Australie, qui sont de bien utiles pays. En l'année 1804, s'ils grelottaient les pieds dans l'eau, sondant avec mélancolie le cours troublé de la Seine, c'est que la légende plaçait au fond de la Seine un fantastique Eldorado.
Au coin de la rue de Bretonvilliers et du quai, il y avait un petit cabaret de fondation nouvelle qui portait pour enseigne un tableau, brossé naïvement par un peintre étranger à l'Académie des beaux-arts.
Ce tableau représentait deux sujets fraternellement juxtaposés dans le même cadre.
Premier sujet : Ezéchiel en costume de ravageur, faisant tourner d'une main sa sébile, au fond de laquelle on voyait briller des pièces d'or, et relevant de l'autre une ligne, dont la gaule, pliée en deux, supportait un monstre marin copié sur nature dans le récit de Théramène.
Ezéchiel était le nom du maître du cabaret.
Second sujet : Ezéchiel en costume de maison, éventrant, dans le silence du cabinet, le monstre dont il est question ci-dessus et retirant de son ventre une bague chevalière ornée d'un brillant qui reluisait comme le soleil.
Il est juste d'ajouter que la bague était passée à un doigt et que le doigt appartenait à une main. Le tout avait été avalé par le monstre du récit de Théramène, sans mastication préalable et avec une évidente volupté dont témoignait encore :
Sa croupe recourbée en replis tortueux.
Les deux sujets jumeaux n'avaient qu'une seule légende qui disait en lettres mal formées :
À la pêche miraculeuse
Le lecteur commence peut-être à comprendre la connexité existant entre le fameux banc de poisson de l'île Saint-Louis et cette rumeur funèbre qui courait vaguement dans Paris.
Nous ne lui marchanderons point, du reste, le chapitre des explications.
Mais, pour le moment, il nous faut dire que tout Paris connaissait l'aventure d'Ezéchiel représentée par le tableau, aventure authentique, acceptée, populaire, et dont personne ne se serait avisé de mettre en doute l'exactitude avérée.
En effet, avec le produit de la vente de ce bijou trouvé dans l'estomac du monstre, Ezéchiel avait monté, au vu et au su de tout le monde, son établissement de cabaretier.
Et comme il avait découvert le premier ce Pérou en miniature, ce gisement de richesses subaquatiques, il était permis à l'imagination des badauds d'enfiler à son sujet tout un chapelet d'hypothèses dorées. Son nom indiquait une origine israélite, et l'on sait la bonne réputation accordée à l'ancien peuple de Dieu par la classe ouvrière. On parlait déjà d'un caveau où Ezéchiel amoncelait des trésors.
Les autres étaient venus quand la veine aurifère était déjà écrémée ; les autres, pêcheurs naïfs ou pécheurs d'aventures : les poètes, les inventeurs, les don Juan battus, les industriels tombés, les artistes manqués, les comédiens fourbus, les philanthropes usés jusqu'à la corde, les génies piqués aux vers – et le notaire n'avaient eu pour tout potage que les restes de cet heureux Ezéchiel.
Ils étaient là, non point pour le poisson qui foisonnait réellement d'une façon extraordinaire, mais pour la bague chevalière dont le chaton en brillants reluisait comme le soleil.
Ils eussent volontiers plongé tête première pour explorer le fond de l'eau, si la Seine, jaune, haute, rapide et entraînant dans sa course des tourbillons écumeux, n'eût pas défendu les prouesses de ce genre.
Ils apportaient des sébiles pour ravager le bas de la berge dès que l'eau abaisserait son niveau.
Ils attendaient, consultant l'étiage d'un œil fiévreux, et voyant au fond de l'eau des amas de richesses.
Ezéchiel, assis à son comptoir, leur vendait de l'eau-de-vie et les entretenait avec soin dans cette opinion qui achalandait son cabaret. Il était éloquent, cet Ezéchiel, et racontait volontiers que la nuit, au clair de la lune, il avait vu, de ses yeux, des poissons qui se disputaient des lambeaux de chair humaine à la surface de l'eau.
Bien plus, il ajoutait qu'ayant noyé ses lignes de fond, amorcées de fromage de Gruyère et de sang de bœuf, en aval de l'égout, il avait pris une de ces anguilles courtes, replètes et marquées de taches de feu qu'on rencontre en Loire entre Paimbœuf et Nantes, mais qui sont rares en Seine, autant que le merle blanc dans nos vergers : une lamproie, ce poisson cannibale, que les patriciens de Rome nourrissaient avec de la chair d'esclave.
D'où venait l'abondante et mystérieuse pâture qui attirait tant d'hôtes voraces précisément en ce lieu ?
Cette question était posée mille fois tous les jours, les réponses ne manquaient point. Il y en avait de toutes couleurs ; seulement, aucune n'était vraisemblable ni bonne.
Cependant, le cabaret de la Pèche miraculeuse et son maître Ezéchiel prospéraient. L'enseigne faisait fortune comme presque toutes les choses à double entente. Elle flattait à la fois, en effet, les pêcheurs sérieux, les pêcheurs de poissons, et cette autre catégorie plus nombreuse, les pêcheurs de chimères, poètes, peintres, comédiens, trouveurs, industriels, bourreaux de femmes en disponibilité et le notaire.
Chacun de ceux-là espérait à tout instant qu'un solitaire de mille louis allait s'accrocher à son hameçon.
Et vis-à-vis de la rangée des pêcheurs, il y avait, de l'autre côté de la rivière, une rangée de badauds qui regardaient de tous leurs yeux. Les cancans allaient et venaient, les commentaires se croisaient : on fabriquait là assez de bourdes pour désaltérer tout Paris, incessamment altéré de choses vraies qui n'ont pas le sens commun.
Je dis choses vraies, parce que, soyez bien persuadés de cela, sous toute rumeur populaire, si absurde qu'elle puisse paraître, un fait réel se cache toujours.
L'opinion la plus accréditée, sinon la plus vraisemblable, se résumait en un mot qui sollicitait énergiquement les imaginations et valait à lui seul deux ou trois des plus ténébreux livres de Mme Anne Radcliffe. Ce mot était plus sombre que le titre fameux le Confessionnal des pénitents noirs. Ce mot était plus mystérieux que les Mystères du château des Pyrénées, que les Mystères d'Udolphe et que les Mystères de la caverne des Apennins ; il sonnait le glas, il flairait la tombe.
Ce mot, sincèrement appétissant pour les esprits inquiets, curieux, avides, pour les femmes, pour les jeunes gens, pour tous les curieux de terreur et d'horreur, c'était la VAMPIRE.
Notre éducation au sujet de ces funèbres pages du merveilleux en deuil a peu marché depuis lors. On a bien écrit quelques-uns de ces livres qui dissertent sans expliquer, qui compilent sans condenser et qui relient en de gros volumes le pâle ennui de leurs pages didactiques, mais il semblerait que les savants eux-mêmes, ces braves de la pensée, abordent avec un esprit troublé les redoutables questions de démonologie. Parmi eux, les croyants ont un peu physionomie de maniaques, et les incrédules restent mouillés de cette sueur froide, le doute, qui communique à coup sûr l'ennui contagieux.
Je cherche, et je ne trouve pas dans mes souvenirs d'enfant le titre du prodigieux bouquin qui prononça pour la première fois à mes yeux le mot Vampire. Ce n'était pas un décourageant article de revue, ce n'était pas une tranche de ce pain banal qu'on émiette dans les dictionnaires : c'était un pauvre conte allemand, plein de sève et de fougue sous sa toilette de naïveté empesée. Il racontait bonnement, presque timidement, des histoires si sauvages, que j'en ai encore le cœur serré.
Je me souviens qu'il était en trois petits volumes, et qu'il y avait une gravure en taille-douce à la tête de chaque tome.
Elles ne valaient pas un prix fou, mais, Seigneur Dieu, comme elles faisaient frémir !
La première gravure en taille-douce, calme et paisible comme le prologue de tout grand poème, représentait… j'allais dire Faust et Marguerite à leur première rencontre.
Il n'y avait rien là qu'un jeune homme regardant une jeune fille, et cela vous mettait du froid dans les veines, tant Marguerite subissait manifestement le magnétisme fatal qui jaillissait en gerbes invisibles de la prunelle de Faust !
Pourquoi ne garderions-nous pas ces noms : Faust et Marguerite ? Qu'est le chef d'œuvre de Goethe, sinon la splendide mise en scène de l'éternel fait de vampirisme qui, depuis le commencement du monde, a desséché et vidé le cœur de tant de familles ?
Donc Faust regardait Marguerite. – Et c'était une noce, figurez-vous, une noce de campagne où Marguerite était la Fiancée et Faust un invité de hasard. On dansait sur l'herbe parmi des buissons de roses.
Les parents imprudents et le marié aussi, car il avait le bouquet au côté, le pauvre jeune rustre, contemplaient avec admiration Faust qui faisait valser Marguerite.
Faust souriait ; la tète charmante de Marguerite allait se penchant sur son épaule, vêtue du dolman hongrois.
Et sur le buisson de roses qui fleurissait au premier plan, il y avait un large filet dodécagone : une toile d'araignée, au centre de laquelle l'insecte monstrueux qu'on appelle aussi la vampire suçait à loisir la moelle d'une mouche prisonnière…
C'était tout pour la gravure en taille-douce. Au texte maintenant.
La plume peint mieux que le crayon. – Ce sont des plaines immenses que la vieille forteresse d'Ofen regarde par-dessus le Danube, qui la sépare de Pesth la moderne.
De Pesth jusqu'aux forêts Baconier, le long de la Theiss bourbeuse et tumultueuse, c'est la plaine, toujours la plaine, sans limites comme la mer.
Le jour, le soleil sourit à cet océan de verdure, et la brise heureuse caresse en se jouant l'incommensurable champ de maïs, qui est la Hongrie du sud.
La nuit, la lune glisse au-dessus de ces muettes solitudes. Là-bas, les villages ont soixante mille âmes, mais il n'y a point de hameaux. Le souvenir de la guerre avec le Turc agglomère encore les rustiques habitations, abritées comme les troupeaux de moutons au bercail, derrière la tour ventrue coiffée du dôme oriental et armée de canons hors d'usage.
C'est la nuit. Les morts vont vite au pays magyare en Allemagne, mais ils vont en chariot et non à cheval.
C'est la nuit. La lune pend à la coupole d'azur, regardant passer les nues qui galopent follement.
L'horizon plat s'arrondit à perte de vue, montrant ça et là un arbre isolé ou la bascule d'un puits relevée comme une potence.
Un char attelé de quatre chevaux à tous crins passe rapide comme la tempête : un char étrange, haut sur roues, moitié valaque, moitié tartare, et dont l'essieu jette des cris éclatants.
Avez-vous reconnu ce hussard dont le dolman flotte à la brise ? – Et cette enfant, cette douce et blonde fille ? Les morts vont vite : les clochers de Czegled ont fui au lointain, et les tours de Keczkemet et les minarets de Szegedin. Voici les fières murailles de Temesvar, puis, là-bas, Belgrade, la cité des mosquées…
Mais le char ne va pas jusque-là. Sa roue a touché les tables de marbre du dernier cimetière chrétien ; sa roue se brise. Faust est debout, portant Marguerite évanouie dans ses bras…
La seconde gravure en taille-douce, oh ! je m'en souviens bien ! représentait l'intérieur d'une tombe seigneuriale dans le cimetière de Petervardein : une longue file d'arceaux où se mourait la lueur d'une seule lampe.
Marguerite était couchée sur un lit qui ressemblait à un cercueil. Elle avait encore ses habits de fiancée. Elle dormait.
Sous les arceaux, éclairés vaguement, une longue file de cercueils, qui ressemblaient à des lits, supportaient de belles et pâles statues, couchées et dormant l'éternel sommeil.
Toutes étaient vêtues en fiancées ; toutes avaient autour du front la couronne de fleur d'oranger. Toutes étaient blanches de la tête aux pieds, sauf un point ronge au-dessous du sein gauche : la blessure par où Faust Vampire avait bu le sang de leur cœur.
Et Faust, il faut bien le dire, se penchait au-dessus de Marguerite endormie : le beau Faust, le valseur admiré, le tentateur et le fascinateur.
Il était hâve ; sans son costume de hussard vous ne l'auriez point reconnu ; les ossements de son crâne n'avaient plus de cheveux, et ses yeux, ses yeux si beaux, manquaient à leurs orbites vides.
C'était un cadavre, ce Faust, et, chose hideuse à penser, un cadavre ivre !
Il venait d'achever sa lugubre orgie : il avait bu tout le sang du cœur de Marguerite !
Et le texte ? Ma foi, je ne sais plus. Ce second tome était bien moins amusant que le premier. Le vampire hongrois s'ennuie chez lui comme don Juan l'Espagnol, comme l'Anglais Lovelace, comme le Français, bourreau des cœurs, quel que soit son nom. Tous ces coquins-là, tuent platement, comme des pleutres qu'ils sont au fond. Ils ne valent qu'avant l'assassinat. Je n'ai jamais pu découvrir, pour ma part, la grande différence qu'il y a entre ce pauvre Dumolard, vampire des cuisinières, et don Juan grand seigneur. La statue du commandeur elle-même ne me semble pas plus forte que la guillotine.
Et s'il est un maraud capable de plaider la cause aux trois quarts perdue de la guillotine, c'est don Juan.
Passons à la troisième gravure en taille-douce, et qu'on me décerne un prix de mémoire !
Celle-là était la statue du commandeur, la guillotine, tout ce que vous voudrez.
Personne n'ignore qu'un bon vampire était invulnérable et immortel, comme Achille, fils de Pelée, à la condition de n'être point blessé à un certain endroit et d'une certaine façon. Le fameux vampire de Debreckzin vécut et mourut, pour mieux dire, pendant quatre cent quarante quatre ans. Il vivrait encore si le professeur Hemzer ne lui eût plongé dans la région cardiaque un fer à gaufrer rougi préalablement au feu.
C'est là une recette bien connue et qui, au premier aspect, ne nous semble pas dépourvue d'efficacité.
La troisième gravure montrait le vrai cercueil de Faust, où il reposait peut-être depuis des siècles, gardant la bizarre permission de se relever certaines nuits, de revêtir son costume de hussard, toujours propre et fort élégant, pour aller à la chasse de Marguerite.
Faust était là, le monstre ! avec ses yeux brillants et ses lèvres humides. Il buvait le sang de Marguerite, couchée un peu plus loin.
Les gens de la noce avaient, je ne sais trop comment, découvert sa retraite. On avait apporté un fourneau de forge, on avait fait rougir une vaillante barre de fer, et le fiancé la passait à deux mains, de tout son cœur, au travers de l'estomac du vampire, qui n'avait garde de protester.
Et Marguerite s'éveillait là-bas, comme si la mort de son bourreau lui eût rendu la vie.
Voilà ce que disait et ce que contenait mon vieux bouquin en trois petits tomes. Et je déclare que les articles des recueils savants ne m'en ont jamais tant appris sur les vampires.
J'ajoute que les badauds de Paris, en l'an 1804, étaient à peu près de notre force, au bouquin et à moi : ce qui donne la mesure de ce que pouvait être leur opinion au sujet de cet être mystérieux que la frayeur publique avait baptisé : la Vampire.
II. SAINT-LOUIS-EN-L'ILE
La vampire existait, voilà le point de départ et la chose certaine : que ce fût un monstre fantastique comme certains le croyaient fermement, ou une audacieuse bande de malfaiteurs réunis sous cette raison sociale, comme les gens plus éclairés le pensaient, la vampire existait.
Depuis un mois il était bruit de plusieurs disparitions. Les victimes semblaient choisies avec soin parmi cette population flottante et riche qu'un intervalle de paix amenait à Paris. On parlait d'une vingtaine d'étrangers pour le moins, tous jeunes, tous ayant marqué leur passage à Paris par de grandes dépenses, et qui s'étaient éclipsés soudain sans laisser de traces.
Y en avait-il vingt en effet ? La police niait. La police eût affirmé volontiers que ces rumeurs n'avaient pas l'ombre de fondement et qu'elles étaient l'œuvre d'une opposition qui devenait de jour en jour plus hardie.
Mais l'opinion populaire s'affermit d'autant mieux que les dénégations de la police sont plus précises. Dans les faubourgs, ce n'était pas de vingt victimes que l'on parlait, on comptait les victimes par centaines.
À ce point qu'on affirmait l'existence d'un ténébreux charnier situé au bord du fleuve. On ne savait, il est vrai, où ce charnier pouvait être caché ; on objectait même des impossibilités matérielles, car il eût fallu supposer que le fleuve communiquait directement avec cette tombe, pour expliquer le phénomène de la pêche miraculeuse. Et comment admettre la présence d'un canal inconnu aux gens du quartier ?
Dans la saison d'été, la Seine abandonne ses rives et livre à tous regards le secret de ses berges.
C'était assurément là une objection frappante et qui venait à l'appui de l'outrageuse invraisemblance du fait en lui-même : une oubliette au dix-neuvième siècle !
Les sceptiques avaient beau jeu pour rire.
Paris ne se faisait point faute d'imiter les sceptiques. Il riait ; il répétait sur tous les tons ; c'est absurde, c'est impossible.
Mais il avait peur.
Quand les poltrons de village ont peur, la nuit, dans les chemins creux, ils chantent à tue-tête. Paris est ainsi : au milieu de ses plus grandes épouvantes, il rit souvent à gorge. Paris riait donc en tremblant ou tremblait en riant, car les objections et les raisonnements ne peuvent rien contre certaines évidences. La panique se faisait tout doucement. Les personnes sages ne croyaient peut-être pas encore, mais l'inquiétude contagieuse les prenait, et les railleurs eux-mêmes, en colportant leurs moqueries, augmentaient la fièvre.
Deux faits restaient debout, d'ailleurs : la disparition de plusieurs étrangers et provinciaux, disparition qui commençait à produire son résultat d'agitation judiciaire, et cette autre circonstance que le lecteur jugera comme il voudra, mais qui impressionnait Paris plus vivement encore que la première : la pêche miraculeuse du quai de Béthune.
C'était, on peut le dire, une préoccupation générale. Ceux qui se bornaient à hocher la tête en avouant qu'il y avait là « quelque chose » pouvaient passer pour des modèles de prudence.
Est-il besoin d'ajouter que la politique fournissait sa note à ce concert ? Jamais circonstances ne furent plus propices pour mêler le mélodrame politique à l'imbroglio du crime privé. De grands événements se préparaient, de terribles périls, récemment évités, laissaient l'administration fatiguée et pantelante. L'Empire, qui se fondait à bas bruit dans la chambre à coucher du premier consul, donnait à la préfecture les coliques de l'enfantement.
Le citoyen préfet, qui ne devait jamais être un aigle et qui ne s'appelait pas encore le comte Dubois, tressaillait de la tête aux pieds à chaque bruit de porte fermée, croyant ouïr un écho de cette machine infernale dont il n'avait point su prévenir l'explosion. Les sombres inventeurs de cet engin, Saint-Rejant et Carbon, avaient porté leurs têtes sur l'échafaud : mais, du fond de sa disgrâce, Fouché murmurait des paroles qui montaient jusqu'au chef de l'état.
Fouché disait : Saint-Rejant et Carbon ont laissé des fils. Avant eux, il y avait Ceracchi, Diana et Arena qui ont laissé des frères. Entre le premier consul et la couronne, il y a la France républicaine et la France royaliste. Pour sauter ce pas, il faudrait un bon cheval, et Dubois n'est qu'un âne !
Le mot était dur, mais le futur duc d'Otranto avait une langue de fer.
Celui qui devait être l'empereur l'écoutait bien plus qu'il n'en voulait avoir l'air.
Quant à Louis-Nicolas-Pierre-Joseph Dubois, ce n'était pas un âne, non, puisqu'il mangeait des truffes et du poulet, mais c'était un brave homme prodigieusement embarrassé.
Les cartes se brouillaient, en effet, de nouveau, et une conspiration bien autrement redoutable que celle de Saint-Rejant menaçait le premier consul.
Les trois ou quatre polices chargées d'éclairer Paris, affolées tout à coup par ce danger invisible que chacun sentait, mais dont nul ne pouvait saisir la trace palpable, s'entre-choquaient dans la nuit de leur ignorance, se nuisaient l'une à l'autre, se contrecarraient mutuellement, et surtout s'accusaient réciproquement avec un entrain égal.
Paris avait pour elles tant d'affection et en elles tant de confiance, qu'un matin, Paris s'éveilla disant et croyant que la vampire, cette friande de cadavres, était la police, et que les jeunes gens disparus payaient de leur vie certaines méprises de la police ou des polices frappant au hasard, les prétendus constructeurs d'une machine infernale.
Ce jour-là Paris oublia de rire ; mais il s'en dédommagea le lendemain en apprenant que Louis-Nicolas-Pierre-Joseph Dubois avait fait cerner par deux cent cinquante agents l'enclos de la Madeleine, douze heures juste après la fin d'un conciliabule en plein air tenu par Georges Cadoudal et ses complices, derrière les murailles de l'église en construction.
Il semblait, en vérité, que Paris sût ce que le citoyen Dubois ignorait. Le citoyen Dubois passait au milieu de ces événements, gros de menaces, comme l'éternel mari de la comédie qui est le seul à ne point voir les gaietés de sa chambre nuptiale.
Il cherchait partout où il ne devait point trouver, il se démenait, il suait sang et eau et jetait, en fin de compte, sa langue au chien avec désespoir.
Ce fut dans ce conciliabule de l'église de la Madeleine que Georges Cadoudal proposa aux ex-généraux Pichegru et Moreau le plan hardi qui devait arrêter la carrière du futur empereur.
Le mot hardi est de Fouché, duc d'Otrante Au mot hardi Fouché ajoute le mot facile.
Voici quel était ce plan, bien connu, presque célèbre.
Les trois conjurés avaient à Paris un contingent hétérogène, puisqu'il appartenait à tous les partis ennemis du premier consul, mais uni par une passion commune et composé d'hommes résolus.
Les mémoires contemporains portent ce noyau à deux mille combattants pour le moins : Vendéens, chouans de Bretagne, gardes nationaux de Lyon, babouvistes et anciens soldats de Coudé.
Une élite de trois cents hommes, parmi ces partisans, avait été pourvue d'uniformes appartenant à la garde consulaire.
Le chef de l'État habitait le château de Saint-Cloud.
À la garde montante du matin, et à l'aide d'intelligences qui ne sont pas entièrement expliquées, les trois cents conjurés, revêtus de l'uniforme réglementaire, devaient prendre le service du château.
Il paraît prouvé qu'on avait le mot d'ordre.
À son réveil, le premier consul se serait donc trouvé au pouvoir de l'insurrection.
Le plan manqua, non point par l'action des polices qui l'ignorèrent jusqu'au dernier moment, mais par l'irrésolution de Moreau. Ce général était sujet à ces défaillances morales. Il eut frayeur ou remords. L'exécution du complet fut remise quatre jours de là.
Jamais les complots remis ne s'exécutent.
On raconte qu'un Breton conjuré, M. de Querelles, pris de frayeur à la vue de ces hésitations, demanda et obtint une audience du premier consul lui-même et révéla tous les détails du plan.
Napoléon Bonaparte rassembla, dit-on, dans son cabinet, sa police militaire, sa police politique et sa police urbaine : M. Savary, depuis duc de Rovigo ; le grand juge Régnier et H. Dubois. Il leur raconta la très curieuse histoire de la conspiration ; il leur prouva que Moreau et Pichegru allaient et venaient depuis huit jours dans les rues de Paris comme de bons bourgeois, et que Georges Cadoudal, gros homme de mœurs joyeuses, fréquentaient assidûment les cafés de la rive gauche après son dîner.
L'histoire ne dit pas que son discours fût semé de compliments très chauds pour ses trois chargés d'affaires au département de la clairvoyance.
Le futur empereur ne remercia que Dieu – et son ancien ami J.-Victor Moreau, qu'il avait toujours, regardé comme une bonne arme mal chargée et susceptible de faire long feu.
Moreau et Pichegru furent arrêtés. Georges Cadoudal, qui n'était pourtant pas de corpulence à passer par le trou d'une aiguille, resta libre.
Et Fouché se frotta les mains, disant : Vous verrez qu'il faudra que je m'en mêle !
Par le fait, les gens de police sont rares, et Fouché lui-même fut en défaut nombre de fois. Argus a beau posséder cinquante paires d'yeux, qu'importe s'il est myope ? L'histoire des bévues de la police serait curieuse, instructive, mais monotone et si longue, si longue, que le découragement viendrait à moitié route.
Nous avions, pour placer ici cette courte digression historique, plusieurs raisons qui toutes appartiennent à notre métier de conteur. D'abord il nous plaisait de bien poser le cadre où vont agir les personnages de notre drame ; ensuite il nous semblait utile d'expliquer, sinon d'excuser, l'inertie de la police urbaine en face de ces rumeurs qui faisaient, par la ville, une véritable concurrence aux cancans d'État.
La police avait autre chose à faire et ne pouvaient s'occuper de la vampire. La police s'agitait, cherchait, fouillait, ne trouvait rien et était sur les dents.
Le 28 février 1804, le jour même où Pichegru fut arrêté dans son lit, rue Chabanais, chez le courtier de commerce Leblanc, un homme passa rapidement sur le Marché-Neuf, devant un petit bâtiment qui était en construction, au rebord même du quai, et dont les échafaudages dominaient la Seine.
Les maçons qui pliaient bagages et les conducteurs des travaux connaissaient bien cet homme, car ils l'appelèrent, disant :
– Patron, ne venez-vous point voir si nous avons avancé la besogne aujourd'hui ?
L'homme les salua de la main et poursuivit sa route en remontant le cours de la rivière.
Maçons et surveillants se prirent à sourire en échangeant des regards d'intelligence, car il y avait une jeune fille qui allait à quelque cent pas en avant de l'homme, enveloppée dans une mante de laine noire et cachant son visage sous un voile.
– Voilà trois jours de suite, dit un tailleur de pierres, que le patron court le guilledou de ce côté-là.
– Il est vert encore, ajouta un autre, le patron !
Et un troisième :
– Écoutez donc ! On n'est pas de bois ! Le patron a un métier qui ne doit pas le régayer plus que de raison. Il faut bien un peu rire.
Un vieux maçon, qui remettait sa veste, blanche de plâtre, murmura :
– Voilà trente ans que je connais le patron ; il ne rit pas comme tout le monde.
L'homme allait cependant à grand pas, et se perdait déjà derrière les masures qui encombrent le Marché-Neuf, aux abords de la rue de la Cité.
Quant à la fillette voilée, elle avait complètement disparu, L'homme était vieux, mais il avait une haute et noble taille, hardiment dégagée. Son costume, qui semblait le classer parmi les petits bourgeois, dispensés de tous frais de toilette, était grandement porté. Il avait, cet homme, des pieds à la tête, l'allure franche et libre que donne l'habitude de certains exercices du corps, réservés, d'ordinaire, à la classe la plus riche.
Du bâtiment en construction jusqu'au pont Notre-Dame, nombre de gens se découvrirent sur son passage ; c'était évidemment une notabilité du quartier. Il répondait aux saluts d'un geste bienveillant et cordial, mais il ne ralentissait point sa course.
Sa course semblait calculée, non point pour rejoindre la jeune fille, mais pour ne la jamais perdre de vue.
Celle-ci, dont les jambes étaient moins longues, allait du plus vite qu'elle pouvait. Elle ne se savait point poursuivie ; du moins pas une seule fois elle ne tourna la tête pour regarder en arrière.
Elle regardait en avant, de tous ses yeux, de toute son âme. En avant, il y avait un jeune homme à tournure élégante et hautaine qui longeait en ce moment le quai de la Grève. Le suivait-elle ?
Plus notre homme que les maçons du Marché-Neuf appelaient le patron approchait de l'Hôtel de Ville, moins nombreux étaient les gens qui le saluaient d'un air de connaissance. Paris est ainsi et contient des célébrités de rayon qui ne dépassent pas tel numéro de telle rue. Une fois que l'homme eut atteint le quai des Ormes, personne ne le salua plus.
L'homme cependant, « le patron », qu'il courût ou non le guilledou, avait la vue bonne, car, malgré l'obscurité qui commençait à borner les lointains, il surveillait non seulement la fillette, mais encore le charmant cavalier que la fillette semblait suivre.
Celui-ci tourna le premier l'angle du Pont Marie, qu'il traversa pour entrer dans l'île Saint-Louis ; la fillette fit comme lui ; le patron prit la même route.
Le pas de la fillette se ralentissait sensiblement et devenait pénible. Rien n'échappait au patron, car sa poitrine rendit un gros soupir, tandis qu'il murmurait :
– Il nous la tuera ! Faut-il que tant de bonheur se soit changé ainsi en misère !
On ne voyait plus le jeune cavalier, qui avait dû tourner le coin des rues Saint-Louis-en-l'Ile et des Deux-Ponts. La fillette marchait désormais avec un effort si visible, que le patron fit un mouvement comme s'il eût voulu s'élancer pour la soutenir.
Mais il ne céda point à la tentation, et calcula seulement sa marche de façon à bien voir où elle dirigerait sa course, après avoir quitté la rue des Deux-Ponts.
Elle tourna vers la gauche et franchit sans hésiter la porte de l'église Saint-Louis.
La brume tombait déjà dans cette rue étroite. À l'ombre de l'église et devant le portail, il y avait un riche équipage qui allumait ses lanternes d'argent.
La République dormait, prête à s'éveiller Empire. Elle avait fait trêve un peu au luxe extravagant du Directoire, mais elle ne proscrivait en aucune façon les allures seigneuriales. La voiture arrêtée à la porte de l'église Saint-Louis eût fait honneur à un prince. L'attelage était splendide, le coffre d'une élégance exquise, et les livrées brillaient irréprochables.
En ce temps, la rue Saint-Louis-en-l'Ile ne se distinguait point par une animation exceptionnelle : elle desservait un quartier somnolent et presque désert ; elle ne venait d'aucun centre, elle ne menait a aucune artère. Vous eussiez dit, en la voyant, la rue principale d'un chef-lieu de canton situé à cent lieues de Paris.
À l'heure où nous sommes, Paris n'a point de quartiers déserts. Le commerce s'est emparé du Marais et de l'île Saint-Louis, Les uns disent qu'il déshonore ces magnifiques hôtels de la vieille ville, les autres qu'il les réhabilite.
À cet égard, le commerce n'a pas de parti pris. Il ne demande pas à réhabiliter, il ne craint pas de souiller. Il veut gagner de l'argent et se moque bien du reste.
Sous le Consulat, Paris ne comptait guère plus de cinq cent mille habitants. Toute cette portion orientale de la ville, abandonnée par la noblesse de robe et n'ayant point encore l'industrie, était une solitude.
À cause de cela, sans doute, le resplendissant équipage stationnant à la porte de l'église avait attiré un concours inusité de curieux : vous eussiez bien compté dans la rue une douzaine de commères et un nombre égal de bambins. Le concile en plein air était présidé par un portier.
Le portier, adonné comme ses pareils à une philosophie austère et détestant tout ce qui est beau parce qu'il était affreusement laid, prononçait un discours contre le luxe. Les gamins regardaient luire les lanternes et piaffer les chevaux ; les commères se disaient : Si le ciel était juste, nous éclabousserions aussi le pauvre monde !
– S'il vous plaît, demanda le patron des maçons du Marché Neuf, à qui appartient cette voiture ?
Gamins, commères et portier le toisèrent de la tête aux pieds.
– Celui-là n'est pas du quartier, dirent les gamins.
– Est-il chargé de faire la police ? demanda une commère.
– Comment vous nomme-t-on, l'ami ? Interrogea le portier, nous n'avons pas de comptes à rendre à des étrangers.
Car les gens de Paris sont des étrangers pour ces farouches insulaires penitùs toto divisos orbe, séparés du reste de l'univers par les deux bras de la Seine.
À l'instant où le patron allait répondre, la porte de l'église s'ouvrit, et il recula de trois pas en laissant échapper un cri de surprise, comme si un spectre lui eût apparu.
C'était, en tous cas, un fantôme charmant : une femme toute jeune et toute belle, dont les cheveux blonds tombaient en boucles gracieuses autour d'un adorable visage.
Cette femme donnait le bras à un jeune homme de vingt-cinq à trente ans, qui n'était point celui que suivait naguère notre fillette, et que vous eussiez jugé Allemand à certains détails de son costume.
– Ramberg !… murmura le patron.
La délicieuse blonde était assise déjà sur les coussins de la voiture où le jeune Allemand prit place à côté d'elle. Une voix sonore et douce commanda :
– À l'hôtel !
Et la portière se referma.
Les beaux chevaux prirent aussitôt le trot de parade dans la direction du Pont Marie.
– Je vous dis que c'est une ci-devant ! affirma le portier.
– Non pas ! riposta une commère, c'est une duchesse de Turquie ou d'ailleurs.
– Une espionne de Pitt et Cobourg peut-être !…
Les gamins, à qui on avait jeté des pièces blanches, couraient après l'équipage en criant avec ferveur :
– Vive la princesse !
Le patron resta un moment immobile. Son regard était baissé ; on lisait sur son front pâle le travail de sa pensée.
– Ramberg ! répéta-t-il. Qui est cette femme ? Et qui me donnera le mot de l'énigme ?… On croyait le baron de Ramberg parti depuis huit jours, et voilà plus de deux semaines que le comte Wenzel a disparu… La femme avec qui je le vis était brune, mais c'était le même regard…
Sans s'inquiéter davantage du petit rassemblement qui l'examinait désormais avec défiance, il monta tout pensif les marches de l'église et en franchit le seuil.
L'église semblait complètement déserte. Les derniers rayons du jour envoyaient à peine, à travers les vitres, de sombres et incertaines lueurs. La lampe perpétuelle laissait battre sa lueur toujours mourante au-devant du maître-autel. Pas un bruit n'indiquait dans la nef la présence d'un être humain.
Le patron était pourtant bien sûr d'avoir vu entrer la jeune fille, et si la jeune fille était entrée, ce devait être sur les traces de celui qu'elle suivait.
Le patron avait déjà parcouru l'un des bas-côtés, visitant de l'œil chaque chapelle, et la moitié de l'autre, lorsqu'une main le toucha au passage, sortant de l'ombre d un pilier.
Il s'arrêta, mais ne parla point, parce que la créature humaine qui était là, tapie dans l'angle profond laissé derrière la chaire, mit un doigt sur ses lèvres et montra ensuite un confessionnal situé à quelques pas de là.
Le patron s'agenouilla sur la dalle et prit l'attitude de la prière.
L'instant d'après, la porte du confessionnal s'ouvrit, et un prêtre jeune encore, dont la tonsure laissait une place d'une blancheur éclatante au milieu d'une forêt de cheveux noirs, se dirigea vers l'autel de la Vierge et s'y prosterna.
Après une courte oraison, pendant laquelle il frappa trois fois sa poitrine, le prêtre baisa la pierre en dehors de la balustrade, et gagna la sacristie.
L'ombre sortit alors de son encoignure et dit :
– Maintenant, nous sommes seuls.
C'était un enfant, ou du moins il semblait tel, car sa tête ne venait pas tout à fait à l'épaule de son compagnon, mais sa voix avait un timbre viril, et le peu qu'on voyait de ses traits donnait un démenti à la petitesse de sa taille.
– Y a-t-il longtemps que tu es là, Patou ? demanda notre homme.
– Monsieur le gardien, répondit l'ombre, la clinique du docteur Loysel a fini à trois heures douze minutes, et il y a loin de Saint-Louis-en-l'Ile à l'École de médecine.
– Qu'as-tu vu ? interrogea encore celui qu'on nommait ici M. le gardien, et là-bas « le patron ».
Au lieu de répondre, cette fois, le prétendu enfant secoua d'un mouvement brusque la chevelure hérissée qui se crêpait sur sa forte tête, et murmura comme en se parlante lui-même :
– Je serais bien venu plus tôt, mais le professeur Loysel faisait sa leçon sur l'Organon de Samuel Hahnemann. Voilà huit jours que dure cette parenthèse, où il n'est pas plus question de clinique que du déluge. Je n'avais jamais entendu parler de ce Samuel Hahnemann, mais on l'insulte tant et si bien à l'École, que je commence à le regarder comme un grand inventeur…
– Patou, mon ami, interrompit le gardien, vous autres de la Faculté, vous êtes tous des bavards. Il ne s'agit pas de ce Samuel, qui doit être un juif ou tout au moins un baragouineur allemand, puisqu'il a un nom en mann… Qu'as-tu vu ? Dis vite !
– Ah ! monsieur le gardien, répliqua Patou, de drôles de, choses, parole d'honneur ! Les gens de police doivent s'amuser, c'est certain, car pour une fois que j'ai fait l'espionne, je me suis diverti comme un ange !… La jolie femme, dites donc !
– Quelle femme ?
– La comtesse.
– Ah ! ah ! fit le gardien, c'est une comtesse !
– L'abbé Martel l'a appelée ainsi… Mais pensiez-vous que je voulais parler de votre Angèle, pauvre cher cœur, puisque vous me demandiez : Quelle femme ?
– N'as-tu point vu Angèle ?
– Si fait… bien pâle et avec des larmes dans ses beaux yeux.
– Et René ?
– René aussi… plus pâle qu'Angèle… mais le regard brûlant et fou…
– Et as-tu deviné ?
– Patience !… Au lit du malade, celui qui expose le mieux les symptômes ne découvre pas toujours le remède. Il y a les savants et les médecins : ceux qui professent et ceux qui guérissent… Je vais vous exposer les faits : je suis le savant… vous serez le médecin, si vous devinez le mot de la charade… ou des charades, car il y a là plus d'une maladie, j'en suis sûr.
Un bruit de clefs se fit entendre en ce moment du côté de la sacristie, et le bedeau commença une ronde, disant à haute voix : On va fermer les portes.
Hormis le gardien et Patou, il n'y avait personne dans l'église. Le gardien se dirigea vers rentrée principale, mais Patou le retint et se mit à marcher en sens contraire.
En passant près du petit bénitier de la porte latérale, le gardien y trempa les doigts de sa main droite, et offrit de l'eau bénite à Patou, qui dit merci en riant.
Le gardien se signa gravement.
Patou dit :
– Je n'ai pas encore examiné cela. Hier je me moquais de Samuel Hahnemann, aujourd'hui j'attacherais volontiers son nom à mon chapeau ; quand j'aurai achevé mon cours de médecine, je compte étudier un peu la théologie, et peut-être que je mourrai capucin.
Il s'interrompit pour ajouter en montrant la porte :
– C'est par là que M. René est sorti et après lui Mlle Angèle. Le gardien était pensif.
– Tu as peut-être raison de tout étudier, Patou, mon ami, dit-il avec une sorte de fatigue, moi je n'ai rien étudié, sinon la musique, l'escrime et les hommes…
– Excusez du peu ! fit l'apprenti médecin.
– Il est trop tard pour étudier le reste, acheva le gardien. Je suis du passé, tu as de l'avenir : le passé croyait à ce qu'il ignorait ; vous croirez sans doute à ce que vous aurez appris ; je le souhaite, car il est bon de croire. Moi, je crois en Dieu qui m'a créé ; je crois en la république que j'aime et en ma conscience qui ne m'a jamais trompé.
Patou sauta sur le pavé de la rue Poultier, et fit un entrechat à quatre temps qu'on n'eût point espéré de ses courtes jambes.
– Vous, patron, dit-il en éclatant de rire, vous êtes naïf comme un enfant, solide comme un athlète et absurde comme une jolie femme. Vous confondez toutes les notions. J'ai un petit-neveu qui me disait l'autre jour : J'aime maman et les pommes d'api. C'est de votre… À propos ! – c'est cette belle comtesse blonde qui me fait songer à cela, – quel sujet à disséquer ! J'étudie en ce moment les maladies spéciales de la femme. J'aurais grand besoin de quelqu'un… j'entends quelqu'un de jeune et de bien conformé… un beau sujet… Auriez-vous cela dans votre caveau de bénédiction, M. Jean-Pierre ?
III. GERMAIN PATOU
Il faisait presque nuit. Un seul pas, lourd et lent sonnait sur le pavé si vieux, mais presque vierge, de ces rues mélancoliques où nul ne passe et que le clair regard des boutiques ouvertes n'illumine jamais. Ce pas solitaire était celui d'un pauvre estropié qui allait, allumant l'une après l'autre les mèches fumeuses des réverbères avares de rayons.
L'estropié cahotait sous ses haillons comme une méchante barque secouée par la houle. Il chantait une gaudriole plus triste qu'un libéra.
Patou et l'homme que nous avons désigné sous tant de noms déjà, le patron des maçons du Marché-Neuf, M. le gardien, M. Jean-Pierre, descendaient de la petite porte de l'église Saint-Louis au quai de Béthune. Dans l'ombre, la différence qui existait entre leurs tailles atteignait au fantastique. Patou semblait un nain et Jean-Pierre un géant.
Quelque jour nous retrouverons ce nain, grandi, non par au physique beaucoup, mais au moral ; nous verrons le docteur Germain Patou porter à son chapeau, selon sa propre volonté, le nom de Samuel Hahnemann comme une cocarde et produire de ces miracles qui firent lapider une fois, à Leipzig, le fondateur de l'école homéopathique, mais qui fondirent plus tard le bronze dont est faite sa statue colossale, la statue de ce même Samuel Hahnemann, érigée au beau milieu de la maîtresse place, en cette même cité de Leipzig, sa patrie.
Si l'on pouvait appliquer un mot divin à ces petites persécutions qui arrêtent un instant, puis fécondent le progrès à travers les siècles, nous dirions que la plus curieuse de toutes les histoires à faire est celle des calvaires triomphants.
Dans cette comédie bizarre et terrible que nous mettrons bientôt en scène sous ce titre : Numéro treize, le docteur Germain Patou aura un rôle.
Le patron répondit ainsi à sa dernière question :
– Petit homme, tu ne parles pas toujours avec assez de respect des choses qui sont à ma garde. Je n'aime pas la plaisanterie à ce sujet ; mais tu vaux mieux que ton ironie, et l'on dit que pour le métier que tu as choisi il n'est pas mauvais de s'endurcir un peu le cœur. Je t'ai connu enfant ; je n'ai pas fait pour toi tout ce que j'aurais voulu.
Patou l'interrompit par une nouvelle pression de main.
– Halte-là, s'écria-t-il. Vous m'avez donné deux fois du pain, monsieur Sévérin, prononça-t-il avec une profonde émotion qui vous eût étonné bien plus encore que l'entrechat à quatre compartiments : le pain du corps et celui de l'âme ; c'est par vous que j'ai vécu, c'est par vous que j'ai étudié ; si je domine mes camarades à l'école, c'est que vous m'avez ouvert ce sombre amphithéâtre près duquel vous dormez, miséricordieux et calme, comme la bonté incarnée de Dieu…
Sur la main du patron une larme tomba.
– Tu es un bon petit gars ! murmura-t-il, merci.
– Je serai ce que l'avenir voudra, repartit Patou, qui redressa sa courte taille. Je n'en sais rien, mais je puis répondre du présent et vous dire que, sur un signe de vous, je me jetterais dans l'eau ou dans le feu, à votre choix !
Le patron se pencha sur lui et le baisa, répétant à demi voix :