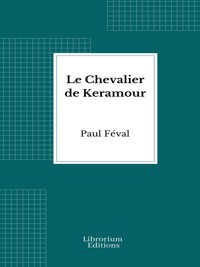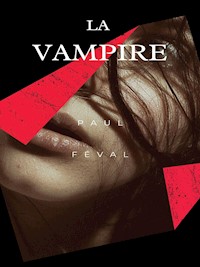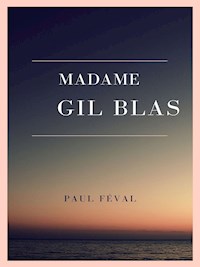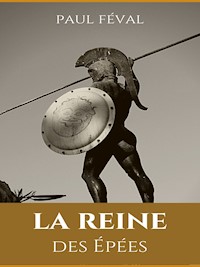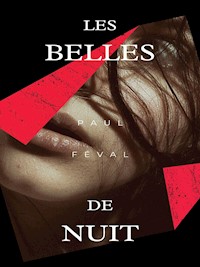Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
L'antique manoir de Rohan-Polduc a été témoin de deux tragédies: l'expulsion de César de Rohan avec sa jeune femme et son fils, la malédiction de Valentine de Rohan, portant sa fille dans ses bras. César en est mort, et Valentine aussi, peut-être. Guy, comte de Rohan, leur père, jeté lui-même hors de sa demeure par la trahison d'Alain Polduc, était parti seul, sans tourner la tête. Depuis lors, les gens de la contrée ignorent ce qu'était devenu le comte Guy, cet implacable vieillard, dur comme les héros de la légende celtique. César, sa femme et son fils passent pour morts. Nul ne sait le sort de Valentine ni de sa fille...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Louve
La LouvePREMIÈRE PARTIE. LA PETITE CENDRILLONDEUXIÈME PARTIE. LA COMTESSE ISAURETROISIÈME PARTIE. ROHANVALENTINE DE ROHAN. CONCLUSIONPage de copyrightLa Louve
Paul Féval
PREMIÈRE PARTIE. LA PETITE CENDRILLON
I LE BOUDOIR
Les pierres racontent, dit-on, l’histoire des catastrophes dont elles furent les témoins. L’antique manoir de Rohan-Polduc avait été témoin des deux tragédies qui furent comme le prologue de notre présent drame : l’expulsion de César de Rohan avec sa jeune femme et son fils, la malédiction de Valentine de Rohan, portant sa fille dans ses bras.
César de Rohan était mort de cela, et Valentine de Rohan aussi peut-être. Guy, comte de Rohan, leur père, jeté lui-même hors de sa demeure, par la trahison d’Alain Polduc, était parti seul, sans tourner la tête, laissant derrière lui ce double et terrible châtiment.
Depuis lors, les gens de la contrée ignoraient ce qu’était devenu le comte Guy, cet implacable vieillard, dur comme les héros de la légende celtique. César, sa femme et son fils passaient pour morts ; nul ne savait le sort de Valentine ni de sa fille.
Mais le manoir ne racontait rien de ces lugubres choses. Au contraire, la physionomie autrefois si sombre de ses vieilles pierres s’essayait maintenant à sourire. On avait fait ce qu’on avait pu pour égayer ces noires murailles dont la vétusté faisait honte à leur nouveau seigneur.
M. le sénéchal de Bretagne, que nous appelions autrefois maître Alain Polduc, et qui faisait en ce temps là profession d’humilité était maintenant un personnage d’importance. Il ne se contentait plus de vivre en Maître dans la maison où nous le connûmes valet, et ne cachait point qu’il aurait mieux aimé la demeure moderne, toute blanche et toute carrée, de monsieur son beau-père, l’intendant Feydeau, mais l’intendant gardait pour lui sa demeure.
Du vivant de sa fille aimée, femme d’Alain Polduc, transformé en vicomte de Rohan, depuis qu’on l’avait institué sénéchal, Achille-Musée Feydeau de Brou, intendant royal de l’impôt pour la province de Bretagne, vieillard ridicule et qui mettait sa gloire à copier les mœurs de la cour du régent, avait éloigné de lui dès longtemps ses deux plus jeunes filles pour les placer auprès de leur sœur. Maintenant que le sénéchal était veuf, Agnès et Olympe Feydeau restaient au manoir, du consentement de leur père, lequel menait en son château, seul et sans contrainte, sa vie de vieux Céladon. Elles étaient comme les filles d’adoption du sénéchal, qui postulait auprès du parlement pour leur faire porter le nom de Rohan-Polduc. Pas n’est besoin de dire à ceux qui se souviennent de maître Alain et de son excellent caractère que M. le sénéchal espérait bien trouver son compte à cela.
L’intendant et le sénéchal étaient, du reste, les deux doigts de la main. Pythias et Damon s’aimaient d’une amitié moins tendre. Depuis vingt ans ils faisaient ensemble des affaires extrêmement délicates, et jamais ils ne se querellaient devant témoin.
C’est là le sublime de l’amitié entre spéculateurs.
Au temps où maître Alain était majordome chez son noble cousin, le comte Guy, son rôle avait été d’aider à la ruine de l’irascible vieillard et de faciliter au contraire l’agrandissement des domaines de Feydeau. Grâce à lui, les futaies de Rohan, ses fermes, ses guérets, avaient passé peu à peu et moyennant vil prix entre les mains de l’intendant royal.
Pour avoir le manoir lui-même et les domaines inaliénables, il avait fallu jouer un autre jeu ; et nous venons de faire allusion au drame de famille qui priva de ses deux héritiers le comte Guy dont la fièvre politique s’était changée en folie par suite des excitations de maître Alain. La trame était simple, quoique savamment ourdie : aucun fil ne se rompit. Une fois le vieux Rohan exilé ou mort et ses enfants disparus maître Alain Polduc fut amplement récompensé de ses peines. Grâce au crédit de son beau-père, il fut nommé sénéchal et son beau-père lui-même, ayant mission, par sa charge d’intendant, de juger les conflits de noblesse put le coucher sur un registre en qualité de vicomte de Rohan.
C’était assurément beaucoup pour un gars du pays de Tréguier, qui était arrivé dans la haute Bretagne avec ses sabots pleins de paille et sa veste de futaine, mais M. le sénéchal demandait davantage. Feydeau était huit ou dix fois plus riche que lui ; cela lui donnait de l’émulation. Il prétendait à la lieutenance de roi et voulait pêcher encore en eau trouble un ou deux petits millions avant le soir de sa vie.
Quelqu’un qui serait revenu au pays après quinze ou vingt ans d’absence aurait eu de la peine à reconnaître l’abord sauvage de la maison de Rohan ; les douves, comblées dans tout leur parcours, s’étaient changées en parterres ; une allée de tilleuls taillés en boules coupait la pelouse à son milieu et conduisait au perron. Chaque tronc de tilleul s’entourait d’un buisson d’épines auquel la cisaille avait donné la forme d’un vase.
Les murailles avaient été replâtrées ; les moulures vénérables de la maîtresse porte s’empâtaient sous une triple couche de peinture verte. La partie du château qui tombait en ruines se relevait, et vous n’eussiez retrouvé sur la façade de l’ouest que le vieux balcon de granit conservé intact comme curiosité.
À l’intérieur, même changement. Le pauvre grand salon d’honneur, séparé en deux par une cloison, ne gardait rien de sa sévère magnificence. La fille aînée de l’intendant Feydeau l’avait trouvé trop long, trop large et trop triste. Les deux pièces qui le remplaçaient n’étaient pas tout à fait à la mode de la cour, mais leur ameublement Louis XIV n’en faisait pas moins, avec l’architecture gothique, le contraste le plus malheureux. Par les croisées, aux chassis renouvelés, on apercevait la terrasse grattée et blanchie, ainsi que le jardin, dont tous les arbres avaient été proprement émondés.
Nous le répétons, parce que c’est justice, on avait fait ce qu’on avait pu. Il y avait entre cette maison bien tenue et l’ancien manoir la même différence qu’entre le visage noble et triste du comte Guy et le menton rougeaud, rasé de frais, de M. le sénéchal, son ex-majordome.
La partie occidentale du manoir, à cause de son aspect plus moderne, avait été choisie par les demoiselles Feydeau ; elles y faisaient leur demeure. La dernière chambre, située au bout du corridor, celle qui donnait sur un balcon de granit en saillie d’où l’on apercevait la vallée de Vesvres, leur servait de boudoir commun.
L’histoire légendaire de ce balcon est racontée dans notre précédent récit : La Louve.
Les demoiselles Feydeau étaient parisiennes, riches, jeunes il y a toujours quelque lueur de goût chez la jeunesse à qui rien ne coûte. La retraite favorite d’Olympe et d’Agnès était charmante ; vous eussiez dit un observatoire gracieux et brillant où les deux belles paresseuses venaient s’étendre sur leur sofa de velours, parmi les draperies roses, les peintures coquettes, les fleurs débordant hors des grands vases de Chine, pour regretter Paris en face de la campagne admirable.
C’est dans le boudoir des filles de Feydeau que nous conduirons tout d’abord le lecteur ; seulement, sur le sofa de velours qui faisait face à la fenêtre, nous ne trouverons ni mademoiselle Agnès, ni mademoiselle Olympe, ni même leur pauvre petite compagne Céleste, qu’on appelait dans le pays la Cendrillon du manoir de Rohan. Céleste était dans sa chambrette hâtant sa besogne et mettant la dernière main aux toilettes de ces demoiselles, car ces demoiselles devaient faire toilette ce soir, grande toilette ; il y avait fête à Rennes, au palais du gouvernement, pour la réception officielle de monseigneur le comte de Toulouse, redevenu gouverneur de Bretagne, après plusieurs années de disgrâce.
Céleste avait des doigts de fée ; Olympe et Agnès pouvaient compter sur elle. En attendant, elles étaient au salon, faisant les honneurs du château à de nombreux invités et se laissant appeler, par flatterie anticipée : Mesdemoiselles de Rohan, gros comme le bras !
Sur le sofa du boudoir, M. l’intendant et M. le sénéchal causaient en tête-à-tête. Maître Alain Bolduc n’avait point changé notablement. Il était plus gros, et paraissait plus court ; ses épaules dodues étaient au plein de son habit de velours ponceau. C’est à peine si ses cheveux plats et rares commençaient à grisonner.
Ses prétentions aux belles manières avaient naturellement grandi, on le voyait bien à l’élégance de sa mise. Sous l’habit de velours ponceau, il y avait en effet une veste de satin bleu de ciel qui battait, rattachée à l’aide de boutons en diamants, sur une culotte de taffetas vert tendre. Les boucles de ses souliers à talons éblouissaient. Sous son double menton et autour de ses poignets ruisselaient des flots de dentelles. Comme on peut le penser, tout cela formait un ensemble des plus satisfaisants au point de vue comique, et pourtant M. le sénéchal ne prêtait point trop à rire, parce que son large visage, intelligent dans sa laideur, avait une expression inquiétante. On devinait dans ces petits yeux méchants l’expérience et la science d’un coquin émérite ; l’excellent sourire qui ridait l’embonpoint fleuri de ses joues ne cachait pas assez le sang-froid résolu du spoliateur.
Mais un type charmant, complet, tout d’une pièce, c’était Achille-Musée Feydeau, seigneur de Brou, du Mont et de la Muette, Intendant royal pour la province de Bretagne, ancien disciple d’Apollon et vieilli au service des dames. Achille-Musée pouvait bien avoir soixante ans, mais les efforts réunis de son barbier, de son dentiste et de son valet de chambre, lui promettaient une jeunesse éternelle.
Considéré de près, son visage offrait tout l’attrait d’une œuvre d’art. Ses yeux d’un bleu terne et un peu vitreux avaient des cils rechampis au pinceau : l’encre de Chine, habilement employée, allongeait leur fente trop courte et leur donnait du caractère. À droite et à gauche, à la hauteur des tempes, il y avait un empâtement hardi, qui dissimulait deux écheveaux de rides.
La brosse, enduite de noir de fumée, restaurait chaque matin la courbe galante de ses sourcils ; quelques boucles perdues de sa noble perruque à la Louis XIV venaient jouer adroitement sur les plis de son front qu’elles dissimulaient à merveille. Ses lèvres, passées au carmin, faisaient ressortir la blancheur de trente-deux dents savoyardes achetées à beaux deniers comptant. Ces perles, montées en perfection, donnaient à son parler un gazouillement enfantin plein de charmes.
Achille-Musée n’avait garde de tomber dans les mêmes barbarismes de toilette que son gendre ; son accoutrement était irréprochable et sentait vraiment l’homme de cour. Il était haut sur jambes comme l’oiseau symbolique des hiéroglyphes de Memphis ; il avait le torse un peu voûté et très court. Assis nonchalamment comme nous le trouvons, aujourd’hui sur un sofa de boudoir, il portait ses genoux croisés à la hauteur de son menton.
Dans sa main gauche peinte en blanc, au doigt de laquelle brillait un solitaire de la plus belle eau, une boîte d’or enrichi de perles fines tournait gracieusement, sollicitée par les doigts de sa main droite, également couverts d’une couche de peinture fraîche. Il aurait fallu faire tout Paris pour trouver un financier retouché plus savamment.
– Je vous ai amené ici, monsieur l’intendant, disait le sénéchal, parce que ma maison est pleine et que nous avons besoin de causer en paix.
– Eh mais ! fit Achille-Musée Feydeau de Brou, en secouant son jabot avec tout plein de grâce, vous n’avez pas besoin d’excuse… un boudoir, cela me connaît, mon gendre !
Alain Polduc fit mine de le regarder avec admiration.
– Vous êtes bien positivement l’homme de votre siècle ! s’écria-t-il, et les compagnons de M. le Régent ne sont que des novices auprès de vous !
– Eh ! eh ! eh ! ricana le financier ; j’avoue que, sur la route de la vie, j’ai laissé les épines pour ne cueillir que les fleurs.
– Charmant ! mais vit-on jamais chose semblable ! Les fâcheux nous poursuivent dans ce château avec un acharnement tel que nous sommes réduits à conspirer jusque dans le boudoir de vos filles.
Achille-Musée chiffonna le bout de son jabot en homme disert qui va soutenir une thèse mignonne.
– Mon gendre, répliqua-t-il, conspiration et boudoir ne s’accordent pas mal ensemble. Voyez la Fronde ! J’ai rimaillé jadis, ajouta-t-il en se renversant sur les coussins, alors que j’occupais mes heures perdues à la culture des belles lettres, j’ai rimaillé tant bien que mal un petit conte à la façon d’Italie, intitulé : le Boudoir conspirateur… Le titre est assez piquant, que vous en semble ?
– Charmant ! répéta Alain Polduc.
– N’est-ce pas ?… Mais je croyais que nous n’étions pas ici pour conspirer, monsieur mon gendre.
– Nous sommes ici pour convenir de nos faits. Il en est grand temps, monsieur mon beau-père ! nous sommes menacés par les événements, et il y a des jours où je pense qu’à force de nager entre deux eaux on finit par se noyer.
– Nous ne nageons pas, mon gendre, répliqua l’intendant, nous sommes en terre ferme, Dieu merci ! Nous avons un pied à la cour de France, un pied à la cour d’Espagne, voilà tout.
– Mon beau-père, les petits cadeaux entretiennent l’amitié ; voici bien longtemps déjà que nous n’avons fait à M. le Régent aucune agréable surprise.
II L’INTENDANT ROYAL
L’intendant jeta sur son gendre un regard d’inquiétude.
– C’est juste, dit-il pourtant, c’est trop juste. On ne saurait se montrer trop aimable avec M. le régent… Quand S. A. R. a eu vent des bruits qui courent sur mon hymen avec la comtesse Isaure…
– Causons affaires, interrompit le sénéchal.
– S. A. R. poursuivit l’intendant a poussé un grand cri, disant : est-il possible qu’Achille-Musée retombe dans le piége du mariage !
– Combien comptez-vous lui offrir en étrennes ?
– À la belle comtesse ? La corbeille me coûtera…
– J’entends à M. le régent.
Achille-Musée ouvrit sa boîte d’or.
– Diable ! diable ! dit-il, l’impôt ne rentre pas comme sur des roulettes.
– J’ai à vous parler de cela et d’autres choses. Comptons sur nos doigts. J’ai à vous parler des Loups qui ont passé la nuit en armes autour de la mare de Muys ; j’ai à vous parler de la comtesse Isaure, au point de vue de votre caisse seulement… J’ai à vous parler de l’ancien sabotier Yaumy et de certaine sorcière qui fait des miracles au vieux moulin de la Fosse-aux-Loups. J’ai à vous dire que la Louve a reparu dans la forêt ; que madame Saint-Elme, la mystérieuse protectrice de Rohan, est à Paris mieux en cour que jamais, si bien en cour que nos correspondants lui attribuent la rentrée en grâce de M. de Toulouse… Faites-moi songer aussi, au cas où je l’oublierais, à vous toucher un mot de ce beau cavalier qui est arrivé cette nuit en ma maison.
– Le seigneur Martin Blas ? interrompit l’intendant avec un léger bâillement.
– Oui. Ce don Martin Blas vient justement de Paris avec un message pour la comtesse Isaure.
– Monsieur mon beau-père ! s’écria Polduc, écoutez attentivement, croyez-moi ; la partie est engagée malgré nous ; nos cartes se mêlent toutes seules, et il ne dépend pas de notre volonté de retirer les enjeux !
– Expliquez-vous, je vous prie, voulut dire l’intendant, au sujet de ce message…
– Plus tard, interrompit le sénéchal. Il s’agit d’abord de régler le don gratuit, comme on dit en langage parlementaire, que nous allons déposer de compte à demi aux pieds de M. le Régent de France. Je ne suis qu’un pauvre gentilhomme, et, pour ma part, je sais bien ce que je fournirai, mais vous, mon beau-père, vous fournirez le reste, c’est-à-dire un pot-de-vin de cinq à six cent mille livres, pour que Son Altesse Royale ait le cœur content.
L’intendant bondit sur le sofa, et le sang lui monta au visage.
– Je ne parle pas poursuivit le sénéchal tranquillement, d’une bagatelle de vingt ou vingt-cinq mille écus pour certain illustre valet, qui aime presque autant les petits cadeaux que son maître.
Nouveau bond de l’intendant, qui supputa d’un accent désolé :
– Six cent soixante-quinze mille livres !
Puis il ajouta en regardant Polduc de travers :
– Mon gendre, vous êtes fou !
– Mon beau-père, répliqua le sénéchal, qui avait assurément son but en faisant suivre à l’entretien cette route pleine de circuits, ne discutons pas encore ; ce serait prématuré. Avant d’approfondir la question, permettez-moi de vous apprendre certains détails que vous ignorez à coup sûr.
– Six cent soixante-quinze mille livres ! répéta l’intendant, dont la boîte d’or tournait entre ses doigts comme une toupie d’Allemagne.
Alain Polduc se mit à l’aise à l’autre bout du sofa et commença ainsi :
– Il y avait autrefois, je vous parle d’une douzaine d’années, au bourg de Pléchastel, entre Quimper et Châteaulin, en Basse-Bretagne, un paysan qui se nommait Thurien le Bozec. Il avait une bonne ferme au bord du Bénaudet, et comme sa femme, Julienne, ne lui avait point donné d’enfant, il avait adopté un orphelin… Oubliez un instant vos six cent soixante et quinze mille livres, mon beau-père, et devinez qui je reconnus un jour assis par terre au seuil de Thurien le Bozec, et faisant sauter sur ses genoux le petit orphelin qui souriait ?
– Qu’importe cela ! gronda Feydeau tout entier à sa méchante humeur.
– Cela importe beaucoup, mon beau-père, répliqua Polduc avec calme. Vous possédez environ les deux tiers des anciens domaines de Rohan, et c’est la meilleure plume de votre aile… Or, César de Rohan et Jeanne de Combourg, unis en légitime mariage, ont laissé un fils dont la naissance fut authentiquement constatée par le chapelain du manoir où nous sommes…
L’intendant commençait à ouvrir de grands yeux.
– Cela vous importe beaucoup, reprit encore Alain Polduc, car vous savez comme tout le monde qu’après la fin tragique de César et Jeanne, sa femme, le vieux Rohan monta un matin à cheval pour aller chercher leur fils qui était ici près, en la paroisse de Noyal. Le vieux Rohan fut plusieurs jours sans revenir, et l’on disait dès ce temps-là qu’il avait été jusqu’à Quimper… Cela vous importe beaucoup, je vous le répète, car l’homme qui faisait jouer l’orphelin sur ses genoux ; au seuil de Thurien le Bozec, était Josselin Guitan, l’ami, le serviteur de César et l’âme damnée de Valentine :
Chaque passion a son travail et ses jobs. La passion d’Achille-Musée Feydeau était la vanité du parvenu : vanité à propos de tout, argent, honneurs, élégance, poésie, esprit, crédit, bravoure même, et popularité, et don de plaire.
Cette passion du reste, n’était pas très exigeante, quoiqu’elle coutât fort cher. Pour peu que la foule parût croire à son bonheur, Achille-Musée était heureux pour tout de bon ; il vivait de gloriole.
Or, le plus beau de ses triomphes était assurément cette rumeur qui le mariait dans un avenir prochain avec la comtesse Isaure. Quoiqu’il fût très économe, il avait dépensé de grosses sommes pour alimenter ce bruit.
La comtesse Isaure régnait sur la jeunesse bretonne ; tout ce que Rennes contenait de noble, de vaillant et de beau, était à ses pieds. Quelle gloire, veuillez en convenir, pour Achille-Musée Feydeau, qui n’avait plus vingt ans, selon son propre aveu, et qui n’était, après tout, qu’un gentilhomme de finance, quelle gloire de damer le pion à toute cette noblesse d’épée !
La comtesse Isaure puisait à sa caisse, c’était là un fait avéré. Feydeau eût voulu l’écrire en grosses lettres sur la porte cochère de son hôtel. La comtesse Isaure avait avec lui des entretiens particuliers de jour et de nuit. En ces occasions, Feydeau eût arboré volontiers au sommet de sa plus haute cheminée un drapeau pour le faire savoir à la ville entière.
Voyez cependant la méchanceté des gens ! Les gens ne croyaient pas beaucoup au bonheur de l’intendant Feydeau. Le monde avait saisi son ridicule, le monde s’amusait de lui d’autant mieux qu’il était plus riche, plus puissant et plus haut placé ; ceux-là seuls qui avaient besoin de sa bourse et de son influence condescendaient à faire semblant de croire.
Le sénéchal était tout naturellement au nombre de ces derniers, en sa qualité de gendre d’abord, ensuite parce qu’il avait toujours besoin de Feydeau. Pour que le sénéchal montrât aujourd’hui si peu de complaisance, il fallait une circonstance grave. Feydeau l’avait pressenti vaguement dès le début de l’entrevue et ne s’était point trompé. Il s’agissait de la base même de son immense fortune. Il laissa de côté pour un instant sa manie et se résolut à écouter.
– Soyez tranquille, beau-père, dit cependant Alain Polduc comme s’il eût voulu jouer avec les perplexités du financier, nous allons revenir tout à l’heure à la belle comtesse… Avant de vous dire ce que faisait là-bas ce Josselin Guitan, j’ai besoin d’établir clairement, avec vous, notre situation mutuelle au sujet des biens de Rohan.
– Parbleu ! s’écria Feydeau, la situation est bien claire… j’en ai acheté les trois quarts à peu près.
– Acheté ? répéta le sénéchal, qui secoua la tête. Moi seul et vous nous savons à quel prix !
– Et quant au quatrième quart, poursuivit Feydeau, vous vous l’êtes fait donner après la confiscation.
– Et je voudrais bien le garder, mon beau-père prononça Polduc avec un gros soupir.
La boîte d’or de l’intendant s’arrêta entre ses doigts, et sa figure prit une expression de réelle inquiétude.
– Tant qu’il n’y a pas eu lieu, poursuivit Polduc, je ne vous ai point fatigué de ces détails ; vous avez acheté, c’est vrai, mais comme on peut acheter les biens d’apanage, sauvegardés par les articles 7, 22 et 23 du second annexe à l’acte d’union. Pour rendre votre possession définitive, il fallait absence d’héritier ou ordonnance royale. Cette ordonnance, vous n’avez pas pu l’obtenir du feu roi, et jusqu’à cette heure M. le Régent a négligé de vous l’octroyer.
– Voici quinze ans que les choses sont en cet état, voulut objecter Feydeau.
– Reste donc le défaut d’héritier, interrompit Polduc : la meilleure de toutes les conditions à mon sens pour nous tirer de peine. Mais celle-là ne dépend pas de nous plus que l’autre. Le double mariage de César et de Valentine fut célébré, selon le rite catholique, par Dom Sidoine, chapelain de Rohan ; il a produit un double fruit, vous savez cela comme moi. César eut de Jeanne de Combourg un héritier mâle ; Valentine mit au monde une fille dont le père est Morvan de Saint-Maugon.
– Qui a disparu… objecta l’intendant.
– Qui a disparu, répéta Polduc ; ceci ne fait rien à l’affaire… outre que les gens qui disparaissent ainsi peuvent bien revenir quand on ne les attend plus. Aux termes de la Coutume de Bretagne, qui laisse tomber les biens nobles en quenouille, la fille de Valentine est autant à craindre pour nous que le fils de César.
– Existe-il donc, demanda Feydeau, ce fils ou cette fille ?
– J’ai lieu de croire, répondit Polduc, qu’ils existent tous les deux.
III DEUX HÉRITIERS
À cette réponse catégorique et menaçante, Achille-Musée Feydeau s’agita sur son sofa.
– On existe… on existe… grommela-t-il, mais, quand on n’a ni papier ni preuves…
– Le jeune César et la jeune Valentine de Rohan, répliqua Polduc, peuvent avoir tout cela.
– Leur naissance… commença l’intendant.
– Leur naissance, interrompit le sénéchal, fut constatée par le même chapelain dom Sidoine, qui mourut quand la fille, cadette du fils de César, de Saint-Maugon avait déjà trois mois.
– Vous avez vu les actes ? demanda l’intendant.
Le sénéchal ne put s’empêcher de sourire.
– Si je les avais vus, répliqua-t-il tout bas, je les aurais eus, et si je les avais eus, mon beau-père, nous parlerions à l’heure qu’il est de choses plus divertissantes… Mais, à présent, je suis sûr que vous sentez tout l’à-propos de mon histoire, et je la reprends au point où je l’avais laissée, avec la certitude d’être attentivement écouté. Revenons donc en Basse-Bretagne. Vous pensez bien que je jugeai inutile de me montrer à maître Josselin Guitan. J’attendis son départ derrière un fossé. Quand il fut parti, j’entrai dans la ferme de Thurien le Bozec ; je l’interrogeai le plus adroitement que je pus, mais c’était un vrai Bas-Breton, taciturne et rude, dont je ne pus tirer rien qui vaille. Il fallut patienter encore jusqu’au lendemain ; à l’heure du labour, Thurieu s’en alla aux champs, et je restait seul avec sa femme Julienne.
– Ah ! ah ! fit Achille-Musée, que fîtes-vous ?
– Je pris la main noire de Julienne, je l’ouvris et j’y versai une pleine poignée de gros sous… En Basse-Bretagne, une poignée de gros sous fait l’effet d’une pluie d’or. Julienne me dit tout ce qu’elle savait.
Malheureusement, elle ne savait pas grand’chose : Trois ans auparavant, remarquez bien la date, Julienne avait vu arriver un gentilhomme de haute taille, monté sur un grand cheval normand. Ce gentilhomme se tenait droit en selle, bien qu’il fût un vieillard ; une longue barbe blanche encadrait son visage sévère. À mesure qu’il approchait, Julienne cherchait à reconnaître la nature du fardeau qu’il portait. C’était un enfant.
Le vieillard s’arrêta devant la maison de Thurien le Bozec et dit à Julienne : Bonne femme, voulez-vous donner le vivre et le couvert à l’orphelin que voici ? Vous ferez de lui un paysan honnête et craignant Dieu. Pour votre peine, vous aurez, chaque année, douze écus de trois livres à la Noël.
Sur cette base, le marché n’était pas difficile à conclure. Julienne appela son homme et empocha les douze écus. Le vieillard n’avait pas quitté la selle, il tourna bride et s’en alla sans même embrasser l’enfant.
Le temps passa ; on ne revit plus le vieillard qu’à la Noël suivante, où il vint apporter les douze écus. Julienne remarqua cette fois que, son visage était plus pâle et que ses yeux brûlants avaient des regards fous. Il demanda si l’enfant vivait, paya et s’en retourna.
Mais quelqu’un l’avait suivi à son insu et, dès qu’il eut tourné le coude de la route, Julienne vit s’approcher un homme qui prit l’enfant dans ses bras et le couvrit de baisers en l’appelant son jeune seigneur…
– Et vous dites que cette Julienne ne vous apprit pas grand’chose s’écria l’intendant, qui avait de la sueur sous sa perruque.
– J’aime à vous voir ainsi, mon beau-père ! répliqua gaîment le sénéchal ; l’intérêt que vous prenez à mon récit me flatte, et je n’ai pas besoin de vous dire que, dès ce moment, j’eus la certitude d’avoir retrouvé le fils de César de Rohan. Je réfléchis, comme bien vous devinez, et le résultat de mes réflexions fut celui-ci : Tant que l’enfant est à la ferme des le Bozec, me dis-je, élevé en petit paysan, selon le vœu de son aïeul, qui se fait notre complice sans le vouloir, rien à craindre ; le mal, ce sont les visites de ce Josselin Guitan : il faut y mettre ordre.
L’enfant avait six ou sept ans : j’étais déjà seigneur de Rohan-Polduc et je croyais le comte Guy réfugié en Angleterre. Ce détail est peut-être sorti de votre mémoire : nous fîmes arrêter Josselin Guitan, sous je ne sais quel prétexte, et les verrous de la Tour Lebat se refermèrent sur lui. Je me mis alors à la place du comte Guy qui avait cessé de solder la pension. Tous les ans à la Noël j’envoyai de mes propres deniers douze écus tournois à Thurien le Bozec pour qu’il continuât de loger et de nourrir l’enfant.
– Et l’enfant est devenu un jeune homme ? demanda Feydeau, dont la curiosité impatiente pressait le dénoûment de l’aventure.
– L’enfant doit arriver à sa vingtième année, répondit le sénéchal.
– Il est toujours à la ferme de Thurien le Bozec ?
– Hélas ! non, mon beau-père, et c’est bien là le diable ! Je fus du temps sans l’aller voir, à cause de nos nouvelles occupations politiques. Ce coquin de Josselin Guitan prit la clé des champs au commencement de nos troubles, mais je n’eus point d’inquiétudes, parce que sa vieille mère se mit en noir après le combat de Châteaubourg et s’en alla partout pleurant son fils, tué par les gens de France… Quand je retournai à la ferme de le Bozec, l’oiseau était envolé.
L’intendant laissa tomber ses deux bras le long de son corps.
– Je comprends, fit le sénéchal. Votre avis est qu’on aurait pu prendre de meilleures précautions ; vous êtes dans le vrai, mon beau-père, mais ce qui est fait est fait. D’ailleurs, ce fils de César et de Jeanne de Combourg n’a point reparu jusqu’à présent ; il n’entre dans le total de nos embarras que pour mémoire. Je vous fais remarquer à l’occasion cette circonstance assez curieuse : nous avons reconnu pertinemment l’identité de l’héritier de Rohan, et nous ne savons pas où il est ; nous savons au contraire où est l’héritière de Rohan, mais nous n’avons sur son identité que des données bien incertaines.
– Comment, comment ! l’héritière de Rohan ! fit l’intendant en se redressant.
– Le fruit de l’autre mariage, célébré par le chapelain Dom Sidoine, répondit Alain Polduc, la fille de ma chère cousine Valentine et du beau Morvan de Saint-Maugon.
– Vous ne m’aviez rien dit… s’écria Feydeau. – C’est juste, j’allais y venir. Ce qui m’a fait anticiper, c’est la façon extraordinaire dont les deux histoires se croisent à dater d’un certain moment ; il y a là sujet à méditation, mon beau-père, et vous allez éprouver quelque surprise à voir entrer en scène un nouveau personnage que vous connaissez beaucoup, politiquement parlant… Ce n’est pas à vous qu’il faut apprendre que la volonté de M. le Régent fut transgressée, lors de l’exécution des quatre gentilshommes bretons à Nantes ; le maréchal de Montesquiou garda le message royal qui accordait la grâce, et ces quatre têtes tranchées pèseront lourdement sur sa conscience à sa dernière heure.
– D’accord, mon gendre, fit le sénéchal, mais vous vous éloignez de notre sujet.
– Non pas ! Avez-vous souvenir de certaine romanesque aventure qui précéda immédiatement l’exil du comte Guy, mon noble cousin, il y a quinze ans ? une entrevue de Valentine et du comte de Toulouse ? une révélation ?…
– Je me souviens de tout cela, mon gendre : mais quel rapport ?…
– Voici une autre historiette. On raconte que M. le Régent aperçut un soir à l’Opéra, dans le demi-jour d’une loge une femme merveilleusement belle.
– Mon Dieu ! mon gendre, interrompit Feydeau, qui était sur les épines, il y a temps pour s’occuper de ces sornettes.
– Voici la première fois, mon beau-père, que je découvre le côté sérieux de votre esprit. Permettez cependant, je vous ai parlé de l’entrevue de Valentine avec le comte de Toulouse parce que nous arrivons à quelque chose qui y ressemble. Ce n’est ni léger ni fleuri. La belle dame était à Paris tout exprès pour parler à M. le régent de choses infiniment sérieuses. Elle le lui dit dans une audience qu’elle eut au Palais-Royal. Il s’agissait d’affaires d’État. Quand elle sortit, la conspiration des chevaliers de la Mouche-à-Miel était découverte et M. le régent avait donné sa parole de gentilhomme que pas une tête ne tomberait, pour ce fait, en Bretagne.
– Cette parole là n’était pas de l’argent comptant, murmura Feydeau. Vous me racontez l’histoire de madame Saint-Elme, mon gendre !
– Précisément, mon beau-père, et vous allez deviner pourquoi. Posons d’abord que si les circonstances firent mentir le Régent pour ce qui regardait le bourreau, il a gardé du service rendu un reconnaissant souvenir. Madame Saint-Elme ne paraît point à la cour mais chacun sait bien que son pouvoir, pour rester mystérieux n’en est pas moins énorme. Son Altesse Royale la consulte, l’écoute et suit même ses avis : m’accordez-vous ces prémices ?
– Je n’y vois pas d’inconvénient.
– Eh bien ! beau-père, quand je retournai à la ferme de Thurien le Bozec, où notre petit bonhomme n’était plus, je commençai tout naturellement par jeter feu et flamme. Voici ce qui me fut raconté : Josselin Guitan était venu, non pas seul cette fois ; il était venu avec une dame jeune et belle, qui portait sur son visage pâli des traces de souffrance, Josselin Guitan et sa compagne avaient demandé l’hospitalité à la ferme ; les fermes de Basse-Bretagne n’ont qu’une chambre ; pour faire place à leurs hôtes, les époux le Bozec s’arrangèrent un lit dans l’étable. Le lendemain, en s’éveillant, ils ne trouvèrent ni Josselin Guitan, ni la jeune dame ; l’enfant, âgé alors de huit ou neuf ans, avait également disparu. Sur la table, il y avait une bourse bien garnie. Dans les draps du lit où avait couché la belle dame, pendant que Josselin veillait armé au dehors, Julienne trouva un chiffon de papier qu’elle porta, ne sachant point lire, au curé de la paroisse ; c’était l’adresse d’une lettre, et la suscription était ainsi conçue :
– À mademoiselle Valentine de Rohan ?… interrompit l’intendant, sûr de son fait.
« – À madame la baronne de Saint-Elme, à Paris, » rectifia lentement le sénéchal.
Feydeau enfla ses joues bleuies et resta comme abasourdi.
– Vous croiriez ?… commença-t-il après un silence.
– J’en suis sûr ! répondit le sénéchal.
– Vous l’avez vue ?
– Jamais !
– J’ai cependant un vague souvenir de lettres échangées entre vous.
– Elle m’a écrit une seule fois, mon beau-père, et nous entrons ici dans la partie de l’histoire qui concerne la fille de Valentine et de Morvan de Saint-Maugon.
* *
*
L’intendant royal était abasourdi. Jusqu’alors il avait cru que cette maison de Rohan-Polduc, déchue et dépouillée, s’éteignait tout doucement dans l’exil. Si parfois l’idée du vieux comte, et de sa fille Valentine, traversait son esprit par hasard, c’était un souvenir si lointain et si vague, que ses digestions n’en étaient nullement troublées. Il se sentait riche ; il avait l’ambition naïve des écus animés qui veulent rouler à la cour ; il se disait qu’en devenant plus riche encore, il achèterait quelque jour le pouvoir politique, comme il avait acheté les petites satisfactions de sa gloriole mondaine.
On ne peut pas dire que son gendre, le sénéchal, l’eût entraîné dans la comédie de Cellamare. Il y était entré de lui-même par désir de paraître, de jouer au chef de parti. Les financiers de cette sorte sont moins rares qu’on ne le pense. Bien des gens sont d’avis qu’une poignée de verges et une cellule aux incurables, suffiraient pour châtier ces Catilinas de carton. D’autres pensent au contraire que de pareils pantins ne méritent point de pitié.
La prétention que Feydeau avait d’être choisi entre tous pour conduire à l’autel la comtesse Isaure l’avait enfoncé très avant dans le complot. Il était par sa charge, le caissier du roi ; il se faisait en secret le caissier des conjurés, à condition de verser les sommes dues entre les belles mains de la comtesse Isaure.
À la condition surtout de laisser parfois son carrosse stationner devant le logis de la comtesse, et de franchir de temps à autre le seuil de sa maison après la nuit tombée, avec des apparences de mystère.
Le lecteur se tromperait, s’il assimilait la charge d’intendant royal, tenue par Achille-Musée à un emploi quelconque de finances existant de nos jours.
L’intendant de l’impôt, à la fois traitant et magistrat, était un personnage de premier ordre. Il était traitant par cela qu’il prenait à forfait les redevances d’une province, se portant fort pour le paiement d’une certaine somme fixée de gré à gré entre lui et l’État. Il était magistrat en ce qu’il avait droit de juger en premier ressort les litiges relatifs à l’impôt, et en ce second lieu parce qu’il connaissait des cas contestés de noblesse. Ceci lui donnait une influence énorme. De ses décisions, il n’y avait appel qu’à la chambre du roi.
Le motif de cette autorité mise entre les mains d’un homme de finances était du reste aisé à comprendre. Les gentilshommes ne payaient point la taille. L’intendant royal devait donc avoir le droit de demander à ces privilégiés les preuves de leur noblesse. On ferait un livre curieux avec les concussions des intendants, à l’endroit de la noblesse.
Pendant qu’il écoutait son gendre, tout un horizon vaste et sombre s’ouvrait devant Feydeau. Il avait cru causer de petites tracasseries politiques, et on lui montrait comme une main mystérieuse qui menaçait de se refermer sur ses millions mal acquis.
Ces Rohan semblaient renaître de leurs cendres ! On lui parlait d’un fils de César, d’une fille de Valentine. Une occulte protection entourait évidemment ce fils de César, dernier héritier de Rohan ; cette protection ne pouvait manquer à la fille de Valentine.
Cette protection avait un nom. Elle s’appelait madame Saint-Elme.
Achille-Musée faisait tous ses efforts pour repousser une idée qui lui venait : Cette madame Saint-Elme était-elle Valentine de Rohan ?
– Mon beau-père, reprit cependant le sénéchal, madame Saint-Elme m’a fait l’honneur de m’écrire une fois, comme je vous le disais ; je n’aurai pas besoin d’un grand effort de mémoire pour me rappeler sa lettre, car sa lettre ne contenait qu’une seule ligne. Voici comment elle était conçue :
« Je suis à Paris, Paris est loin, mais j’ai le bras long, prenez garde ! »
« Saint-Elme. »
IV MADAME SAINT-ELME
À la lecture de ce laconique message, l’intendant secoua la tête et fronça le sourcil.
– C’était une menace, cela, dit-il.
– Je le pris ainsi, mon beau-père, répliqua le sénéchal.
– Mais à quel propos cette menace ?
– J’ai toujours eu le cœur tendre, vous le savez, et mes penchants sont charitables, quand j’y trouve quelque intérêt. Je venais de recueillir chez moi cette enfant qui sert vos filles…
– Céleste ?
– Oui… Et l’un de mes valets m’avait raconté je ne sais quelle fantastique histoire de cette petite Céleste sommeillant là-bas dans la bruyère auprès du Pont-Joli et d’une belle dame qui se penchait au-dessus d’elle pour la baiser en pleurant…
– Mais cette Saint-Elme, interrompit l’intendant avec un véritable effroi, serait donc venue dans le pays !
– J’ai lieu de croire qu’elle y est en ce moment, mon beau-père… Notre petite Céleste a été consulter la Sorcière de la forêt, et la Sorcière lui a promis qu’elle serait comtesse.
Est-ce que vous croyez aux sorcières, vous, monsieur le sénéchal ?
– Je crois au diable, monsieur l’intendant, et je me résume : Paris est loin, mais la femme qui a sauvé le Régent de France a le bras long. Vous et Moi nous pouvons perdre en cette affaire autre chose que de l’argent.
Achille-Musée se sentait venir des vapeurs comme s’il eût été une jolie marquise. Il ferma les yeux et vit passer les quatre gentilshommes de Nantes avec leurs épaules sans têtes. Mieux que personne il savait que le soir du jour où Philippe d’Orléans avait causé avec Mme Sainte-Elme, sans elle, les quatre gentilshommes auraient enlevé Philippe d’Orléans à main armée.
– Pourquoi ne m’avez-vous pas parlé de cela plus tôt ? murmura-t-il plaintivement.
– Les choses marchent, mon beau-père, répondit Polduc avec calme, et leur allure qui varie détermine notre conduite de chaque jour. Peut-être que, hier encore, j’avais intérêt à vous laisser ignorer tout cela.
– Nos intérêts ne sont-ils donc pas les mêmes ?
– Si fait, mon beau-père, si fait… en thèse générale au moins.
L’intendant releva sur son gendre un regard soupçonneux. Polduc se prit à sourire.
– J’ai sur vous l’avantage du plus faible, poursuivit-il ; l’humble lierre s’attache au chêne puissant et ne s’inquiète point de l’étouffer.
– M’étouffer ! monsieur de Polduc ! se récria l’intendant avec une sérieuse horreur.
C’était vraiment pitié que de noyer un si pauvre homme dans la bouteille au noir ! Polduc jugea qu’il l’avait amené à un degré suffisant d’épouvante et poursuivit en changeant de ton :
– Avec un nourrisson des muses tel que vous, mon beau-père, j’ai cru pouvoir me permettre une figure de rhétorique. Vous connaissez, du reste, tout mon dévoûment à votre personne : chaque fois que je pourrai vous aider sans me nuire, je le ferai de grand cœur. Mais l’Évangile chrétien et la fable païenne se sont rencontrés pour poser le même principe : Aide-toi toi-même !… J’achève ce que j’avais à vous dire sur les héritiers de Rohan : Sans autre preuve matérielle que la lettre brève et caractéristique de la Saint-Elme, je suis certain que la jeune Céleste est la fille de Valentine et de Saint-Maugon.
– Dans votre idée, interrompit l’intendant, cette madame Saint-Elme serait Valentine elle-même ?
– Je n’ai pas dit cela ! Seulement cette Saint-Elme a enlevé le fils de César à la femme de le Bozec, et cette même Saint-Elme paraît s’intéresser très-vivement à la fille de Valentine. Je laisse votre excellent esprit tirer de ce double fait toutes conséquences logiques.
L’intendant reprit à partie sa boîte d’or et fit mine de réfléchir profondément. Il savait bien que son gendre lui épargnerait en définitive le soin de tirer toute espèce de conséquences.
– Arrivons maintenant, continua le sénéchal, quelque chose de beaucoup plus étrange encore. Vous n’êtes pas sans avoir entendu parler de la Meunière ?
– Est-ce que ce n’est pas la même que la Sorcière ?… Mon intelligence répugne à ces sottises surnaturelles.
– Je ne veux point vous parler des miracles qui effraient nos sabotiers. Je veux vous dire qu’on a trouvé la semaine passée le corps de la Meunière sous un tas de branchages non loin de la hutte qu’elle habitait dans la grand’lande de Saint-Aubin-du-Cormier.
– Dieu la bénisse !
– Amen !… Et que nonobstant, la Meunière continue de rendre des oracles dans la forêt.
L’intendant huma une pincée de tabac d’Espagne avec le sourire des sceptiques.
– Arrangez cela ! fit-il en haussant les épaules.