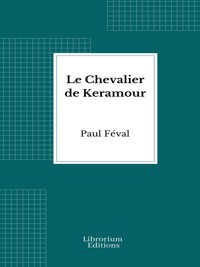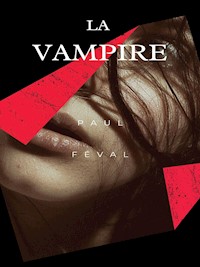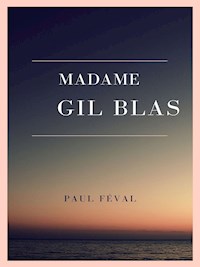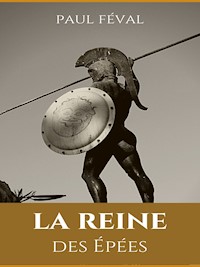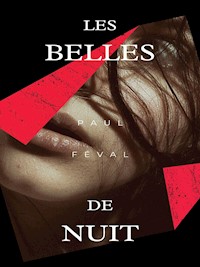Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Depuis plusieurs générations, une légende hante le célèbre château de Bluthaup en Allemagne. Trois hommes rouges apparaissent plusieurs fois par siècle, lorsqu'un danger menace la famille. Ils apparaissent une nouvelle fois à l'occasion du décès du Comte Gunther de Bluthaup pour essayer de sauver la comtesse Margarethe et son fils, surnomme « le fils du diable » à cause des mystères planant sur sa conception et les occupations diaboliques du vieux Gunther, son prétendu père. Vingt ans après, les trois hommes rouges se préparent à apparaitre une dernière fois dans le but de rétablir le fils du diable comme le riche héritier des Bluthaup et maitre incontesté du château et de ses domaines immenses.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 926
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Fils du diable
Le Fils du diableQUATRIÈME PARTIE. LE CABARET DES FILS AYMONCINQUIÈME PARTIE. LE MYSTÈRE DE LA TRINITÉSIXIÈME PARTIE. LES BÂTARDS DE BLUTHAUPT.SEPTIÈME PARTIE. LE BARON DE RODACH.Page de copyrightLe Fils du diable
Paul Féval
QUATRIÈME PARTIE. LE CABARET DES FILS AYMON
I. – Affaire conclue.
Nous reprenons notre histoire où nous l’avons laissée ; nous sommes encore au Temple, le soir du lundi gras de l’année 1844.
Les cabarets qui avoisinent le marché faisaient tous bonne recette. Bien que le lundi-gras soit un jour de relâche entre les bombances du dimanche et l’orgie consacrée du mardi, il fait partie du carnaval et demande à être arrosé, ne fût-ce que modérément.
En conséquence, on buvait comme il faut tout autour du Temple ; le cidre et le petit vin blanc prodiguaient leurs flots aqueux. Les cabarets à la mode regorgeaient de chalands, ni plus ni moins que la veille, et déversaient le trop plein de leurs pratiques sur les guinguettes moins illustres, qui prenaient ainsi part à l’aubaine.
C’était à peu près l’heure où madame de Laurens descendait l’escalier roide et glissant de Batailleur, pour gagner la place de la Rotonde. Comme nous l’avons dit, elle s’était arrêtée un instant au bout de la rue du Petit-Thouars, parce qu’elle avait cru reconnaître, à la lueur des réverbères, Franz, traversant la place d’un pas rapide et se glissant dans une obscure allée.
Petite était une femme forte, et ces frayeurs vulgaires qui ont coutume d’arrêter son sexe ne la gênaient nullement : elle avait intérêt à joindre Franz, et sans la voix de l’idiot Geignolet qui vint jeter sa monotone chanson dans les ténèbres de l’allée, Petite se fût engagée intrépidement dans cette route inconnue.
Le chant de l’idiot arrêta son premier mouvement. Était-ce bien Franz d’ailleurs ? Ces lueurs vacillantes qui tombent des réverbères sont sujettes à tromper. Comme elle hésitait, son regard se tourna vers le bâtiment de la Rotonde et ses yeux demeurèrent fixés sur un point lumineux qui brillait dans l’ombre du péristyle.
Elle n’hésita plus ; on eût dit que cette lumière aperçue l’attirait comme un aimant.
Elle traversa la place et s’arrêta devant la boutique du bonhomme Araby. Au moment où elle collait son œil aux fentes de la devanture, un équipage élégant débouchait au carrefour du château d’eau et s’engageait dans la rue du Temple. Le cocher arrêta ses fringants chevaux à la hauteur de l’église Sainte-Elisabeth ; le laquais abaissa le marchepied et un homme dont le costume disparaissait sous un manteau en caoutchouc descendit sur le trottoir.
– Attendez moi, dit-il.
Le laquais referma la portière et se promena de long en large devant l’église. Le cocher, infatigable dormeur comme tous ses pareils, s’arrangea sur son siége et entama un somme.
Le maître remonta le trottoir durant quelques pas et tourna l’angle de la rue de Vendôme.
Il était vêtu comme un jeune homme, et la coupe écourtée de son imperméable dénotait de sérieuses prétentions à l’anglomanie. Sa démarche voulait être vive et leste. Sous les petits bords de son chapeau, on voyait briller les boucles d’une abondante chevelure. On ne voyait que cela, parce que les collets de son caoutchouc, relevés britanniquement, cachaient la majeure partie de son visage.
La rue de Vendôme, qui doit son nom au dernier grand-prieur de la langue de France, marque encore l’une des frontières de l’ancien domaine des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Bien qu’elle confine au Paris bruyant et marchand, elle est déjà du Marais, et son tranquille silence fait contraste avec le fracas affairé du boulevard voisin. Entre elle et ce groupe de théâtres qui se disputent les faveurs inconstantes du peuple parisien, il n’y a qu’une étroite ligne de maisons ; mais c’est comme un monde ; les habitants de ces demeures touchent d’un côté à la foule, de l’autre au désert.
Notre homme suivit la rue de Vendôme, rasant de près les murailles et se donnant les airs d’un personnage en bonne fortune. Il ne pouvait point toutefois, malgré sa grande envie, ôter à son pas une roideur lourde. Les plis droits de son caoutchouc dissimulaient mal une obésité déjà très-prononcée, et ses efforts n’aboutissaient qu’à lui donner la tournure d’un ci-devant jeune homme.
Cette tournure est éminemment dangereuse en temps de carnaval, et les gens très-gais sont, par nature, impitoyables pour les beaux Narcisses parvenus à la cinquantaine. Mais notre homme n’avait à redouter aucune rencontre fâcheuse dans la voie solitaire qu’il avait choisie. Quelques cris joyeux et railleurs arrivaient jusqu’à lui par le passage Vendôme, cet indigent corridor qui veut singer les élégances des galeries fashionables : c’était tout. Le passage se montrait presque aussi désert que la rue, et la lumière du gaz y prenait une teinte mélancolique pour éclairer ses bazars dédaignés.
À l’angle des rues de Vendôme et du Puits, notre homme tourna court et redescendit vers le Temple. Le vent souleva en ce moment les pans rigides de son petit manteau, qui flottèrent en rendant un bruit de parchemin, et découvrirent son vêtement de dessous lequel était un paletot blanc.
M. le chevalier de Reinhold essaya d’abord de contenir les mouvements désordonnés de son imperméable, mais le vent faisait rage et il fut obligé de reporter sa sollicitude sur son petit chapeau, dont la perte eût pu entraîner celle de sa chevelure.
Il poursuivit sa route en grondant et ne s’arrêta que devant les rideaux quadrillés du cabaret de la Girafe.
Le comptoir de Johann était plein comme l’œuf. La Girafe s’asseyait à son poste plus ronde, plus grosse, plus rouge, plus souriante que jamais ; elle versait le vin de champagne avec des façons si avenantes, et dans des canons si évidemment rincés, que ses pratiques ne pouvaient point se lasser de boire. Elle avait pour chacun, l’enchanteresse, quelques petits mots de baragouin français-allemand, qui donnaient soif comme autant de pincées de poivre.
Son mari, le marchand de vin Johann, se tenait debout à l’autre extrémité de la salle et daignait converser avec la partie grave de l’assemblée.
C’était là un grand honneur, car Johann passait pour avoir du foin dans ses bottes et ne causait vraiment point avec le premier venu.
Parmi son auditoire se trouvaient deux ou trois de nos convives allemands de la veille ; mais la plupart manquaient : il n’y avait là ni le brave Hermann, ni le bon marchand d’habits Hans Dorn, ni Fritz le sombre courrier de Bluthaupt. L’assemblée se composait en majeure partie de gens inconnus et que nous n’avons point intérêt à connaître. Nous citerons seulement deux des buveurs privilégiés qui s’échauffaient aux sourires de la Girafe.
Le premier était un gros garçon à la physionomie épaisse, à la tournure lourde, un pétras, comme on dit au Temple et ailleurs, qui se plantait droit et silencieux devant le comptoir avec tout le flegme germanique. Ce garçon était très blond, très-charnu, très-rose et semblait parfaitement préservé de pensées. Il s’appelait Nicolas : c’était le neveu de Johann, ce propre neveu pour lequel le cabaretier avait convoité la main de Gertraud, et qui était par conséquent la cause de l’animadversion conçue par Johann contre les pauvres Regnault ; car Jean, le joueur d’orgue, malgré sa misère, barrait la route à Nicolas.
Le second était un petit homme de cinquante à cinquante-cinq ans, dont le crédit semblait parfaitement assis dans la maison. Ce petit homme avait la réputation d’être un peu agent de police ; cela lui donnait de la considération : il avait nom Romain dit Batailleur. À une époque déjà fort éloignée, il avait noué avec une jeune fille du quartier des Halles un de ces mariages transitoires qui se passent de la mairie et de l’église. Le divorce avait eu lieu entre eux depuis longtemps, mais cette union avait donné à la jeune fille le droit extra-légal de porter le beau nom de Batailleur.
Elle en usait. Elle était devenue une des notabilités du Temple. Son ancien mari était tout fier d’elle ; il eût donné beaucoup pour redevenir son seigneur et maître. Il eût résigné pour elle ses fonctions politiques ; il eût planté là le gouvernement de grand cœur, pour redevenir simple marchand de frivolités.
Mais il n’était plus temps : le malheureux Romain tournait en vain autour de son ex-femme, qui le tenait rigoureusement à distance. Il en était réduit aux inutiles regrets du passé. Bien qu’il fût jovial et bon vivant, personne n’ignorait la blessure de son cœur ; son chagrin se faisait jour malgré lui, et quand le petit vin blanc le rendait plus expansif, il avait coutume de commencer ses histoires par cette formule à la fois orgueilleuse et tout imprégnée de mélancolie attendrissante :
– Du temps que j’étais l’époux de madame Batailleur…
À la vue de la foule qui encombrait le cabaret de la Girafe, M. le chevalier de Reinhold était resté indécis et comme décontenancé. D’ordinaire, l’établissement de Johann ne péchait point par trop de chalands. Le chevalier avait coutume de parvenir jusqu’à lui incognito, et quand il ne le faisait point mander à l’hôtel, leurs conférences avaient lieu dans cette chambre réservée où nous avons assisté au repas des Allemands.
Mais aujourd’hui c’était le lundi-gras : le salon de société se trouvait plein comme le comptoir lui-même. Le chevalier, qui venait de glisser son regard à travers les carreaux poudreux, y avait vu une nombreuse et belle compagnie, des dames du Temple avec leurs sigisbés, des chineurs en goguette, et dans un coin le brillant Polyte, favori de madame Batailleur, qui consommait les vingt-cinq sous octroyés par sa reine.
Le chevalier savait qu’il était parfaitement connu dans le Temple. Le jeu qu’il y jouait ne l’entourait pas d’une popularité très-grande, et il répugnait à se montrer en public, ce soir-là surtout, qui venait après un jour d’échéance.
Il ne savait pas exactement le compte des saisies opérées dans la journée ; mais les saisies ne manquaient jamais aux époques de payement, et l’indigence connue de ses pauvres clients ne lui laissait aucun doute à cet égard.
Les groupes de buveurs lui cachaient Johann, qui se trouvait à l’extrémité la plus reculée de la pièce. Dans le premier moment il ne se sentit point le courage d’affronter cette foule hostile, et d’instinct il fit quelques pas en arrière pour regagner son équipage. Mais la réflexion le retint. Il fallait qu’il parlât à Johann. Bien que l’intrépidité ne fût point son fort, il se fit honte à lui-même et revint se placer devant la porte du cabaret, en ayant soin de se tenir dans l’ombre.
Il resta là durant plusieurs minutes, cherchant à distinguer son factotum dans l’atmosphère fumeuse du comptoir, et se garant de son mieux contre les rayons du gaz qui traversaient la rue étroite.
Un mouvement qui se fit parmi les buveurs démasqua enfin la figure revêche du cabaretier Johann. Le chevalier enfonça son chapeau sur ses yeux, releva davantage le collet de son caoutchouc, et traversa la rue en trois enjambées.
Il entra. Malgré ses précautions, tout le monde le reconnut du premier coup d’œil. Un murmure sourd se fit dans la salle.
– Le bausse !… c’est le bausse ! prononçait-on à demi-voix.
Mais ce murmure n’avait absolument rien de menaçant, et Reinhold avait eu grand tort de craindre.
Parmi la jalousie du pauvre contre le riche, il y a un respect étrange que la passion elle-même, à ses heures de paroxysme, ne peut pas secouer sans peine. Si la haine légitime et l’esprit de vengeance se joignent à la jalousie, il y a explosion parfois, mais c’est rare.
Et encore faut-il des circonstances agglomérées. En thèse générale, le pauvre n’ose pas. Quand il se fâche une fois, c’est de la fièvre et de la rage ; il frappe alors à l’aveugle, et ses vrais ennemis savent éviter ses coups.
À peine le chevalier fut-il entré dans le cabaret de Johann, que sa frayeur passa comme par enchantement. Il vit sa force. Toutes les têtes se découvrirent humblement autour de lui ; un seul et même sourire, modeste, soumis, adulateur, vint à toutes les bouches. La Girafe éleva son énorme corpulence au-dessus du comptoir, dessina un triple salut et retomba, écrasée sous le poids de son respect.
– Johann ! s’écria-t-elle, oh ! Johann… c’est monsieur le chevalier !
Le marchand de vin avait déjà quitté le groupe dont il faisait partie, et s’avançait vers Reinhold, la casquette à la main.
Le chevalier prit un air d’empereur ; son regard parcourut les rangs de l’assemblée émue et saisie de vénération.
– Bonsoir, Lotchen, ma grosse mère, dit-il à la Girafe qui devint cramoisie de joie ; voilà de bons garçons qui fêtent le lundi-gras !… Ça me fait plaisir de voir le peuple s’amuser !… J’aime le peuple !… Versez un verre de vin à tous ces braves gens, Lotchen, afin qu’ils boivent à ma santé.
Il avait pris la pose de Henri IV prononçant le fameux vœu de la poule au pot.
L’assemblée s’agita, respectueuse et reconnaissante.
Le chevalier sortit d’un pas royal, en faisant signe à Johann de le suivre.
– C’est un brave homme tout de même ! s’écria Romain dit Batailleur, en vidant son verre de vin. – De loin, ça semble des tigres, dit le neveu Nicolas d’un air niais ; de près, c’est des bons enfants !…
Deux ou trois voix s’élevèrent pour protester, objectant qu’on avait saisi le jour même, à la requête du chevalier, une demi-douzaine de pauvres marchandes du Temple.
Mais la Girafe, indignée, frappa son broc d’étain contre le plomb du comptoir, et s’écria dans un élan inspiré :
– C’est des gueuses qui n’ont pas le moyen de payer leurs dettes !… Faudrait-il pas prendre des gants avec ça ! – Excusez ! appuya Batailleur, quand j’étais l’époux de madame, ça se trouvait aussi qu’on avait par-ci par-là de mauvaises pratiques… Eh bien ! je dis qu’on les faisait marcher, quoi donc ! – Quoi donc !… répéta le neveu Nicolas. – Parbleu ! conclut l’assemblée ; il faut de l’exactitude dans le commerce ! – Et puis, ça fait du bien aux bons sujets qui ont de quoi, reprit Batailleur ; tenez, il y a la place de la mère Regnault, là-bas au coin de la Rotonde, qui est fameuse pour les refaçonnés… Si j’étais encore avec madame, je prendrais cette place-là tout de suite. – Pauvre bonne femme Regnault ! murmurèrent quelques âmes trop tendres.
La Girafe haussa les épaules.
– On dit qu’on va la mettre en prison ! à son âge ! – Peuh ! fit l’époux Batailleur. Il y a trente ans que la mère Regnault encombre cette place-là ; chacun son tour.
M. de Reinhold et Johann étaient tous les deux dans la rue et s’entretenaient à voix basse.
– Il y en a eu cinq de mises à la porte, disait le marchand de vin ; sur les cinq, j’en vois trois qui payeront, parce qu’elles ont des nippes… Les deux autres n’ont rien… et savez-vous que maman Regnault nous doit beaucoup d’argent, monsieur le chevalier ?
– Nous parlerons de cela plus tard, interrompit Reinhold. J’ai une affaire d’importance à mettre entre vos mains. – Mais celle-là n’est pas indifférente !… et comme je me suis laissé dire que la mère Regnault avait quelque part, dans le haut monde, de bonnes accointances, ma foi ! j’ai fait exécuter le jugement…
– Elle est arrêtée ? dit le chevalier avec une certaine vivacité. – Non pas… elle se cache… mais il fera jour demain !
Le chevalier s’arrêta court, en ce moment, et se posa en face de son factotum. Johann voulut poursuivre l’entretien ; mais il fut interrompu par un geste de Reinhold, qui lui serra le bras en le regardant fixement.
– Vous devez avoir de bonnes économies, Johann ? dit le chevalier ; mais vous n’êtes pas encore ce qu’on appelle un homme riche… – Tant s’en faut ! commença le maître de la Girafe. – D’un autre côté, reprit Reinhold, vous voici arrivé à un certain âge… Vous avez bien cinquante-cinq ans, n’est-ce pas, Johann ? – Cinquante-sept ans, vienne le mois de juin ! – Eh bien ! mon brave garçon, quand on a cet âge-là, il n’est plus temps de mettre les sous de côté, un à un… il faut renoncer à faire fortune, ou faire fortune tout d’un coup…
Johann baissa les yeux pour examiner le chevalier en dessous.
– Pourquoi me dites-vous cela ? murmura-t-il. – Parce que vous êtes un homme sage, Johann, répliqua Reinhold avec un sourire flatteur ; parce que vous savez voir le bon côté des choses… et que je vous crois un serviteur dévoué. – Vous avez quelque rude besogne à faire faire, monsieur le chevalier ! – Du tout !… Quelques mesures à prendre… Une demi-douzaine de gaillards à trouver… C’est une affaire où vous n’auriez point à travailler personnellement, Johann… Je tiens trop à vous, mon bon ami, pour vous exposer ainsi à l’avant-garde… Il y a donc du danger ? demanda le marchand de vin. – Oui et non… En France, ce serait dur… Mais en Allemagne… – Ah ! ah ! fit Johann, l’affaire est en Allemagne ?…
Le chevalier se prit à rire.
– Une occasion de revoir le pays ! dit-il. – Et que ferait-on ?
Le chevalier ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de lui pour se bien convaincre que nulle oreille curieuse n’était à portée de l’entendre ; puis il se rapprocha de son interlocuteur.
– Il s’agit de l’enfant, dit-il. – Ah !… fit Johann, qui prit un air attentif et curieux ; vous avez donc de ses nouvelles ? – Il est à Paris. – Je vous l’avais bien dit, l’autre fois ! – Ami Johann, ne vous vantez pas !… vous n’avez pas fait bon guet en cette occasion… Que m’avez-vous appris ? Rien du tout !… Et cependant, il y a longtemps déjà que le petit bonhomme est au milieu de nous, et ce serait bien le diable si vos camarades allemands n’en savaient pas quelque chose ! – Je puis vous certifier… – À la bonne heure !… votre dévouement ne fait pas pour moi l’ombre d’un doute… mais êtes-vous bien sûr que ces brutes allemandes n’ont pas pris quelque défiance ?… – De moi ? s’écria Johann. Allons donc !… ils me croient entiché comme eux de la mémoire de Bluthaupt… S’ils ne m’ont rien dit, c’est qu’ils n’en savent pas plus long que moi. – Tant mieux ! – Mais comment avez-vous appris vous-même ?… – Ceci est une autre affaire, et l’histoire serait longue. L’important, c’est que nous l’avons appris et qu’il ne nous reste aucun doute à cet égard… Il y a plus : comme la diligence est la mère de toutes les vertus, nous avons manœuvré sans perdre de temps et joué une première partie. – Et vous l’avez perdue ? – Nous avions beau jeu ! dit le chevalier avec un accent de regret ; mais la chance était contre nous… Le petit homme se porte fort bien, et nous en restons pour nos peines.
Johann releva son regard sur le chevalier et fit un geste significatif.
– Fi donc ! s’écria Reinhold répondant à ce geste. Vous autres bonnes gens, vous ne rêvez que coups de couteau… C’est trop dangereux, ami Johann, je n’en use pas. – Quand on veut en finir… voulut dire le marchand de vin. – Quand on veut entrer, interrompit Reinhold, il n’est pas absolument nécessaire d’enfoncer la porte ! J’avais trouvé un peu mieux que cela… un bon petit duel avec un maître d’armes. – Tonnerre ! dit Johann, suffoqué d’admiration ; c’était pourtant fameux ! – Pas trop mauvais !… mais l’homme propose et le diable dispose… La partie est remise, il s’agit de jouer mieux.
Ils étaient à l’embouchure de la rue du Puits, à quelques pas seulement des baraques du Temple, sous lesquelles régnaient le silence et les ténèbres. Le chevalier jeta une seconde fois son regard dans la nuit ; les trottoirs étaient déserts ; rien ne s’agitait dans l’ombre du marché vide.
Par excès de précaution, il attira Johann au centre du pavé, à égale distance des maisons de la rue du Petit-Thouars et des baraques du Temple ; puis il mit sa bouche tout contre l’oreille du marchand de vin et reprit la parole à voix basse.
Il parla durant deux ou trois minutes sans s’arrêter.
Quand il eut achevé, Johann baissa la tête d’un air d’hésitation.
– Me comprenez-vous ? demanda le chevalier. – C’est assez clair comme ça ! répliqua Johann. – Eh bien ? – Eh bien !… il y a des juges en Allemagne comme en France… et je n’ai qu’une tête entre mes deux épaules, monsieur le chevalier. – Laissez donc ! reprit Reinhold, vous connaissez le pays mieux que moi, et vous savez très-bien… – Il y a des ressources, c’est la vérité… mais, voyez-vous, malgré mes cinquante-sept ans, je n’ai pas encore envie de m’en aller dans l’autre monde. – Qui parle de cela ? – Les faits… On a vu de ces histoires finir très-mal, vous savez bien… et je crois qu’il vaut mieux mettre de côté sou à sou quelques années encore, que de risquer un coup si chanceux.
Le chevalier ne savait trop si Johann marchandait ou refusait ; il le considérait attentivement et tâchait de son mieux à lire la vérité sur sa physionomie ; mais la physionomie triste et sèche de l’ancien écuyer de Bluthaupt était un livre fermé.
Johann restait maintenant froid et silencieux. Le chevalier commençait à désespérer.
– Allez-vous donc me refuser ? demanda-t-il enfin. – Ma foi, monsieur le chevalier, répliqua Johann, ça me fait cet effet-là… Encore si vous disiez ce que vous comptez donner !…
Reinhold se frappa le front, en éclatant de rire.
– Ami Johann, dit-il, vous êtes le seul Allemand d’esprit que j’aie jamais rencontré !… Sans vous, j’allais oublier le principal !… Vous devez bien avoir, n’est-ce pas, une cinquantaine de mille francs placés quelque part ? – À peu près. – Eh bien ! cette affaire-là vous complétera les mille écus de rente… Vous voyez que je ne marchande pas !… les autres seront payés convenablement et par votre canal, ce qui vous permettra peut-être de faire encore quelque bon bénéfice… Cela vous va-t-il ?
Le visage de l’Allemand n’exprima ni joie ni aucune autre émotion quelconque.
– Tope ! dit-il seulement en avançant la main, je fais l’affaire.
II. – Larifla.
Reinhold et son premier ministre Johann étaient désormais parfaitement d’accord sur le fait principal ; restaient les difficultés d’exécution.
Ils se promenaient côte à côte maintenant sur le trottoir, causant à voix basse et discutant le fort et le faible de l’entreprise.
– C’est difficile, disait Johann en attirant le chevalier vers son cabaret ; au Temple, on trouve encore pas mal d’honnêtes garçons qui n’ont pas de préjugés… Pour une bonne petite affaire où il ne s’agirait que de police correctionnelle, je connais vingt sujets, tous très-capables… il n’y aurait que l’embarras du choix… mais pour une grande affaire, ce n’est pas le quartier… ils ne tiennent pas cet article-là… et vous sentez bien, bausse, qu’on ne peut pas s’avancer ici à la légère. – Je le crois bien ! répliquait Reinhold ; mais cherchons. – Cherchons ! cherchons !… Quand il n’y a pas, il n’y a pas… et puis vous avez cette coquine de condition de savoir l’allemand, qui rend la chose encore plus malaisée. – Vous sentez bien que c’est indispensable… – Je ne dis pas non. – Il faut qu’ils puissent s’acclimater dans le pays et jouer au besoin leur rôle de paysans du Wurzbourg. – Sans doute, mais… – Ami Johann, cherchons.
Ils arrivaient devant la porte de la Girafe ; Johann attira le chevalier de l’autre côté de la rue, et se mit à compter de l’œil les buveurs rassemblés dans son cabaret.
À mesure que son regard passait de l’un à l’autre, il hochait la tête avec mauvaise humeur.
– Voilà bien trois ou quatre Allemands qui feraient notre affaire, grommelait-il ; mais allez donc leur parler de la chose !… Hans Dorn le saurait dès ce soir, et le procureur du roi descendrait chez moi demain matin. – Mais ce Hans Dorn lui-même, demanda le chevalier, ne pourrait-on pas l’acheter ?…
Johann leva sur lui un regard stupéfait.
– Acheter Hans Dorn ! murmura-t-il, c’est le mulet le plus obstiné qui soit dans le Temple… Vous êtes bien riche, monsieur le chevalier, mais vous vous ruineriez vingt fois avant d’avoir eu seulement un petit morceau de Hans Dorn !… À part les Allemands, je ne vois rien chez moi qui puisse vous convenir… Le père Batailleur est un vieux coquin qui a fait tous les métiers, et qui ne reculerait peut-être pas devant notre affaire ; mais c’est un Parisien pur sang, qui n’a jamais perdu de vue le dôme des Invalides, et qui ne sait guère d’autre langue que l’argot du Temple. – Et ce beau-fils ? demanda Reinhold en montrant du doigt Polyte, qui sortait après avoir jeté ses vingt-cinq sous sur le comptoir.
Johann haussa les épaules énergiquement.
– Ça ! dit-il, c’est un feignant qui sent l’eau de Cologne… ça va sucer un cure-dent sur le boulevard, pour faire croire que ça a dîné chez Deffieux.
Deffieux est le Café de Paris de ces latitudes.
Polyte avait épuisé la carte de la Girafe ; il remontait fièrement vers les théâtres, en écartant la poitrine et en faisant belle cuisse, pour imiter ces jeunes mannequins entretenus par les tailleurs, qui encombrent, aux heures fashionables, le boulevard de Gand, et que les gens de bonne foi prennent pour des boutures de pairs de France.
– Et ce gros garçon qui cause avec votre femme ? demanda encore Reinhold, en indiquant le neveu Nicolas. – Ceci est une autre paire de manches, répondit Johann en se redressant avec dignité, c’est mon propre neveu !… un enfant élevé comme il faut, et qui connaît le prix des sous : ça fera son chemin… mais ce n’est pas moi qui voudrais l’embaucher pour notre besogne, monsieur le chevalier. – Mais enfin, dit ce dernier, qui prendre ?
Johann se gratta le front sous sa casquette, d’un air sérieusement embarrassé.
– C’est malaisé, grommela-t-il ; si nous étions seulement là-bas, derrière Notre-Dame ou du côté des Gobelins, nous n’aurions qu’à choisir… – Allons-y, dit Reinhold. – Allez-y !… Quant à moi, je ne me risque pas si loin de mon établissement… On me connaît dans le Temple, j’y ai mes coudées franches, c’est très-bien ; mais de l’autre côté de l’eau, j’ai ouï dire qu’ils sont enrégimentés et qu’il ne fait pas bon les flairer de trop près quand on n’a pas le mot de passe. – Romans que tout cela ! grommela le chevalier. – C’est bien possible, bausse, mais le bagne est de l’histoire.
Reinhold fit quelques pas sur le trottoir en frappant du pied avec impatience, puis il revint brusquement vers Johann.
– Je vois bien que l’affaire ne vous va pas, reprit-il. J’en suis fâché, car c’était un joli bénéfice… Il me reste à vous demander le secret. Je vais me pourvoir ailleurs. – Attendez, dit Johann. – La chose presse… – La Girafe est un établissement trop bien tenu, et il y a d’autres endroits au Temple… Voyez-vous, bausse, ce n’est pas l’argent qui me tient ; mais je ne voudrais pas vous laisser dans l’embarras… Faisons un tour sur la place de la Rotonde ; je regarderai en passant chez mes confrères, et çà me donnera peut-être des idées.
Ils prirent la rue de la Petite-Corderie et débouchèrent, au bout de quelques pas, sur la place de la Rotonde devant la maison de Hans Dorn.
– À l’Éléphant et Aux deux Lions, dit Johann en se parlant à lui-même, c’est de la haute !… Au Camp de la Loupe, c’est des amours… il n’y a que les Quatre Fils Aymon… – J’ai entendu parler de cet endroit-là, interrompit Reinhold. – Je crois bien !… c’est un établissement bien gai. Ceux qui font les hardes volées s’y réunissent tous les soirs, et l’on peut se nipper là, des pieds à la tête, proprement, à très-bon compte… Ah ! bausse, si c’était rangé, ces lurons-là, ça pourrait s’établir un peu bien !… J’en connais qui font des trente francs d’habits dans leur journée. Où ça ? je n’en sais rien ; mais quand ils reviennent le soir aux Quatre Fils, ils ont toujours deux ou trois pantalons l’un sur l’autre, quelque beau gilet dans leur poche et des cravates dans leurs chapeaux… Mais ça ne sait pas se tenir ; c’est débraillé, mauvais ton, toujours ivre… ça joue, ça se bat, ça fait du bruit ; si bien qu’au lieu d’avoir un rang, ça passe la moitié de sa vie en prison. – Et le cabaret est-il loin d’ici ? demanda Reinhold. – Le voilà, répondit Johann en montrant du doigt une lanterne jaunâtre suspendue au-devant d’une allée sombre.
Tout en parlant, ils avaient continué de marcher, et se trouvaient de l’autre côté de la Rotonde, à l’opposé du marché du Temple. Cette partie de la place qui débouche dans les rues Forez et Beaujolais présente, la nuit venue, un aspect plus triste et plus solitaire que le reste du quartier. Ce n’est point un lieu dangereux pour le passant, à cause du corps de garde qui s’ouvre à quelques pas de là, au coin de la rue Percée ; mais, nonobstant cela, les passants y sont rares. Les becs de gaz, placés à de trop longs intervalles, jettent des lueurs indécises sur les devantures fermées des misérables boutiques de la Rotonde ; l’ombre règne sous le péristyle solitaire entre les colonnes duquel des loques roidies se balancent tristement au vent ; aucune lumière n’apparaît aux portes closes ; aucun pas ne sonne sur le pavé inégal. La masse du bâtiment de la Rotonde dresse d’un côté son ovale sombre et lourd ; de l’autre, ce sont de hautes maisons à la physionomie indigente où s’entassent, du rez-de-chaussée aux combles, de pauvres familles de brocanteurs.
L’allée noire, marquée par une lanterne, occupait à peu près le centre de ces maisons[1].
Au-dessus de la porte de l’allée, les lueurs réunies des réverbères et de la lanterne éclairaient faiblement un tableau de moyenne grandeur, où l’on voyait, sur un fond enfumé, quatre hommes habillés en dragons, à cheval sur une longue bête qui n’a point de nom dans l’histoire naturelle.
C’étaient les Quatre Fils Aymon.
Au-dessous, l’enseigne portait :
Commerce de vins, bière, eau-de-vie. Billard public. Jardin et jeu de siam au fond de la cour.
Reinhold et Johann s’étaient arrêtés vis-à-vis de l’enseigne dans l’ombre du péristyle.
– Au cas où nous ne trouverions pas là ce qu’il nous faut, dit Johann, je veux être pendu si je sais où le chercher ! – Comment faire pour s’en assurer ? répliqua Reinhold ; ici, on ne peut pas regarder à travers les vitres.
Comme le cabaretier ouvrait la bouche pour répondre, un pas lourd et lent se lit entendre sous le péristyle, du côté du corps de garde. En même temps, de l’autre côté de la place, on ouït des lambeaux d’un air fameux, répétés à l’unisson par deux voix masculines, puissamment enrouées.
– Allons-nous-en, murmura le chevalier, dont le premier mouvement appartenait toujours à la prudence. – Du diable ! murmura Johann au lieu de répondre, il me semble que je connais ces deux voix-là.
Les deux voix hurlaient :
La ri fla fla fla
La ri fla fla fla
La ri fla ! fla fla !…
L’homme qui venait du côté du corps de garde tournait en ce moment la courbe de la Rotonde et apparaissait aux regards de nos deux compagnons. C’était un pauvre diable, vêtu d’un mauvais paletot grisâtre, qui marchait courbé en deux et le menton dans la poitrine.
Au lieu de continuer à suivre le péristyle, il descendit sur le pavé de la place et se dirigea vers l’enseigne des Quatre Fils Aymon.
Quand il passa sous le réverbère voisin, on put apercevoir les grandes mèches de ses cheveux qui s’échappaient de son chapeau pelé, et les touffes ébouriffées de sa barbe couvrant comme un masque de fourrure fauve la majeure partie de son visage.
– Où donc ai-je vu cet homme-là ? pensa tout haut le chevalier.
Johann le regarda sournoisement et se prit à sourire.
– Cet homme-là vous occupe plus souvent que bien d’autres, murmura-t-il ; et vous m’avez parlé de lui bien des fois… – Quel est son nom ? – À la rigueur, il pourrait faire un de nos ouvriers… pas de bon gré, assurément, car il se ferait hacher pour le fils de Bluthaupt ! – Quel est son nom ? répéta le chevalier avec une curiosité croissante. – Mais, poursuivit Johann avant de répliquer, on lui parlerait du diable, qu’il croit son maître, depuis certaine aventure à vous parfaitement connue, monsieur le chevalier…
– Mais dites-moi donc son nom ! – On lui parlerait de l’Enfer de Bluthaupt qu’il voit toutes les nuits dans ses rêves, et d’un cadavre couché dans la neige, au fond du trou, sur la traverse de Heidelberg… – Serait-ce lui ?… balbutia le chevalier d’une voix changée.
– On lui dirait qu’il a reçu le prix du sang, acheva Johann ; et il ferait tout ce qu’on voudrait… C’est le pauvre Fritz, l’ancien courrier de Bluthaupt.
Reinhold détourna la tête. Il était pâle et sa respiration devenait pénible.
– Faute de mieux, cela fait toujours un, reprit Johann ; et celui-là, je sais où le retrouver…, mais où diable sont donc passés les Larifla ?…
On n’entendait plus en effet ni les pas ni la voix des deux chanteurs. Au moment où Fritz disparaissait dans l’allée des Quatre Fils Aymon, Johann sortit du péristyle pour jeter un regard à l’extérieur ; il aperçut au loin, contre le mur décrépit qui ferme la place, au bout de la rue du Petit-Thouars, deux ombres qui s’agitaient.
D’abord, il ne put rien distinguer, mais au bout de quelques secondes les mouvements silencieux des deux ombres prirent pour lui une signification. Les ombres étaient occupées à faire une sorte de toilette. À l’aide d’un secours réciproque et fraternel, elles enlevaient des pantalons qui formaient double et triple emploi sur les jambes.
Johann entendait de loin leurs éclats de rire étouffés et leurs plaisanteries échangées à voix basse.
– Je ne les croyais pas à Paris, se dit-il après quelques instants d’hésitation ; si ce sont eux, tonnerre ! c’est de la chance… J’ai mes mille écus de rente dans ma poche !
Les deux hommes cependant continuaient leur étrange besogne ; chacun d’eux, tour à tour présentait un pied à son camarade, qui tirait dessus et amenait une jambe de pantalon.
Le dépouillé ne restait pas pour cela sans culottes.
Cela ressemblait en vérité à cette scène grotesque du Cirque Olympique, où le clown ôte deux douzaines de gilets sans parvenir à se mettre en chemise.
Johann regardait de tous ses yeux. Il croyait bien les reconnaître, mais il hésitait encore parce que ceux à qui venait de faire allusion sa dernière phrase étaient deux coquins émérites, aussi prudents d’habitude que téméraires dans certaines occasions.
Il ne s’expliquait pas pourquoi ils bravaient les inutiles dangers d’une toilette en plein air, à une centaine de pas d’un corps de garde.
– Bonnet-Vert et Blaireau ne s’exposent pas ainsi ! pensait-il, ça n’est pas dans leur caractère… Quand ils ont fait des pantalons, ils vont se dédoubler aux Quatre Fils, et pas dans la rue…
Comme il songeait ainsi, l’un des deux hommes leva la jambe un peu trop haut et tomba lourdement le long du mur. Son compagnon, qui voulut l’aider à se relever, perdit l’équilibre également et partagea sa chute.
Alors, ce fut une lutte folle sur les tas de débris amoncelés près de la muraille. Les deux hommes se roulèrent dans la pondre, en riant comme des bienheureux.
Qui serait expert en fait d’ivresse, sinon un cabaretier allemand des abords du Temple ? Johann jugea le timbre de ces rires.
Sa face revêche se dérida tout à coup.
– Ils ont boissonné, les deux templiers ! se dit-il joyeusement ; et, au fait, un lundi-gras, quand on a travaillé comme il faut, on est bien loisible de se boire… – Johann ! demandait tout bas le chevalier de Reinhold ; que faites-vous là tout seul ?
Le cabaretier poursuivait le cours de ses inductions et se disait :
– C’est égal ! je les aimerais mieux dans un cabinet des Quatre Fils qu’à ce coin de rue, les braves garçons !… C’est juste notre affaire !… Il n’y a pas à dire, on ne trouverait pas à les remplacer dans tout le Temple… et si une patrouille venait me les prendre sous le nez, ce serait dix mille francs de flambés !… Mais vont-ils finir aujourd’hui ou demain ?…
Dans sa sollicitude soudainement excitée, il fit quelques pas pour les rejoindre et leur prodiguer de prudents conseils.
– Johann ! Johann ! criait le chevalier qui ne voyait rien sinon la retraite inexplicable de son premier ministre, faut-il aller avec vous ?
En ce moment, Johann s’arrêta. Les deux hommes venaient de se relever, chancelant sur leurs jambes avinées, et faisaient chacun un paquet de son butin.
Quand ils eurent achevé, ils se prirent bras dessus, bras dessous, et se dirigèrent, en roulant et en se poussant, vers les Quatre Fils Aymon.
De temps en temps, ils essayaient une manière de danse sur l’air de Larifla, et ils chantaient :
Habits et pantalons,
Gilets et caleçons,
Pour nous jamais ne sont
Ni trop courts, ni trop longs.
Larifla, etc.
Et après le refrain, ils criaient à tue-tête, en imitant l’accent mélancolique des chineurs allemands :
– Vié hâbits ! hâbits ! câlons, vié, hâbits… rrrrchand d’hâbits !
Les canons des fusils d’une patrouille sortante résonnèrent au seuil du poste de la rue Percée.
Johann fut ému comme un père qui redoute l’imprudence de son fils.
– Les malheureux ! pensa-t-il, les malheureux… on va me les pincer !
Les deux hommes qu’il appelait Bonnet-Vert et Blaireau s’avançaient toujours, criant et chantant, avec leurs paquets sous le bras.
Reinhold avait enfin compris que Johann les guettait comme un gibier, et il demeurait coi, appuyé contre sa colonne.
La patrouille, cependant, arrivait au pas ordinaire ; Bonnet-Vert et Blaireau ne voyaient rien et ne s’inquiétaient de rien.
Ce fut seulement lorsqu’ils atteignirent le seuil des Quatre Fils qu’ils aperçurent la force armée à quelques pas d’eux.
Johann avait la chair de poule.
À la vue des soldats, les deux voleurs s’arrêtèrent un instant et se turent, déconcertés. Mais ils avaient le vin téméraire ; au lieu de s’esquiver, ils se plantèrent sur le seuil, firent tous les deux le salut du guerrier, et entonnèrent avec enthousiasme ce couplet bien connu que l’auteur de la chanson, ancien élève de l’École polytechnique, a dédié à l’armée française :
Pour rester caporal,
Faut être un animal ;
Mais plus d’un animal
Devient un général !
Larifla, fla, fla, etc.
Puis ils disparurent dans la longue et noire allée, en lançant, d’un aigre fausset, le cri classique du carnaval.
Johann tremblait de tous ses membres et avait au front des gouttes de sueur froide.
Le chef de la patrouille, qui portait justement les insignes du grade attaqué, s’arrêta un instant sous la lanterne des Quatre Fils. La question fut sans doute agitée, de savoir si l’on poursuivrait les deux insolents jusque dans le cabaret.
Mais le carnaval a ses priviléges. La force armée, clémente et magnanime, poursuivit sa route.
Johann respira ; il avait cent livres de moins sur le cœur.
– Et de trois ! s’écria-t-il en revenant vers le chevalier ; voilà deux lapins qui n’ont pas leurs pareils dans toute la ville ! – Sont-ils aussi Allemands ? demanda le chevalier qui songeait toujours à Fritz. – Le diable sait leur pays, répondit Johann ; ce qui est certain, c’est qu’ils parlent l’allemand, car j’ai causé souvent avec eux… Je crois qu’ils ont fait autrefois le grand chemin sur les frontières de l’Alsace.
Le chevalier se recula instinctivement.
– Eh bien ! s’écria Johann sincèrement étonné, cela vous fait peur ?… Ne croyez-vous pas que j’allais vous choisir des prix Monthyon ? – C’est juste… balbutia Reinhold. – Diable ! oui, bausse, c’est juste, répéta le cabaretier ; si j’avais su que ces deux bons garçons étaient à Paris, je ne me serais pas tant fait prier quand vous m’avez proposé la chose… Mais je les croyais au bagne.
Reinhold fit un second haut-le-corps.
Johann souffla dans ses joues.
– Ma parole, dit-il, je ne vous comprends pas !… Vous cherchez, et quand vous avez trouvé, vous faites la petite bouche ! – Du tout, balbutia Reinhold, en dissimulant de son mieux ses répugnances, je suis fort content… mais dites-moi un peu quels sont ces deux hommes ? – C’est Castor et Pollux, répondit Johann, qui lisait volontiers du papier à la livre et possédait en conséquence une certaine teinture de la mythologie ; c’est Damon… et l’autre !… Ceux-là ont fait leurs preuves, voyez-vous, et ce ne sont pas des trembleurs comme les filous du Temple. Avec de l’argent, vous en aurez tout ce que vous voudrez… Le chef de la communauté s’appelle Mâlou, dit Bonnet-Vert, un souvenir de Brest ; l’autre a nom Pitois, dit Blaireau, auquel il ressemble… Ils ont passé devant le jury l’un portant l’autre une demi-douzaine de fois, et si je les croyais au bagne, c’est que leur dernière condamnation emportait les travaux forcés à perpétuité. – Pour cause de meurtre ? demanda le chevalier. – Comme vous dites, répliqua Johann ; ils se seront évadés, car je ne pense pas qu’on leur ait fait grâce… Quant à ce qu’ils manigancent dans le Temple à l’heure qu’il est, ça me paraît assez faible… Ils m’ont l’air d’en être réduits à voler des pantalons comme les derniers des derniers… Autrefois, du temps que je les connaissais, ils fréquentaient les marchands de bijoux du Palais-Royal, et vendaient leurs produits au bonhomme Araby. – Et ils ne l’ont pas dénoncé devant les assises ? demanda Reinhold. – Peuh ! fit Johann ; dénoncer Araby !… le vieux est sorcier ; ce serait perdre sa peine… Maintenant, bausse, voici nos trois hommes dans le même nid… Peut-être bien que nous en trouverons un quatrième parmi la société qui se rassemble aux Quatre Fils… C’est tout ce qu’on peut espérer pour la chose dont il s’agit ; je vous en préviens. – À la rigueur, répondit Reinhold, on peut se contenter de quatre… mais il n’en faut pas un de moins… Je voudrais savoir comment vous allez vous y prendre. – C’est tout simple, et vous allez bien le voir… car je pense, monsieur le chevalier, que vous ne refuserez point de m’appuyer de votre présence dans la démarche que je vais tenter auprès de nos hommes ?…
Reinhold fit un geste énergiquement négatif.
– À quoi bon ! dit-il ; mon concours ne peut vous être d’aucune utilité. – Pardonnez-moi, répondit Johann. J’y ai compté !… j’y compte encore. – Mais, la raison ?…
Il ne plaisait point à Johann de dire la véritable raison, qui était de compromettre son patron le plus possible et de l’engager irrévocablement.
– La raison saute aux yeux, répliqua-t-il sans hésiter ; ce sont des sommes considérables que nous allons proposer à Mâlou et à Pitois… N’allez pas croire qu’ils soient novices en affaires : rien n’est avocat comme un voleur !… Ils savent que je suis un pauvre gargotier à la tête d’un établissement assez modeste…
Il leur faudra des garanties… vous les leur donnerez.
Le premier mouvement de Reinhold fut de refuser tout net. Puis il se prit à réfléchir ; au bout de plusieurs minutes d’hésitation, il releva brusquement la tête et se tourna vers Johann.
– J’accepte, dit-il ; entrons. – Tout beau ! s’écria le cabaretier en riant ; maintenant, vous allez trop vite !… votre costume ne serait point en bonne odeur aux Quatre Fils, dont les habitués ne suivent pas la mode de si près… Il va falloir changer de toilette. – Retourner jusqu’à l’hôtel ?… – Non pas… jusque chez moi seulement… j’ai ce qu’il vous faut ; venez !
Le chevalier se laissa emmener sans mot dire. Ils parcoururent à grands pas la route qu’ils avaient faite, et entrèrent chez Johann, non point par le cabaret, mais par la porte de l’allée.
Quelques minutes après, on aurait pu les voir ressortir. Johann avait conservé le même costume ; mais le chevalier, au lieu de son castor brillant et de son caoutchouc fashionable, portait maintenant une casquette et une blouse…
III. – Les Quatre Fils Aymon.
Le commerce de vins des Quatre fils Aymon, tenu par madame veuve Taburot, occupait tous les derrières de la maison qui fait face au point central de la Rotonde.
Les profanes entraient et sortaient par l’allée noire, ouverte sur la place même ; mais les habitués de choix qui avaient les bonnes grâces de la veuve Taburot connaissaient une autre issue, et savaient qu’ils pourraient, au besoin, gagner la rue Charlot par la maison voisine.
Alors, comme aujourd’hui, entre les chalands des Quatre fils, il y en avait bien peu qui pussent être indifférents à une commodité de ce genre. Il y a bien longtemps, en effet, que cet établissement est spécial ; on n’y connaît guère que les industries excentriques et périlleuses. Parmi ceux qui le fréquentent, quelques-uns sont vagabonds purement et simplement, d’autres sont escrocs, d’autres, sous prétexte de vendre des contre-marques, exploitent les abords des théâtres ; d’autres encore sont ces malheureux marins, échappés du naufrage, qui vous offrent des rasoirs d’Angleterre assez bien affilés pour trancher un cheveu à la volée. Les plus purs proposent à leurs bons moments, des cannes à pommes d’étain ou des chaînes de sûreté aux promeneurs des boulevards. Ceux qui ont des goûts champêtres font le buis bénit du dimanche des Rameaux : le prix de revient de cette verdure sacrée reste toujours un mystère, mais le débit en est excellent et donne un prétexte de se tenir au plus épais de la foule, près de la porte des églises.
Cela suffit, pourvu qu’on ait la main preste et une bonne conscience.
Enfin, il y a là mille et une variétés d’entrepreneurs de jeux en plein air, les uns tolérés par la police, les autres sévèrement prohibés.
Vous y retrouvez l’homme au lapin blanc, que vous avez entrevu à Sceaux, à Meudon, aux Loges, et qui invite gracieusement les amateurs de gibelotte à couvrir les ronds de sa table enchantée avec des palets de fer-blanc.
Vous retrouvez l’homme à la poule, qui veut que vous cassiez, le traître, une vitre protégée par quelque sortilége.
C’est le rendez-vous de ces banquiers perfides, qui, sous prétexte de macarons, ressuscitent la roulette à la face du ciel, et dévorent les gros sous des simples.
C’est là enfin que l’on rencontre ces redoutables escamoteurs, fléau des petites rues du faubourg Saint-Antoine, qui dépouillent à coup sûr l’ouvrier avide et naïf au jeu ingénieux du tirlibibi.
Ceux-là sont d’autant plus âprement chassés par les sergents de ville, que leur banque n’admet point de cuivre ; ils ne jouent que des pièces de 5 francs, comme à Frascati ; et cette élévation de l’enjeu n’est certes point destinée à compenser leurs frais d’établissement, car ils mènent leur partie au milieu de la rue, sur la cuve renversée d’un chapeau.
Trois cartes qui sautent l’une par-dessus l’autre avec une rapidité magique, une rue sombre, un jour sans soleil, quatre ou cinq compères qui veillent aux avenues, une dupe et un fripon, tels sont les ingrédients du noble jeu du tirlibibi.
Mais le travail le plus universellement fêté aux Quatre Fils Aymon est le vol d’habits ou d’étoffe : le voisinage du Temple donne à ce commerce une importance très-satisfaisante. Un bon négociant des Quatre Fils fournit à lui tout seul jusqu’à deux échoppes de fripiers ; s’il sait s’arranger, il a une dame qui honore de sa confiance tous les magasins de nouveautés à la fois, et qui emporte sous son camail quantités de denrées pour le quartier des frivolités.
Ces dames sont très-bien mises et très-distinguées, ce qui ne les empêche pas de s’enivrer le soir avec de l’eau-de-vie ; de temps en temps, les journaux en citent une ou deux qui se font arrêter, mais c’est rare, elles sont adroites, prudentes, exercées, et l’habileté de leurs mains met chaque année un fort long article au chapitre profits et pertes des magasins de nouveautés.
Il faut reconnaître, néanmoins, que les véritables artistes en ce genre, les virtuoses, ne fréquentent point l’obscur cabaret de la place de la Rotonde. Le choix de cette profession aimable indique assurément une certaine distinction de goûts et de manières. La plupart des dames qui la pratiquent aiment à se faire comtesses de quelque chose et à voir le beau monde.
On en a vu donner des bals et patronner des œuvres de bienfaisance. Avec un peu de bonheur, elles peuvent mourir très-vieilles, dans de très-bons lits, entourées d’une famille très-honnête…
Le commerce de vins des Quatre Fils Aymon n’avait pas du tout la même physionomie que les autres cabarets des alentours du Temple. Pour y parvenir, il fallait traverser d’abord l’allée noire, puis une cour fangeuse où s’élevaient deux berceaux en treillage de bois vermoulu.
C’était le jardin.
Il avait pour ombrage, en toute saison, un petit cyprès jaune, mort depuis des années, et un pot de basilic, servant aux préparations culinaires de madame veuve Taburot.
En sortant du jardin, on descendait trois marches et on entrait dans une grande salle, basse d’étage, où se trouvait un billard à blouses, au tapis noirâtre et gras.
Cette salle avait pour ornement trois tableaux, contenant des inscriptions entourées de force paraphes.
L’une de ces inscriptions portait : On ne fume pas ici, quand il y a des dames.
La seconde : On joue la poule.
La troisième était un code manuscrit des règles du billard.
À gauche de cette pièce d’entrée, se trouvait une longue salle, située également au-dessous du sol de la cour. C’était là que se tenait madame veuve Taburot, derrière un comptoir entouré d’une basse galerie de cuivre et chargé d’une multitude de fioles à liqueurs.
Il n’y avait ni brocs cerclés de fer, ni comptoir de plomb incessamment humide ; on vendait le vin à la mesure, mais dans des litres de verre, et cela ressemblait plutôt à un estaminet borgne qu’à un cabaret ordinaire.
Madame veuve Taburot était une femme de plus de cinquante ans, à la physionomie virile et digne ; les plus vieux habitués se souvenaient de l’avoir vue toujours au comptoir des Quatre Fils Aymon ; néanmoins, elle se prétendait veuve d’un capitaine de la garde impériale, en foi de quoi elle avait un portrait de l’empereur dans sa chambre à coucher.
Quand elle parlait de Napoléon, elle disait : l’autre. Elle avait des opinions politiques, un bonnet à grands rubans et du goût pour le grog.
C’était, du reste, une femme grave et tout à fait à la hauteur de sa position sociale ; dans les fréquentes occasions où la police était descendue chez elle, elle s’était habilement réclamée de sa qualité de veuve d’un ancien militaire, et sa conduite ferme en même temps que soumise avait toujours sauvé son établissement.
Elle inspirait à ses habitués une affection mêlée de respect : elle savait faire crédit à propos, et si quelqu’un de ses chalands lui eût apporté une maison volée, elle eût trouvé très-certainement quelque cachette pour la mettre en sûreté.
Au moment où nous entrons aux Quatre Fils, madame veuve Taburot lisait un feuilleton contre les jésuites, dans un journal qui se nourrit de prêtres ; elle ponctuait cette lecture attachante en buvant à petites gorgées du grog très-fort, qu’elle avait fait mettre dans une tasse à tisane pour le décorum.
Autant elle était tranquille et froide, autant son entourage se montrait bruyant. Le personnel des Quatre Fils Aymon était ce soir au grand complet ; il y avait eu festin et l’on tachait de se donner le bal.
Les tables de bois marbré avaient été reléguées contre les murailles ; on avait poussé les tabourets sous les tables, et le milieu de la salle présentait un espace vide assez large pour former des quadrilles.
Madame Taburot n’avait point permis cet extra, mais elle ne l’avait point défendu.
On dansait ; le billard abandonné montrait tristement son tapis pelé aux lueurs fumeuses des deux lampes ; personne ne s’égarait dans le jardin à l’ombre du basilic ; tout le monde était dans la salle, tout le monde riait, tout le monde chantait ; vous n’eussiez point trouvé dans Paris entier, à cette heure, une aussi joyeuse réunion.
Il y avait pourtant, parmi cette assemblée en goguette, un homme qui se séparait de la joie commune, et qui demeurait silencieux dans un coin.
Cet homme était assis tout au bout de la salle, dans un endroit où il ne gênait personne. Il avait à côté de lui une chopine d’eau-de-vie, où il puisait largement et pour ainsi dire sans relâche.
C’était Fritz, l’ancien courrier de Bluthaupt. Il venait là chaque soir et il buvait ; il buvait jusqu’à ce que l’ivresse le terrassât vaincu.
Il n’adressait jamais la parole à âme qui vive ; seulement, lorsque l’eau-de-vie mettait du feu dans sa cervelle, on voyait ses lèvres remuer lentement, et jeter dans le vide quelques mots perdus.
S’il n’avait pas été si sincèrement ivrogne, on l’aurait vu de mauvais œil au cabaret des Quatre Fils ; car on ne lui connaissait rien sur la conscience, et il n’avait jamais remis sous la garde de madame Taburot aucun objet dérobé.
C’était une tache dans l’assemblée ; mais, en définitive, un homme qui buvait tant pouvait bien se passer d’un autre vice.
Fritz était à peu près à la moitié de sa chopine d’eau-de-vie. Il avait mis à côté de lui, sur la table, son chapeau rougi et déformé ; on voyait le sommet de sa tête couvert de poils rares et comme grillés, tandis que de grandes masses de cheveux incultes s’ébouriffaient autour de ses tempes ; sa barbe longue et toute parsemée de poils blancs tombait sur sa poitrine chétive.
Il avait la tête baissée.
Quand il la relevait pour porter son verre à ses lèvres, sa main tremblait, le verre choquait ses dents. On voyait sa joue pâle et creuse, au centre de laquelle l’ivresse naissante et la teinte maladive mettaient une tache de feu.
On voyait ses yeux mornes, creusés par la maigreur et qui n’avaient plus ni rayons ni pensée.
Il jetait sur la foule environnante un regard absorbé : puis sa tête retombait, tandis qu’un murmure confus glissait entre ses lèvres blêmes.
Il paraissait ne rien voir de ce qui se passait autour de lui et ne rien entendre des clameurs folles qui emplissaient la salle.
Les habitués des Quatre Fils lui rendaient du reste la pareille et ne prenaient point souci d’observer sa lugubre humeur, on ne songeait qu’à mener le plus gaiement possible la soirée du lundi-gras.
Il y avait là des toilettes de toutes sortes, et ce que le marchand de vin, Johann, avait dit au chevalier de Reinhold, pour l’engager à changer de costume, n’était pas rigoureusement exact. Les habits fashionables du chevalier, portés par un des chalands de l’établissement, n’auraient point excité l’attention, parce que toute parure était bonne à ces hardis industriels. Parmi les blouses qui formaient la majeure partie de la réunion, on voyait çà et là plus d’un habit noir et plus d’une redingote élégante ; mais Johann avait eu raison nonobstant, un inconnu vêtu avec recherche devait nécessairement exciter en ce lieu l’attention et la défiance.
D’un autre côté, le bausse était un personnage trop célèbre dans le Temple pour qu’il ne se trouvât pas là quelque brocanteur ayant été à même de le voir. Johann ne voulait point qu’il fût reconnu ainsi par tout le monde.
S’il y avait de la différence entre les toilettes des hommes, celles des dames étaient encore plus disparates. Le même quadrille réunissait quelque grosse mère portant un fichu à carreaux et un mouchoir de cotonnade sur la tête, avec quelque pimpante grisette et quelque grande dame qui semblait échappée d’un boudoir du faubourg Saint-Honoré.
Et tout cela vivait en parfaite intelligence ; la grande dame tutoyait la commère, qui le lui rendait du meilleur de son cœur.
La danse, il est à peine besoin de le dire, était un peu échevelée ; néanmoins elle ne dépassait pas de beaucoup les bornes imposées aux amateurs de nos bals publics par l’autorité intelligente des sergents de ville ; les gestes se modéraient par respect pour la majesté de madame veuve Taburot, qui interrompait de temps en temps sa lecture pour boire un coup de tisane au rhum et répéter d’une voix royale :
– Tâchez voir un peu de ne pas faire de bêtises !
Cela dit, elle se replongeait dans son antique journal. Les grisettes lui faisaient bien des pieds de nez à la sourdine et les cavaliers-seuls ajoutaient quelque agrément nouveau à la pastourelle ; mais, en somme, c’était beaucoup moins accentué que ces jolis bals du Prado et de la Chaumière, où les bons parents de province envoient leurs héritiers pendant les dix mois de l’année scolaire.
L’orchestre était composé de Mâlou, dit Bonnet-Vert, et de son Pylade Pitois, dit Blaireau.
Pitois jouait du violon ; Mâlou soufflait dans une bombarde[2], souvenir de Bretagne, qu’il avait apporté du bagne de Brest.
Comme étaient à moitié ivres tous les deux et qu’ils n’entendaient point se priver du plaisir de la danse, ils jouaient dans le quadrille même et sautaient comme des bienheureux, en tirant de leurs instruments des sons impossibles.
C’était un concert de canards et de grincements à faire tressaillir le tympan d’un sourd-muet.
La galerie accompagnait en faux-bourdon et la voix aiguë de ces dames faisait à cet ensemble étrange un diabolique dessus.
Mais les honneurs du concert restaient à l’instrument breton, dont les gémissements nasillards dominaient tous les autres bruits.
Mâlou, dit Bonnet-Vert, en tirait un excellent parti ; il soufflait de toutes ses forces et dansait de même ; ses tempes suaient à grosses gouttes ; quand l’haleine lui manquait, il renversait dans sa large bouche, pour se rafraîchir, le goulot d’une bouteille de rhum.
Ce Mâlou était un garçon assez remarquable. Il pouvait avoir trente-cinq ans ; son front bas, mais large, était entouré d’une profusion de cheveux courts et bouclés ; il avait le teint basané, les yeux noirs et brillants, la bouche fermement dessinée. L’ensemble de son visage, dont l’expression s’amollissait en ce moment dans le sourire de l’ivresse, annonçait une hardiesse vive et une certaine franchise. Il dansait avec une jolie petite fille de quinze ans, au minois effronté, qu’il appelait Bouton-d’Or.
Son camarade Pitois, dit Blaireau ne lui ressemblait aucunement. Autant Mâlou était leste et bien découplé, autant Blaireau se montrait gauche dans tous ses mouvements. Il était noir comme une taupe, et des mèches de cheveux plats tombaient jusque sur ses sourcils. Il y avait pourtant une certaine joyeuseté dans ses petits yeux souriants et mobiles ; mais, en somme, c’était là une physionomie repoussante et dont l’aspect seul menait en défiance.
Pitois avait une quarantaine d’années.
Il était le cavalier d’une grande et belle femme, portant, ma foi, camail de velours et chapeau à plumes, qui dansait le cancan avec une verve singulière.
Cette belle femme était connue sous le nom de la duchesse. Avec les marchandises qu’elle avait dérobées en sa vie, tantôt sous son camail de velours, tantôt sous son châle des Indes, elle aurait pu monter un superbe magasin de nouveautés.
Mâlou et Pitois ne s’étaient jamais quittés ; ils s’étaient engagés autrefois en même temps comme soldats ; ils avaient déserté de compagnie ; ils avaient travaillé ensemble dans le grand et dans le petit genre, sur les chemins et sous les réverbères des rues ; ils avaient été ensemble en prison, ensemble encore au bagne ; ils s’étaient évadés ensemble ; ils se connaissaient dans le bonheur comme dans l’infortune ; ils s’aimaient. Et (c’est une chose étrange) l’amitié, ce sentiment que les poëtes ont rendu fastidieux à force de le chanter, se rencontre plus souvent parmi les bandits qu’entre les honnêtes gens.
Mâlou avait mis plus d’une fois sa poitrine entre Pitois et le couteau ; Pitois avait cédé à Mâlou une femme qu’ils aimaient tous les deux ; et il en avait fait une maladie, ni plus ni moins qu’un héros de roman.
Ils étaient si mal l’un sans l’autre, que Pitois s’était laissé prendre exprès, lorsque Mâlou avait été mis au bagne.
Il est superflu d’ajouter que leur pécule était commun. Entre eux cependant l’égalité n’était pas complète ; dans tout ménage il faut un maître ; Mâlou, dit Bonnet-Vert, était le chef de l’association.
Il est remarquable que, dans toutes les réunions de malfaiteurs, la considération s’acquiert en raison directe de la culpabilité plus ou moins avancée. Un escroc est loin d’avoir le même rang qu’un faussaire ; un simple voleur ne vaut pas le quart d’un assassin. Mâlou et Pitois avaient parcouru de compagnie tous les degrés de l’échelle du crime ; au milieu des pauvres filous du Temple, ils étaient des aigles : figurez-vous deux académiciens, encanaillés parmi des poëtes confiseurs !
On les admirait, on souriait de confiance aux moindres de leurs dires ; s’ils daignaient plaisanter, c’était de l’enthousiasme ; on ne se possédait pas de joie à les voir grincer du violon et de la bombarde.
Les femmes les voulaient, les hommes les respectaient et n’arrivaient pas même jusqu’à la jalousie. Ils étaient les héros, les incomparables ; Bonnet-Vert surtout semblait un dieu…
Le bal était à son plus haut période de gaieté, lorsque Johann et le chevalier, traversant de nouveau la place de la Rotonde, s’engagèrent dans l’allée noire.
IV. – L’amour.
Le pauvre chevalier se sentait tout déconfit dans son nouveau costume. Il était mal à l’aise, comme un paon privé de sa queue. Les rôles avaient changé ; il semblait maintenant le domestique de son factotum : il le suivait pas à pas, l’oreille basse et d’un air soumis.
Johann entra le premier dans le billard et le traversa en homme qui connaît les êtres. Reinhold faillit se rompre le cou, en descendant les trois marches étroites et roides.
– Oh ! oh ! dit le marchand de vin en se dirigeant vers la seconde salle, il n’y a pas de poule ce soir. Quel diable de sabbat est-ce donc ?
Depuis la porte de l’allée, ils entendaient les sons stridents du violon et de la bombarde.
Malgré l’écriteau pendu aux murailles du billard et portant défense de fumer en présence des dames, tous les danseurs avaient la pipe à la bouche. La galerie, bien entendu, ne se gênait pas plus que les danseurs. Johann et le chevalier, en arrivant au seuil de la salle, ne virent qu’une masse de fumée grisâtre, au milieu de laquelle s’agitait un mouvement confus.
Et de cette brume épaisse, sortaient des cris étranges, un bruit de gros souliers frappant le carreau à peu près en mesure, des rires, des bribes de chants, des accords faux hurlant sur le violon, et des notes boudeuses de bombarde.
Le chevalier regardait bouche béante par-dessus l’épaule de Johann ; il croyait rêver ; cela lui faisait l’effet d’un cauchemar fantastique, et il avait peur.
Il n’en était pas à se repentir d’avoir accepté la proposition de Johann. Plusieurs motifs l’avaient entraîné dans le premier moment : d’abord, l’intérêt puissant qu’il avait à réparer au plus tôt l’échec du duel, ensuite, un sentiment puéril et bizarre qui était tout particulier à sa nature de vieil enfant ; il s’était posé en homme de ressource auprès de M. le baron de Rodach, et il tenait singulièrement à lui donner une haute idée de son savoir-faire. La supériorité du baron l’humiliait ; il éprouvait, par avance, un plaisir singulier à l’idée de se pavaner devant cet étranger qui se proclamait si orgueilleusement nécessaire.
Cette pensée l’avait entraîné plus encore que son intérêt ; il n’avait pu résister à l’espoir d’étonner le baron à son tour et de lui dire : Voilà ce que j’ai fait !
Pour un instant sa couardise s’était changée en témérité ; il avait fermé les yeux et il s’était jeté en avant sans réfléchir.
Maintenant il réfléchissait, et Dieu sait quelles terreurs punissaient sa courte outrecuidance :
Il était là, derrière Johann, et il se sentait du froid dans les veines. Le marchand de vin, pour compléter son déguisement, lui avait planté une cravate de soie noire sur l’œil gauche ; la cravate était déjà mouillée de sueur.
Pour plus de précautions encore, Johann avait parlé de mettre bas la perruque blonde, et de se présenter aux Quatre Fils avec une tête au naturel, mais Reinhold avait défendu son toupet avec acharnement.
Johann lui avait laissé son toupet.
– Il y a bal, grommela le marchand de vin d’un air de mauvaise humeur ; comment faire pour leur parler dans cette bagarre ?… – Allons-nous-en, opina le malheureux chevalier. – Non pas !… Qui sait si nous les retrouverions demain ! – Donne-toi des grâces, madame la duchesse, disait-on derrière la fumée de tabac. – Hardi, Blaireau ! un temps de polka pour la fin !… – Voilà Bonnet-Vert qui porte Bouton-d’Or à bout de bras en valsant… et qui joue Vive Henri IV ! de l’autre main !… – Ah ! le diable de Bonnet-Vert !…
Puis des voix de femmes :
– Portez-moi donc comme ça, Loiseau ! – Porte-moi donc comme ça, Petit-Louis ! – Et mets-y les deux mains, si tu veux !
Mais Loiseau et Petit-Louis n’étaient pas si forts que Bonnet-Vert, et leurs dames pesaient deux fois plus que Bouton-d’Or.
Au plus fort du tumulte, la sonnette du comptoir s’agita et la voix roide de la veuve Taburot prononça les paroles consacrées :
– Tâchez voir de ne pas faire de bêtises…
La contredanse finissait : on eut l’air d’obéir à la veuve du garde impérial et l’orchestre se tut.
En ce moment, les fenêtres, ouvertes pour rafraîchir la salle, chassèrent le nuage de fumée ; le chevalier put embrasser toute la scène d’un coup d’œil ; mais en même temps, sa tête qui passait par-dessus l’épaule de Johann fut aperçue de l’intérieur.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? s’écriait-on de plusieurs côtés à la fois. – Tiens ! dit la petite Bouton d’Or ; c’te figure !… il a un bandeau sur l’œil… c’est peut-être bien l’Amour.
Le mot fut couvert d’applaudissements. En un clin d’œil, le pauvre chevalier se vit entraîné, malgré les efforts de Johann, et comme enclavé dans une masse empressée de curieux.
Chacun le regardait sous le nez, les quolibets se croisaient. Le chevalier avait perdu plante…
– Oh ! quelle tête ! quelle tête ! dit Mâlou en l’examinant avec admiration ; il a pour soixante-quinze centimes de blanc et de rouge sur la joue !… – Il faut l’exposer sur une table, ajouta Bouton-d’Or, et on donnera un sou pour aller le regarder de près.
Aussitôt fait que dit. Il y eut un mouvement dans la cohue, et le chevalier, sans savoir comment, se trouva élevé de deux ou trois pieds au-dessus de la foule. Dans le trajet, une main maladroite ou perfide lui avait arraché sa casquette et sa perruque en même temps : de sorte que le bandeau noir, placé en diagonale, tranchait maintenant entre sa face fardée et son crâne nu comme un genou.
L’assemblée trépignait de joie et hurlait :
– C’est l’Amour ! c’est l’Amour !…
Jamais on ne s’était tant diverti aux Quatre Fils Aymon. La farce arrivait à point entre deux contredanses ; c’était comme une attention délicate du hasard, qui avait choisi le bon moment pour lancer l’intermède.
Le tumulte joyeux allait sans cesse augmentant : chacun disait son mot plaisant ou grotesque ; ces dames n’en pouvaient plus à force de rire, et s’appuyaient, pâmées, aux bras de leurs seigneurs. Madame Taburot, malgré ses qualités respectables et la déférence qu’elle inspirait d’ordinaire à ses pratiques, n’était plus maîtresse de la situation ; c’était en van, désormais, qu’elle agitait la sonnette de son comptoir, ni plus ni moins qu’un président d’assemblée délibérante ; c’était en vain qu’elle enflait sa voix sèche et rogue pour jeter au milieu du fracas son fameux : Tâchez voir de ne pas faire de bêtises…
On ne l’entendait pas ; les rires se croisaient avec les quolibets. Hommes et femmes, danseurs et gens de la galerie, tous s’étaient réunis en un solide noyau qui occupait à peine un quart de la salle et se pressait autour du malheureux chevalier de Reinhold.
Celui-ci posait toujours sur la table qui lui servait de piédestal ; il raidissait sa taille épaisse et courte ; celui de ses yeux qui était libre restait baissé timidement ; il n’osait ni bouger, ni regarder cette foule dont les clameurs moqueuses arrivaient à son oreille, enflées par sa propre frayeur et toutes pleines de terribles menaces.