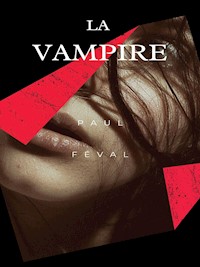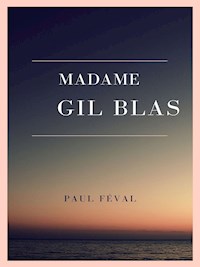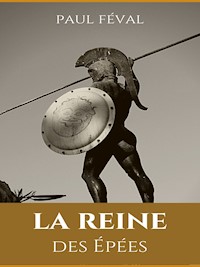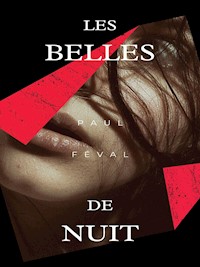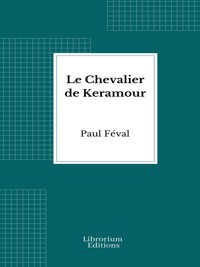
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Je suis né le 21 mars 1751, au manoir de Pendor, dans la paroisse de Guidel, en Bretagne. Mon père était de bonne maison et ma mère demoiselle. J’étais tout petit quand je les perdis.
J’avais quatre ans quand notre joli manoir de Pendor fut vendu. Le bois de grands vieux hêtres qui ombrage la route de Lorient à Quimperlé m’a bien souvent fait peine à regarder, du temps que j’allais à l’école du presbytère ; mes camarades me disaient :
— C’était à toi autrefois, Keramour, tous les nids et toutes les noisettes qui sont là dedans.
Et moi je répondais, car l’orgueil est de tous les âges :
— Nous avions aussi le grand château de Keramour, avec ses quatre étangs et sa forêt, qui a trois lieues de large ; et nous avions bien d’autres choses encore, que je rachèterai quand j’aurai fait fortune.
J’ajoute tout de suite que ce beau château de Keramour avait abandonné ma famille depuis bien longtemps. Lors de ma naissance, il appartenait déjà au vieux Merlin, qui n’était pas l’enchanteur de ce nom.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Paul Féval
LE CHEVALIER DE KERAMOUR
© 2024 Librorium Editions
ISBN : 9782385746858
PREMIÈRE PARTIE
IMA GRAND’TANTE. – MA COUSINE VIVETTE. – MON ONCLE LE BIHAN
Je suis né le 21 mars 1751, au manoir de Pendor, dans la paroisse de Guidel, en Bretagne. Mon père était de bonne maison et ma mère demoiselle. J’étais tout petit quand je les perdis.
J’avais quatre ans quand notre joli manoir de Pendor fut vendu. Le bois de grands vieux hêtres qui ombrage la route de Lorient à Quimperlé m’a bien souvent fait peine à regarder, du temps que j’allais à l’école du presbytère ; mes camarades me disaient :
— C’était à toi autrefois, Keramour, tous les nids et toutes les noisettes qui sont là dedans.
Et moi je répondais, car l’orgueil est de tous les âges :
— Nous avions aussi le grand château de Keramour, avec ses quatre étangs et sa forêt, qui a trois lieues de large ; et nous avions bien d’autres choses encore, que je rachèterai quand j’aurai fait fortune.
J’ajoute tout de suite que ce beau château de Keramour avait abandonné ma famille depuis bien longtemps. Lors de ma naissance, il appartenait déjà au vieux Merlin, qui n’était pas l’enchanteur de ce nom.
Voici comment la noble demeure de mes ancêtres était tombée aux pattes de ce vilain :
À la fin du dernier règne, la branche aînée de Keramour n’était représentée que par une quenouille : demoiselle Armelle-Ermengarde-Guillemette Riban de Loc-Talahoutrec, dame de Faoux, de Tregueheneuc et Keramour-en-Béhaigne.
On sait que chez nous, dans l’évêché de Vannes, la coutume de Bretagne, au contraire de la loi française, permet aux femmes de succéder à tous biens, même aux fiefs de lance. Et nous passons pour moins galants que les Français !
Demoiselle Armelle tenait donc légitimement le patrimoine entier de la famille, que son économie arrondissait d’année en année ; et mon grand-père, qui était alors un jeune homme, voyait la chose sans déplaisir, car il était l’héritier unique de la bonne fille. Elle allait sur les quarante-neuf ans, et ne voyait personne que son chapelain. Elle était d’ailleurs un peu bossue, très boiteuse, et borgne d’un œil et demi.
Vous allez voir que ce n’était pas assez.
Dans la maison de Keramour, nous avons tous, les messieurs et les dames, un tempérament porté vers la sensibilité. Demoiselle Armelle avait été jusqu’alors une farouche exception à la règle générale. Dans sa jeunesse, vingt partis s’étaient présentés, malgré sa bosse et ses imperfections physiques : elle les avait tous refusés ; mais le jour de sa cinquantième année, ayant offert un petit régal à son chapelain, elle eut dans la nuit un chagrin digestif, qui nécessita l’appel d’un médecin.
Le médecin se trouvait être un jeune homme blond, doux de visage et obligeant de manières. Non seulement il fit à ma grand’tante l’ordonnance voulue en pareil cas, mais il poussa le dévouement jusqu’à l’exécuter lui-même. Il avait nom le docteur Merlin.
Cupidon n’a pas l’habitude de choisir pour cachette l’instrument vulgaire auquel je risque ici une timide allusion ; mais une fois n’est pas coutume. Cette nuit, le petit dieu s’y était embusqué par hasard : car demoiselle Armelle fut piquée au cœur, et six semaines après elle s’appelait Mme Merlin.
Une fille naquit de cette union disproportionnée, chétive créature dont la naissance coûta la vie à ma tante Armelle. Voilà donc mon grand-père évincé, et ce Diafoirus, le docteur Merlin, maître du domaine de Keramour.
Mon grand-père ne perdit pas cependant toute espérance. La petite était mal venue et n’avait que le souffle. Pendant vingt-cinq ans, chaque semaine, elle manqua, pour le moins trois fois, de trépasser. Mon grand-père envoyait, de deux jours l’un, savoir de ses nouvelles fidèlement.
La dernière fois qu’il envoya, la pauvre fille était morte, à vingt-cinq ans et douze heures. Elle avait eu le droit et le temps de tester en faveur de son père, aux termes de cette même coutume de Bretagne, recueil de graves sornettes qui semble avoir été compilé pour marier les demoiselles hors d’âge et dépouiller les beaux garçons.
Aussi n’y a-t-il point dans l’univers entier un pays où les vieilles demoiselles soient plus épousées et, par conséquent, plus battues. Chaque demi-lieue carrée nourrit au moins un Breton qui pourrait dire « maman » quand il parle à sa femme.
On se demandera peut-être quel est le sort des jeunes et jolies filles dans une pareille contrée. C’est bien simple. Les jeunes filles épousent les veufs des vieilles femmes, quand ceux-ci ont perdu leurs dents et blanchi leurs cheveux à tuer « maman ». C’est alors une autre diablerie, et « maman » est vengée.
Mon oncle et tuteur, M. Le Bihan de Polduc, m’avait raconté, plutôt cent fois qu’une, cette lamentable histoire de tante Armelle et de son mariage. Vous pensez que je n’aimais pas beaucoup le docteur Merlin, qui vivait encore parce qu’il avait eu l’esprit de rester veuf.
C’était un vilain vieillard, bien conservé, sec et vert, qui tenait le haut bout à la grand’messe. Il avait savonné sa roture au sceau du roi et se faisait appeler M. de Tregueheneuc, du nom d’une de nos anciennes tenances. Les gentilshommes du voisinage piquaient l’assiette chez lui, tout en lui tirant la langue par derrière. Depuis quarante ans que tante Armelle était morte, il avait arrondi le domaine, achetant tout ce qui était à vendre ; tout, même notre joli manoir de Pendor. Il était riche comme le marquis de Carabas.
À dix lieues à la ronde, mon oncle Le Bihan était le seul qui eût son franc-parler avec lui.
Voilà un vrai Breton, mon oncle Le Bihan ! court, trapu large, solide sur ses jambes noueuses, rouge de figure, la barbe rude comme une étrille, buvant dur, mangeant fort, ne se séparant pas plus de sa pique que de son nez, grand chasseur, brave pêcheur, et parlant dans l’oreille des gens avec une voix qui éclatait comme le tonnerre. Quand il contait une gaudriole après souper, Vivette se glissait dehors, et les verres grinçaient, ainsi que les vitres.
Vivette – Mlle Viviane – entamait ses seize ans quand j’atteignis ma vingt et unième année. Elle était brune, avec des clairs de couleur fauve dans la miraculeuse abondance de ses cheveux toujours en révolte contre le ruban rouge qui les nouait à la diable. Jamais je ne lui ai vu ni ombrelle ni chapeau quand elle courait les champs dans le soleil ; mais le soleil ne pouvait rien contre le satin doré de sa joue. Son sourire éclairait comme un rayon quand il montrait ses dents de neige. Sa voix chantait mieux que le rire des fauvettes. Elle était jolie, mais jolie ! Et je me souviens que mon cœur me faisait mal quand par hasard (cela n’arrivait pas souvent) la rêverie jetait un voile sur les joyeux diamants de sa prunelle.
Au moral, elle était brave, franche et bonne. Son éducation n’avait pas été négligée : elle savait épeler « dans le gros » et pétrir des biscuits comme le pâtissier n’en pouvait point faire.
Elle parlait trois langues : le français assez bien, le bas breton joliment, et le gallo comme un ange.
Le gallo est le patois des paysans de l’autre côté de Lorient ; il est favorable à la poésie, exemple :
Si j’aviomme un p’tit coutiau,
J’te couperiomme au chantiau,
Ma mignonnaille, un’ beurrée ;
Si j’seriom’ le p’ti ouaisiau
Qui gosille ès bout d’la prée,
J’voleriomme à la vêprée
Becquer ton mignon musiau.
Nous nous aimions, Vivette et moi, longtemps ayant de le savoir. Nous le savions depuis que mon oncle Le Bihan nous l’avait dit, en ajoutant de sa voix qu’on entendait jusqu’à Hennebont :
— Eh bien ! calotte à papa ! Keramour, si tu la prends avec ma bénédiction pour dot, je te les flanquerai toutes deux, mon bonhomme !
Ce fut marché conclu. À partir de ce jour-là, nous allions et nous venions ensemble, Vivette et moi ; libres comme l’air ; un vrai petit mari avec sa petite femme.
C’était un bien brave homme que mon oncle. Il s’habillait un peu comme les paysans ; mais il clouait des éperons à ses sabots quand il allait en campagne, et il portait l’épée par-dessus sa veste de futaine. Ce qu’il se mettait de cidre dans le corps passerait croyance. Le vieux Merlin, qui n’était pas bon, disait qu’il avait sous chaque talon un pertuis par où le cidre s’en allait.
Mon oncle était un fin dégustateur, et reconnaissait les diverses provenances du jus de pommes, comme un gourmet de Guyenne sait distinguer les crus du bordeaux.
Joson, le « toucheur » de bœufs, qui faisait le lit de mon oncle dès qu’il avait fini de faire l’étable, lui apportait à son réveil une écuelle de cidre, ou mieux une soupière jaugeant quatre pintes. Le bonhomme ne faisait son signe de croix qu’après l’avoir mise à sec.
Outre Joson, nous avions cinq autres serviteurs et six servantes : les douze coûtaient par an vingt-quatre écus de six livres et vingt-quatre paires de sabots.
Je vais vous dire tout de suite pourquoi mon oncle Le Bihan dépensait tant d’argent à tenir ce grand état de maison. Il était de race royale, tout uniment. Le Bihan est Polduc, comme il l’expliquait lui-même ; Polduc est Rohan, et Rohan est Bretagne.
Aussi avait-il un canton d’hermines dans son écusson d’argent, portant trois goretons de sable, avec cette devise : « Bihan ! bihan ! bihan ! »
Pour les malheureux qui ne savent pas parler le bas breton, j’expliquerai que bihan veut dire petit, et que ce cri : Petit, petit, petit ! sert de cloche pour appeler chez nous les goretons ou petits pourceaux au réfectoire.
À tous les repas, mon oncle et tuteur prenait la peine de réciter en latin ce qu’il savait du bénédicité et des grâces, ajoutant chaque fois invariablement :
— Je remplace aujourd’hui M. l’abbé, mon chapelain qui se trouve être par hasard en vacances.
Je ne sais à quelle époque M. l’abbé était parti pour ses vacances, mais on ne les vit jamais finir.
En outre de ce refrain, il y avait une autre cérémonie également périodique et encore plus importante. Deux fois par jour, après le déjeuner et après le dîner, mon oncle Le Bihan se levait et tirait son épée en disant :
— Au nom de mon seigneur Dieu et du droit des gens, je proteste. La duchesse Anne était une coquine, les Français sont des saligauds. Moi, Corentin-Yvon-Judic-Marie Le Bihan de Polduc-Rohan-Bretagne, j’interromps la prescription pour m’asseoir, moi ou mes héritiers, quand l’opportunité y sera, sur le trône de mes ancêtres ! Qu’on se le dise à Quimper et à Paris ! Amen !
Vivette et moi, nous n’avions jamais la permission de nous envoler avant l’accomplissement de cette revendication solennelle.
Par une belle matinée de printemps, le quatorzième jour du mois de mai, en l’an 1772, M. Le Bihan, qui remplaçait la cloche aussi volontiers que le chapelain, cria par la fenêtre de sa chambre :
— À la soupe, enfants ! à la soupe !
Vivette et moi nous arrivâmes. Dans la cuisine, servant aussi de la salle à manger, quoique la vache y eût sa litière dans un petit coin (et c’était de beaucoup le mieux tenu), mon oncle et M. Merlin, sire de Tregueheneuc, étaient attablés déjà. M. Merlin pouvait avoir alors soixante-quinze ans bien sonnés. Il s’habillait avec une certaine recherche. Ses vêtements de couleurs tendres faisaient ressortir les rides parcheminées de son vieux visage. Vivette, qui le détestait, se moquait à la journée de ses quatre montres, qu’il portait deux dans chaque gousset.
Il y avait sur la nappe, dans une terrine de faïence brune, un cochon de lait rôti, que les deux convives attaquaient avec une égale énergie. Tous deux poursuivaient une conversation commencée, et nous pûmes bien voir, Vivette et moi, qu’il s’agissait d’une pièce de bétail que M. Merlin voulait acheter et que mon oncle répugnait à vendre.
Je crus que c’était la génisse de l’année, au premier abord ; Vivette penchait pour la pouline, qu’on n’avait pas encore ferrée.
Petite jument ou petite vache, l’objet du marché avait son prix, car on se débattait ferme.
— Voisin Merlin, disait M. Le Bihan, dont le langage ne péchait jamais par un excès de vaine délicatesse, je ne voudrais pas vous mécontenter un jour où vous mangez ma viande ; mais quand on lave ses mains, c’est qu’on ne les a pas propres ; et, ma foi ! le sceau du roi n’est bon que pour lessiver une vilenie. Est-ce vrai, Joson ?
— Tout de même, répondit le valet de chambre des bœufs, je ne mens point : sauf le respect qu’on lui doit, M. Merlin est sorti de la racaille.
— Comme quoi ! reprit mon oncle, videz donc votre écuelle, voisin, calotte à papa ! Je dis ça au lieu de jurer, parce que, quand il avait soif, papa tirait sa calotte de cuir et buvait dedans. J’en ai fait autant plus d’une fois dans mes sabots. À la guerre comme à la guerre, pas vrai ? Tout est bon pour boire, excepté les tasses d’or quand on y met de l’eau. Et ne vous vantez pas de vos rentes, voisin ! Votre défunte femme, la bossue, était plus coquine encore que Mme Anne de Bretagne, qui m’a volé ma couronne. Je descends du roi Grallon, chien d’Anglais ! Je dis ça au lieu de jurer, à cause d’un goddam qui m’acheta mon chien galeux, que je voulais noyer. Tant mieux s’il a gagné la gale ! Les Anglais ne valent pas mieux que les Normands. Contez l’histoire du vieux Legall, voisin : elle est drôle, et je veux l’apprendre pour la redire.
— Voyons ! voyons ! fit M. Merlin, qui dévorait consciencieusement, je mettrai un jambon dans le marché et quatre poules de plus : des grasses.
— Je veux d’abord l’histoire, toutes les nièces sont rousses ! Je dis ça au lieu de jurer, à cause du recteur de Kerantrech, qui avait sept nièces, dont la moins roussaude aurait allumé le soleil ponant. L’histoire !
— Et nous finirons le marché après ?
— Peut-être, si vous êtes raisonnable. La petite bêtaille vaut son prix.
M. Merlin conta l’histoire du vieux Legall, qui est devenue une légende, mais qui était alors une nouveauté. Elle datait du dernier dimanche, et l’on n’avait pas encore retrouvé le corps du pendu.
Le vieux Legall était chantre de la paroisse de Guidel ; il avait le même culte que mon oncle à l’endroit du cidre, mais il ne le portait pas si bien, et souvent il chantait les vêpres étant, comme on dit là-bas, « chaud-de-boire ».
Or, M. le recteur (curé) de Guidel avait un neveu qui poussait pour être d’église et qui savait un bout de latin. Il louchait des deux yeux, le méchant singe, et le vieux Legall avait eu le malheur de l’appeler une fois Grippe-Soleil. Le neveu dit : « Je te revaudrai ça. »
Le nom de Grippe-Soleil le coiffait si bien qu’il lui resta.
Voilà donc que, le dernier dimanche de mai, il y avait grandes vêpres à la paroisse de Guidel. Outre le recteur et ses deux vicaires, on voyait aux stalles une chape de Ploemeur et un camail de Lorient. Legall, qui avait son plein de bon cidre, se surpassait lui-même et dégoisait les psaumes comme un loriot. Les cinq messieurs prêtres le suivaient cahin-caha.
Un peu avant le Magnificat, le neveu Grippe-Soleil tira Legall par la manche et lui dit :
— Attention ! n’oublie pas le nouveau verset, bonhomme !
— Quel verset ?
— Celui que Mgr l’évêque de Vannes, ce matin, a fait tout exprès pour nos messieurs prêtres de Guidel. Tiens le voici ; regarde : on y parle du presbytère.
Et le vilain singe lui passa un carré de parchemin enluminé aux armes de monseigneur l’évêque.
— Et où met-on ce verset-là ? demanda le chantre sans défiance.
— En tête. Marche ! Voilà le serpent qui commence.
Le bonhomme Legall, heureux de faire honneur à ses patrons, couvrit le serpent de sa plus belle voix et chanta en tonnerre :
« Quinque sunt presbyteri Gudellis – qui nesciunt intonare – tonum quintum. »
M. le recteur se leva tout debout dans sa stalle ; les deux vicaires, la chape et le camail l’imitèrent. Le vieux Legall, fier d’un tel résultat, leur envoya un sourire modeste et remercia tout bas Grippe-Soleil.
Vêpres finies, le bonhomme n’eût rien de plus pressé que d’aller à la sacristie recevoir son dû de compliments.
— Maraud ! lui dirent en chœur les cinq messieurs prêtres, nous savons notre plain-chant mieux que toi.
Et M. le recteur ajouta :
— Je te chasse.
— Qu’ai-je donc fait ? qu’ai-je donc fait ? s’écria le malheureux Legall.
— Tu nous as chanté en latin, misérable, sacrilège et blasphémateur : « Ils sont cinq messieurs prêtres à Guidel, et pas un ne sait entonner le cinquième ton ! »
— Alors, dit le bonhomme, je suis déshonoré : je vais aller me pendre.
Il avait gagné, tout courant, la forêt de Keramour, et personne ne l’avait vu depuis lors, pas même le malin singe de neveu, qui furetait partout dans la futaie pour avoir un brin de la corde.
— Calotte à papa ! s’écria mon oncle quand l’histoire fut finie, elle est drôle, elle est drôle !… Quinque sunt… Vous m’apprendrez le verset… Nous disons donc que vous donnez pour la petite bêtaille cinq cents écus, la paire de jeunes bœufs, le clos Huant, les douze jambons, les sept sommes de blé noir et les quatorze poulettes.
— Oui, répondit M. Merlin la bouche pleine ; acceptez-vous ?
Vivette et moi nous nous regardions avec de grands yeux.
En voilà une petite bêtaille qui était chère !
— Mettez cinq fûts de fort cidre par-dessus le marché, dit mon oncle, et l’affaire est faite.
— Cinq fûts !
— Non, six… voyons, sept !
— Tope ! repartit M. Merlin avec précipitation, car il voyait venir le huitième.
— Tope ! répéta mon oncle. Le Païen qui s’en dédit !
Ils continuèrent de manger paisiblement.
Après le dîner, M. Merlin s’en alla.
— Vivette, dit mon oncle, va voir dans ta chambre, si j’y suis.
Et quand nous fûmes seuls tous deux, mon oncle reprit :
— Toi, tu as envie de savoir, pas vrai ? Eh bien ! je ne veux pas te faire languir : la petite bêtaille du marché, c’est Vivette. Je viens de faire sa fortune et son bonheur.
IILES JURONS DE MON ONCLE
À cette déclaration de mon oncle Le Bihan, je restai positivement atterré.
— Et toi, reprit-il, mon gaillard, tu vas aller faire ton tour de France. Ah ! ah ! toutes les nièces sont rousses, ventrebleu ! mais c’est égal, on en rencontre encore des brunes et des blondes derrière les haies. Tu vas t’en donner, chevalier, attends voir un peu !
Il se leva en sursaut, car il avait oublié les grâces, et il récita dévotement la formule :
— Je remplace aujourd’hui monsieur mon chapelain, qui se trouve être par hasard en vacances.
Après quoi il dégaina pour protester contre l’indélicatesse de la duchesse Anne et interrompre ainsi la prescription, qui, sans cela, lui eût mangé petit à petit ses droits à la couronne de Bretagne.
— La treizième barrique ! s’écria-t-il en se rasseyant, tu as l’air d’un saint de bois, toi !
Le fait est que je ne trouvai aucune parole pour exprimer ma surprise désespérée.
— Sais-tu, reprit mon oncle, pourquoi je jure la treizième barrique ? C’est à cause de la bonne femme.
Il ôta son bonnet d’un air bourru, mais avec respect.
Dans les manoirs bretons, la « bonne femme », c’est la mère.
— C’était en 42, poursuivit-il : l’année était mauvaise, et madame ma maman tenait le domaine, parce que j’étais encore en minorité. Il n’y avait pas de pommes dans le pays ; mais notre clos Dréo, celui qui donne le meilleur cidre, avait fourni quatorze barriques. Madame ma maman avait voulu en faire de l’argent ; et un matin je vis arriver dans la cour des marchands de Lorient avec leurs charrettes.
J’avais pensé à cela toute la sainte nuit. Laisser partir tant de bon cidre ! Et l’idée que d’autres le boiraient me donnait la fièvre de misère. Je me mis à la fenêtre. Madame ma maman avait vendu douze barriques et la treizième pour le remplissage. On était en train de la charger. Je pris mon fusil et je la mis en perce par le milieu du premier coup.
— Que faites-vous, Monsieur Le Bihan ? me cria la bonne femme, voyant que je rechargeais mon fusil.
— Madame ma maman, répondis-je, les douze autres vont y passer, chien d’Anglais !
— Déchargez ! déchargez ! cria-t-elle aux marchands : voici mon petit gars qui est devenu homme !
Comme ça, culotte à papa ! la treizième barrique sauva tout le reste.
Louis XIV, sur ses vieux jours, racontant comment il avait saisi les rênes du char de l’État, devait avoir un peu l’air de mon oncle Le Bihan narrant cette anecdote caractéristique.
Pendant qu’il parlait, je me retrouvais un peu moi-même.
— Mais, mon oncle, lui dis-je, Vivette n’est pas une petite bêtaille, et il n’est pas permis de vendre ses enfants !
— Trois péchés mortels ! s’écria-t-il ; et ce juron-là, c’est l’histoire de mon mariage. Je te la dirai une autre fois. Comme la jeunesse est raisonneuse ! Veux-tu parier avec moi que le monde ne durera plus bien longtemps, chevalier ?
— Mais enfin, repartis-je, vous êtes gentilhomme : un gentilhomme n’a qu’une parole, et vous m’aviez promis Vivette, si je la prenais sans dot.
Mon oncle Le Bihan se gratta le bout du nez, qu’il avait rouge et pompeusement bourgeonné.
— Tu as raison, chevalier, me répondit-il. Malheureusement pour toi, je n’ai que ma parole. Si j’avais autre chose que ma parole, chien d’Anglais ! Je serais capable de la tenir ! Et sais-tu ? L’Anglais guérit mon chien galeux que je lui avait vendu. Il fit dessus un bénéfice… deux bénéfices ! car son Anglaise prit la maladie en caressant le chien ; il épousa la maîtresse de la poste, qui partit avec un douanier. Quinque sunt… et le reste ! Voilà qui m’épargnera plus d’une fois le péché de jurer. De compte fait, l’Anglais eut trois bénéfices, et il cassa la tête du douanier, ce qui donne quatre. Je t’avais promis Vivette, et je te la donnerai, si tu as les cinq cents écus, la paire de jeunes bœufs, le clos Huant, dont les pommes sont si bonnes, les douze jambons, les sept sommes de blé noir et les sept fûts de cidre. Je te fais grâce des quatorze poulettes.
— Je ne sais pas ce que j’ai, murmurai-je ; mais vous le savez, vous, puisque vous êtes mon tuteur. Je vous donnerai tout ce que j’ai.
— Oui bien, je le sais, chevalier, toutes les nièces sont rousses ! Ta majorité va sonner, mon ami. Prends le registre qui est là-bas avec le lard, dans le saloir : nous allons nous amuser nous deux à régler mes comptes de tutelle.
J’eus beaucoup de peine à distinguer le registre des morceaux de lard. Toutes les choses graisseuses qui étaient dans la huche se ressemblaient horriblement. Je rapportai enfin un vieux bouquin qui eût fait aisément douze marmitées de soupe ; et mon oncle, avant de l’ouvrir, le caressa de deux mains.
— Vois-tu, chevalier, me dit-il, je n’ai jamais battu ma femme. Aussi elle est morte jeune. Un camouflet fait vingt-huit chopines ! Fais-moi penser à t’expliquer ce juron-là. Et ne vaut-il pas mieux se soulager ainsi que de profaner le saint nom de Dieu ? Mon papa buvait encore mieux que moi. Il avait humé les deux tiers du domaine avant que j’aie seulement séché ma première écuellée. J’ai mis vingt-cinq ans à riboter le restant, et je dis qu’il a fallu de l’économie ! Je n’ai plus rien que ma soif : ainsi, que je te redoive ou non, c’est à peu près la même chose… Tiens, mon gars, voici la page où ton papa coucha son testament. Lis-moi ça : je n’ai pas mes lunettes.
Il me tendait le registre ouvert.
Il faut vous dire que ce respectable livre, malgré sa vétusté, ne contenait pas beaucoup de pages écrites. Il commençait à la date de l’an 1694, par les stipulations matrimoniales du grand-père et de la grand-mère de mon oncle Le Bihan ; puis venait une recette pour confire la sardine ; puis le texte d’une oraison latine, propre à éloigner le tonnerre ; puis encore un cantique familier, commençant ainsi :
Bergère
Légère,
Gardez-vous de glisser
Quand vous dansez sur la fougère…
Çà et là on rencontrait quelques additions, des reçus, des mentions de vente ; des images pieuses, collées avec de la mie de pain ; des dates de décès, de naissances et de mariages.
Il y avait une page qui disait : « Année 1748, deux éclipses, grand’marée de septembre qui démolit la douane de Lorient, mort de la vieille mère et des quatre bœufs. Baptême de la grosse cloche. Trop de pommes : on manquera de fûts. »
Et une autre qui relatait la façon dans le cœur de mon oncle avait parlé pour la première fois : « 1er octobre 1739. Ai poussé jusque chez M. de Guerhouzou pour goûter son cidre de garde. Bon, mais dur ; j’entends le cidre. La demoiselle Vincente en a bu une chopine de plus que moi. Seize ans, une brouettée d’appas. Ai voulu druger (jouer), m’a cogné. L’ai demandée au bonhomme en mariage. Accordé. M’a recogné d’amitié dans la cuisine (3 octobre). Ventrebleu ! quelle poigne elle a ! »
À la lecture de ce memento, on comprenait vaguement pourquoi mon oncle n’avait jamais battu ma tante.
Ce que mon oncle appelait le testament de mon père, était ainsi :
« Je soussigné, Antoine-Gaston Le Bihan, chevalier de Keramour, me sentant à l’article de ma fin, déclare mourir confessé et réconcilié dans le giron de notre sainte mère l’Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
« Item : donner et léguer tout ce qui est de moi et de défunte ma dame bien-aimée à notre fils unique Gaston, chevalier de Keramour, qui serait maître de Pendor, sans que nous l’avons malheureusement vendu, et seigneur de tout le grand Keramour, sans que ma tante Armelle (à qui je pardonne) nous en a injustement dépouillés, pour en faire du bien à ce misérable empoisonneur de Merlin (envers qui je ne garde point de rancune).
« Item : donner à monsieur mon cousin Le Bihan de Polduc, héritier du sang de Bretagne, ma trompe et mon gobelet de chasse, ainsi que mon coutelas avec sa gaine, et le soin d’élever chrétiennement mon fils Gaston, chevalier de Keramour.
« En foi de quoi, n’ayant rien autre à dire, sinon remercier mondit sieur cousin Le Bihan, qui a donné pendant deux ans le vivre et le couvert à ma famille et à moi dans notre détresse, je prie Dieu qu’il l’ait en sa garde, lui et sa maison. »
Au-dessous de la ligne, ces mots étaient tracés d’une main plus tremblante :
« Pour Gaston :
« Adieu, mon petit gars. Je vais prier pour toi avec ta mère. Sois un Breton ! »
C’est à peine si je me souvenais de mon père, qui nous avait quittés quand j’étais petit. Je n’avais jamais vu ni son écriture ni sa signature. Mon oncle ne parlait pas souvent de ceux qui étaient morts : il détestait la tristesse.
Dans mon idée d’enfant, je ne me croyais certes pas riche ; mais j’étais à cent lieues de soupçonner que j’eusse été élevé par charité dans la maison de M. Le Bihan.
Je ne sais si d’un seul mot on peut rendre à un brave homme un plus éclatant hommage.
Je baisai le seing de mon père et je fermai le registre. Mes joues étaient inondées de larmes. M. Le Bihan toussait avec force sans en avoir envie. Quand je lui pris les deux mains, il voulut les retirer, tant il était à la gêne.
— Alors, dis-je, mon oncle… mon père, plutôt ! voilà seize ans que vous êtes mon bienfaiteur, et je l’apprends par hasard ?
— La paix ! fit-il presque durement. C’est moi qui suis une bête : je n’aurais pas dû te montrer des choses pareilles. Ton père et moi nous nous étions rossés avant de tenir sur nos jambes. Et ta mère ! belle et douce comme la sainte Vierge ! Tu sais ? si tu me fais pleurer, je tape ! Ventrebleu ! calotte à papa ! chien d’Anglais ! et son Anglaise ! et la gale ! et les douaniers ! Tu lui ressembles, à ta maman… Et vas-tu t’essuyer les yeux, failli drôle ! Jamais je n’ai été si en colère de ma vie… En mourant, elle m’avait dit : « L’enfant vous reste, cousin. Je vous connais : je n’ai pas peur. » Enjôleuse ! Ah ! petit, le diable n’y peut rien ! C’était une sainte que ta mère !
IIIOÙ MON ONCLE MONTRE LE FOND DE SON CŒUR
Pour un empire, mon oncle n’aurait pas voulu avouer à des tiers la grosse larme qui roulait lentement parmi les rubis de sa joue. Je me jetai dans ses bras ; il fit mine de me repousser, mais il me serra contre sa poitrine.
— On peut s’embrasser de plus loin, pas vrai, chevalier ? reprit-il en manière d’apologie : après Vivette, tu es mon plus proche parent. Mais où ça mène-t-il ? Eh bien, voilà ! mon registre n’est pas bavard, puisqu’il reste les trois quarts de son papier blanc (sauf les taches de sauce), depuis près de cent ans qu’il est dans la famille. Et cependant il dit bien des choses. Tu vois ces petites croix qui n’ont l’air de rien ? chacune d’elles marque des funérailles : ici, c’est le deuil d’une ferme ; là, celui d’un moulin, d’un étang, d’un clos, d’un taillis ou d’un baliveau d’âge. Nous étions riches. Après ? Nous voilà pauvres. On tâchera de boire tout de même. Si tu voulais me dire que tu ne m’en veux pas pour ton mariage manqué, ça me ferait plaisir tout de même.
— Nous nous aimons bien, Vivette et moi, murmurai-je.
— Et crois-tu que tu ne me manqueras pas ? s’écria mon oncle impétueusement. Je suis habitué à toi comme à ma pipe ! Calotte à papa ! qu’aurai-je pour te remplacer ? Ce vieux grigou de Merlin ? Je ne peux pas le voir en peinture ! Mais sois tranquille : notre Vivette le mettra dans sa poche. Et qui sait ? le coquin est encore dur ; mais il a de l’âge, et c’est peut-être par sa veuvière que tu rentreras dans ta maison de Keramour. Vous l’avez perdue par une vieille fille : elle vous reviendra par une jeune veuve. Ah ! ah ! ah ! voilà ! Toutes les nièces sont rousses ! l’idée n’est pas mauvaise, hé ?
Il plongea la main dans sa sacoche et en retira deux écus de six livres.
— Mon gars, me dit-il brusquement, les plus courts adieux sont les meilleurs. Je te donne Taupin pour ton voyage, avec la selle et la bride. Va faire ta valise, prends ces deux braves écus, et bonne chance ! Je ne veux plus te revoir.
— Quoi ! m’écriai-je, vous me chassez tout de suite ?
— À coup de bâton, s’il le faut, oui mon pauvre petit gars. Il faut avoir pitié de Vivette. Et puis, c’est dans mon marché avec le Merlin. Je ne connais personne à Paris à te recommander ; mais on m’a dit que Noël Menou, de Pendor, l’ancien domestique de ton père, avait fait fortune à la cour. Il est, à ce qu’il paraît, chambrier d’un ministre. Fais ton profit de cela… Et décampe, chien d’Anglais ! Tu devrais déjà être parti.
Il fourra dans ma poche les deux pièces de six livres que je ne prenais point. Je balbutiai :
— Mon oncle, je ne peux pas vous dire ce que je ressens…
— Beaucoup de rancune, mon gars ?…
— Non, sur l’honneur !
— Et un peu de reconnaissance. Il n’y a pas de quoi boire.
Il me prit par les épaules, me fit tourner de l’autre côté de la porte, qu’il ferma sur moi.
Mais je l’entendis qui disait en un véritable gémissement :
— Ah ! misère ! misère ! misère ! toutes les nièces rousses ! et les cinq prêtres ! et le cinquième ton, le diable et ses cornes ! ça vaut mieux que de jurer. Il faut donc mettre une croix sur le registre pour dire que j’ai vendu aussi ces deux enfants-là pour boire !
Je montai à ma chambre, résolu d’obéir. Mon cœur se fendait à la pensée de quitter Vivette sans même lui donner le baiser d’adieu ; mais je ne peux dire à quel point je respectais la volonté de M. Le Bihan.
Je l’admirais tel qu’il était, vices et vertus ; et pendant que je faisais ma valise, je revoyais toujours cette grosse larme roulant le long de sa joue rougeaude à la pensée de ma mère.
L’arrimage de mes effets dans le portemanteau n’était pas une besogne compliquée. Comme j’achevais, Joson entra sans frapper.
Joson était de Pendor et frère de ce Noël Menou qui avait servi mon père en qualité de petit valet.
— Voilà ce que c’est, me dit-il ; je ne mens point : la demoiselle est en bas qui pleure. Elle a tout écouté derrière la porte de l’étable. Elle dit comme ça qu’il faut passer, en vous en allant, par la grande avenue de Keramour. Si vous voulez, monsieur le chevalier, j’irai domestique aussi, moi, avec vous, jusqu’à Paris, faire fortune, comme de juste.
Je ne sais pas si, depuis sa naissance, Joson avait jamais prononcé un aussi long discours.
— Mon brave garçon, répondis-je, je n’ai en tout que douze livres.
— Ça ne fait rien.
— Et comment me suivras-tu ?
— À pied donc.
— Et si tu es malade en route ?
Sa large bouche s’ouvrit pour rire tout bas.
Joson malade ! c’était là, en effet, une drôle d’idée.
— Alors, conclut-il, voyant la faiblesse de mes objections, c’est dit : je vas faire mon paquet, sûr et vrai, et lier mes sabots.
Il s’éloigna. Je descendis à l’écurie pour seller Taupin. Ce n’était pas un coursier de bataille. Il avait charroyé du charbon pendant dix ans dans la forêt de Quimperlé avant de venir chez nous, et je le voyais porter mon oncle depuis tantôt dix autres années aux foires et pardons des alentours ; mais ces petits chevaux du Finistère, vifs et sobres comme des chèvres, vivent aussi vieux que des corbeaux. Le nom de Taupin disait sa robe, qui était noire avec des reflets d’un gris fauve. Il allait la tête basse et les jambes écartées, mais il allait tant qu’on voulait.
Je lui mis ma valise sur le dos et le fis sortir dans la cour. Mon oncle était debout et les bras ballants à la porte de l’écurie. Sa pipe éteinte pendait tristement à ses lèvres.
— Chevalier, me dit-il d’une voix véritablement altérée, te voilà donc qui t’en vas, mon pauvre petit gars ? Trois péchés mortels ! coquine de duchesse Anne ! saligauds de Français ! Je n’aurais pas cru que j’aurais tant de mal à me séparer de toi ! et il faudra que le Merlin mette six autres fûts avec une barrique de vin vieux, que j’avais oubliée. Il peut bien ajouter un tonnelet d’eau-de-vie, pas vrai, cadet ? Ventrebleu ! ventrebleu ! calotte à papa ! j’ai le cœur trop triste ! Veille à Taupin dans les descentes, le fer de derrière, à droite, n’a qu’un clou. Et ne me la fais pas trop pleurer : j’entends Vivette, à qui j’ai permis d’aller t’attendre au Grand-Carrefour. Veux-tu boire un coup ? Non ? Alors, bon voyage ! la treizième barrique ! Si j’étais notre âne, je brairais !
Il me serra la main terriblement dur et se sauva dans la cuisine.
Les cinq valets et les six servantes me firent escorte jusqu’au seuil de la cour. Il ne manquait que Joson. Un instant je le cherchai des yeux, puis je n’y pensai plus.
Bonsoir-à-revoir, Monsieur le chevalier ! criaient tous ces braves amis à tue-tête. Ça va être du deuil assez par chez nous de ne plus vous voir ni soir ni matin, et le Merlin à la place de vous, misère de malheur ! la bénédiction du bon Jésus et de la sainte Vierge Marie ! C’est la maison qui sera grande ! Portez-vous bien, monsieur le chevalier, et le paradis après vos jours !
Je mis Taupin au petit galop dans le chemin qui montait à la lande entre les deux taillis de châtaigniers. J’avais donné des poignées de main à tout le monde, hélas ! et rien avec. Mais jusque par delà les taillis, je les entendis qui récitaient pour moi le Pater noster de si bon cœur !
Tout ce que je voyais me serrait la poitrine : le pré gras où l’on coupait l’herbe pour l’étable, le douhet (bassin) près de la fontaine où les laveuses battaient le gros linge en mesure, les guérets qui attendaient encore une semaille de blé noir, et les choux grands comme des arbres, et les froments déjà hauts qui ondulaient à la brise. Chapeau bas, je dis adieu au clocher, j’envoyai un baiser aux deux pauvres croix de bois plantées l’une à côté de l’autre dans le petit cimetière.
Là, dans le cimetière et dans l’église, l’histoire de notre maison était racontée par les tombes. Nous avions été toujours en descendant depuis des siècles. Dans le chœur de la paroisse, trois Keramour dormaient sous des dalles de granit, et les dalles disaient de chacun d’eux : Haut et puissant seigneur…
Puis la mort avait passé le seuil. Trois autres tombes étaient tout près du porche ; – puis d’autres vers le milieu : des maîtres et des maîtresses de Pendor ; – puis les deux dernières, qui n’avaient ni tables ni grillages et se cachaient le long du mur…
Vers quel autre lointain champ de repos allais-je, moi le banni, plus pauvre qu’un mendiant ? Quelqu’un prendrait-il seulement la peine d’écrire mon nom avec un « Priez Dieu pour lui » sur les deux lattes croisées pour marquer mon dernier asile ?
Ventrebleu ! comme disait mon oncle, le soleil brillait là-haut joyeusement, annonçant déjà sa tombée par le rose orangé qu’il mettait aux rebords des nuages. Je n’étais pas d’humeur à garder longtemps ces mélancolies.
J’allongeai un coup de houssine à Taupin et je me dis :
— Chevalier, mon seul ami, c’est quand on est en bas de la côte qu’il s’agit de remonter. La méchante veine ne peut pas durer toujours, et Dieu t’a fait un fier cadeau, mon homme : c’est de n’avoir plus rien à perdre !
La route montait, justement. Au sommet, comme une opulente couronne, le parc de Keramour arrondissait les jeunes verdures de ses vieux arbres.
Je me dis encore :
— Puisqu’on peut tout perdre, on peut tout gagner au jeu de la vie. En avant, Taupin, ma bique ! Tu ne t’en doutes pas, ni moi non plus ; mais nous allons peut-être à notre fortune !
Comme je parlai ainsi, j’entrai sous la futaie pour abréger la route qui devait me conduire au Grand-Carrefour.
Je n’avais pas fait deux cents pas sous le couvert, que je vis quelque chose de noir pendre à une branche, comme ces sentinelles de paille qui gardent les cerises mûres contre le pillage des merles et des moineaux.
Je pensai tout de suite à ce pauvre bonhomme Legall, le chantre de Guidel, et je m’approchai dans l’intention de couper la corde, s’il était temps encore, par hasard.
IVLE GRAND-CARREFOUR
Le cuisiner Vatel s’est rendu célèbre dans l’univers entier par un suicide du même genre que celui de M. Legall. Tous les deux moururent d’une humiliation professionnelle. J’espère que les présents mémoires feront passer le nom du chantre de Guidel à la postérité la plus reculée. Je lui dois bien cela, comme on pourra le voir.
L’odeur qui empestait l’air me convainquit tout de suite de l’inutilité de tout secours. Il y avait une nuée de mouches à l’entour du cadavre. Je pus voir que la main crispée du malheureux tenait encore ce fatal carré de parchemin où était inscrit le verset apocryphe inventé par le neveu Grippe-Soleil.
Je remarquai encore autre chose. On sait le préjugé populaire qui s’attache à la corde de pendu. Il me sembla qu’on avait déjà beaucoup dîmé sur celle de l’infortuné Legall : elle était réduite, par de nombreux emprunts, au tiers de sa grosseur et toute effiloquée.
Je payai un Requiem au défunt, sans lui dérober en échange aucun brin de sa corde, et je continuai ma route. Trois minutes après, je débouchais dans la grande avenue de Keramour, et je mettais pied à terre pour recevoir dans mes bras ma petite Vivette chérie, qui pleurait comme une Madeleine.
Nous fûmes longtemps avant de parler. Elle tremblait sur mon cœur, comme un jonc au courant de l’eau qui s’enfuit.
L’air était doux qui venait des grandes roches de Kerpape et de la falaise de Loc-Mener. Ce vent du large, si cher à la poitrine des Bretons, chantait mélancoliquement dans les hautes branches des hêtres.
Ah ! de ce moment-là, toute ma vie je me souviendrai.
C’était un noble lieu. J’ai vu bien des châteaux royaux, je n’en ai pas trouvé un seul qui eût cette splendide approche. Au Grand-Carrefour, il y avait cinq allées en étoile, toutes les cinq larges comme l’avenue de Vincennes et bordées par trois rangs d’arbres gigantesques, adossés partout à la futaie. Autour des vieux troncs qui déchaussaient leurs racines énormes, la mousse verte et fauve croissait comme une chevelure, tachée çà et là par les toitures basses, épaisses et brunes des monstrueux champignons. Par places, les bords du chemin étaient tout bleus de pervenches ; et de chaque côté des fossés, aussi bien que le long des ornières profondes, la lande renaissait, mêlant l’or des ajoncs au rose obscur de la bruyère, dont l’odeur d’incendie allume la passion du chasseur.
Trois des percées allaient à la mer, parce que le domaine de Keramour est un promontoire ; l’allée de l’ouest tombait dans l’immensité de l’Océan ; l’allée du sud apercevait l’île de Groix et ses roches basaltiques ; l’allée de l’est regardait le clocher de Larmor, les remparts de Port-Louis et la rade de Lorient, bizarre et jolie comme un coin du paradis de l’Inde ; les deux autres enfin, dirigées vers la terre ferme, découvraient les larges échappées, forêts, plaines et montagnes qui vont de Kervalloz à Pendor.
Ces noms peuvent vous sembler barbares. Pour nos oreilles bretonnes, ils sonnent comme l’harmonie des syllabes grecques remuait le cœur des guerriers pélasges évoquant sur la terre étrangère l’Illissus, l’Eurotas ou la bien-aimée Argos.
Nous avons nos poètes aussi, qui chantent sur la harpe des bardes Scaër et ses lutteurs, les trente chevaliers d’Évran, les douze vierges de Treffeleur, Kerillis et ses visions blanches ; Ellé, la rivière enchantée ; Isôle, sa sœur, la rivière bénie ; Quimperlé, où est la fête des rouges-gorges ; Uzel, où est Notre-Dame-des-Anges ; Saint-Priol, où la brise s’embaume en passant sur le Pardon-des-Fleurs…
Ce ne sont pas ici de vains mots. Parler de tout cela, c’est songer encore à ma petite chérie, que j’allais quitter en abandonnant mon pays.
Savais-je alors comme je les aimais toutes les deux, ma Viviane et ma Bretagne ?
Quand Vivette retrouva la parole, ce fut pour me dire :
— Gaston, je n’en veux pas à papa ; et toi ?
— Ton père, répondis-je, est la meilleure âme…
— Bon ! bon ! Embrasse-moi. Tu vas voir du pays : cela console. Moi, j’aurai à chauffer les gilets de laine du vieux grigou de Merlin. Est-il laid ! est-il ratatiné ! râpé ! sec ! méchant ! abominable ! Dis-moi que tu ne m’oublieras jamais.
— Oh ! jamais ! m’écriai-je.
— Combien papa t’a-t-il donné pour ton voyage ?
— Un demi-louis.
— Pauvre papa ! Tiens, prends cela : c’est toute ma fortune.
Comme j’hésitais, elle ajouta :
— Je n’en ai plus besoin, puisque je vais être si riche ! Il y a cinq louis d’or : c’est assez pour aller jusqu’à Paris ; et il y a ma croix de cou, qui vaut trente-huit livres pesant, et l’alliance de maman. L’alliance, c’est pour mettre en gage, si tu as besoin, mais je te défends de la vendre.
Je ne voulus pas de l’alliance, et je n’acceptai la croix d’or que pour la porter sur mon cœur.
Si vous saviez comme Vivette était jolie, assise sur la mousse à mes genoux !
— Tu es bien gentil, me dit-elle, de n’en pas vouloir à papa ; mais, si tu m’aimais beaucoup, beaucoup, tu te mettrais plus en colère, et je serais obligée de me mettre à tes genoux pour t’empêcher de tuer M. Merlin, sais-tu ?
L’idée ne m’en était pas venue, de tuer M. Merlin.
— Au fait, m’écriai-je en sautant sur mes pieds, si on l’assommait, ce vieux coquin-là, un petit peu !
— Tu le ferais ? demanda-t-elle en fixant sur moi ses yeux brillants.
— Tout de suite, répondis-je. Attends-moi seulement : je vais revenir.
Elle m’entoura de ses bras charmants, et, souriant à travers ses larmes :
— Il ne l’aurait pas volé, dit-elle. Mais qui donc mettrait des fûts dans la cave de papa ? Je te remercie, mon Gaston, tout comme si tu avais fait la chose pour moi. Va, on n’est pas sur la terre pour se divertir, c’est sûr. J’ai bien réfléchi : je serai bonne avec M. Merlin, malgré tout, et je ne lui jouerai pas de niches, pour que papa ait à boire et à manger. Embrasse-moi.
Elle mit sa tête sur mes genoux. Combien de fois ne s’était-elle pas endormie ainsi par les soirs d’été, quand nous étions enfants tous les deux !
Le soleil enfilait déjà l’allée de l’ouest, allumant dans la mer une traînée plus longue. De sa voix cassée, le clocher de Guidel envoya la cinquième heure. Viviane se releva en sursaut.
— Père m’avait dit de n’être pas longtemps, fit-elle. Il faut que je vieille à lui : car il est capable de reprocher ton départ à M. Merlin, quand il aura son coup du soir, et de le battre comme plâtre. Où couches-tu cette nuit ?
— À Auray.
— Pousse jusqu’à Saint-Anne, et dis à la bonne mère de la Vierge que je l’aimerai bien si elle te garde contre tout malheur. Tiens, voici mes boucles d’oreilles : tu les suspendras à droite en entrant dans la chapelle, auprès de mon petit bracelet d’or que j’avais porté l’an dernier, quand tu fus malade. Le reconnaîtrais-tu ?
Je baisais ses belles mains sans répondre ; mon cœur se fondait à cette heure de la séparation.
Elle me mit sur mes jambes et m’entraîna vers Taupin, qui attendait, broutant les jeunes pousses des ajoncs.
— Il y a de si bons chevaux dans l’écurie de M. Merlin ! soupira-t-elle et tes fontes n’ont même pas de pistolets ! Il en a de change et de rechange, lui, et qui ne servent pas. Comme je le déteste !
Nous entendîmes un bruit de feuilles sèches sous le couvert. Mon oncle Le Bihan et son futur gendre arrivaient bras dessus bras dessous. M. Merlin était armé en guerre : il portait à la main un bâton fourchu à deux dards, bonne défense contre les chiens enragés ; et un mouchoir de Cholet, noué autour de sa veste, soutenait une paire de forts pistolets.
— Les voilà ! parbleu ! dit-il. Est-ce bientôt fini, ces grimaces-là ?
Mon oncle allait la tête penchée ; il grommela :
— Les plus courts adieux sont les meilleurs. Allons, garçailles, embrassez-vous ; et en route, toi, chevalier !
Vivette m’avait quitté pour aller aux nouveaux venus.
Sans mot dire, elle prit les deux pistolets à la ceinture de M. Merlin et les fourra dans mes fontes.
— Eh bien ! eh bien ! s’écria le grigou. Voyez-vous ce que fait l’effrontée, voisin !
— Ventrebleu ! répliqua mon oncle, puisque vous n’avez plus les deux bêtes, voisin, lâchez le fourrage aussi.
Il me tendit en même temps la petite poire à poudre et le sac à balles, qu’il venait d’ôter de la poche de son gendre.
— Et décampe, cadet ! ajouta-t-il. Calotte à papa ! si on te revoit dans le pays, je te fais mener par les chiens comme un lièvre !
— Les chiens vous mèneraient plutôt que lui ! dit Vivette. Il va s’en aller, soyez tranquille, et la joie, de notre maison le suivra. Vous et moi, mon père, nous avons vieilli de dix ans aujourd’hui. Monte, Gaston, ajouta-t-elle en s’adressant à moi. C’est fini pour un temps ; mais qui vivra, verra.
Quand je fus en selle, le grigou poussa un grand soupir de soulagement.
Depuis qu’on lui avait pris ses pistolets et ses munitions, il n’avait pas soufflé mot, mais le diable n’y perdait rien. Il me regardait avec ses yeux de chouette, et la colère faisait remuer ses lèvres.
Vivette ne m’embrassa même pas ; elle me tendit la main d’un geste stoïque en disant :
— Adieu, Gaston ! que Dieu te bénisse !
Et je partis vitement. Mes yeux me brûlaient. Je ne voulais pas que M. Merlin me vit avec des larmes sur la joue.
Je l’entendis qui grommelait :
— Que le diable t’emporte !
J’allais en remontant vers la grande route. Le jour s’assombrissait par l’ombre des futaies, quoique le soleil fût encore au-dessus de l’horizon. J’avais fait dessein de ne point me retourner.
Tout à coup j’entendis un pas léger qui courait derrière moi sur la mousse, et des voix déjà lointaines criant :
— Vivette ! Vivette !
Je sentis un choc soudain ; deux jolis bras bien-aimés se nouèrent autour de mon cou : c’était Vivette qui venait de sauter en croupe.
Ne vous étonnez pas. Taupin n’était pas bien haut sur ses jambes, et ma pauvre petite Viviane se serait moquée d’Atalante au combat de l’agilité.
— Bête que je suis ! me dit-elle tout essoufflée, j’avais oublié le principal. Jamais je ne m’en serais consolée, prends ceci, et promets-moi, sur ton salut éternel, de ne jamais t’en séparer.
Elle tendit en même temps une petite bonbonnière de corne étamée, comme on en vend à la foire.
— Qu’y a-t-il là-dedans, chérie ? demandai-je, les lèvres déjà collées sur ses doigts.
— Jures-tu ?
— Je jure ?
— Sur ton salut ?
— Sur mon salut.
— Il y a un peu de mes cheveux d’abord, et puis un peu de la corde qui a servi au pauvre bonhomme Legall. Avec les deux j’ai tressé une bague…
Quelle folie !
— Tu as juré !
Elle m’enlaça d’une dernière étreinte, mit ses fraîches lèvres sur ma joue, et se laissa glisser dans le chemin, disant dans le patois gallo qu’elle parlait si doucement :