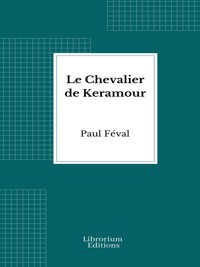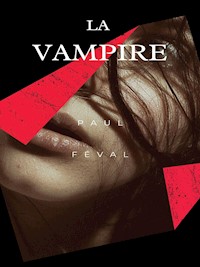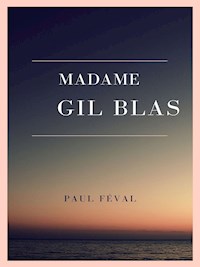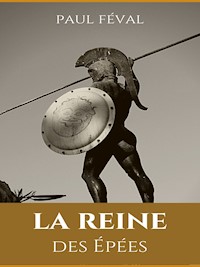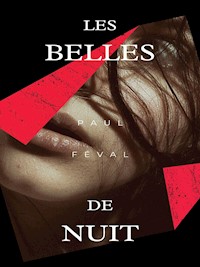Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Le cycle des habits noirs
- Sprache: Französisch
Le secret des Habits noirs est le tome 4 du cycle des Habits noirs, roman historique dans la lignée du Comte de Monte Cristo et de Lagardère. Il se compose le sens aigu de la progression dramatique, l'habileté des intrigues, l'évocation pittoresques du vieux Paris, l'étonnante galerie de types sociaux partagés entre l'innocence et la passion du crime font des Habits noirs un chef d'oeuvre de mystère et de suspens. de deux romans: l'Arme invisible et Maman Léo. Ce roman et sa suite "Maman Léo" est centré sur le combat que mène le jeune magistrat Rémy d'Arx contre les Habits noirs dont le chef est le colonel Bozzo. Ce dernier se sert d'une arme psychologique "l'Arme invisible" pour maitriser le magistrat. Il le rend fou amoureux de Fleurette, enfant d'origine inconnue, recueillie par des saltimbanques.... Bonne lecture.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 833
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Cycle des HABITS NOIRS
Tome 1 : Les habits noirs
Tome 2 : Cœur d’acier
Tome 3 : La rue de Jérusalem
Tome 4 : Le secret des Habits noirs (L’Arme invisible et Maman Léo)
Tome 5 : L’Avaleur de sabres
Tome 6 : Les compagnons du trésor
Tome 7 : la bande cadet
Les mystères de Londres: 2 Tomes
Table des matières
Le cycle des HABITS NOIRS
Tome 4
Le secret des Habits noirs
Première partie L’Arme invisible
1. Les diamants de M
lle
Bernetti.
2. Le confessionnal de Toulonnais-l’Amitié.
3. Chapitre aux portraits.
4. Le colonel.
5. La demande en mariage.
6. Première entrevue.
7. Première dompteuse.
8. Souper à la baraque.
9. Valet de carreau, neuf de pique.
10. Biographie de Maurice.
11. L’assassinat.
12. Le colonel.
13. L’arrestation.
14. Le réveil.
15 Le conseil des Habits-Noirs.
16. Le manuscrit de Remy d’Arx.
17. Remy d’Arx.
18. L’interrogatoire.
19. Valentine.
20. Cadeau de noces.
21. La confession de Valentine.
22. La corbeille.
23. Le Diable.
Deuxième partie Maman Léo
1. Théâtre Universel et National.
2. Choix d’un tire-l’œil.
3. L’affaire Remy d’Arx.
4. D’où maman Léo sortait
5. Triomphe de M. Baruque.
6. La chevalerie d’Échalot.
7. M. Constant.
8. Échalot aux écoutes.
9. La folie de Valentine.
10. La maison de santé.
11. La folie de Valentine.
12. En dormant.
13. Aux écoutes.
14. Coyatier, dit le Marchef.
15. Le salon.
16. Embauchage de maman Léo.
17. Le billet de Valentine.
18. Soirée à « l’Épi-Scié ».
19. Les conjurés.
20. Le scapulaire, le secret, le trésor.
21. Le roman du colonel.
22. Où il est parlé pour la première fois de la noce.
23. Maman Léo entre en campagne.
24. Le Rendez-vous de la Force.
25. La Force.
26. Le prisonnier.
27. La maison de Remy d’Arx.
28. La visite des Habits-Noirs.
29. La mort de Remy.
30. Le testament
31. Le commissionnaire.
32. Le cœur de Valentine.
33. L’agonie d’un roi.
34. La tentation de Similor.
35. Le combat.
36. Le dernier
37. La récompense d’Échalot.
38. Avant de combattre.
39. Départ pour le bal.
40. Antispasmodique.
41. La voiture des mariés.
42. Le bien et le mal.
Première partie
L’Arme invisible
Source
Ce livre est extrait de la bibliothèque numérique Wikisource et les illustrations de Wikimedia Commons, la médiathèque libre.
Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution – Partage dans les mêmes conditions 3.0 non transposé. Pour voir une copie de cette licence, visitez: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
ebouquin
1.
Les diamants de Mlle Bernetti.
Un soir de vendredi, vers la fin de septembre, en 1838, à la tombée de la nuit, le garçon du marchand revendeur établi à l’angle des rues Dupuis et de Vendôme était en train de fermer la boutique lorsqu’un élégant coupé s’arrêta devant la porte. Les échoppes du quartier du Temple reçoivent souvent d’aussi belles visites que les magasins à la mode ; le faubourg Saint-Germain et la Chaussée-d’Antin ont appris dès longtemps le chemin de cette foire et y viennent en tapinois, soit pour acheter, soit pour vendre.
Le garçon remit à terre le volet qu’il avait déjà soulevé à demi et attendit, pensant que la portière du coupé allait s’ouvrir.
Mais la portière ne s’ouvrit point et le store rouge qui défendait l’intérieur de la voiture contre les regards curieux resta baissé. Le cocher, beau garçon au teint fleuri, planta son fouet dans la gaine comme s’il eût été arrivé au terme de sa course et tira de sa poche une pipe qu’il bourra paisiblement.
Le garçon, quoiqu’il fût d’Alsace, connaissait assez bien son Paris, car il se demanda :
— Est-on monsieur qui attend une dame là-dedans ou une dame qui espère un monsieur ?
Et avant de reprendre son volet il tourna le coin de la rue de Vendôme pour voir à quel sexe appartenait le retardataire ; mais il se trouva tout à coup en face d’un bon gros père qui arrivait les mains dans ses manches et qui le salua d’un débonnaire sourire.
— Tiens ! tiens ! dit le garçon, c’est M. l’Amitié qui venait voir le patron ! Vous n’avez pas de chance, papa Kœnig et sa dame viennent de partir pour leur petit jardin de Saint-Mandé. Des propriétaires, quoi ! ça n’est heureux que dans leur campagne ; un carré de gazon large comme un mouchoir et douze manches à balai qui ont chacun trois feuilles malades… faudra-t-il dire quelque chose au patron de votre part ?
M. l’Amitié l’écarta du coude et continua sa route après lui avoir adressé un signe de tête amical.
C’était un homme jeune encore à ne regarder que ses yeux vifs et rieurs, mais il portait une barbe grisonnante, très mal peignée, qui trahissait l’approche de la cinquantaine. Sous les plis d’une houppelande délabrée et très large qui semblait venir en droite ligne de la Judengasse de Francfort, on pouvait deviner la remarquable carrure de ses épaules. Il marchait sans bruit dans une paire de ces doubles bottes fourrées que les voyageurs mettaient par-dessus leurs chaussures, au temps où il y avait des diligences.
En passant devant le cocher bien mieux habillé que lui, il secoua la tête doucement, puis il franchit le seuil de la boutique.
— Quand je vous dis que le patron est sorti… marmottait derrière lui le garçon alsacien.
M. l’Amitié, gardant toujours ses mains dans ses manches, traversa le magasin encombré de débris misérables, parmi lesquels on eût découvert quelques meubles de prix et de riches étoffes. Parvenu à la porte du fond, il l’ouvrit en silence et continua sa route.
— Ah çà ! ah çà ! s’écria l’Alsacien, êtes-vous sourd, l’homme ? Quand je vous dis…
Il n’acheva pas. M. l’Amitié s’était enfin arrêté. Sa main se posa sur l’épaule du garçon, qu’il regarda en face, il prononça tout bas ces trois mots :
— Il fait jour.
L’Alsacien recula de plusieurs pas et son visage naïf exprima la consternation la plus complète.
— Faut-il en avoir du guignon ! grommela-t-il en crispant ses doigts dans ses cheveux : m’être mis dans un pareil pétrin pour une fois que je me suis fait payer à boire ! À Paris, avant de parler avec quelqu’un, faudrait lui demander ses papiers.
M. l’Amitié approuva du bonnet et choisit un bon vieux fauteuil où il s’assit commodément.
— Tu parles comme un livre, Meyer, mon ami, dit-il d’un ton doux et jovial. Est-ce que tu as les clefs de la cave ?
Meyer haussa les épaules, et M. l’Amitié reprit :
— Non ? le père Kœnig est un homme prudent… Alors, va-t-en au cabaret me chercher une bouteille de Mâcon cachetée à vingt-cinq.
L’Alsacien se dirigeait vers la porte, M. l’Amitié l’arrêta.
— Attends, continua-t-il, je vais te donner toutes tes instructions d’un seul coup. Tu viens toi-même de constater le faible de ton maître pour les plaisirs des champs ; en conséquence nous n’avons nulle crainte d’être dérangés. Jusqu’à voir, je suis ici chez moi…
— Comment, chez vous ! voulut interrompre Meyer.
— Tais-toi. Il va venir un brave jeune homme d’une trentaine d’années, un peu boiteux, et qui se sert en marchant d’une grosse canne de jonc à pomme d’ivoire ; il te demandera si M. Kœnig est à la maison, tu lui répondras : Oui.
L’Alsacien protesta par un geste énergique, mais il baissa les yeux sous le regard de M. l’Amitié, qui poursuivit :
— Et tu diras en t’adressant à moi : Patron, v’là quelqu’un qui voudrait vous parler. Je consentirai à recevoir le visiteur en question, et comme il m’est envoyé par un ami, je l’inviterai à prendre un verre de vin. Tu apporteras alors, comme si elle venait de la cave, la bouteille de cacheté à vingt-cinq. Est-ce compris ?
— Et pourquoi tout cela ? demanda Meyer.
— Est-ce compris ? répéta M. l’Amitié.
L’Alsacien laissa échapper un geste d’impuissante colère.
— Et après ? demanda-t-il.
— Après, tu fermeras ta devanture et tu iras te promener.
— Mais vous ?
— Ne t’inquiète point de moi, répondit M. l’Amitié.
— Vous coucherez ici ?
— Il y a la petite porte de l’allée, mon fils.
— Elle est fermée.
— Voici la clef.
Meyer resta bouche béante à regarder le loquet rouillé que son interlocuteur lui montrait.
— Est-ce que papa Kœnig en mange ? balbutia-t-il.
— Peut-être bien, répliqua l’Amitié, qui remit ses mains dans ses manches.
Meyer avait les joues rouges jusqu’aux oreilles.
— Écoutez, s’écria-t-il, tout ça a mauvaise odeur et vous êtes capable de faire un méchant coup. Je suis un honnête homme, vous allez prendre la porte et tout de suite, ou j’appelle la garde !
M. l’Amitié croisa l’une sur l’autre ses jambes chaudement chaussées et s’arrangea le plus commodément qu’il put dans son fauteuil.
— Il y avait une fois, dit-il sans élever la voix, un jeune garçon qui faisait semblant de dormir sur une table du cabaret de la Pomme de Pin, pendant qu’on assassinait le receveur de la banque dans la salle voisine…
— Je dormais ! fit Meyer avec épouvante, je jure devant Dieu que je dormais ! j’étais ivre pour la première fois de ma vie.
— On cherche ce jeune garçon poursuivit M. l’Amitié… As-tu quelquefois vu des billets doux comme celui-là, bonhomme ?
Sa main se plongea sous les revers de sa houppelande et un papier frappé d’un large timbre vint tomber aux pieds de Meyer.
Le malheureux garçon se pencha pour mieux voir, puis ses genoux fléchirent comme s’il eût reçu un coup sur la tête.
— Un mandat d’amener ! prononça-t-il d’une voix étranglée ; oui, je connais cela ; j’ai été domestique au greffe de Colmar… et mon nom ! mon nom écrit en toutes lettres !… qui donc êtes-vous ?
— Peut-être un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, répliqua M. l’Amitié, dont le sourire devint cruel. Parlons en français : je suis en train de pêcher aujourd’hui un plus gros poisson que toi. Si tu marches droit, je fermerai un œil et tu auras le temps d’aller te faire pendre ailleurs. Tiens, voilà un louis, va acheter le vin et garde la monnaie pour ton voyage. Si tu m’en crois, tu coucheras cette nuit sur la route d’Allemagne.
Meyer sortit d’un pas chancelant ; ses cheveux hérissés remuaient sur son crâne.
Un quart d’heure après, toujours dans l’arrière-boutique du papa Kœnig, revendeur de vieilleries et amateur de joies champêtres, M. l’Amitié était assis devant un guéridon soutenant une bouteille entamée, deux verres pleins et une chandelle de suif.
De l’autre côté de la table s’asseyait le visiteur mystérieux dont il avait donné le signalement à Meyer.
Meyer avait disparu.
— Je suis tout joyeux, disait M. l’Amitié, qui parlait maintenant avec un léger accent allemand, de faire la connaissance d’un compatriote et d’un coreligionnaire. Comment vont tous nos bons amis de Carlsruhe, mon cher M. Hans ?
— Les uns bien, les autres mal, répondit le visiteur, dont le visage accusait énergiquement le type israélite.
L’Amitié frappa ses mains l’une contre l’autre.
— Voilà des réponses comme je les aime ! s’écria-t-il. Passé le pont de Kehl, de ce côté-ci, on ne rencontre plus que des fous qui parlent droit, hé ! mon frère ?
Hans ne répondit que par un signe de tête approbatif. C’était un jeune homme aux traits pointus, à l’air maladif. Sa physionomie inquiète exprimait la dureté et la méfiance.
— Trinquons, reprit l’Amitié, qui affectait au contraire une extrême rondeur : à la santé de Moïse, de Jacob, d’Issachar, de Jéroboam, de Nathan, de Salomon et des autres.
Les verres se choquèrent et l’Amitié ajouta :
— Comme cela, mon bon frère, vous voulez me vendre un petit tas de bric-à-brac. Ce ne sont pas des meubles, je pense, car le port serait cher du grand-duché jusqu’ici. Ne serait-ce pas plutôt un lot d’étoffes ? Ah ! vous souriez, compère ? Je parie qu’il y a de la dentelle ! il en passe à Bade tous les ans pour des millions et sur de jolies épaules encore. Mais vous devez être un homme sage, Hans Spiegel, vous laissez les épaules et vous ne vous occupez que des dentelles.
Hans Spiegel souriait peut-être en dedans, mais sa figure restait morne et chagrine.
— On m’a dit, prononça-t-il tout bas, après avoir trempé ses lèvres dans son verre sans boire, que vous étiez homme à traiter au comptant une affaire d’une certaine importance.
— Au comptant, répéta l’Amitié au lieu de répondre, au comptant, cela dépend. L’argent a peur ; il se cache. Qu’est-ce que vous appelez une affaire importante, frère Hans ?
Spiegel rougit imperceptiblement et répliqua en baissant la voix davantage :
— Une affaire dans les cent… deux cents… peut-être trois cent mille francs.
— Vive Dieu ! s’écria l’Amitié, les jolies épaules étaient donc diantrement chargées ?
Spiegel toussa d’un air mécontent.
— D’ordinaire, dit-il avec sécheresse, les gens de notre état et de notre religion ne plaisantent pas quand ils parlent d’affaires.
L’Amitié répondit à son regard sévère par un coup d’œil humide, mais narquois.
— Bon ! bon ! fit-il, vous n’aimez pas le mot pour rire, frère Hans ? Chacun son caractère. Moi, je ne suis jamais mélancolique quand il s’agit de gagner honnêtement de l’argent… Parlons donc sérieusement, bonhomme, et faites-moi voir vos petites pierres.
Hans Spiegel s’agita sur son siège et regarda la porte.
— Mon compagnon, reprit l’Amitié, je vous sers suivant votre envie, je parle net maintenant parce que vous l’avez désiré. Souhaitez-vous qu’on mette tout à fait les pieds dans le plat ? Soit ! Frère Hans, vous ne venez pas de Carlsruhe. Si vous étiez de l’autre côté du Rhin, vous y resteriez et vous donneriez bien la moitié du prix des diamants de la Bernetti à l’homme qui vous fournirait les moyens de passer la frontière.
De rouge qu’il était, Hans Spiegel devint très pâle et murmura :
— Maître Kœnig, je ne sais pas ce que vous voulez dire.
— Ces coquines-là, reprit l’Amitié sans s’arrêter à cette protestation, font maintenant un tort énorme aux duchesses. Je connais quelqu’un qui avait eu avant vous l’idée de l’opération, mais vous êtes un jeune homme actif et plein de talent, monsieur Spiegel ; vous avez été plus vite que nous en besogne. Combien demandez-vous des écrins de la Bernetti ?
La figure maladive du juif s’assombrissait. Son regard était celui du renard poltron qui devient brave à toute extrémité et fait fête aux chiens quand on l’accule.
L’Amitié le considérait du coin de l’œil. Il se versa un verre de vin.
— Je suis bien forcé de boire tout seul, reprit-il, puisque vous n’avez pas soif.
Il ajouta en posant sur la table son verre, vidé d’un trait :
— Un joli jonc que vous avez là, mon camarade.
D’un mouvement instinctif, Spiegel serra entre ses jambes sa canne à pomme d’ivoire.
Mais ce l’Amitié était beaucoup plus vif qu’il n’en avait l’air. Il jeta son corps en avant comme un tireur d’armes qui se fend à fond, et son bras allongé par-dessus la table atteignit la canne, qui lui resta dans la main.
Alors eut lieu une scène muette et rapide comme l’éclair. Un pistolet jaillit en quelque sorte de la poche de Spiegel, qui visa et tomba terrassé avant d’avoir pu presser la détente.
L’Amitié, riant bonnement, désarma le pistolet et le jeta à l’autre bout de la chambre.
— Je n’ai plus vingt-cinq ans, murmura-t-il, mais ma poigne est restée solide. Allons relevez-vous mon camarade, et si vous avez un autre joujou comme celui-là, gardez-le pour une meilleure occasion.
Tout en parlant, il dévissait la pomme d’ivoire de la canne et la secouait au-dessus de la table comme il aurait fait d’un étui. Un assez grand nombre de diamants démontés qui, pour la majeure partie, étaient d’une grosseur considérable, roulèrent et s’éparpillèrent sur le tapis en lambeaux.
Spiegel restait désormais immobile et semblait pétrifié.
L’Amitié prit au hasard trois ou quatre pierres et les examina d’un air indifférent.
— Avec cela, dit-il, un garçon comme vous qui n’a pas de mauvaises habitudes peut rentrer dans son village, épouser Lischen ou Gretchen, acheter une ferme, voire même un manoir et avoir sa place au conseil municipal, quand sa barbe devient grise. Mais il faut d’abord vendre cette marchandise qu’on ne peut pas porter au marché ; il faut ensuite passer la barrière de Paris, où il y a des collets tendus ; il faut enfin franchir la frontière d’Allemagne, tout le long de laquelle le télégraphe a envoyé des pièges à loup avec le signalement du futur conseiller municipal… Je ne vous en veux pas pour votre frasque, mon frère Hans, chacun défend son bien comme il l’entend, et ceci est votre bien puisque vous l’avez volé, mais vous ne savez pas ce que vous faites : sans moi vous étiez perdu.
Et comme le regard du juif exprimait une rancuneuse incrédulité, l’Amitié ajouta :
— Les oreilles ne vous ont donc pas tinté ? Vers quatre heures, aujourd’hui, on a réglé votre histoire au bureau de la Sûreté. Les diamants de Carlotta Bernetti venaient du levant et du couchant, du midi et du septentrion ; elle avait une parure appartenant à la famille des princes Bérézow, une rivière qui avait quitté pour elle l’antique écrin des comtesses Ratthianyi ; tel bracelet avait orné le poignet d’une pairesse d’Angleterre, telle broche avait brillé sur la poitrine d’une grande d’Espagne. C’est une collectionneuse, et selon son propre calcul, sa pacotille vaut plus de la moitié d’un million.
— Au bas mot ! murmura Spiegel, qui retrouvait sa nature israélite.
— À la bonne heure ! s’écria l’Amitié, voilà que nous nous réveillons. Les demoiselles de l’espèce de la Bernetti, quand elles se mettent à crier, ont des voix qui s’entendent à trois lieues à la ronde comme les sifflets de chemin de fer ; autour de cet instrument principal et suraigu se sont groupées des voix plus mâles, appartenant à M. le prince, à M. le comte, à M. le président, à M. le maréchal et même à quelque mauvais petit agent de change. La Sûreté en a failli perdre la tête. Résultat prévu : à cinq heures, on avait tout ce qu’il fallait pour pincer votre canne et vous.
— Et c’est vous qui êtes chargé de m’arrêter ? demanda Spiegel avec assez de sang-froid.
L’Amitié éclata de rire.
— Mais pas du tout ! répliqua-t-il, je vous dis que je suis votre salut ! Je n’appartiens pas le moins du monde à la police, mais la police m’appartient un peu, parce que je vais et je viens d’une fleur à l’autre comme les papillons.
Notre métier n’est pas facile, M. Spiegel, pour ceux qui ne veulent pas, comme vous, se mettre dans le pétrin du premier coup. Vous avez fait une grosse affaire, c’est vrai ; mais, la belle avance, si elle vous rapporte en bénéfice net vingt ans de séjour à Brest ou à Toulon !
Nous autres, car je ne me vante pas, je suis tout bonnement membre d’une société qui jouit d’un certain crédit sur la place, nous autres, nous agissons prudemment, regardant deux fois plutôt qu’une l’endroit où il s’agit de poser le pied. Nous n’improvisons rien ; nos combinaisons ne s’exécutent qu’après avoir été fouillées avec un soin parfait.
Moi qui vous parle, je verrais un million pendu à un arbre du bois de Boulogne, que j’en ferais douze fois le tour avant de le décrocher.
Mais arrivons à ce qui vous concerne : vous êtes entre mes mains, mon bon frère, je pourrais vous rançonner, je ne le veux pas ; l’habitude de notre maison est de se contenter d’un honnête bénéfice : je vous offre 50,000 francs et un passeport à l’étranger : est-ce gentil ?
— Donnez ! s’écria Spiegel avec empressement, j’accepte.
M. l’Amitié eut encore son bon gros rire.
— Minute ! fit-il en remettant un à un les diamants dans la canne creuse, nous avons passé l’âge des étourderies. Moi, je ne me connais pas du tout à ces brimborions-là, et vous pourriez tout aussi bien me donner, en échange de mes 2,500 louis, des petits morceaux de verre valant une trentaine d’écus. Les affaires sont les affaires, monsieur Spiegel, vous allez reprendre tout cela, ce qui vous prouve bien que je n’ai point envie de vous tromper, et cette nuit même, un employé de chez nous, qui est expert en joaillerie, se rendra à votre domicile, examinera les pierres et vous comptera l’argent.
Le juif resta un instant indécis.
— Ah ! ah ! fit l’Amitié, vous aimeriez mieux prendre tout de suite la clef des champs, je comprends ça, mais soyez tranquille, on va vous donner l’ordre et la marche. Si vous suivez de point en point mes instructions, votre nuit sera bonne et vous voyagerez demain sur la route de notre chère patrie.
En sortant d’ici, allez-vous-en dîner où vous voudrez et restez longtemps à table. Vous concevez bien que ce serait folie de rentrer chez vous en ce moment.
Vers minuit, pas avant, rendez-vous rue de l’Oratoire-des-Champ-Élysées et demandez la chambre que le papa Kœnig aura retenue pour vous dans la petite maison située au fond de la cour du no 6. À deux heures du matin, je dis deux heures sonnant, vous entendrez gratter à votre porte, vous demanderez qui est là, on vous répondra : Le bijoutier. Je n’ai pas besoin de vous expliquer le reste. Quand vous aurez votre argent, vous dormirez la grasse matinée ou vous prendrez la poudre d’escampette, à votre choix… Est-ce dit ?
Il tendait la canne à Spiegel qui la prit et répliqua :
— C’est dit.
— Et bien dit ! appuya l’Amitié en le regardant dans les yeux. Ce qui est là-dedans vous brûle désormais les doigts et je ne crains pas que vous nous faussiez compagnie.
Il se leva et ouvrit la petite porte donnant sur l’allée.
— C’est que, murmura Spiegel d’un air honteux, pour exécuter vos instructions, il faudrait avoir de quoi dîner.
— Ma parole ! s’écria l’Amitié, je me doutais de cela ! Vous avez jeûné, mon pauvre garçon, avec des diamants plein vos poches ! Allons, allons, vous n’êtes pas fort ! Reprenez votre pistolet, voilà dix louis ; à vous revoir ! je vous souhaite bonne chance.
Spiegel le quitta au bout de l’allée et se dirigea vers le marché du Temple. Il avait caché la fameuse canne sous sa redingote et marchait à grands pas, regardant tout autour de lui avec inquiétude.
M. l’Amitié, au contraire, tourna le coin de la rue de Vendôme, cheminant d’une allure paisible, avec les deux mains dans ses manches.
Le cocher du coupé, qui semblait dormir, prit aussitôt son fouet, toucha son cheval et suivit au pas à quelques toises de distance.
2.
Le confessionnal de Toulonnais-l’Amitié.
Il était environ huit heures du soir et le boulevard du Temple, ce rendez-vous des plaisirs populaires qui reste dans la mémoire de tous les Parisiens, malgré le square lugubre qu’on a mis à sa place, éclatait en mille bruits joyeux. La foule se pressait autour des théâtres dont l’enseigne promettait le rire ou les larmes, la foire des petits marchands allumait ses lanternes et ceux-là mêmes qui n’avaient pas trois sous pour entrer chez le regretté Lazari trouvaient à passer leur soirée gratis devant la baraque de quelque successeur de Bobèche.
Quand le singulier personnage qu’on nommait M. l’Amitié déboucha par la rue Charlot en quittant le logis du papa Kœnig, le boulevard était à l’apogée de son allégresse quotidienne ; mais ces joies, paraîtrait-il, n’étaient pas l’affaire de notre homme à la houppelande juive, car il n’accorda pas même un regard aux fameuses illuminations de la foire, et tourna court dans la direction de la colonne de Juillet.
Le coupé aux stores fermés fit comme lui et longea lentement le trottoir.
Le costume choisi par M. l’Amitié se rencontrait alors plus souvent qu’aujourd’hui dans le quartier du Temple. Les choses caractéristiques tendent à s’effacer de plus en plus et les vieux vautours de la petite semaine s’habillent maintenant comme des casse-noisettes ordinaires. Les jeunes ont parfois leur tailleur aux environs de l’Opéra. M. l’Amitié pouvait donc continuer sa promenade sans exciter autrement l’attention des passants. Il allait d’un pas doux comme la peau de mouton qui rembourrait ses bottes et chantait à demi-voix cet air qui n’eut jamais rien de factieux :
Il pleut, il pleut bergère, Ramenez vos moutons…
Mais tout en fredonnant, il songeait, et sa rêverie ne ressemblait point à sa chanson.
— Le colonel, pensait-il, m’a tracé mon chemin pouce par pouce et je fais comme à l’ordinaire le métier de marionnette. Voilà longtemps que ça dure. Au commencement je m’amusais à deviner ses manigances qui sont cousues de fil blanc, mais j’en ai trop deviné et le bonhomme m’ennuie. Il serait temps à la fin que le vieux fît un peu de place aux jeunes, d’autant que les jeunes comme moi commencent à mûrir. Qu’est-ce que c’est que tout cet argent qui reste là-bas enterré dans un trou, au fond de la Corse ? et pourquoi continuer les affaires quand on pourrait rouler carrosse ? c’est joli les combinaisons du bonhomme ; ça a trois, six, neuf compartiments comme les baux de mon propriétaire, mais la liquidation ne vient pas et tant va la cruche à l’eau…
Il s’interrompit et descendit jusqu’au bord du trottoir, cherchant une place propice pour traverser la chaussée. Un sergent de ville qui marchait derrière lui dit tout bas :
— Bonsoir, M. Lecoq.
L’Amitié regarda tout autour de lui avant de répondre :
— Bonsoir, bonhomme.
— On dit là-bas, à la préfecture, reprit le sergent, que vous chauffez une histoire pour cette nuit.
— Fais ton ouvrage, répliqua brusquement l’Amitié, qui se lança sur le pavé boueux.
— Ma parole, grommelait-il, il n’y a pas bavards comme ces hirondelles ! On risque à chaque pas de se compromettre avec eux. Le Père est bien tranquillement à faire son whist pendant qu’on s’éreinte. Il a juré ses grands dieux que l’affaire de M. Remy d’Arx, le juge d’instruction, serait sa dernière affaire, mais voilà dix ans qu’il radote cela. Moi, je patiente et j’obéis ; mais du diable si je comprends, cette fois, la mécanique du vieux, avec ses diamants et tout l’embrouillamini qu’il a imaginé à l’entour. Quand je l’ai interrogé, il m’a répondu comme moi au sergent de ville : Fais ton ouvrage.
Il s’arrêta de l’autre côté du boulevard, et conclut :
— On fera l’ouvrage, papa, mais tout a une fin, et une fois l’ouvrage faite, je connais quelqu’un qui vous demandera son compte un peu bien !
Le bruit et le mouvement qui donnaient autrefois un aspect si particulier au vieux boulevard du Temple ne s’étendaient pas très loin. Chacun peut se souvenir que le Château-d’ Eau d’un côté, les environs de la Galiotte de l’autre, étaient relativement des lieux déserts.
On appelait la Galiotte la dernière maison formant angle entre la rue des Fossés-du-Temple et le boulevard, parce que l’entreprise des bateau-poste du canal de l’Ourcq tenait là ses bureaux. Derrière la Galiotte et très près de l’endroit où la façade du Cirque éclaire maintenant ce quartier jadis si misérable, s’ouvrait, au milieu de maisons décrépites et de masures à physionomies campagnardes, une ruelle étroite qui s’en allait rejoindre, après un long et tortueux parcours, la rue du Faubourg-Saint-Martin à la hauteur de la mairie actuelle.
Cette ruelle n’avait point de nom officiel, sinon au point où elle coupait le faubourg du Temple, derrière les chantiers de Malte. Là un écriteau l’intitulait rue du Haut-Moulin ; mais partout ailleurs on l’appelait familièrement le Chemin-des-Amoureux.
La première maison du Chemin-des-Amoureux, en entrant par la rue des Fossés, était un café borgne qui portait pour enseigne ce hardi calembour : Estaminet de L’Épi-Scié. Cet établissement, entouré d’une détestable renommée et dans lequel la police faisait de fréquentes razzias, avait sa façade tournée vers le boulevard, à cause d’un coude brusque de la ruelle.
Du lieu où M. l’Amitié s’était arrêté, il pouvait voir à travers les rideaux rouges de deux fenêtres les lueurs de la salle de billard. On y jouait la poule, selon la promesse d’un petit écriteau, fabriqué à la main et placé sous la lanterne rouge qui disait aux passants du boulevard les prix du gloria et de la demi-tasse : 10 et 20 centimes.
Le billard, large comme une prairie, haut sur jambes et recouvert d’un tapis abondamment graisseux, était placé au milieu d’une salle assez spacieuse, mais basse d’étage. Tout à l’entour, des tables de bois, soutenues par deux pieds seulement, s’appuyaient de l’autre côté sur une tringle appliquée contre le mur.
Vis-à-vis de la porte d’entrée il y avait un comptoir de marchand de vins, où trônait une grosse mère à la figure violette dont le bonnet, garni de vieux rubans rouges, laissait échapper des mèches de cheveux gris pommelé. Son nom était Mme Lampion ; elle avait ruiné des porteurs d’eau dans sa jeunesse.
La poule, bien nourrie, comptait une douzaine de joueurs dont les costumes étaient sensiblement disparates. Quelques-uns portaient des blouses, d’autres des paletots plus ou moins déguenillés ; d’autres, enfin, des habits de bon drap, presque propres et assez cossus.
La toilette semblait d’ailleurs être ici un élément de considération assez médiocre ; il y avait des haillons qui parlaient haut et qui obtenaient le sourire des dames, tandis que certaine redingote tolérable gardait la timidité du simple soldat, admis à la table des fourriers. Le lion, car il y a partout un favori qui fait la mode, était un jeune gars de vingt à vingt-cinq ans, avec une toute petite casquette posée de travers sur une forêt de cheveux blonds frisés.
Il jouait en bras de chemise. Il avait des bottes et son pantalon froncé sur les hanches le serrait à la ceinture comme une robe de femme.
C’était lui qui « bloquait » le plus de billes et qui plaçait le plus de « mots. » Son succès était complet ; tous les hommes l’admiraient, toutes les dames le caressaient du regard. Cocotte, c’était le nom qu’on lui donnait, acceptait ces hommages comme une chose due et gagnait gaiement les sous de ses partners en guenilles.
Deux personnes seulement, dans toute l’assemblée, paraissaient ne point s’occuper de lui. C’était d’abord Mme Lampion, qui, selon l’habitude, sommeillait majestueusement derrière son comptoir, et c’était ensuite un homme de taille herculéenne, dont la figure hâve et malheureuse se cachait à demi sous ses cheveux en désordre. Cet homme occupait la table la plus éloignée du centre, à droite de la porte, et un large vide existait autour de lui, à droite comme à gauche. Il s’était fait servir un petit verre qui restait intact. Depuis son entrée, il demeurait immobile, la tête enfoncée entre ses deux robustes mains.
Les regards que les joueurs et la galerie jetaient à ce personnage étaient rares ; ils exprimaient à la fois de la répugnance et de la crainte. Cocotte seul lui avait dit lors de son entrée :
— Bonjour, marchef ; comment va ?
Encore avait-il ajouté à voix basse :
— Il y a du tabac, puisque voici le Coyatier ! Quand cet oiseau-là sort de son trou, méfiance ! Je parie que nous allons avoir du nouveau cette nuit.
Aussi quand la porte s’ouvrit pour donner passage à la judaïque figure de M. l’Amitié, il y eut un effet produit, comme on dit au théâtre.
Les conversations se turent autour des tables, les billes s’arrêtèrent sur le billard, et, de groupe en groupe, on aurait pu entendre ce nom prononcé à voix basse : Toulonnais-l’Amitié.
— Qu’est-ce que je vous avais dit ? ajouta le jeune M. Cocotte en clignant de l’œil à la ronde. Tabac !
Le nouveau venu referma la porte et dit d’une bonne grosse voix toute ronde que nous n’aurions point reconnue, car il parlait sur un autre ton dans l’échoppe du père Kœnig :
— Bonsoir, les petits vieux, ça va-t-il comme vous voulez ? Je passais ici en me promenant, j’ai eu l’idée d’entrer pour savoir un peu ce que vous pensez du cours de la Bourse et des affaires politiques.
Il y eut un éclat de rire un peu contraint, et quelques dames allèrent jusqu’à dire :
— Est-il farceur, ce M. l’Amitié !
L’homme à la taille d’athlète qui était tout seul dans son coin n’avait pas bougé, et Mme Lampion dormait toujours.
L’Amitié, en changeant de voix, avait changé aussi de tournure et de visage. Son allure était brusque, son regard hardi et franc.
— Vous apportez de l’ouvrage, patron ? demanda Cocotte d’un air soumis et presque caressant.
— Savoir, bijou, savoir… Je ne vois pas ton ami Piquepuce, hé ?
— Il n’est pas venu ce soir.
— Il viendra… nous avons à causer… Holà ! amour, ajouta-t-il en secouant l’épaule massive de la limonadière, qui ouvrit en sursaut ses yeux frangés d’écarlate, je paye une tournée de vin chaud à tout ce joli monde-là pour boire à la santé du roi de Prusse et de son auguste famille.
On rit encore, mais au milieu du rire une voix lugubre se fit entendre.
C’était l’homme au bout de la salle qui avait relevé la tête et qui disait :
— Monsieur Lecoq, moi je ne suis pas ici pour m’amuser. On m’a ordonné de venir, et je suis venu. Dites-moi tout de suite ce qu’on veut de moi.
— Je n’en sais rien, répondit sèchement l’Amitié ; chacun son tour, tu auras le tien. Bois un verre de vin chaud, marchef, si tu veux, et prends patience. Ce soir, il y en a d’autres que toi qui ne sont pas ici pour s’amuser.
L’athlète reprit son immobilité chagrine et repoussa un verre plein que le garçon lui tendait.
— Amour, reprit l’Amitié, qui revint vers la grosse dame de comptoir, fais allumer le confessionnal.
Et il ajouta en s’adressant à Cocotte.
— Allons, petit, monte.
— C’est que, objecta le plus élégant des joueurs de poule, ma bille vaut 1 fr. 75.
— Je t’en donne 2 francs, repartit l’Amitié, et je l’offre à ce bon Coyatier.
— Nous ne jouons pas avec le marchef ! dirent les autres d’une seule voix.
Celui-ci ne répondit point, mais ses yeux s’ouvrirent tout grands et se fixèrent tour à tour sur chacun de ceux qui avaient parlé. Il n’y en eut pas un seul pour soutenir ce regard à la fois triste et terrible.
L’Amitié ricanait.
— Quand mons Piquepuce va revenir, ajouta-t-il en se dirigeant vers un petit escalier en colimaçon, situé derrière le comptoir, il faudra l’envoyer à confesse.
Cocotte le suivit. Dès qu’ils furent éloignés, au lieu de continuer la partie, joueurs et buveurs se massèrent en un seul groupe où l’on se mit à parler tout bas. Le résumé de l’entretien aurait pu se traduire ainsi :
— Cocotte, Piquepuce et le marchef ! c’est une mécanique à grand spectacle !
L’endroit que ce bon M. l’Amitié appelait son confessionnal était tout bonnement un cabinet particulier, situé au premier étage. L’unique fenêtre de ce réduit, destiné à fêter l’amour en guenilles et Bacchus frelaté, donnait en face de la ruelle et avait vue sur le boulevard. Une double porte toute neuve et bien rembourrée faisait contraste avec l’indigence malpropre de l’ameublement. Ce luxe était dû à Toulonnais-l’Amitié, qui avait fait de ce lieu une succursale de ses divers cabinets d’affaires.
Car c’était un homme considérablement occupé.
Au moment où Cocotte passait le seuil, une voix cria du bas de l’escalier :
— Ne fermez pas, j’arrive à l’ordre !
L’instant d’après, Toulonnais était assis sur le vieux divan entre ses deux acolytes.
Mons Piquepuce avait une dizaine d’années de plus que le joli Cocotte, dont il était l’inséparable : Virgile, avant nous, avait mis cette différence d’âges entre Nisus et Euryale. L’apparence de mons Piquepuce était celle d’un rat de chicane prétentieux et romantique ; il portait de longs cheveux cachant le col d’un habit pelé.
— Cause, lui dit l’Amitié, le petit n’est pas de trop ; il est bon qu’il sache un bout de l’histoire.
— Eh bien ! commença Piquepuce d’un air important, notre jeune homme est à Paris.
— Parbleu ! fit Toulonnais, qui haussa les épaules. Si tu veux, je vas te donner son adresse.
— Si vous en savez plus long que moi… voulut dire Piquepuce.
— Cela se pourrait bien, bonhomme, interrompit l’Amitié, mais tu es là pour répondre et non point pour te fâcher. As-tu vu la dompteuse ?
— Je la quitte. Elle a sa baraque place Walhubert, devant le Jardin des Plantes, et doit emballer après-demain pour la fête des Loges.
— Se souvient-elle de Fleurette ?
— Je le crois bien ! quand ce ne serait que par jalousie !
— Ah ! ah ! fit l’Amitié avec une certaine vivacité, voyons ça… Ce vieux Père a décidément de la corde de pendu plein ses poches !
— J’ai donc payé le petit noir à la dompteuse, reprit Piquepuce, au café de la gare d’Orléans. C’est encore une femme agréable, quoiqu’un peu puissante. Il paraît qu’elle en tenait dans l’aile pour ce jeune Maurice et que ça lui est même resté malgré la suite des temps. Vous savez, les dompteuses d’animaux féroces, c’est presque toujours des femmes romanesques ; il n’y a pas plus langoureuse que Mme Samayoux, quoiqu’elle ait mis jadis son mari à l’hôpital d’un coup de boulet ramé, en jouant et sans malice, dont il est mort au bout de cinq semaines de souffrances ! Elle fait des vers comme père et mère, sauf l’orthographe, et pince la guitare à l’espagnole…
L’Amitié frappa du pied.
— Il ne s’agit pas de Mme Samayoux, dit-il, mais de Maurice et de Fleurette.
— J’allais y arriver. Quand on vint chercher la petite à la baraque de la part de ses parents, pour la faire comtesse ou autre, et Mme Samayoux dit que c’est encore là une drôle d’histoire, car l’enfant n’avait ni marque, ni signe, ni croix de sa mère, à l’aide desquels il est facile d’effectuer une reconnaissance dans les règles : quand donc on vint la réclamer, le jeune Maurice faillit devenir fou. Vous savez ou vous ne savez pas qu’il était fils de parents comme il faut et qu’il s’était engagé chez la Samayoux pour le trapèze, la boule et la perche à cause de Fleurette, qu’il idolâtrait.
La petite était en ce temps-là somnambule lucide et manigançait la seconde vue. Ça a dû être un drôle de rêve tout de même quand elle a vu le carrosse qui venait la chercher pour la mener dans un hôtel des Champs-Élysées, où elle a présentement des robes de soie et des cachemires… Ne vous impatientez pas… Le jeune Maurice fit donc un coup de sa tête ; malgré que Mme Samayoux lui proposait de l’épouser en lui laissant par contrat sa baraque, ses outils et ses bêtes, il s’engagea soldat et partit pour l’Afrique. Qui est-ce qui pleura ? ce fut la dompteuse. Elle se serait même périe par le charbon sans un musicien de son orchestre qui lui adoucit momentanément sa douleur.
— Pour une chose racontée agréablement, murmura Cocotte, ça y est !
— Et la fillette ? demanda l’Amitié, non sans donner de nouveaux signes d’impatience.
— J’allais y venir. Mme Samayoux fut cinq ou six mois sans entendre parler de la fillette ; elle ne savait pas même où elle était, car on lui avait compté une gentille somme pour avoir Mlle Fleurette, mais une fois partie, ni vu ni connu, tout s’était fait dans le plus grand mystère.
Un beau matin, à la foire de Saint-Cloud, Mme Samayoux, après avoir pris sa chopine de blanc, allait porter le déjeuner à ses bêtes, lorsqu’elle vit entrer dans la baraque une brassée de taffetas, de jais, de fleurs et de dentelles : c’était Fleurette qui se jeta à son cou en lui disant : « Où est-il ? j’en mourrai si vous ne voulez pas m’apprendre où il est ! »
— Je vous dis qu’il en a ! s’écria l’Amitié, qui claqua ses mains l’une contre l’autre, il en a tout un rouleau !
Piquepuce, interloqué, le regarda avec étonnement, mais Cocotte expliqua :
— Le patron entend de la corde de pendu… va toujours.
— Ça lui importe donc, au vieux dont vous avez fait mention, poursuivit Piquepuce, que Mlle Fleurette et le jeune M. Maurice s’entr’adorent ? Alors tout va pour lui comme sur des roulettes, car la petite demoiselle est revenue plus de dix fois, au risque de se compromettre et rien que pour parler de lui. Il n’y a pas comme les dompteuses pour avoir de la sensibilité ; ça fendait l’âme de maman Samayoux de voir l’inclination mutuelle des deux jeunes gens, mais elle s’intéressait à leurs amours comme si c’était une pièce de la Gaîté, et elle a même fait là-dessus une romance qu’elle voulait me chanter à toute force.
C’est elle qui a écrit au jeune homme en Afrique en lui disant : « Revenez, on vous attend, » mais sans lui révéler les mystères de l’aventure, parce que Mlle Fleurette dit qu’il y a de grands dangers autour d’elle… et vous devez bien savoir si elle a tort ou raison, patron. Par quoi, il n’est pas toujours si facile de revenir d’Afrique que d’y aller ; mais le jeune homme a fini par trouver la clef des champs, et Mme Samayoux était tantôt dans tous ses états, car c’est aujourd’hui même que M. Maurice doit venir la trouver pour savoir enfin ce que parler veut dire.
Mons Piquepuce se tut et l’Amitié resta un instant pensif.
— Voilà ! murmura-t-il ; j’essaye des carambolages absurdes et les trois billes du bonhomme reviennent toujours dans le petit coin !
— À ton tour, Cocotte, ajouta-t-il brusquement, mons Piquepuce a fini et il peut aller voir en bas si nous y sommes.
Ce dernier obéit aussitôt, et dès que la double porte fut refermée, l’Amitié reprit :
— À nous deux, petit, ce n’est pas toi qui vas parler, c’est moi, et tâche d’écouter comme il faut. Ta besogne n’est pas difficile, puisque tu as été dans la partie, mais il faut que la chose soit faite avec soin : c’est pour payer la loi. Rue de l’Oratoire-du-Roule no 6, tout auprès des Champs-Élysées, il y a un garni…
— Je vois ça, interrompit Cocotte, deux corps de logis. J’ai connu une dame qui demeurait sur le derrière ; on montait une cour en pente pour arriver chez elle et sa fenêtre était à cinq pieds du carreau parce que Mme la marquise d’Ornans ne voulait pas qu’on regardât dans son jardin.
— C’est parfait, petit ; tant mieux si tu connais les êtres. Il s’agit justement du second corps de logis où demeurait la dame ; il y a là deux chambres au second qui se touchent.
— Les numéros 17 et 18, dit encore Cocotte.
— Précisément. Tu vas prendre avec toi ta trousse, et tu ouvriras la porte du numéro 17.
— Minute ! objecta le jeune bandit, le concierge m’a vu vingt fois.
— Tu arrangeras ta tête, ça te regarde.
— Mais s’il y avait quelqu’un dans la chambre numéro 17 ?
— Il n’y aura personne. Quand un amoureux revient d’Afrique et trouve quelqu’un à qui parler de sa belle…
— Est-ce que ce serait ?… commença Cocotte.
— La paix ! fit M. l’Amitié d’un ton péremptoire, et note sur ton calepin le nom que je vais te dire : M. Chopin. C’est un pauvre diable de musicastre qui court le cachet. Si le concierge te laisse passer tu ne diras rien ; s’il s’arrête, tu lui jetteras ce nom de Chopin : il a une classe le soir. Est-ce fait ?
— C’est fait.
— À la bonne heure ! Te voilà donc entré au numéro 17…
— En crochetant la porte ?
— Oui, mais à l’œuf ! et sans laisser de traces. Au milieu de la cloison de gauche, en entrant et tout auprès du lit, il y a une porte condamnée qui communique avec la chambre numéro 18. Nous te payons cher, petit, parce que tu es un des plus habiles serruriers de Paris ; il faut que tu nous fasses ici quelque chose de soigné. Tu dévisseras d’abord les deux verrous, puis tu briseras la serrure.
— Sans laisser de trace encore ?
— Du tout ! au contraire ! Tu joues désormais le rôle d’un voleur novice ; tout doit être fait grossièrement et les preuves d’effraction doivent sauter aux yeux. Seulement, et voilà où tu montreras ton talent, les choses doivent rester en place et paraître en bon état jusqu’à ce que quelqu’un touche la porte condamnée, s’y appuie, la pousse… Tu m’entends ?
— Oui, répondit Cocotte qui souriait, je vous entends… et après ?
— Après, tu laisses un « monseigneur » sous une chaise, une pince dans la ruelle du lit ; tu refermes proprement la porte d’entrée et tu files en te disant : Voilà une soirée qui m’a apporté un billet de cinq cents francs… Roule ta bosse et fait monter le Marchef.
Quand Coyatier entra, M. l’Amitié était debout. Il devint un peu pâle, en voyant l’athlète refermer successivement les deux portes, et, certes, il y avait de quoi.
Mme Samayoux n’avait point dans sa ménagerie de bête féroce comparable à celle-là.
C’était un homme grand et gros dont les membres massifs semblaient posséder une puissance extraordinaire ; sa tête, écrasée, s’enfonçait entre deux épaules d’une largeur énorme.
Il était laid, il était triste ; il faisait peur.
Pourtant, à le bien regarder, il n’avait point ce qu’on appelle l’air méchant, et le brutal ensemble de ses traits dégageait je ne sais quelle expression de douleur résignée. Il avait été soldat, bon soldat, et même sous-officier, comme son sobriquet de Marchef l’indiquait. Il ne racontait son histoire à personne, mais on disait qu’il avait été trompé par une femme, et qu’il l’avait tuée dans un transport d’amour jaloux. Il s’était enfui après ce meurtre, et on avait trouvé son rival couché sur une grande route avec la tête broyée.
Quand il eut refermé les portes, il resta immobile auprès du seuil.
— Bonhomme, lui dit l’Amitié en essayant de prendre un ton léger, nous avons de la besogne : il va faire jour cette nuit.
Coyatier ne répondit point.
— Tu n’es pas plus bavard qu’à l’ordinaire, reprit l’Amitié, dont l’accent se raffermit, mais tu es un garçon de bon sens et tu sais bien que nous t’avons mis une corde au cou une fois pour toutes. Tant que nous serons contents de toi, la justice aura beau faire et beau dire, tu n’a rien à craindre ; mais le jour où tu désobéiras…
— J’attends ! interrompit le marchef avec rudesse.
— À la bonne heure, nous sommes d’accord. C’est rue de l’Oratoire-du-Roule, no 6.
— Écrivez l’adresse sur un bout de papier, dit le Marchef, je vas perdant la mémoire.
L’Amitié fit ce qu’on lui demandait et poursuivit :
— Tu pars tout de suite, car la route est longue ; en entrant là-bas, tu diras au concierge : M. Chopin, pour la classe du soir.
— Écrivez cela, dit encore le marchef.
— Soit ! Tu traverseras la cour ; M. Chopin demeure au troisième étage sur le derrière. Tu monteras au quatrième, où sont les greniers, et tu te cacheras dans le bûcher, à droite de l’escalier.
— À droite de l’escalier, répéta le Marchef, c’est bien.
— Là, tu attendras pas mal de temps, car la classe de M. Chopin finit à dix heures et il faut arriver avant la sortie de ses élèves ; d’un autre côté, la besogne n’est que pour deux heures du matin.
— Deux heures du matin, répéta encore Coyatier, bon !
— Il y a une horloge à l’hôtel d’Ornans, tu l’entendras comme si elle sonnait dans ton bûcher. À deux heures juste, tu descendras deux étages et tu frapperas doucement à la porte, qui est à gauche, sur le carré du second.
— Au second, dit le marchef, porte à gauche, ça y est.
— On te demandera : Qui est là ? tu répondras : Le bijoutier.
— Ah ! fit Coyatier, le bijoutier… bon !
— On t’ouvrira, et tu te trouveras en face d’un homme armé.
— Armé… bien !
— Pour entrer en matière, tu l’assommeras d’un coup de poing, car si tu montrais ton couteau il te brûlerait la cervelle.
Coyatier fit un signe d’assentiment.
— Ensuite, poursuivit l’Amitié, tu l’achèveras comme tu voudras.
— Bien ; et que faudra-t-il prendre ?
— Rien, sinon une canne à pomme d’ivoire que tu trouveras quelque part dans la chambre. Cherche vite, car il y aura quelqu’un dans la pièce voisine.
— Bien ! et quand j’aurai la canne à pomme d’ivoire ?
— Tu t’en iras.
— Par la porte ?
— Non, il y a une fenêtre qui donne sur le jardin de l’hôtel d’Ornans, et le mur est couvert d’un treillage du haut en bas ; tu pourras descendre comme par une échelle. Une fois dans le jardin, tu prendras la première charmille à droite, au bout de laquelle est une porte qui te mettra dans les terrains de Beaujon.
— Il faudra la forcer ?
— Voici de quoi l’ouvrir.
Sans s’approcher du Marchef, l’Amitié lui jeta une clef enveloppée dans un billet de banque. L’athlète attrapa le tout à la volée.
Il déplia le papier, regarda le chiffre du billet de banque et dit :
— Qu’y aura-t-il une fois la chose faite, M. Lecoq ?
— Le double, répondit l’Amitié.
Le Marchef tourna le dos, rouvrit les deux portes et se retira sans ajouter une parole. L’Amitié respira fortement.
— J’ai toujours l’idée, murmura-t-il, que ce sanglier-là, quelque jour, me plantera son boutoir dans le ventre, mais à part cet inconvénient-là, quel meuble ! On le ferait faire sur commande que jamais on n’en obtiendrait un pareil !
Il redescendit l’escalier en colimaçon et traversa de nouveau la salle basse de l’estaminet de l’Épi-Scié, où la poule était en pleine activité.
— Bonsoir, amour, dit-il à la grosse limonadière, qu’est-ce que nous offririons bien à tous ces braves enfants-là ? Une goutte de punch ? Allons ! va pour un punch, puisque le vin chaud est bu.
Il déposa un double louis sur le comptoir et s’éloigna au milieu d’une acclamation générale. À quelques pas de là, au coin de La Galiotte, le coupé aux stores baissés l’attendait fidèlement. Il y monta en disant au cocher :
— Hôtel d’Ornans, Giovan, et brûlons le pavé !
Quand le coupé, après avoir traversé tout Paris au trot allongé de son cheval, eut franchi la porte cochère élégante de l’hôtel, situé aux Champs-Élysées, à droite de la rue de l’Oratoire-du-Roule, ce ne fut point le juif à la houppelande sordide et aux vieilles bottes fourrées qui en sortit.
L’homme qui sauta sur le perron, propre et rasé de frais, était chaussé de bottes vernies et portait un habit noir tout chamarré de décorations étrangères. Il passa dans l’antichambre, la mine haute, en habitué de la maison, et fut annoncé ainsi à la porte du salon :
— M. le baron de la Perrière !
Le cocher ne parut nullement surpris du miracle qui s’était accompli dans sa voiture et alla prendre place parmi les équipages rangés en ligne le long des trottoirs de la grande allée de l’Étoile.
3.
Chapitre aux portraits.
C’est un pays original et qui ne ressemble nullement aux autres quartiers de Paris.
D’abord les rues ne s’y appellent point comme ailleurs : Louis-le-Grand, Bonaparte, aux Ours, de la Chopinette, Chilpéric ou Oberkampf ; on a eu la bizarre idée de leur donner des noms de poètes, quoique ce soit très loin de l’Odéon ; il y a la rue Balzac, la rue Chateaubriand, la rue Lord-Byron.
C’est un drôle de coin où l’alignement désormais nécessaire au bonheur des peuples et de M. le préfet de la Seine n’a pu encore pénétrer ; on y monte, et y descend, on y tourne, comme si la baguette d’une fée avait mis cette petite montagne à l’abri des aplatissements universels.
Paris passe à droite et à gauche par le boulevard Haussmann et par la grande avenue des Champs-Élysées, mais on dirait qu’il n’entre pas là. On y respire la paisible odeur des capitales étrangères. Tout le monde y est anglais, russe ou ottoman ; les hommes qu’on y voit sont grooms, les femmes school mistresses ; on n’y vend rien en effet, sinon des chevaux de sang noble et la pâle éducation des boarding houses.
En 1838, on trouvait là de grands terrains vagues ayant appartenu à la Folie-Beaujon ; il n’était pas encore question de l’avenue Friedland. À part quelques pensions cosmopolites, une célèbre maison d’accouchement et trois ou quatre hôtels perdus dans de magnifiques jardins, il n’y avait de constructions importantes que sur les anciennes voies de communication, telles que la rue de l’Oratoire et la grande avenue des Champs-Élysées.
La principale de ces maisons était, sans contredit, l’hôtel habité par Mme la marquise d’Ornans, veuve d’un ancien pair de France et sœur d’un ministre de la Restauration.
C’était une charmante maison de style italien, dont le principal corps de logis avait été bâti, dit-on, par le célèbre financier qui a laissé son nom à tout le quartier. Elle était beaucoup plus grande que le petit temple grec où mourut Delphine de Girardin, de l’autre côté de l’avenue, mais l’œil allait involontairement de l’une à l’autre, attiré par une vague ressemblance de style.
La blanche colonnade, élevée au-dessus d’un perron circulaire d’aspect monumental, était tout ce qu’on apercevait de l’hôtel d’Ornans. Des bosquets touffus, aidant l’inégalité des terrains, cachaient entièrement le surplus des constructions, qui étaient considérables. Il y avait par-derrière un jardin qui eût presque mérité le nom de parc ; une passerelle entourée de lianes franchissant le chemin qui porte maintenant le nom de Balzac et prolongeait le gracieux domaine de la marquise à travers des pelouses veloutées, de grands massifs sombres et des corbeilles de fleurs jusqu’au mur du Bel-Respiro.
On démolit l’hôtel vers la fin du règne de Louis-Philippe, et ses dépendances furent morcelées.
Mme la marquise d’Ornans, née Julie de la Mothe-d’Andaye, avait déjà franchi, à l’époque où se passe notre histoire, les dernières limites de la jeunesse ; elle se coiffait en cheveux gris et ne détestait point qu’on lui donnât le titre de femme politique.
Elle avait aussi quelques prétentions au bel esprit.
Sa politique, du reste, était plutôt une religion, et rarement son chapeau sortait de l’étui dévot où elle le gardait au fond de son armoire.
Elle croyait à Louis XVII.
C’est un fait assez remarquable que l’allure uniformément paisible des divers personnages, imposteurs ou non, qui jouèrent le rôle de Louis XVI. On en vit beaucoup dans la première moitié de ce siècle : quelques collectionneurs soigneux en ont compté, je crois, jusqu’à une douzaine ; mais tous ces prétendants, ainsi que leurs partisans, avaient, depuis le premier jusqu’au dernier, des physionomies débonnaires.
Aucun d’eux, à ma connaissance, ne battit bien vivement le briquet pour allumer le flambeau de la guerre civile.
On eût dit que leur ambition se bornait à réunir autour d’eux une petite église de gens riches et crédules qui pussent les appeler tout bas « Votre Majesté, » en leur assurant bonne table, bon logis et chaude garde-robe.
Ils furent pourtant, on doit le dire, malgré leur inertie, un des dissolvants les plus efficaces de ce grand parti royaliste qui, malade dès le temps de la Restauration, gardait encore sous Louis-Philippe une considérable vitalité. Aussi la sagesse bourgeoise du gouvernement de Juillet se gardait-elle bien d’apporter la moindre entrave au commerce pacifique des prétendus héritiers du roi martyr ; le mot d’ordre était donné d’un bout à l’autre de la France ; les Louis XVII pouvaient se promener dans le faubourg Saint-Germain et en province sans être inquiétés le moins du monde.
Volontiers leur eût-on signé des feuilles de route, avec secours, pour faire pièce à l’opposition légitimiste. Tout ce qu’on exigeait d’eux, c’était de garder l’oriflamme sous leur chemise et de ne se faire sacrer qu’à huis-clos dans le salon fermé de quelque vieux manoir ou dans la salle à manger d’un presbytère.
Mme la marquise d’Ornans possédait une très belle fortune et nourrissait un Louis XVII qu’elle espérait bien un jour voir assis sur le trône de France, mais cela sans verser préalablement des flots de sang, et grâce au seul travail de la Providence qui, tôt ou tard, dessille les yeux des peuples aveugles.
Pour aider tout doucement la Providence et favoriser la restauration de son prince, Mme la marquise d’Ornans donnait en son hôtel des Champs-Élysées de fort jolies fêtes où elle recevait le meilleur monde.
Nous ne saurions trop répéter que ses salons n’avaient aucune couleur politique ; on y trouvait réunis des partisans du gouvernement et des orateurs de l’opposition, quelques écrivains, quelques membres du clergé, beaucoup de jolies femmes et bon nombre d’hommes à la mode, parmi lesquels nous devons citer un jeune magistrat de haut avenir, honoré de l’amitié du garde des sceaux et qui, certes, se fût éloigné de tout conciliabule suspect : le juge d’instruction Remy d’Arx.
Remy d’Arx, malgré ses travaux sérieux, et les avances qui l’appelaient vers le monde officiel, était un fidèle habitué de l’hôtel d’Ornans. La marquise et son cercle intime l’accueillaient avec le plus vif empressement.
Il était surtout le favori d’un homme vénérable qui trônait dans toute la force du terme, à l’hôtel d’Ornans, et qui partageait avec « le prince » les respects religieux de la marquise. C’était un vieillard de très grand âge, fort riche et de bonne maison, qui s’était fait de la bienfaisance une occupation, on pourrait presque dire une carrière. Il avait servi autrefois dans les armées des Bourbons de Naples et portait de préférence son titre militaire. On l’appelait le colonel Bozzo-Corona.
Au-dessous du prince et du colonel, un troisième personnage était admis fort avant dans la familiarité de la marquise : c’était un de ces gentilshommes dont il ne faut point fatiguer les parchemins, d’autant plus qu’il se livrait franchement à la pratique des affaires ; il avait nom de la Perrière et ne se fâchait point quand on passait sous silence son titre de baron. La marquise lui avait dès longtemps confié ses intérêts, qu’il administrait avec une minutieuse probité.
Nous ajouterons, mais c’est un grand secret, que M. de la Perrière, qui était un des hommes les plus répandus de France et de Navarre, avait mission, sans rien compromettre et en usant de la plus extrême prudence, de tâter les gens et de rassembler autour du « prince » un noyau de partisans discrets.
On n’arrivait jamais tard chez la marquise, c’était la loi de la maison, et bien que dix heures vinssent à peine de sonner, les salons commençaient à se remplir.
Au côté droit de la cheminée en marbre blanc rehaussé d’or, se tenait un groupe composé de M. de Saint-Louis, comme on appelait le « Prince », du colonel Bozzo et d’un vieux prêtre à cheveux blancs.
M. de Saint-Louis n’avaient rien en lui de précisément remarquable, sinon sa personnalité même et l’intérêt qui ne peut manquer de s’attacher à une position romanesque. Il était gras et même un peu joufflu ; son nez aquilin, mais charnu et un peu court, avait précisément cette forme qu’on est convenu d’appeler bourbonienne ; son habit bleu semblait taillé sur le patron de celui que les gravures prêtent au comte de Provence de 1810 à 1815. Il portait les cheveux ramenés en arrière et rattachés en une petite queue, qui laissait au collet une légère trace de poudre.
Ce genre de coiffure ne courait assurément plus les rues en 1838, mais vous en eussiez trouvé encore plus d’un spécimen dans les vieux hôtels du faubourg Saint-Germain.
Le prêtre était un chanoine de la cathédrale de Paris qui occupait ses vieux jours à rassembler les matériaux d’un livre intitulé : Histoire miraculeuse du dauphin, fils de Louis XVI.
Entre ces deux figures insignifiantes, la tête du colonel, énergique et fine, ressortait vivement.