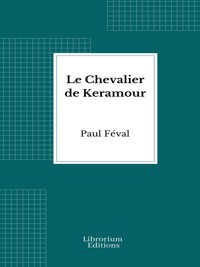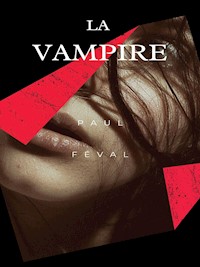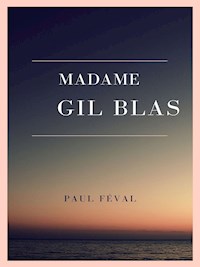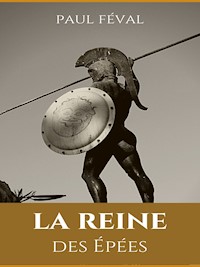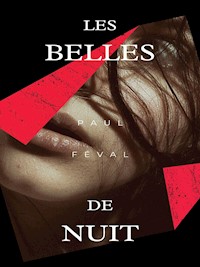Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ce roman nous conte l'histoire d'une famille pauvre, les MacDiarmid, descendante des anciens rois d'Irlande dirigée par un patriarche fier, partisan du pacifiste, Daniel O'Connell. Les huit fils se sont engagés contre l'avis de leur père dans une organisation secrète qui lutte contre la présence anglaise en Irlande par des actions violentes. On assiste à la tragédie de cette famille perdant ses membres les uns après les autres, pourchassés par les forces britanniques. Féval construit son roman sans progression chronologique, traduisant ainsi les troubles de la société irlandaise touchées de plein fouet par la grande famine et les premiers soubresaut des mouvements d'indépendance.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Quittance de minuit
La Quittance de minuitDEUXIÈME PARTIE. LA GALERIE DU GÉANTI. DEUX AMIESII. BARBE-BLEUEIII. LE SLOOPIV. LE PAIN D’AVOINEV. ANCIENNE SERVANTEVI. L’IVRESSEVII. LE CŒUR DE MORRISVIII. BEAU RÊVEIX. LA CROIX DE SAINT-PATRICKX. LA LOGE SUPÉRIEUREXI. LE CORRIBXII. VEILLÉE DE MORTXIII. LE BLESSÉXIV. LA TRÊVEXV. LE MONSTREXVI. LES ENFANTS DE GIBXVII. LE RÉVEIL DE MARY WOODXVIII. LA POURSUITEXIX. QUATRE TRICKSXX. LE DERNIER JOURXXI. EN PLEINE POITRINEXXII. LES RUINES DE DIARMIDXXIII. LA LUTTEXXIV. GRANDE TOMBEÉPILOGUE. O’CONNELLPage de copyrightLa Quittance de minuit
Paul Féval
DEUXIÈME PARTIE. LA GALERIE DU GÉANT
I. DEUX AMIES
Le boudoir de lady Georgiana, au château de Montrath, était quelque chose de charmant. Son tapissier l’avait précédée au manoir, et venait de jeter partout à profusion les merveilles toutes neuves du luxe parisien. Le tapissier de milady demeurait rue de la Paix.
La pièce était, il faut le dire, admirablement disposée et formait par elle-même un délicieux réduit. Nous ne saurions point indiquer le style précis de son architecture intérieure, parce que les architectes anglais ont la bonne habitude de poser en ce genre d’inextricables énigmes : ils mêlent volontiers toutes les époques et trouvent encore moyen d’installer, au milieu de cet éclectisme, l’indispensable confort. Il y avait dans le boudoir de lady Montrath des réminiscences gothiques étonnées de s’allier à quelques intentions Pompadour ; comme transition, la manière du siècle d’Élisabeth jetait çà et là ses revêches essais.
Mais tout cela se voyait peu. La tenture de velours avait recouvert en grande partie ces froides excentricités du génie britannique ; le jour, qui arrivait brisé, dans ce nid de soie et d’or, éclairait seulement les riches moulures des frises et les arabesques du plafond. Le reste était d’hier. Aux murailles vêtues il y avait çà et là quelques tableaux d’un grand prix : des Teniers, que le siècle de Louis XV eût quatre fois couverts d’or, une fantaisie de Hogarth, deux scènes d’Angelica Kaufmann, et de ces beaux enfants qui sortaient, naïfs et souriants, de l’inimitable pinceau de Lawrence.
Lady Georgiana Montrath était assise auprès d’un secrétaire en bois de rose, incrusté d’émail et chargé de miniatures exquises. Elle faisait bien parmi ces richesses. Elle était très jeune, très jolie, et son aristocratique beauté cadrait comme il faut avec le luxe de son entourage.
Elle avait l’air d’une enfant. Vous eussiez dit une de ces blondes misses dont les visages sourient comme des vignettes et que l’on suit au parc, emportées par le trot allongé de leurs grands attelages ; une de ces figures d’anges dont les traits s’effacent doucement, qui jettent volontiers au ciel leurs regards alanguis, et dont, le front penché a pour couronne l’or pâle d’une molle chevelure.
Ces anges vous font rêver et vous ramènent bien doucement aux créations éthérées que balance au-dessus du monde charnel le souffle caressant des poètes. Cela est frêle et suave. Leurs pieds mignons touchent-ils à la terre ? Ces corps de sylphides sont-ils nourris par les grossiers aliments de l’homme ?
Hélas ! oui. Seulement, l’homme le plus robuste aurait peine à manger ce qu’engloutissent ces anges.
Elles passent leur vie à rêver, à dévorer d’énormes tartines au jambon, et à boire un océan de thé.
Lady Montrath avait le coude appuyé sur son bureau et son front se penchait dans sa main. Les tentures bleues du boudoir donnaient une blancheur mate à son joli visage. Ses yeux, à demi fermés, glissaient entre les rideaux de sa fenêtre et couraient, distraits, au dehors.
Devant elle, sur la tablette du secrétaire, il y avait un cahier de vélin où se séchaient quelques lignes d’une écriture fine et pointue. Lady Georgiana, comme presque tous les anges pâles dont nous parlions naguère, faisait de longs petits romans fashionables, fades et interminables récits, écrits avec une goutte de la bonne encre de Bulwer, délayée dans une immense quantité d’eau gommée, – fashionables rapsodies dont les héros ont des talents de tailleur, et où les jeunes filles se prennent d’amour pour des nœuds de cravates.
Écrire est désormais, parmi les femmes de Londres, un travers endémique. On est bas-bleu, là-bas, comme on est poitrinaire, c’est le climat.
Lady Georgiana Montrath était à l’œuvre. Elle racontait, pour la centième fois, cette histoire éternelle de Lovelace, que les plumes anglaises écrivent toutes seules dès qu’on les laisse courir. – C’était délicat, mais puéril au degré suprême. L’observation s’y montrait d’une finesse microscopique, et l’importance des événements rappelait le fameux bracelet perdu et retrouvé d’Artemène.
Lady Montrath avait laissé la plume ; son regard fatigué ne dénotait point une inspiration très fougueuse ; il y avait de l’ennui sur ses jolis traits. C’était comme un acompte sur le succès de son livre.
Elle avait repoussé son fauteuil, et de temps à autre un bâillement venait entr’ouvrir ses lèvres.
Au bout de quelques minutes sa pensée quitta le domaine littéraire et revint parmi les choses de la vie. Alors sa physionomie changea ; l’ennui fit place à la tristesse. Elle se leva et gagna la fenêtre, qui donnait sur la baie de Kilkerran. Ses yeux errèrent sur la grande mer parsemée d’îles rocheuses. Çà et là quelques petites voiles blanches coupaient la ligne bleue de l’horizon. Lady Montrath était plus triste.
Elle soupira le nom de Londres avec un mélancolique regret ; puis elle ramena son regard sur le paysage voisin.
C’était le parc de Montrath, dont les hauts arbres bruissaient sous le vent du large : une nature opulente, mais sauvage, et à qui l’art avait laissé son aspect sombre. Entre les massifs touffus, la jeune femme apercevait de belles clairières, des pelouses vertes et unies comme de larges tapis de soie ; et, tout à côté, de grands rochers blancs, des ruines à demi voilées sous le feuillage ; puis, à droite, en remontant la pointe, la masse noire des tours de Diarmid.
Et tout cela était désert. Dans les clairières, sur la pelouse, le long des tortueuses lisières du bois, en haut et en bas de la montagne, régnaient la solitude et le silence.
La jeune femme promenait son regard du paysage muet au château de Diarmid, dont le squelette à jour dominait encore la contrée. Il y avait sur son visage un effroi d’enfant.
– Mon Dieu ! mon Dieu ! murmura-t-elle, ce pays me fait peur ! Depuis que je suis en Irlande, les paroles de cette odieuse femme me poursuivent sans cesse. À Londres, je me riais d’elle ; mais ici, Seigneur, qui donc viendrait mon secours ?
Son corps frêle eut un frémissement ; sa joue devint plus pâle.
– Je crois bien que milord m’aime, reprit-elle ; j’ai trouvé en lui, jusqu’à présent, un mari indulgent et affectueux. Mais cette femme ! ses mystérieuses menaces me troublent et me font peur. Je cherche un sens à ses paroles ambiguës, et toujours je crois deviner un crime !
Elle s’interrompit, tremblante ; des pas sonnaient sur le carreau du corridor qui conduisait à sa porte ; elle tressaillit, comme font les enfants au moindre bruit qui s’entend dans les ténèbres.
La porte s’ouvrit, et la charmante figure de miss Frances Roberts parut sur le seuil.
Lady Montrath poussa un cri de joie et s’élança vers elle, les bras étendus. Il n’y avait plus sur ses traits ni crainte ni tristesse. Elle embrassa Frances avec une affection de sœur, et l’entraîna jusqu’à une causeuse, où elle s’assit auprès d’elle.
Frances semblait heureuse aussi et témoignait franchement son plaisir. Cette sévérité de physionomie, que nous lui avons reprochée à Galway, n’était qu’une sorte de réaction involontaire contre la folie froide de Fenella Daws. Hors de la présence de sa tante, et auprès d’une amie, Frances recouvrait la gaieté de son âge.
Ce fut entre les deux jeunes femmes un long échange de sourires, des baisers prodigués, une lutte de chers souvenirs.
Elles étaient du même âge. Dès l’enfance, elles s’étaient choisies pour s’aimer. Georgiana n’avait point peut-être la droiture de cœur et la franchise ferme de Frances. C’était une jolie femme, faite pour le monde et rompue aux accommodements du monde. En elle ce qui était appris étouffait bien un peu ce qui était naturel. L’éducation lui avait donné une bonne dose de ces délicatesses factices qu’on met à la place de la sensibilité vraie ; mais elle avait gardé à sa compagne d’enfance une affection sincère. À Londres même, au milieu des plaisirs du West-end, elle aurait eu de la joie à revoir Frances ; – dans cette solitude qui s’ouvrait pour elle si amère et toute pleine de terreurs, elle eut à retrouver son amie un véritable transport.
Dès le matin, elle avait envoyé la voiture de milord à Galway avec une lettre pressante qui engageait miss Roberts à venir au château. Lady Montrath n’avait jamais trouvé le hasard si secourable. Elle bénissait du fond du cœur Josuah Daws ; elle lui savait gré d’être sous-intendant de police, et d’avoir été envoyé en mission dans le Connaught.
Frances, si ferme, si courageuse, si bonne, allait être pour elle une providence.
Il y avait un an à peu près qu’elles ne s’étaient rencontrées. Depuis leur sortie de pension elles suivaient des routes qui ne se croisaient point. Georgiana, fille d’un comte, avait été emportée tout d’abord par le tourbillon fashionable ; elle était riche et bien jolie ; son existence fut une suite non interrompue de triomphes.
Frances, au contraire, après avoir passé les années de sa première jeunesse dans une pension brillante, où le titre et la position personnelle de son père lui avaient donné accès, était rentrée tout à coup dans le monde bourgeois. Son père mort, il ne restait rien, dans sa famille, qui pût la rapprocher de cette vie noble à laquelle son éducation l’avait préparée.
Frances eut pour mentor Fenella Daws, pour compagnes les amies de Fenella Daws, pour soupirants les incroyables de Poultry, les fanfarons du commerce, les dandies d’arrière magasin. Personne à qui parler ! pas une seule cervelle parmi tant de têtes !
Dans le monde elle eût peut-être trouvé des déceptions, car son esprit sincère et clairvoyant ne se fût point arrêté aux surfaces ; mais son intelligence eût été satisfaite, sinon son cœur. Elle eût bénéficié de tout ce qui sépare le ridicule original de la burlesque copie.
Parmi les compagnes de son enfance, elle n’avait conservé d’autre amie que Georgiana. Les premiers mois, elles s’étaient vues souvent. Plusieurs fois par semaine, Frances prenait le chemin du West-end, et plusieurs fois l’équipage de la jeune lady s’arrêtait devant la demeure modeste du sous-intendant de police, au grand et vaniteux contentement de Fenella, Daws.
On en parlait dans Poultry, dans Ludgate et jusque dans le Cornhill. Cela donnait aux actions de Fenella un cours tout à fait considérable.
Mais, la « saison » finie, Georgiana quitta Londres, où il n’est point permis de rester après l’automne ; les visites cessèrent ; Frances fut seule.
Au printemps suivant, elle revit son amie une fois, deux fois peut-être : ce fut tout, parce qu’il y avait de si beaux bals ! Et puis Georgiana était sur le point de se marier.
C’était donc après une longue absence qu’elles se retrouvaient aujourd’hui, bien contentes : Georgiana, parce qu’elle était dans un moment d’ennui mortel et de tristesse ; Frances, parce qu’elle avait bon cœur et qu’elle aimait.
– Comme vous voilà devenue plus jolie, Frances, dit Georgiana en caressant doucement les mains de la jeune fille ; ou voit bien que vous êtes heureuse !
Frances leva sur elle ses grands yeux bleus souriants.
– Et vous, milady, murmura-t-elle, n’êtes-vous pas heureuse ?
Un nuage passa sur le sourire de Georgiana. Ce fut l’affaire d’une seconde. Il lui plaisait en ce moment d’être gaie.
– Chère, répliqua-t-elle avec une petite moue, vous me trouvez donc enlaidie ?
Elles étaient là sur la causeuse tout près l’une de l’autre, et charmantes toutes deux. Leurs cheveux blonds se touchaient presque, mariant leurs nuances pareilles ; leurs yeux bleus rivalisaient de douceur ; le même rose pâle était sur leurs joues.
Pourtant elles ne se ressemblaient point. Dans la délicate fraîcheur de Frances, il y avait une force vierge et vive ; chez lady Montrath, la fatigue se montrait déjà, et la beauté pâlissait, déflorée. Il y avait en elle quelque chose d’indécis, de lassé ; on devinait une de ces natures débiles qui n’ont même pas besoin de la douleur pour être vaincues, et qui se courbent après un jour d’ennui.
Frances couvrait lady Montrath d’un regard affectueux et inquiet.
– Je vous trouve toujours bien jolie, Georgy, dit-elle ; mais vous n’avez plus vos couleurs qui me faisaient envie ; il y a un cercle bleu autour de vos yeux.
Lady Montrath poussa un gros soupir, mais elle répondit gaiement :
– La fatigue du voyage, Fanny. Je suis moins forte que vous, et quatre jours de mer, c’est une bien longue traversée… Mais parlez-moi de vous, chère, je vous en prie. Ne songez-vous donc point à vous marier ?
Frances baissa les yeux et rougit, non point de cette rougeur banale qu’une question pareille amène, invariablement au front des fillettes, mais comme si la demande de sa compagne eût fait surgir en elle une pensée pénible. Georgiana ne s’en aperçut point.
– Comment se porte mister Daws ? continua-t-elle. Et la bonne mistress Fenella, écrit-elle toujours ses Mémoires ?
Tout cela fut dit avec beaucoup d’entrain ; mais dans la dernière question il y avait un peu d’ironie.
Lady Montrath était un ravissant bas-bleu de la noblesse ; Fenella était un vilain bas-bleu de la bourgeoisie : si grande que soit la distance entre deux bas-bleus, l’un ne parle jamais de l’autre sans se moquer, et c’est justice.
Frances ne répondit point. Son regard se tourna vers le secrétaire où gisait le vélin accusateur.
Les sourcils délicats de lady Montrath se froncèrent légèrement, comme si cette comparaison muette eût trouvé le défaut de son orgueil.
– Oh ! Fanny ! murmura-t-elle d’un ton moitié rieur, moitié fâché, je n’ai point voulu offenser l’excellente mistress Daws ; mais ne regardez pas ainsi mon secrétaire, j’écris pour moi toute seule et je m’ennuie tant, chère Fanny, dans ce vilain château !
Frances parcourut des yeux les gracieuses élégances du boudoir.
– Je sais ce que vous allez dire, s’écria lady Montrath avec impatience : c’est beau, pittoresque, c’est admirable ! Mon Dieu ! chère, vous avez raison, mais c’est si triste !
Elle prit le bras de Frances et l’entraîna, vers la fenêtre. Frances laissa échapper un cri d’admiration.
– Hélas ! oui, chère, dit Georgiana, c’est superbe ! et je compte bien le mettre dans un de mes livres. Mais que j’aime mieux les avenues sablées de Regent’s-Park ! que tout cela est triste ! Voyez ces grandes tours… tout ne vous parle-t-il pas ici de mystères et de crimes ?
Frances se prit à sourire. Une sorte de fatalité l’entourait sans cesse de romans faits chair. La fière lady avait sa part du travers de la pauvre Fenella.
– Vous vous laissez emporter par votre imagination, Georgy, dit Frances, il n’y a là ni mystères ni crimes. Ce sont de belles ruines, dominant un magnifique paysage, voilà tout. Moi qui ne suis pas poète comme vous, je voudrais passer ma vie en face de ces merveilles.
– Dites-vous vrai ? s’écria Georgiana vivement.
L’expression de son visage venait de changer tout à coup. Elle releva sur Frances ses yeux, où il y avait une véritable joie mêlée à une épouvante naïve.
– Oh ! restez, restez avec moi, Fanny ! reprit-elle, venez habiter le château ! j’en serais bien heureuse ; je vous aime tant ! Et puis, ajouta-t-elle en baissant la voix, si vous saviez comme j’ai peur !
Ces dernières paroles avaient un accent de réalité, peu commun dans la bouche de lady Montrath. Ses traits disaient une souffrance vague, mais sincère. Frances la regardait, étonnée.
– Vous avez peur, Georgy ? dit-elle de quoi ? On parle, il est vrai, des Molly-Maguires ; mais vous avez ici votre mari et une armée de domestiques. Comment d’ailleurs la présence d’une pauvre fille pourrait-elle vous rassurer ?
Lady Montrath prit la main de son amie entre les siennes, qui étaient froides, et la serra convulsivement. Son visage était très pâle et des tressaillements involontaires agitaient tout son corps.
– Frances, dit-elle d’une voix étouffée, ce ne sont pas les Molly-Maguires qui me font peur. Oh ! je suis folle peut-être, mais je suis bien malheureuse.
Deux larmes roulèrent sur sa joue. Frances lui mit un baiser au front et l’attira contre son cœur. Elles s’assirent, parce que lady Montrath ne pouvait plus se soutenir.
– Je vais tout vous dire ! s’écria celle-ci en pleurant. Fanny, vous êtes ma seule amie, et vous me consolerez.
Il n’y avait plus dans le ton de lady Montrath la moindre affectation. Sa détresse pouvait avoir un motif imaginaire, mais ses larmes coulaient malgré elle, et la terreur qui l’accablait n’était point jouée.
– J’ai peur, murmura-t-elle en parlant avec peine ; oh ! j’ai peur ! Lord George a déjà eu une femme ; cette femme est morte, Fanny morte… Mon Dieu, mon Dieu ! je crois que lord George veut aussi me tuer !
II. BARBE-BLEUE
À cet étrange aveu, Frances regarda son amie comme si elle eût craint de découvrir sur son visage des symptômes de démence. Lady Montrath avait l’œil fixe et grand ouvert ; ses larmes étaient séchées sous sa paupière qui brûlait.
Depuis bien longtemps, Frances était habituée aux bizarres comédies que sa tante jouait à tout propos. Fenella Daws inventait tous les jours des scènes nouvelles, afin de se rendre intéressante ; Frances avait le drame en défiance, et ne croyait pas volontiers à ces mystérieux désespoirs dont la cause se cache, et qui portent avec eux une forte odeur de roman. Toute différence gardée, lady Montrath était suspecte de théâtrales inventions, presque autant que Fenella. Le premier mouvement de Frances fut l’incrédulité.
Mais Georgiana souffrait, il n’y avait point à s’y méprendre ; sa pâleur augmentait à chaque instant, et sa respiration affaiblie semblait prête à manquer tout à fait. Frances avait passé son bras derrière sa taille, et la soutenait doucement.
– C’est bien vrai ! murmura lady Montrath, dont la voix s’étouffait ; il me tuera, Fanny… je sais qu’il me tuera !
Frances demeurait sans parole ; l’étonnement la faisait muette.
– Vous tuer, Georgy ! dit-elle enfin, en appuyant la tête vacillante de la jeune femme contre son épaule, vous a-t-il donc menacée ?
Georgiana fit un signe négatif.
– Vous a-t-il parfois montré de l’aversion ? Avez-vous excité sa colère ?
Lady Montrath secoua la tête encore.
– Qui vous fait donc penser ?… commença Frances.
La jeune femme l’interrompit d’un geste, et parvint à se redresser sur la causeuse.
– Il faut que je vous dise tout, Fanny, murmura-t-elle ; vous ne pourriez jamais deviner… vous me croiriez folle… Laissez-moi respirer. Quand cette idée me vient, je me sens perdre courage. Mourir si jeune !
Lady Montrath joignit les mains et sa tête se renversa sur le dossier de la causeuse. Elle recueillait ses esprits troublés. Frances n’osait plus parler, et la contemplait, inquiète.
Au bout de quelques secondes, lady Montrath rouvrit ses yeux demi clos et rompit le silence.
– C’est une étrange histoire, reprit-elle, et dont j’ai pu seulement saisir çà et là quelques pages détachée. Mais cela me suffit pour comprendre, et je sais le sort qui m’attend. Écoutez-moi, Fanny, et n’allez pas me taxer de folie, car ce que je vais dire sera la cause de ma mort. Lord George était veuf depuis quelques mois à peine, lorsque je l’épousai. Personne à Londres ne connaissait sa première femme. Il ne l’avait présentée nulle part, et tant qu’avait duré son mariage, on l’avait vu menant la vie de garçon.
Lady Montrath, celle qui portait ce nom avant moi, était confinée en ce temps dans Montrath-House, la villa que milord possède au-dessous de Richmond. Le mystère qui entourait cette femme est resté entier pour le monde. Elle n’avait point d’amis, nul ne s’est préoccupé de sa disparition.
J’ai su, moi, par les gens de la maison, que c’était une fille de l’Irlande, enlevée par milord, et qu’il l’avait épousée par force.
Un homme de ce pays l’aimait d’un ardent amour. Il vint du Connaught avec ses frères et donna le choix à lord George entre une réparation immédiate ou la mort.
Lord George choisit le mariage, et j’ai vu la tombe de la pauvre Irlandaise dans le cimetière de Richmond…
Georgiana s’interrompit et mit son front dans ses deux mains.
– C’est une triste histoire, Georgy, dit Frances ; mais je n’y vois rien qui puisse faire soupçonner un crime.
– Son nom est sur le marbre, murmura Georgiana au lieu de répondre. Elle s’appelait Jessy O’Brien. Je prie Dieu bien souvent pour elle, car elle est ma sœur en souffrance, et son sort sera le mien.
– Mais qui vous fait croire ?…
– Attendez, Fanny ; vous ne savez rien encore. Entendîtes-vous parler quelquefois dans Londres d’une créature à qui son luxe audacieux a prêté récemment une sorte de célébrité ?
– Comment la nomme-t-on ? demanda Frances.
– Mistress Wood, répondit lady Montrath. Ce nom a pu être prononcé devant moi, dit la jeune fille ; mais le monde où je vis est bien en dehors de vos brillantes excentricités. Je ne me rappelle rien de ce qui concerne cette femme.
– Londres est bien grand, murmura Georgiana, mais il me semblait que ses trois millions d’habitants devaient connaître mistress Wood. Ce nom tinte sans cesse à mon oreille ; elle est partout, et je ne puis faire un pas sans que son visage redouté vienne me barrer le chemin. On parle d’elle en tous lieux ; ses grossières prodigalités occupent le high-life depuis quelques mois ; mille bruits courent sur elle les uns la disent princesse, les autres courtisane. Ce qui est sûr, c’est qu’elle possède des millions. Devinez qui est cette femme, Fanny ?
– Je ne sais.
– Cette femme est l’ancienne servante de la pauvre Irlandaise dont le tombeau est dans le cimetière de Richmond.
Frances fit un geste de surprise.
– Vous allez voir, reprit Georgiana, qui s’animait, et dont la joue pâle se colorait d’un vermillon fiévreux ; vous allez voir, Fanny, si je suis folle et si j’ai raison de compter mes jours. La première fois que je vis cette femme, ce fut le matin de mon mariage, à la chapelle, tout près de l’autel, si près, qu’elle se trouvait presque entre le ministre et moi.
Je me souviendrai longtemps de sa figure immobile et comme stupéfiée, de ses yeux lourds, qu’on eût dits chargés de sommeil, et de ce méchant sourire qui raillait autour de sa bouche. Son regard se fixait obstinément sur milord, et milord tournait les yeux d’un autre côté.
Je ne savais point en ce temps qui était cette femme, couverte d’or et de soie, dont la parure extravagante semblait une insulte au lieu saint. Ma première pensée fut que c’était une folle qui avait trompé la garde de sa famille.
Mais, à la longue, je dus remarquer le soin que mettait milord à fuir ses regards ; il évitait de tourner les yeux vers moi, parce que tout auprès de moi cette femme se dressait comme une muette menace ; son malaise, évident désormais, augmentait à mesure qu’avançait la cérémonie. Il était pâle et je voyais sa lèvre trembler.
Elle se tenait debout devant l’assistance agenouillée. Elle avait les bras croisés sur sa poitrine comme un homme, et son sourire devenait plus railleur. Involontairement et sans savoir pourquoi, je me sentais prendre d’épouvante.
Au moment où, après la bénédiction nuptiale, nous sortions de la chapelle, cette femme, qui nous avait suivis pas à pas, vint se mettre entre milord et moi.
– Elle est presque aussi jolie que l’autre, George Montrath, dit-elle en me toisant d’un œil hardi. Elle est bien riche… Là-bas, il y a place pour deux !
Je sentis lord George chanceler à mon bras.
– Mary, murmura-t-il, laissez-nous, au nom du ciel !
Elle se mit à sourire avec mépris, et tendit sa main que milord toucha.
– Voilà un beau mariage ! dit-elle. Montrath, je vous fais mon compliment.
Puis elle se pencha jusqu’à son oreille et murmura quelques mots que je n’entendis point.
– Vous les aurez demain, Mary, répondit lord George, je vous promets que vous les aurez demain.
Elle tourna le dos sans saluer, et se dirigea vers un superbe équipage qui l’attendait à quelques pas. Sa marche était inégale et mal assurée : on eût dit une femme ivre.
– C’est une pauvre folle, me dit milord, qui semblait soulagé d’un grand poids ; je lui donne quelques secours, et…
En ce moment la femme, qui montait sur le marchepied de son équipage, se retourna et lança un dernier regard à milord, qui balbutia et ne put achever. Nous montâmes en voiture.
À ma place, Fanny, qu’eussiez-vous pensé de cela ?…
Frances fut quelque temps avant de répondre : elle réfléchissait.
– C’est étrange, dit-elle enfin, étrange assurément ; cependant je ne puis voir dans cette circonstance un motif suffisant à vos craintes.
Lady Montrath se rapprocha d’elle, comme si l’instinct de sa frayeur eût cherché machinalement protection et appui.
– Mes craintes ! murmura-t-elle ; oh ! Fanny, je ne crains pas, je suis sûre ! Écoutez ! Depuis lors, j’ai revu bien des fois cette Mary Wood, et toujours elle m’a lancé en passant de mystérieuses menaces. Plus d’une fois elle m’a abordée au parc et à l’église pour me parler, en des termes vagues et qui me font frémir, de la première femme de milord. Cette pauvre fille d’Irlande, Fanny ! on l’avait vue la veille se promener dans les jardins de Montrath-house, et le lendemain on scellait le marbre de sa tombe ! Quand les gens de Montrath parlent d’elle, ils pâlissent, et de sourdes rumeurs ont couru jusque dans les salons de notre monde.
Frances écoutait, attentive ; elle faisait effort pour ne point montrer ses craintes à son amie, mais ce récit commençait à l’impressionner ; elle voyait vaguement, elle aussi, un crime dans le passé, un danger dans l’avenir.
Mais elle s’efforçait de sourire encore, et Georgiana se sentait presque rassurée à ses caressantes tendresses.
– Vous resterez avec moi, Fanny, n’est-ce pas ? dit-elle, vous ne m’abandonnerez pas ? tant que vous serez là, je me croirai protégée.
– Je resterai, chère Georgy ; vos craintes sont exagérées et je n’y vois guère de fondements, mais je resterai, puisque tel est votre désir.
La jeune femme pressa la main de Frances contre son cœur.
– Merci, dit-elle, oh ! merci ! mais n’essayez plus de combattre mes craintes, puisque vous craignez comme moi. Je devine votre bon cœur, Fanny ; vous me comprenez et vous tremblez pour moi au fond de l’âme… et que vous trembleriez davantage, si je pouvais vous dire un à un tous les détails de mes entrevues avec cette femme, les terreurs de milord quand il la voyait s’approcher de moi ! son obéissance d’esclave aux moindres ordres de cette créature, et tous les vagues bruits qui de côté et d’autre sont parvenus jusqu’à mon oreille !
Je ne savais que croire, jusqu’au moment où ma servante m’eut appris que cette mistress Wood avait été autrefois la camériste de Jessy O’Brien.
J’expliquais ainsi les incroyables prodigalités de lord George, car cette femme n’a rien, Fanny, et les millions qu’elle dépense, ce sont mes revenus et ceux de Montrath.
Mais cette révélation fut pour moi le dernier trait de lumière. Je me rappelai tout ce que m’avait dit mistress Wood, et chacune de ses paroles prit une signification redoutable.
Elle était la complice ou la confidente du crime ; elle savait tout ; elle pouvait menacer à coup sûr !
Si vous saviez comme lord George la redoute ! Pour la fuir il m’a menée en France, tout de suite après notre mariage ; nous devions passer trois mois à Paris. Le lendemain de notre arrivée, nous étions à l’Opéra ; la porte de notre loge s’ouvrit, et Mary Wood vint s’asseoir entre milord et moi.
Quelques heures après, nous étions sur la route de l’Italie. À Naples, où nous débarquâmes, la figure de cette femme arrêta nos premiers pas.
Elle sème l’or partout : l’or ne lui coûte rien. Il n’y a pour elle ni obstacles ni distances. À Rome, à Milan, à Venise, toujours cette femme ! Oh ! Fanny ! j’en étais à avoir pitié des angoisses de milord ! En Suisse, en Allemagne, toujours elle ! toujours, toujours, toujours !
Nous revînmes à Londres, et nous l’y retrouvâmes.
Que de fois j’ai été sur le point de m’enfuir chez mon père et de lui tout révéler ! mais, au moment de porter une accusation si grave, je me suis arrêtée. Que vous dirai-je, Fanny ? Depuis la première heure de notre mariage, lord George me traite avec tendresse et douceur ; tout me dit, il est vrai, que je ne me trompe point en le croyant coupable ; – mais si je me trompais…
– Pauvre Georgy murmura Frances, dont les traits exprimaient un doute douloureux.
– J’ai laissé passer les jours, reprit Georgiana, et le moment est venu où milord m’a ordonné de me préparer à ce voyage d’Irlande. Mes terreurs ont redoublé, car en ce pays perdu nul bras ne viendrait me défendre. Mais mon père n’était pas à Londres : à qui donc me confier ? Ah ! Fanny ! Fanny ! vit-on jamais un sort à la fois plus bizarre et plus terrible !
Depuis quelques instants, l’accent de lady Montrath se modifiait sensiblement. On eût dit que son émotion, vraie d’abord, s’était usée peu à peu, et qu’elle avait besoin d’efforts pour soutenir jusqu’au bout son rôle de victime. Femmes de théâtre et, femmes de plume ont ce commun défaut de poser presque malgré elles. Elles arrangent tout ; elles travaillent ce qui se fait tout seul chez le reste du genre humain, et leur effort malheureux réussit d’ordinaire à mettre une glaciale défiance à la place de l’émotion qui naissait.
Frances avait été saisie tout d’abord énergiquement. Son amitié pour lady Montrath lui avait fait voir le danger pressant. Elle restait sous cette impression, et, malgré l’expérience qu’elle avait gagnée auprès de Fenella Daws, cette autre actrice d’un ordre inférieur, la réaction ne se faisait point en elle. Elle s’efforçait de bonne foi et tâchait de sonder jusqu’au fond le mystère qui entourait son amie.
– Voici bien des aventures romanesques, dit-elle au moment où lady Montrath reprenait haleine, en levant ses yeux bleus vers le ciel. Je conçois vos inquiétudes, chère Georgy, et je les partage presque, tant la conduite de cette femme me semble inexplicable. Mais, au demeurant, tous ces mystères qui nous effraient peuvent avoir pour base les faits les plus ordinaires de la vie. Ma tendresse pour vous m’avait portée à recueillir des informations sur votre mari, et tous mes renseignements s’accordaient pour désigner lord George comme un homme d’honneur et un digne nobleman.
– Je le croyais, moi aussi, je le croyais ! murmura Georgiana.
– Cette femme, reprit Frances, dont la droite raison se révoltait vite contre tout ce qui ressemblait au roman ; cette femme qui vous poursuit à ses heures d’ivresse est peut-être une de ces malheureuses que le gin affole, et dont la démence est cruelle ?
Georgiana fit un geste d’impatience.
Il faut si peu de chose souvent, reprit encore Frances, pour expliquer ce qui effraie de loin.
Georgiana retira sa main que Frances avait tenue jusqu’alors entre les siennes.
– Vous ne voulez pas me comprendre, miss Fanny ! dit-elle en rougissant de dépit. Vous traitez mes craintes comme on fait des frayeurs insensées d’un enfant. Mon Dieu ! n’ai-je donc plus d’amie ?
Les yeux de lady Montrath se mouillèrent, et Frances se tut, repentante.
– On explique tout, reprit la jeune femme avec amertume, on se rit des terreurs d’une pauvre femme, tant que la catastrophe n’est pas arrivée. Je ne vous demande plus votre pitié, Fanny. Parlons, s’il vous plaît, de choses qui vous intéressent davantage : j’ai eu tort de vous occuper de moi si longtemps.
– Oh ! Georgy, répondit Frances avec reproche, pouvez-vous me parler ainsi ? Je désire ardemment que vos craintes soient mal fondées, et je ne puis m’empêcher de l’espérer encore. Mais il ne s’agit pas de moi, Georgy : dites-moi tout, je vous en conjure.
Lady Montrath garda pendant quelques secondes un silence boudeur, puis elle reprit la parole, parce que, au fond, ses terreurs étaient bien réelles, et qu’elle avait besoin de s’épancher.
– Je fis mes préparatifs de départ, dit-elle ; j’étais triste, et j’avais comme un pressentiment de malheur. Il y a de cela quelques jours seulement. Nous montâmes en voiture, milord et moi, pour nous rendre au paquebot de Cork, qui nous attendait sous London-Bridge. Une autre voiture croisa la nôtre au moment où nous entrions dans le Strand ; j’y reconnus la figure enflammée de mistress Wood, qui se renversait sur les coussins de son équipage.
– Où allez-vous, Montrath ? cria-t-elle en passant.
Milord ne répondit point, et le cocher fouetta les chevaux. Quand nous arrivâmes devant la douane, la voiture de mistress Wood, lancée au galop, dépassa brusquement l’équipage de milord. Elle nous avait suivis depuis le Strand.
Elle mit pied à terre et vint au-devant de nous.
– Eh bien ! Montrath, dit-elle, je suis aise d’être venue ici. Vous vouliez encore me cacher votre piste, et j’aurais été plus de huit jours en quête. L’Irlande est loin. Votre servante, milady ajouta-t-elle en s’adressant à moi ; j’ai connu des gens qu’on a menés là-bas et qui n’en sont point revenus.
Elle me fit un signe de tête, secoua brusquement la main de lord George, et regagna sa voiture en nous disant : Au revoir !
Nous montâmes sur le paquebot. J’étais brisée de terreur et mon cœur défaillait.
Je savais ce que cette créature coûtait à mon mari.
Mes revenus et les siens, formant ensemble une des maisons les plus opulentes des trois royaumes, n’ont pu suffire aux caprices insensés de cette créature, et lord George a dû faire des emprunts considérables. Je savais cela.
Jamais je n’avais osé interroger. Ce jour, enfin, mon épouvante fut plus forte que ma timidité ; je rassemblai mon courage et j’exigeai une explication…
– Eh bien ? dit Frances.
– Lord George fut longtemps avant de me répondre. Sa physionomie froide, mais bienveillante d’ordinaire, s’assombrissait à mesure qu’il réfléchissait.
– Milady, répliqua-t-il enfin, je vous ai dit déjà que cette femme est une pauvre folle ; c’est tout ce que je puis vous apprendre, et je vous prie de ne plus m’interroger à l’avenir.
Ces derniers mots furent prononcés d’un ton dur que milord n’avait jamais pris avec moi.
La traversée se fit. En arrivant en vue de Galway, nous passâmes du paquebot sur un sloop côtier, afin d’entrer sans danger dans le port, parce qu’une de nos roues avait des avaries. Les matelots du sloop firent grande fête à un homme à longs cheveux qui avait été notre compagnon de traversée. Ils lui serraient la main, tour à tour, et leurs yeux devenaient menaçants lorsqu’ils se tournaient vers lord George.
J’entendis deux matelots qui se disaient :
– Voici Mickey revenu tout seul, Jessy est morte.
– Le Saxon l’a tuée !
– Il l’a tuée pour épouser la fille d’un homme riche…
Georgiana se tut, accablée. Frances ne trouvait point de paroles pour combattre des soupçons qui étaient presque une certitude. Tout s’accordait pour confirmer les craintes de la jeune femme, et Frances elle-même essayait en vain de conserver des doutes.
Il y avait là un crime.
– Je resterai, Georgy, dit Frances ; je ne vous quitterai plus. Je ne suis qu’une pauvre fille ; mais s’il y a du danger, nous le partagerons.
– Oh ! merci, chère ! murmura lady Montrath ranimée ; je serai forte auprès de vous. Si vous saviez quelle nuit j’ai passée et comme on souffre quand on est seule ! Jusqu’au jour il y a eu de la lumière chez milord. Ces bois, qui sont déserts et silencieux maintenant, animaient leur solitude. Aux rayons de la lune j’y ai vu des formes indécises qui se glissaient entre les troncs d’arbre.
Lady Montrath se leva et se pencha en dehors de la fenêtre.
– Cette masse sombre, reprit-elle à voix basse, montrant du doigt le château de Diarmid, ce n’est point une illusion, Frances ! À l’heure de minuit, j’ai vu des lueurs rougeâtres serpenter le long des tours noires et monter jusqu’au faîte des ruines. C’était comme le reflet d’un mystérieux incendie. Oh ! j’ai pensé devenir folle ! et, si je restais seule ici, Frances, milord n’aurait pas même la peine de me tuer !
La jeune femme appuyait sa tête pâlie sur l’épaule de sa compagne, qui, plus forte, n’écoutait pas pourtant sans effroi ce récit extraordinaire. Elles demeurèrent toutes les deux silencieuses et perdues dans leurs réflexions.
Les branches du massif voisin s’agitèrent. Georgiana serra le bras de Frances. Un homme parut entre les branches, et souleva sa casquette de chasse pour adresser aux dames un gracieux salut.
– C’est lui ! murmura Georgiana ; c’est milord !
Frances ouvrit de grands yeux, et considéra cet homme sous l’impression du récit qu’elle venait d’entendre. Elle cherchait dans ses traits immobiles quelque chose de sanguinaire et de cruel. Mais c’était en vain ; la physionomie de lord George lui apparaissait épaisse et débonnaire. Ses doutes lui revinrent : lady Montrath avait pris ses frayeurs tout au fond de son imagination malade.
Il n’y avait rien, rien absolument en cet homme qui pût cadrer avec le portrait de Barbe-Bleue que Georgiana venait de tracer.
Celle-ci pourtant se repliait sur elle-même, comme un oiseau effrayé. Lord George s’avança jusqu’au-dessous de la fenêtre. Il présenta son hommage à miss Roberts et poursuivit :
– Je présume que la fatigue du voyage vous aura procuré une bonne nuit, milady ? Quant à moi, je n’ai fait qu’un somme, je vous jure.
– Il a veillé jusqu’au jour ! murmura Georgiana, de manière à n’être entendue que de Frances.
– Voici une belle matinée, reprit lord George. Ne vous plairait-il point, milady de venir visiter vos domaines ?
– Je suis à vos ordres, milord, répondit Georgiana, qui se mit à trembler.
Puis elle ajouta en s’adressant à Frances :
– Fanny, ne me quittez pas, au nom de Dieu !
III. LE SLOOP
Peu d’instants après, Georgiana, Frances et lord George étaient réunis à l’entrée du parc. Pendant les quelques minutes employées par lady Montrath à échanger sa robe de chambre contre un costume de promenade, Frances avait pu parler et combattre de son mieux les terreurs de la jeune femme. En ces circonstances, toute diversion est heureuse.
Les fantômes qu’on se fait deviennent plus effrayants dans le tête-à-tête. On veut justifier ses craintes et s’excuser d’avoir peur ; on colore, on poétise, on exagère. Si bien que la crainte grandit ; grandit, et qu’on se meurt d’épouvante, pour avoir cherché à se rassurer.
Frances elle-même avait été sérieusement émue par le récit de Georgiana. Quelques circonstances de cette étrange histoire lui avaient donné à penser ; elle avait accepté un instant le crime pour vraisemblable ; elle avait frémi aux menaces de cette femme mystérieuse, dont l’obsession poursuivait son amie. Mais cette émotion, Frances l’avait subie en dépit de sa raison, pour ainsi dire. Elle s’était révoltée plus d’une fois contre la persuasion qui se glissait en elle.
Elle se souvenait. Toute petite, Georgiana faisait déjà des romans. Elle arrangeait les choses de la vie en drames mignons, et savait saupoudrer de mystères les plus vulgaires incidents.
C’était sa vocation que d’embellir ainsi le réel. Il y avait en elle, au plus haut degré, cet élément romanesque qui est une maladie chez les Anglaises. Elle s’entourait à plaisir d’une atmosphère convenue ; elle arrangeait le monde en théâtre, disposant avec une adresse infinie ses décorations, ses trappes et ses doubles fonds. Frances savait cela.
La présence de lord George suffit à lui rouvrir les yeux.
Pourtant elle ne voulut point heurter de front ce qu’elle croyait être la fantaisie de Georgiana ; elle lui dit de bonnes paroles ; elle lui promit son aide, fidèle et la rassura doucement.
Lady Montrath avait subi elle-même l’effet de la venue de son mari. Cette diversion avait rompu brusquement sa lugubre histoire, et l’avait forcée de congédier ses terreurs, si complaisamment évoquées. En elle, ce qui était vrai faisait une confusion si étroite avec ce qui était joué, qu’elle n’eût point su dire elle-même où finissait la réalité, où commençait la comédie. Elle souffrait.
Elle avait sujet de souffrir, et ses craintes, qui avaient un fondement, s’alliaient à de fantastiques effrois que milady s’était faits à elle-même laborieusement, ingénieusement, et qu’elle ne savait plus reconnaître de ses inquiétudes véritables.
Quand elle avait grand besoin d’être calmée, une voix bienfaisante s’élevait au dedans d’elle et lui disait : « Le mal n’est pas si grand que nous voulons bien le faire ; nous avons un peu chargé tout cela. Nous ne savons point le compte de nos exagérations ; mais il y en a, nous pourrions bien jurer… »
C’était la conscience de lady Montrath qui parlait ainsi, confessant sa faiblesse. Cela lui mettait du baume dans l’âme et la rendait brave outre mesure. Pour quelques heures, elle devenait esprit fort. Elle refusait de voir l’évidence, elle qui, l’instant d’auparavant, ajoutait à l’évidence acceptée tout un supplément de fantasmagorie.
Et, comme il arrive toujours, ces revirements avaient lieu après de fortes crises. Aujourd’hui l’accès avait été violent, la réaction s’opéra vite. Avant d’avoir fini sa toilette, lady Montrath était notablement égayée.
– Chère Fanny, dit-elle, comme si elle eût voulu expliquer cette sérénité soudaine, il faut bien que je cache mes craintes. Le moyen le plus sûr de rendre le danger inévitable, ce serait de montrer de la frayeur.
Frances n’eut garde de contredire un raisonnement si sage. La vue de lord George avait éveillé en elle une pensée qui ne se rapportait point à son amie. Elle était venue à Montrath dans un but, et ce but, un instant oublié, lui revenait en mémoire.
Lord George était puissant, et Frances voulait sauver ce noble vieillard que les juges de Galway menaçaient de mort, et qui était le père de Morris Mac-Diarmid.
Lord George accueillit les deux dames avec beaucoup de grâce. Il baisa la main de Frances, il baisa la main de Georgiana, et offrit ses deux bras avec une franche bonhomie.
Il avait vraiment une bonne figure avec son costume de chasse sortant des ateliers de Holmes, sa casquette de sportsman et son beau teint britannique, allumé encore par l’air frais du matin.
Frances avait sa simple toilette de chaque jour ; Georgiana portait une robe blanche, et toutes deux étaient coiffées du chapeau de paille, inévitable parure des fronts anglais. Soit effort de volonté, soit disposition naturelle, Georgiana n’avait rien conservé de sa tristesse récente. Ses joues avaient maintenant de délicates couleurs, et sa jolie bouche retrouvait son sourire.
Frances gardait sa beauté sereine. On n’aurait point su dire laquelle des deux était la plus charmante.
On s’enfonça sous les grands ombrages du parc. Milord était affectueux ; Georgiana recevait comme il faut ses avances, et la promenade se poursuivait, égayée par un excellent accord. Frances regrettait presque ses frayeurs, et se promettait de n’être plus reprise à pareille comédie. D’après le récit de Georgiana, elle s’était fait de lord Montrath une idée si fausse que l’immobile figure du nobleman lui sembla désormais pleine de candeur. Elle prenait confiance à tel point que, au bout d’une demi-heure de promenade, elle avait gagné le courage de présenter sa requête en faveur du vieux Miles Mac-Diarmid.
À ce nom, lord George perdit le sourire qui ne l’avait point quitté depuis le château. Il jeta sur Frances un furtif regard, puis ses yeux se baissèrent.
– On le dit bien coupable, murmura-t-il.
– Il est innocent ! s’écria Frances chaleureusement.
Georgiana, qui n’était point prévenue, regardait son amie avec surprise. Lord George avait eu le temps de se remettre ; son sourire était revenu.
– Assurément, dit-il, miss Roberts est un excellent juge, mais je ne me serais point attendu à recevoir une demande pareille de la part d’une nièce de M. Josuah Daws.
Frances avait les joues couvertes de rougeur, mais son œil ne se baissait point.
– Mon oncle a les devoirs de sa charge, répondit-elle, et je crois que sa charge donne de malheureuses préventions contre tout accusé. Mais j’ai assisté à l’interrogatoire de ce vieillard, milord ; j’ai vu qu’il n’y avait point de preuves, et je viens vous supplier…
– S’il n’y a point de preuves, interrompit Montrath, on ne pourra le condamner.
Frances secoua sa blonde tête d’un air triste.
– Vous savez mieux que moi, milord, murmura-t-elle, que la justice humaine est sujette à se tromper. Mon oncle affirme que ce malheureux vieillard sera mis à mort.
Montrath garda le silence. Ils étaient assis tous les trois sur un banc de gazon, et les deux amies se trouvaient l’une auprès de l’autre. Georgiana, qui s’occupait volontiers d’elle-même, suivait avec distraction cet entretien, qui ne l’intéressait pas personnellement, et n’y prenait aucune part.
Montrath avait les yeux à terre depuis que le nom de Mac-Diarmid avait été prononcé ; il y avait de l’embarras dans son maintien ; il semblait réfléchir, et son visage exprimait de l’indécision.
– Je vous en prie, Georgy, murmura Frances à l’oreille de son amie, venez à mon aide et intercédez comme moi !
– Quel intérêt avez-vous ?… commença lady Montrath également à voix basse.
– Je vous en prie ! interrompit Frances.
Lady Montrath ne put pas hésiter davantage.
– Milord, dit-elle, si je croyais que mon intervention pût avoir quelque influence, je joindrais ma prière à celle de miss Roberts.
Montrath releva sur elle un regard souriant et libre désormais de tout embarras.
– Êtes-vous donc aussi convaincue de l’innocence de l’accusé, milady ? demanda-t-il avec gaieté.
Miss Frances est ma meilleure amie, répondit Georgiana, et ses désirs sont les miens.
Montrath porta la main de sa femme à ses lèvres et se leva.
Je suis trop heureux, dit-il galamment en se tournant vers Frances, de faire quelque chose qui soit agréable à miss Roberts. J’agirai de mon mieux en faveur de ce pauvre homme, qui m’est recommandé par de si charmantes protectrices ; je prends à cet égard un engagement formel.
– Ah ! merci, milord ! s’écria Frances, incapable de contenir l’élan de sa reconnaissance ; que Dieu vous bénisse pour l’espoir que vous me donnez !
Montrath avait sur la lèvre une question, et Georgiana partageait sa curiosité ; mais à cet égard la réserve anglaise fait grande honte à notre indiscrétion. Ils se turent tous les deux ; Montrath s’inclina courtoisement, et Georgiana se contenta d’interroger à la dérobée la physionomie de miss Roberts.
Celle-ci se recueillait en joie ; elle avait promis à Morris de sauver son vieux père, et sa tâche se montrait à elle accomplie à demi.
Les deux jeunes femmes s’étaient levées à leur tour, et Montrath les guida de nouveau à travers les bosquets du parc, poursuivant la promenade commencée. Au bout d’une centaine de pas, derrière un massif de verdure, impénétrable à l’œil, l’horizon s’élargit tout à coup devant eux, et leur montra la baie de Kilkerran avec ses innombrables îles.
Leurs regards embrassaient toute l’étendue comprise entre l’île Masson et le port de Galway. De toutes parts ils apercevaient les voiles blanches des embarcations qui sillonnaient la baie.
Parmi ces embarcations il y en avait une plus grande et plus voisine, qui semblait se diriger vers Ranach-Head, dont la pointe se cachait derrière les arbres. C’était un sloop sous toutes voiles, dont les mâts pavoisés portaient les couleurs du Rappel. Lord George fronça le sourcil et mit le binocle à l’œil.
Les insolents coquins ! murmura-t-il : je serais tenté de croire, Dieu me pardonne ! que c’est Daniel O’Connell faisant une promenade en mer.
Les deux jeunes femmes dirigèrent en même temps leurs regards curieux vers le sloop, qui poursuivait sa course rapide et se balançait doucement, poussé par la brise molle. Mais la distance était trop grande et l’on n’apercevait encore sur le pont que des formes indistinctes.
– Si vous désirez voir cela de plus près, dit Montrath, nous nous dirigerons vers le cap et nous attendrons le sloop au passage. En même temps milady, ajouta-t-il, vous pourrez admirer les ruines du vieux château de Diarmid, le plus noble joyau de vos domaines.
– Ces ruines qu’on aperçoit de ma fenêtre ? demanda Georgiana, dont la voix trembla légèrement au souvenir de ses frayeurs nocturnes.
– Précisément, répondit le lord ; c’est un antique débris de la puissance de nos prédécesseurs. Et tenez, miss Roberts, ce vieillard dont vous demandiez la grâce tout à l’heure est le descendant des premiers maîtres de Diarmid. C’était autrefois une famille bien puissante.
– Et n’a-t-elle rien conservé de sa richesse passée ? demanda Frances.
– Une ferme de sept acres sur le versant du Mamturk, répondit le lord.
Cela fut dit d’un ton simple et froid. Montrath faisait sans y penser le résumé de l’histoire des grandes familles irlandaises, Cette décadence si complète d’une race souveraine ne portait pour lui aucun enseignement ; les descendants des rois étaient de pauvres fermiers, et lui, le fils de la conquête, il possédait leurs immenses domaines.
C’était justice sans doute.
Frances se tut ; sa jolie tête pensive s’inclina sur sa poitrine. Elle resta un peu en arrière, suivant à quelques pas de distance Montrath et Georgiana, qui gravissaient, à travers bois, la pente de Ranach. Elle réfléchissait ; sa méditation n’était point hostile à lord George ; elle lui gardait au fond du cœur de la reconnaissance, et s’étonnait d’avoir pu penser un instant qu’un homme si secourable pût avoir un crime sur la conscience.
Le sentier, étroit et montueux, avait fréquemment des coudes brusques. Frances perdait à chaque instant de vue lord George et sa femme, pour qui la promenade devenait un véritable tête-à-tête. Ils causaient de bon accord. Frances se guidait au son de leurs voix amies, et c’était là pour elle une preuve de plus de la folie de Georgiana, qui certes ne pensait guère en ce moment à la scène tragique qu’elle avait déclamée.
À travers le feuillage, on apercevait déjà d’un côté les constructions modernes de Montrath ; de l’autre, la masse noire et dentelée du vieux Diarmid.
– Comme c’est sombre et grand ! dit Georgiana en ralentissant le pas pour attendre son amie.
On dépassa les derniers arbres, et Frances rejoignit ses hôtes. Les deux jeunes femmes s’arrêtèrent en extase devant les restes imposants du vieux château.
– Venez, mesdames, dit Montrath, nous admirerons tout à l’heure ces belles ruines qui me rendent aux yeux des antiquaires de Londres le plus heureux landlord de l’univers. Si nous tardons, le sloop aura doublé la pointe et nous ne verrons rien.
Il entraîna ses compagnes le long des ruines, et fit le tour de l’enceinte pour gagner l’extrême pointe du cap. En passant au pied de l’une des tours, il s’arrêta pour regarder une sorte de clôture en planches qui semblait destinée à remplacer les battants de la porte détruite.
– On dirait que le château de Diarmid a trouvé un locataire depuis mon dernier voyage ! murmura-t-il.
Il poussa du pied la clôture, qui résista au choc. Puis il passa.
Il venait de heurter, sans le savoir, à la porte du pauvre Pat, qui travaillait en ce moment de son mieux à couper la chaussée de planches, dans le bog de Clare-Galway.
Milord ne savait point, paraîtrait-il, tout ce qui se passait sur son domaine, car il ignorait que le pauvre Pat eût élu domicile dans les ruines de Diarmid.