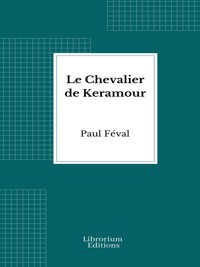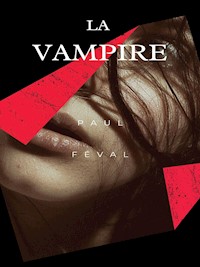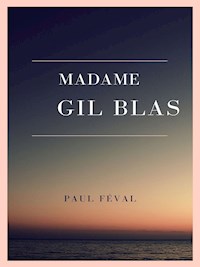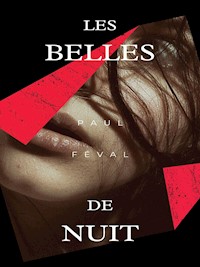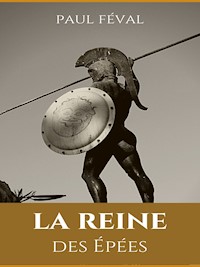
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Au XVIIIe siècle, Frédéric, jeune étudiant allemand, pauvre mais courageux, a conquis le poste suprême de Première Épée de l'université de Tubingue. Il aime en secret Chérie, pupille de l'université et nièce de tous les étudiants après le meurtre de son père par des gardes royaux. À la suite d'un malentendu, le baron de Rosenthal, ennemi juré des étudiants, se retrouve fiancé à Chérie, qui pourtant partage les sentiments de Frédéric. Le comte de Spurzeim, diplomate mégalomane et parent de Rosenthal, en profite pour monter une machination afin d'épouser sa nièce Lenor, éprise elle de Rosenthal. C'est dans la nuit sombre de la Forêt Noire, près de l'antique château de Rosenthal que tous ces personnages se rencontreront pour dénouer l'écheveau de ce récit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Reine des Épées
La Reine des ÉpéesPREMIÈRE PARTIE. LES ARQUEBUSESDEUXIÈME PARTIE. LE CHÂTEAU DE ROSENTHALTROISIÈME PARTIE. LA REINE CHÉRIEConclusion.Page de copyrightLa Reine des Épées
Paul Féval
PREMIÈRE PARTIE. LES ARQUEBUSES
I Le mot de passe.
Sur le flanc gauche du Graben, cette belle et large rue qui suit la ligne des anciens fossés de Stuttgard et qui fait l’orgueil légitime de tous les sujets du roi de Wurtemberg, se trouve un quartier noir et peuplé outre mesure, dont les maisons grimpent, le long de petites rues étroites et tortueuses, jusqu’à la cathédrale. Dans les dictionnaires, on lit, à l’article Stuttgard, que la seule partie de la ville qui soit digne d’être visitée par le voyageur intelligent se compose de deux faubourgs, dont les maisons sont fort bien alignées. Il faut respecter l’avis des dictionnaires ; néanmoins, il est certains esprits qui, à Stuttgard, tout en considérant avec intérêt les grandes rues neuves ornées de restaurants à prix fixe et de magasins de bonneterie, n’ont pas honte de visiter aussi ces quartiers pauvres et dépourvus d’alignement, où se rencontrent les chers vestiges de la vie d’autrefois, où le passé renaît pour le rêveur, où l’imagination reconstruit, à l’aide d’une façade chancelante, d’une tourelle oubliée, d’une girouette de fer épargnée par miracle au sommet d’un pignon, tout ce merveilleux et sombre ensemble des cités gothiques.
C’est un vrai dédale que le quartier de l’Abbaye dans la capitale du Wurtemberg. D’autres villes d’Allemagne ont conservé des restes meilleurs et plus précieux, mais nulle part vous ne rencontreriez un écheveau de ruelles mieux emmêlé, un labyrinthe plus inextricable et plus bizarre.
La principale rue de ce quartier qui a nom Abten-Strass (rue de l’abbaye) et qui descend, à travers mille détours, jusqu’aux bords encaissés du Nesenbach, est bordée dans toute sa longueur de maisons qui présentent leurs pignons aux passants, et quand on y voit arriver devant soi une bande d’étudiants au cou nu, à la poitrine découverte, à la barbe pointue, aux cheveux longs flottant sur les épaules, on pourrait se croire en plein moyen-âge.
C’était vers le commencement de l’automne de l’année 1820. Le Graben était désert depuis longtemps ; la voix monotone et endormie du guetteur venait de crier deux heures après minuit, tandis que deux sons de trompe, lugubres et prolongés, accompagnaient le double coup frappé par le battant de l’horloge royale. Il faisait chaud, et pas un souffle de vent ne passait sur la ville assoupie ; les réverbères fumeux, placés à de trop larges intervalles, achevaient de brûler leur mauvaise huile et n’éclairaient guère que la tôle de leurs lanternes.
Il y avait bien une heure que l’homme du guet, qui dormait debout suivant l’ancienne tradition de son corps, n’avait rencontré âme qui vive.
Au coup de deux heures, un bruit lointain de pas se fit entendre au delà des limites du Graben, et l’écho apporta le son des bottes ferrées grinçant contre le pavé.
– Gute nacht ! grommela l’homme du guet par habitude.
Car ses pareils ne manquent jamais de souhaiter la bonne nuit aux honnêtes gens comme aux voleurs.
Personne n’était là pour lui rendre sa courtoisie. Les pas continuaient de retentir sur le pavé au loin, mais aucune figure ne se montrait dans la solitude du Graben.
Les nuits allemandes sont si pleines de fantômes que le bon guetteur continua paisiblement son somme, pensant bien que ces bottes ferrées invisibles et retentissantes chaussaient des pieds de revenants. Mais il s’éveilla tout à fait en arrivant à l’extrémité orientale du Graben, devant le grand restaurant du Mérite militaire dont les fenêtres demi-closes laissaient échapper de joyeuses lueurs et de gais murmures à travers leurs draperies rabattues.
L’eau vint à la bouche du vieux soldat du guet.
– Si l’on mettait dans une tasse tout ce qui reste là-haut au fond des verres, pensa-t-il avec mélancolie, je boirais un bon coup, et ces dignes seigneurs n’en souperaient pas plus mal !
– Que fais-tu là, Daniel ? dit une voix creuse derrière lui, tout à coup.
Le vieux guetteur se retourna et tressaillit en s’appuyant à la hampe de sa longue et inoffensive hallebarde.
La clarté douteuse du réverbère prochain lui montrait inopinément deux personnages dont aucun bruit n’avait trahi l’approche. Tout à l’heure, avant de penser à ce bon coup qu’il aurait pu boire, le vieux guetteur avait rêvé de fantômes. Les fantômes étaient-ils venus ?
Les deux nocturnes promeneurs se tenaient bras dessus bras dessous. Leurs visages et leurs tournures présentaient un plein contraste. Tous les deux portaient des costumes d’étudiant, mais ces costumes différaient autant que leurs personnes mêmes.
Car il y avait et il y a encore deux costumes dans les universités d’Allemagne : le costume sombre et le costume gai, le costume du mélodrame et le costume de la comédie, les habits du joyeux enfant qui s’amuse en travaillant ou qui travaille en s’amusant, comme vous voudrez l’entendre, et le déguisement lugubre du philosophe en herbe qui s’abrutit avec des sophismes et de la bière, qui pâlit sur l’ennui des rêvasseries politiques et qui conspire à vide vingt-quatre heures par jour comme les traîtres incorrigibles de nos bas théâtres.
L’Allemagne fut toujours la patrie de ces fous tristes et fatigants dont le moindre tort est d’être ennuyeux comme un in-quarto d’illuminisme germanique.
L’étudiant au costume sinistre était grand, maigre, blême et possédait une voix de basse-taille. Il portait la redingote allemande, raide sous les aisselles comme une armure de fer, les larges braies de la Souabe antique et la chemise ouverte. Il n’avait d’autre coiffure que ses cheveux inspirés, c’est-à-dire vierges de cette souillure que le peigne fait subir chaque jour aux perruques des civilisés.
Son camarade était gros, rond, court, joufflu ; il avait un petit dolman sur les épaules, de grosses bottes par dessus son pantalon collant, et sur sa tête une toque bariolée de diverses couleurs.
L’étudiant farouche se nommait Baldus. L’étudiant gai avait nom Bastian.
Et leur réunion offrait un symbole assez frappant de l’état des universités allemandes sous la Restauration. Les Universités se séparaient alors en deux classes : les Camarades et les Compatriotes. Les politiques, les philosophes, avaleurs de rois, se réunissaient dans une association immense qui comprenait tout le système universitaire allemand et qui portait le nom de Bur-schenschaft (famille des Camarades). Il est inutile de dire que les Camarades et leur « famille » n’étaient point d’accord entre eux sur les détails de doctrine : ce qu’ils voulaient, c’était jouer au jeu des révolutions ; ils étaient tous d’accord sur cet article capital.
Les autres étudiants, qui prétendaient étudier dans le sens pratique du mot, qui prétendaient se divertir aussi suivant le penchant de leur âge, formaient des associations particulières, moins vivement poursuivies par la police des souverains, mais qui n’avaient pas non plus les coudées très-franches. Ces associations portaient le titre commun de Landsmannschaft (famille des Paysans ou des Compatriotes).
C’étaient, en général, des associations d’études et de plaisirs. Il y avait bien quelques petits mystères, car l’étudiant d’outre-Rhin a pour Croquemitaine les mêmes tendresses que nos innocents francs-maçons de Paris ; mais enfin, les mœurs du Compatriote étaient tout autres que celles du Camarade. En politique, il ne connaissait que les chansons et n’assassinait presque jamais Kotzebue.
Pour trouver le vrai compagnon d’Université dans toute la poésie tendre et batailleuse de son caractère, il fallait violer le secret d’une famille de Compatriotes et se faire recevoir Renard ou Conscrit dans le sanctuaire des grandes pipes et des grandes épées. L’air y était épais, la bière lourde ; la gaieté ne s’y chauffait pas d’un bois précisément attique ; mais il y avait là de la franchise, de la jeunesse, du cœur et de l’honneur !
Au bas bout de la table, sur la plus méchante escabelle, vous avisiez le nouveau débarqué, timide et triste, regrettant encore l’aile de sa mère, mais ayant appris à dédaigner déjà tout ce qui était Philistin, c’est-à-dire tout ce qui n’était pas étudiant. Cet enfant naïf, ignorant, respectueux bon gré mal gré envers ses anciens, ce plastron, cette victime éternelle des anciennes plaisanteries scolastiques, nous l’avons nommé : c’était le Renard. – Un peu plus loin, le Renard enflammé montrait déjà les promesses de ses moustaches ; il avait mis un peu de hâle sur le rose trop féminin de ses joues ; il jurait rondement par le diable et avait conquis le second grade universitaire. – Puis venait la jeune Maison (Dieu sait où ils allaient pêcher leurs titres !) La jeune Maison avait oublié le village, la jeune Maison portait comme il faut le dolman fanfaron et les éperons d’acier. – Encore un semestre d’études, de bombances, de veilles et de duels, la jeune Maison devenait vieille Maison, puis Maison moussue, ce qui était le comble !
La Maison moussue avait droit au titre vénérable de Renard d’or.
Chacun pouvait franchir ces différents degrés, par le fait seul de sa présence aux cours et à la taverne : c’était une affaire d’ancienneté ; mais il y avait d’autres honneurs qui ne se gagnaient pas si facilement.
Au-dessus de ces compagnons, vieillis dans la poussière des cabarets et des écoles, il y avait de brillantes existences, dont la gloire, éclatant comme un coup de tonnerre, s’était faite en un jour. À ceux-là, on ne demandait point la date de leur entrée dans la famille, dont ils formaient l’état-major : c’étaient les Renommists ou les Crânes.
Pour arriver à cette noble position de Crâne, il fallait passer, par l’épreuve de l’un des trois scandal, à savoir : le bier scandal, le scandal pro patria et le scandal contrà (sous-entendu Philistinos).
Pris en ce sens, le mot scandal peut se traduire par combat à outrance. Le bier scandal était la lutte des schoppes jusqu’à ce que le vaincu, mort ou bien malade, tombât sous les pieds chancelants du vainqueur ; le scandal pro patria était le tournoi entre étudiants ; il avait lieu seulement par permission expresse des Anciens, et lorsque la ville était trop étroite pour contenir deux Crânes d’égale renommée. – Le scandal contrà se renouvelait plus souvent et atteignait presque toujours des proportions tragiques : c’était la croisade de messieurs les étudiants contre les officiers de l’armée, leurs ennemis naturels.
Enfin, au-dessus des Crânes eux-mêmes, on respectait, notamment à l’Université de Tubingue, dans le royaume de Wurtemberg, les Épées (Degen), consuls qui étaient élus au nombre de trois par l’assemblée des Maisons ou Anciens, et qui gouvernaient la république des Compatriotes.
Il y avait déjà du temps que Bastian, notre étudiant gras et gai, suivi de Baldus, notre étudiant triste et maigre, se promenait à la belle étoile.
Baldus était un Camarade politique, et si nous lui donnons un tout petit coin dans ce tableau, c’est que la vérité force le peintre à mettre le charbon parmi la verdure. Bastian était un Compatriote ; le bier scandal lui avait donné rang de Crâne. Bastian et Baldus étaient partis d’une taverne située au centre de la ville vieille pour se diriger vers le Graben. Tous deux avaient quelques pots de bière dans l’estomac et de la fumée de tabac plein la cervelle.
– Diable d’enfer ! disait Bastian, si tous les Camarades de l’Université de Vienne te ressemblent, frère Baldus, on doit s’y morfondre d’ennui, c’est une chose sûre !… Ici, nous dansons comme des perdus, nous courons à cheval entre Stuttgard et Tubingue, et, pour nous reposer, nous chantons le Gaudeamus en buvant du meilleur !… Mais parlons plus bas ; nous approchons du Graben, et si nous voulons savoir au juste quel est ce Philistin, il est bon de ne nous point faire arrêter au préalable par les patrouilles de la garde du roi… Le conseil des Anciens m’a confié une mission, je t’ai choisi pour m’aider : soyons prudents !
– Ce n’est donc pas parce que cet homme m’a fait chasser de ma patrie, dit Baldus avec amertume, que le conseil des Anciens s’occupe de lui ?
– Non, répondit Bastian ; c’est parce que cet homme a re-gardé Chérie à la promenade du soir, dans le jardin du roi.
– Et qu’importe cela ?… dit Baldus, qui s’arrêta indigné.
– Ce que cela importe ? s’écria Bastian avec une chaleur soudaine ; ce que nous importent l’honneur et le bonheur de notre petite reine ?… Diable d’enfer ! Ami Baldus, tu viens de loin et cela t’excuse… Mais si tu parles jamais de Chérie devant nos frères, souviens-toi de cet avis-là : ne demande plus ce qu’importe la moindre des choses qui la regardent !
– C’est donc un fétiche ? murmura Baldus.
– C’est Chérie, notre reine bien-aimée, répliqua le gros Bastian, qui était devenu presque sérieux. C’est notre gloire et c’est notre amour !… Si je te disais que nous sommes fous d’elle, se serait trop peu mille fois… Donc, si tu veux vivre en paix au milieu de nous, mon frère, adore notre Chérie ou fais semblant de l’adorer.
– Voici la seconde fois que tu me dis quelque chose de pareil, murmura Baldus en secouant ses longs cheveux. En sortant de la taverne, tu me disais : « Si tu veux vivre en paix au milieu de nous, frère, aime Frédéric ou fais semblant de l’aimer… » En somme, qu’est-ce que cette Chérie et qu’est-ce que c’est que ce Frédéric ?
On apercevait la lanterne de Daniel le guetteur, qui venait de s’arrêter devant le restaurant du Mérite militaire.
Bastian mit un doigt sur sa bouche.
– C’est la reine et c’est le roi ! répliqua-t-il à voix basse. Demain, à la fête des Arquebuses, tu les verras tous les deux… Autour de Chérie, il y aura cent épées… Frédéric n’en a qu’une, mais elle vaut les cent autres… Viens çà, Baldus, et retiens ta langue !
Ils s’avancèrent à pas de loup vers le pauvre Daniel et ce fut Bastian, l’étudiant gai, qui lui frappa sur l’épaule en disant :
– Que fais-tu là, vieux Daniel ?
– Daniel, répéta aussitôt Baldus avec emphase, saisissant avec avidité cette occasion de déclamer un peu. Puisque tu t’appelles ainsi, pauvre créature, à quoi penses-tu ?
– Je ne pense à rien, meinherr, répondit le guetteur sans hésiter.
– Daniel, Daniel, poursuivit Baldus, les autres dorment, toi tu veilles !… Les autres reposent, toi tu marches !… Pauvre paria d’une civilisation égoïste, te voilà loin de ta femme et de tes enfants, tout seul dans les rues abandonnées !… À quoi penses-tu, Daniel ?
Bastian allumait paisiblement son énorme pipe de porcelaine à la lanterne du guetteur.
– Eh bien ! Meinherr, c’est vrai, dit Daniel en se ravisant, je pensais à quelque chose… Je pensais que ma gorge s’est desséchée à crier les heures et le temps qu’il fait… Je pensais que j’avais envie de boire un bon coup.
Il leva la main vers le premier étage du restaurant et ajouta :
– Ce n’est pas l’embarras, si je leur demandais rasade par la fenêtre, je suis bien sûr qu’ils m’enverraient plutôt une bouteille qu’un verre, car ce sont de dignes seigneurs, ceux-là, entendez-vous !… Ils ne chantent peut-être pas les mêmes chansons que vous, et ils n’ont pas à la bouche des phrases dix fois longues comme ma hallebarde ; mais ils ouvrent volontiers leur bourse en passant auprès d’un vieux soldat et lui disent en bon allemand : « L’ami, voici pour boire à la santé de la vieille Allemagne ! »
– L’aumône ! murmura Baldus avec dédain.
– Il n’y a point d’aumône, mon maître, répliqua le vieillard, quand la main qui donne presse fraternellement la main qui reçoit… J’ai porté le mousquet, ils portent l’épée : que Dieu les garde !… À l’âge où je suis, je ne deviendrai jamais assez savant pour préférer bonne langue à bonne lame !
– Tiens ! dit Bastian, tu n’es donc plus le compère des étudiants, toi, vieux Daniel !
Le guetteur lui tendit la main, que Bastian secoua cordialement.
– Vous, dit-il en souriant, vous êtes le meilleur buveur de bière de toute la Souabe : je vous estime… Si fait, si fait, mon maître, j’aime les étudiants. Passé minuit, ce sont mes seuls compagnons de veille ; je ne rencontre plus qu’eux par les rues et j’écoute leurs pas joyeux en me disant : « Ils sont jeunes ! ». C’est si bon, la jeunesse !… Et tenez, au commencement de ce printemps, je me détournais tous les soirs de mon chemin pour voir quelque chose qui me réchauffait le cœur… C’était là-bas, dans le quartier de l’Abbaye, au coin d’Abten-Strass, devant cette vieille masure que vous appelez, vous autres, la maison de l’Ami… Vers dix heures, un jeune homme, presque un enfant, qui avait de grands cheveux blonds bouclés sous sa petite casquette, montait les rives du fleuve et suivait la rue en rêvant… Il s’arrêtait au même endroit toujours, il regardait toujours la même fenêtre derrière laquelle une lueur pâle se montrait… Il attendait : bien souvent la fenêtre ne s’ouvrait point. Mais quelquefois, quand l’air de la nuit était tiède et doux, les deux battants de la croisée grinçaient sur leurs gonds et une blonde tête d’ange apparaissait sur le balcon…
– Chérie !… murmura Bastian, qui s’était rapproché.
Baldus haussa les épaules avec colère.
– Oui, oui, Chérie !… répéta le vieux guetteur, qui souriait et se complaisait à ce souvenir : celle que vous nommez votre reine et qui est plus belle que toutes les reines !… Quand elle venait là, respirer l’air des nuits, le pauvre étudiant, au lieu de faire un pas en avant, se collait tout tremblant contre la muraille, s’il n’avait pas le temps de s’enfoncer sous l’auvent d’une porte… Je suis bien sûr que la reine Chérie ne se doute même pas qu’il l’aime comme les bons chrétiens adorent la Vierge, mère de Dieu… Et moi qui vous parle, je m’arrêtais dans ma route et je le regardais de bien loin, agenouillé dans l’ombre devant son idole, car il était heureux, et j’avais peur de l’éveiller de son rêve…
– Frédéric ? murmura Bastian, dont le regard interrogeait le guetteur.
Celui-ci ne répondit point et Daniel poursuivit d’un accent rêveur.
– Hier, à la promenade, il y en avait un autre homme qui regardait la reine Chérie… Je ne sais pas lequel est le plus beau, de l’étudiant aux blonds cheveux ou du soldat au brillant uniforme ; je ne sais pas lequel est le meilleur…
– Tu le connais donc, celui-là, Daniel ? demanda Bastian vivement.
Le vieux guetteur jeta un coup d’œil vers les fenêtres éclairées du Mérite militaire.
– Y a-t-il un homme dans Stuttgard qui ne le connaisse pas ? répliqua-t-il ; c’est le plus brave et le plus noble de nos soldats… Le caprice des chambellans, des conseillers et autres gens de cour l’avait éloigné de son pays, mais notre roi Guillaume l’a rappelé de l’exil…
– C’était à Vienne qu’il était, n’est-ce pas ? demanda encore Bastian, qui échangea un coup d’œil avec Baldus.
– Oui, à Vienne… Et l’empereur d’Autriche voulait le faire général, pour le garder auprès de lui ; et il a répondu à l’empereur : « Sire, j’aime mieux être soldat dans mon pays, qu’ailleurs maréchal d’empire ! » – Et tenez, s’interrompit le vieux guetteur au milieu de son enthousiasme, en prêtant l’oreille à un grand bruit qui se faisait derrière les draperies closes de la taverne, si vous voulez le voir, vous n’avez qu’à regarder ; car la fête est finie, et voici les officiers des chasseurs de la garde qui vont regagner leurs logis.
La porte du restaurant du Mérite militaire s’ouvrit sans trop de fracas, et un éventail lumineux se dessina sur le pavé de la rue. L’état-major des chasseurs de la garde sortit éclairé par les garçons de la taverne.
– C’est lui !… murmura Baldus entre ses dents serrées.
– C’est lui !… répéta Bastian.
– Holà ! cria une voix sur le trottoir.
– La voiture du colonel baron de Rosenthal !
Un coup de fouet retentit à l’angle en retour du Graben et une élégante calèche montra ses deux lanternes blanches.
Celui qui était en tête des officiers, et qui portait avec une merveilleuse noblesse un des plus brillants costumes de l’armée allemande, donna des poignées de main à la ronde.
– Diable d’enfer !… murmura Bastian, c’est tout de même un bien bel homme que ce Philistin-là !
– À vous revoir, messieurs et amis, dit le baron de Rosenthal en soulevant son chapeau à plumes. Je n’ai jamais mieux senti la bonté du roi qu’en ce moment, où il me permet de vous serrer les mains et de vous dire : « À vous revoir, messieurs et amis, nous ne nous séparerons plus ! »
Les chapeaux à plumes s’agitèrent au-dessus des têtes ; il y eut un hourra discrètement contenu en l’honneur du colonel, et la brillante calèche descendit au grand galop la montée du Graben.
L’état-major des chasseurs de la garde se dispersa dans toutes les directions ; personne n’avait aperçu nos deux étudiants, protégés par l’ombre des maisons.
– Bonne nuit, messieurs, leur dit le vieux Daniel, dont la taille se courba de nouveau, et qui reprit, appuyé sur sa hallebarde, sa marche somnolente le long des trottoirs du Graben.
– Maintenant, à la Maison de l’Ami ! murmura Bastian.
Et les deux étudiants s’engagèrent aussitôt dans ces rues tortueuses et enchevêtrées qui montent vers Abten-Strass.
Ici la scène change et nous entrons dans le pays des mystères. À peu près au milieu d’Abten-Strass, à l’angle d’une de ces ruelles sans nom qui tournent sur elles-mêmes et font de cet étrange quartier un véritable dédale, une haute maison s’élevait. Sa toiture pointue, surmontée de monstres volants, ses gouttières fantasques et les balcons gothiques qui saillaient à tous les étages lui donnaient une date certaine. Cette maison était vieille comme le vieux nom des ducs de Wurtemberg. La porte cochère, qui donnait sur la rue, était close ; au premier étage, on apercevait une lueur faible à travers l’étoffe des rideaux. Sur la ruelle, tout au bout de la maison, dans un enfoncement profond que surmonte une niche habitée par une petite Vierge de granit, une porte basse s’ouvrait.
Du dehors, le regard, en le plongeant sous cette voûte exiguë, apercevait vaguement comme des ténèbres visibles. C’était un reflet douteux et rougeâtre jouant sur les murailles rugueuses d’un long corridor.
Dans ce couloir, personne ne se montrait, et le passant curieux qui se fût arrêté par hasard devant cette poterne entr’ouverte eût longtemps fatigué ses yeux à percer le mystère de ces demi-ténèbres. Alentour, toutes les maisons étaient noires et silencieuses.
Des nuages épais et gris allaient lentement au ciel. La lune, attardée et achevant son dernier quartier, dépassait à peine la ligne de l’horizon et montrait son croissant mince et rougeâtre à l’extrémité orientale d’Abten-Strass.
Pas un souffle de vent ne bruissait dans ces ruelles où les tempêtes nocturnes trouvent de si sonores échos. Les pignons gothiques s’alignaient à perte de vue et penchaient en avant leurs hautes lucarnes, qui semblaient pendre au-dessus du vide.
L’oreille saisissait çà et là des bruits de pas lointains, et l’on ne voyait personne.
Il faut aller dans les vieilles villes d’Allemagne pour voir ces paysages urbains, si fantastiques et si bizarres aux rayons de la lune, qu’on se perd à déplorer, en les contemplant, la pauvreté de l’imagination des poètes.
Là, tout prête à ces vagues terreurs qui sont si chères à notre nature avide de l’inconnu, amie des choses surhumaines ; ce n’est plus le milieu vivant où nous respirons sous le soleil, c’est une mise en scène sombre, mystique, qui appelle les visions, et ne demande qu’à se peupler de fantômes.
On comprend là, bien mieux encore que dans la campagne allemande, le génie particulier de cette littérature qui cherche tous ses effets dans le noir et dont les plus vives lumières ne dépassent jamais la pâle clarté d’un rayon de lune.
On comprend ces légendes et ces ballades, ces morts ressuscités, ces vampires aux lèvres sanglantes, ces ondines blanches qui glissent dans la brume argentée.
On comprend aussi, par une intuition plus indirecte, cette exaltation froide des têtes germaniques, cette folie pénible et laborieuse, cette philosophie qui semble une gageure insensée, ces rêves malades qui sont des cauchemars !
Tout est sombre, tout est vaporeux ; cette atmosphère grise enveloppe la ville comme un linceul ; la lune qui rase l’horizon semble un grand œil unique et triste, ouvert pour regarder ces mélancoliques ténèbres.
L’airain chante les heures avec accompagnement de cor, au haut des vieilles cathédrales ; la voix monotone du crieur répète, comme un écho affaibli, le cri du temps qui passe ; puis vient le silence, pareil à la mort.
Je vous le dis, cette poésie, hardie et belle dans ses extravagances, ces systèmes audacieux, ces impiétés, ces superstitions, ces songes scientifiques qui laissent loin derrière eux les songes des chercheurs d’or au moyen âge, tout ce qui est enfin l’Allemagne intellectuelle, tout cela c’est l’ouvrage des nuits.
La lampe fumeuse travaille, et non point le soleil.
La science allemande, la philosophie allemande, ce sont de magnifiques brouillards que le grand jour dissipe.
Le génie est si beau, qu’il faut admirer même le fantôme du génie : admirons donc le génie de l’Allemagne.
*
* *
Trois heures de nuit venaient de sonner à l’église de l’Abbaye. Vers la partie basse d’Abten-Strass, sous un réverbère qui allait s’éteindre, deux ombres silencieuses passèrent. En même temps, ces étranges bruits de pas dont l’écho allait courant par la ville semblèrent se rapprocher de toutes parts.
Au fond des ténèbres éclairées de ce corridor qui suivait la petite porte à demi ouverte, on put entendre un léger mouvement. Un homme enveloppé dans un manteau et qui portait la casquette bavaroise rabattue sur les yeux, se montra tout au bout de la galerie et s’avança vers la porte.
Au lieu de franchir le seuil et d’entrer dans la ruelle, il s’arrêta derrière la porte et se blottit dans l’angle formé par l’épais montant de pierre.
Il s’adossa à la muraille ; son manteau s’entr’ouvrit et l’on put voir que sa main gauche s’appuyait sur une longue épée nue.
Il attendit ; les deux ombres qui montaient Abten-Strass tournèrent l’angle de la ruelle et vinrent droit à la porte.
Avant d’entrer, les deux ombres regardèrent soigneusement autour d’elles pour voir si nul œil indiscret n’était ouvert aux environs.
Les deux ombres étaient des étudiants qui portaient le dolman élégant, la toque voyante et l’étroit pantalon des membres de la famille des Compatriotes : dangereux costume pour courir des aventures de nuit.
C’étaient tous les deux de très-jeunes gens, qui ne pouvaient réussir à plaquer sur leurs joyeux visages cet air grave et mystérieux qui convenait à la circonstance.
– Je crois que c’est ici, murmura l’un d’eux ; il me semble bien reconnaître la Maison de l’Ami.
– Il fait noir comme dans un four, répondit l’autre ; maître Hiob devrait bien faire la dépense d’une lanterne pour éclairer la porte de son logis !
Celui qui avait parlé le premier longea la muraille et se prit à palper de la main l’extérieur des montants de pierre qui du haut en bas étaient chargés de sculptures gothiques ; des montants sa main glissa à la porte elle-même, armée de larges bandes de fer forgé que retenaient des clous à la tête biseautée et large comme un écu.
– Toutes les portes de ces prisons se ressemblent, grommela-t-il ; mais il est l’heure et j’aperçois de la lumière là-bas…
– À la grâce de Dieu ! répliqua son compagnon ; nous ne pouvons pas rester dehors comme des pleutres, entrons !
Ils entrèrent de front et reculèrent aussitôt d’un commun mouvement, parce que leurs mains étendues en avant venaient de rencontrer la lame nue d’une épée.
– Qui va là ?… prononça une voix sourde dans l’ombre.
– Tout beau ! s’écrièrent les deux jeunes gens à la fois.
– Je suis Karl ! ajouta l’un.
– Je suis Mikaël ! dit l’autre.
– Deux Renards !… gronda la voix ; j’en étais sûr !… On ne fera jamais rien de propre avec ces étourneaux !… Avancez à l’ordre, chacun à votre tour, et dites le mot de passe !
Karl fit un pas vers le sombre gardien et murmura à son oreille :
– Frédéric !
– C’est bon, dit le gardien, qui le prit par l’épaule et l’envoya se cogner contre le mur opposé. – À l’autre.
Mikaël se pencha et prononça à son tour le nom de Frédéric.
– Et que venez-vous faire dans la Maison de l’Ami ? demanda le gardien.
– Nous venons écouter ce que diront les Anciens, répondit Karl de cette voix que prennent les enfants pour réciter leur catéchisme.
La demande et la réponse étaient réglées par le Comment, ce code fameux des associations d’étudiants en Allemagne.
– Passez ! dit le gardien.
Les deux jeunes gens s’engagèrent en tâtonnant dans le corridor où la lumière avait complètement disparu. Pendant une minute, on entendit leurs pas incertains qui hésitaient sur les dalles ; puis un bruit soudain se fit, et le gardien, qui attendait ce moment, lâcha sa grande épée pour se serrer les côtes.
– Patatras !… fit-il, les voilà dans la cave !… Quand les Renards ne se cassent pas le cou à ce jeu-là, je ne connais rien de tel pour les former !
Des bottes ferrées sonnèrent sur le pavé de la ruelle, le gardien n’eut que le temps de reprendre son glaive. À dater de ce moment, ce fut une véritable procession. Des hommes qui, pour la plupart, cachaient leurs visages dans les plis de leurs manteaux, tournaient silencieusement l’angle d’Abten-Strass, franchissaient le seuil de la Maison de l’Ami, glissaient à l’oreille du gardien le mot Frédéric, et passaient.
Le gardien les comptait.
Il paraît que les premiers venus, ce pauvre Karl et ce pauvre Mikaël, étaient les seuls qui ne connussent point les êtres de la Maison de l’Ami, car il n’y en eut point d’autres à tomber dans la cave.
Tous suivaient d’un pas assuré le ténébreux corridor. Quand ils arrivaient au bout, on entendait un bruit qui ressemblait fort à celui que fait en s’ouvrant la serrure centenaire d’un cachot : une lourde porte roulait sur ses gonds grinçants, une échappée de lumière vive inondait un instant le corridor, puis la porte pesante retombait avec un fracas sourd et la nuit revenait.
Toujours la même chose.
Quand le gardien eut compté vingt-quatre, et que le dernier venu lui eut jeté en passant ce nom de Frédéric, qui ouvrait comme un talisman l’entrée de la Maison de l’Ami, le gardien ferma la porte basse à double tour et prit le même chemin que ceux qu’il avait successivement introduits.
À cet instant-là même, l’entrée principale de la Maison de l’Ami, l’autre, celle qui donnait sur Abten-Strass, s’ouvrait tout doucement et un petit vieillard en robe de chambre et en pantoufles se présentait pour être introduit. En dedans du seuil, il y avait un autre petit vieillard également revêtu d’une robe de chambre et chaussé de pantoufles, qui, en outre était coiffé d’un beau bonnet de coton bleu, rayé de blanc.
– Fidèle au rendez-vous, monsieur l’inspecteur ! dit le petit vieillard de l’intérieur à son hôte.
– Bonsoir, maître Hiob, bonsoir, répliqua l’inspecteur, ne me laissez pas dehors, je vous prie, car j’ai mes douleurs de reins, et les nuits se font fraîches.
– On n’entre dans la Maison de l’Ami qu’avec le mot d’ordre, prononça maître Hiob, qui sous son bonnet de coton blanc et bleu était un gai gaillard ; avez-vous le mot d’ordre, monsieur l’inspecteur ?
– Frédéric !… répondit celui-ci, qui fit un geste d’impatience.
Le flambeau que tenait maître Hiob faillit lui tomber des mains.
– Comment savez-vous ? commença-t-il en se rangeant pour laisser passer son hôte.
– Je sais, maître Hiob, cela suffit, répliqua l’inspecteur sèchement ; nos bons petits enfants sont-ils en séance ?
– Le dernier vient d’arriver.
– Leur avez-vous fait savoir adroitement que cet excellent baron de Rosenthal nous était revenu ?
– Oui, meinherr.
– Eh bien, maître Hiob, cet excellent baron a si rudement malmené les étudiants d’Autriche, que nous aurons quelque bon scandal à son occasion.
– Il n’y a point de bon scandal sans Frédéric, répliqua maître Hiob, et Frédéric n’est pas ici.
L’inspecteur, qui était également conseiller, banquier et receveur général, s’appelait Muller. Il eut un petit sourire machiavélique.
– Maître Hiob, dit-il en s’arrêtant sur la dernière marche du premier étage, mon illustre patron, le comte de Spurzeim, qui est le premier diplomate du monde, m’a donné quelques leçons… Le proverbe : On ne s’avise jamais de tout, est fait pour les gens du commun… Moi, je n’oublie que les choses dont il me plaît de ne pas me souvenir… J’ai envoyé un courrier de cabinet au village où ce jeune Frédéric a reçu le jour… Nous l’aurons, et si le scandal nous débarrasse de Frédéric et du colonel, je vous enverrai deux barils de marcobrunner, maître Hiob.
Il venait de s’engager dans le corridor du premier étage et passait devant une porte dont la peinture toute neuve et toute fraîche jurait énergiquement parmi les tons crasseux du reste des murailles.
L’inspecteur s’arrêta ; son visage ridé prit une expression de tendresse langoureuse.
– C’est là qu’elle respire !… murmura-t-il. Un homme n’est pas vieux à soixante ans, n’est-ce pas, maître Hiob ? et l’âge mûr a encore de beaux jours ; il faut que vous m’aidiez à supprimer ce Frédéric !
On entendit comme l’écho lointain d’un chant ; maître Hiob ne répondit que par un signe de tête franchement affirmatif, et les deux vieillards, pressant le pas, s’élancèrent ensemble vers l’extrémité du corridor.
Ce corridor répondait exactement à celui où nous avons vu naguère s’engager tous ces inconnus qui donnaient pour mot d’ordre au gardien de la petite porte le nom de Frédéric.
La chambre qui terminait le corridor répondait de même à cette pièce du rez-de-chaussée dont l’huis s’était successivement refermé en laissant échapper de vifs rayons de lumière sur les vingt-quatre compagnons.
Les deux vieillards entrèrent dans cette chambre qui terminait le corridor, et tout aussitôt les chants éclatèrent à leurs oreilles, comme s’ils eussent été au beau milieu de la réunion même.
C’était une maison très-curieuse que la Maison de l’Ami, et ces gens du rez-de-chaussée, qui cherchaient si ardemment le mystère, avaient eu en la choisissant la main heureuse.
Au centre de la chambre du premier étage, il y avait une sorte de tambour grillé, ressemblant à peu près à ces bouches de chaleur qui sont dans nos églises trop mondaine ; ce tambour était l’orifice d’un répétiteur acoustique : tout ce qui se disait au rez-de-chaussée, on l’entendait au premier étage.
Auprès du tambour, deux fauteuils attendaient l’inspecteur et maître Hiob, car il est bon d’être à son aise pour écouter. Ils s’assirent et maître Hiob souleva un peu les deux côtés de son bonnet blanc et bleu pour dégager le conduit de ses oreilles.
Pendant que nous y sommes, achevons de dire au lecteur tout ce qui se trouvait dans cette curieuse Maison de l’Ami.
Il y avait d’abord la femme de maître Hiob, discrète personne, assez vieille et très-laide, qu’on appelait dame Barbel.
Dame Barbel était chargée de garder un trésor renfermé dans cette chambre dont la porte peinte à neuf avait arrêté les pas du conseiller-inspecteur. Cette chambre ne ressemblait guère au reste de la maison. Une lampe-veilleuse l’éclairait. Ce n’était pas assez pour que l’œil pût saisir les détails exquis de son ameublement, encore plus élégant que riche ; mais la lumière confuse laissait voir les plis gracieux des draperies aux couleurs douces, la forme charmante des meubles en bois de rose et le luxe harmonieux des tentures.
Tout cela était jeune, tout cela était frais, et c’était merveille quand on venait à penser qu’une simple muraille séparait tout cela de la vieille maison poudreuse et enfumée.
Le contraste rendait ce réduit mille fois plus mignon. À le voir, on songeait involontairement aux miracles des féeries, à ces portes tournantes qui se trouvent dans d’affreux caveaux, que l’on ouvre en prononçant des paroles magiques, et qui montrent, derrière leurs noirs battants, tout un monde d’éblouissements et de prestiges.
La lampe-veilleuse était placée sur une table dont les dorures sculptées renvoyaient sa lumière en faibles étincelles ; la table touchait à un lit en bois de rose, simple de forme et entouré d’une fine draperie de mousseline.
Sur le lit, il y avait une jeune fille endormie.
Et c’était à la jeune fille surtout que nous pensions lorsque nous parlions de trésor, de féeries et de merveilles.
La lueur douce de la lampe tombait obliquement sur ses traits si réguliers et si charmants à la fois, qu’on eût dit l’incarnation du rêve des poètes.
Elle sortait à peine de l’enfance, cette jeune fille ; ses formes avaient encore cette grâce indécise du premier âge ; sa tête, couronnée de blonds cheveux sans liens et sans voiles, se renversait sur ses mains croisées ; elle semblait regarder le ciel à travers ses belles paupières closes.
Elle dormait et un songe animait son sommeil.
Ses lèvres s’agitaient ; un sourire errait parfois tout autour de sa bouche, plus fraîche que la première rose de mai.
Son souffle léger s’arrêtait par intervalles, et son corps, dont la pose virginale, devinée sous la couverture, eût tenté le chaste pinceau d’Ary Scheffer, tressaillit alors faiblement.
On eût dit qu’elle voulait fuir et qu’une invisible main la tenait enchaînée.
On eût dit… Mais à quoi bon se perdre dans ces vagues hypothèses ? Ses lèvres charmantes s’entr’ouvrirent et le secret de son cœur se perdit dans la mousseline diaphane qui planait comme un nuage au-dessus d’elle.
C’était un nom qui résumait le rêve de la jeune fille, un nom que tous les échos de la maison mystérieuse devaient, à ce qu’il semble, répéter cette nuit. Dans son sommeil, la jeune fille avait murmuré, tandis que le sourire abandonnait ses lèvres attristées :
– Frédéric !… Frédéric !…
II Le renard d’or
La fête des Arquebuses du village de Ramberg est célèbre dans toute l’Allemagne du sud-ouest. Les fils de la Souabe antique sont grands amateurs d’exercices du corps. Ils ont, comme presque tous les Germains d’origine, d’énormes prétentions à l’adresse.
Ramberg est un gros bourg situé sur le Necker, à égale distance de Stuttgard et de Tubingue, dans la direction de la forêt Noire. Les maisons du village sont perchées au sommet d’une colline couverte de cette belle végétation qui fait de Wurtemberg le jardin de l’Allemagne, et les ruines de l’ancien château fort, résidence abandonnée des barons de Ramberg, élèvent encore au-dessus des maisons leurs murailles colossales drapées dans un sombre manteau de lierre.
Au pied de la colline coule le fleuve qui s’en va serpentant le long d’une délicieuse vallée.
L’université principale du royaume de Wurtemberg a son siége à Tubingue, qui est à peine séparée de Stuttgard par trois heures de marche. Au temps où se passe notre histoire, les étudiants avaient choisi Ramberg pour tenir leurs réunions de plaisir ou leurs batailleurs comices. Il y avait à Ramberg, comme à Stuttgard et à Tubingue, une Maison de l’Ami et derrière cette maison, qui était le domaine de l’université, une grande et belle taverne portait pour enseigne un animal d’espèce assez problématique, aux poils hérissés, à la queue large comme un plumet de tambour-maître, et entre les pattes duquel on lisait cette légende : AU RENARD D’OR.
Les habitants du bourg de Ramberg professaient un grand respect pour messieurs les étudiants. Ils se regardaient comme les vassaux indirects de l’université de Tubingue. Les réunions d’étudiants qui se renouvelaient sans cesse amenaient dans le pays le mouvement et l’aisance. Mais ces réunions amenaient aussi les agents de la police royale, et cela modérait la joie des bonnes gens de Ramberg.
En somme, paysans et paysannes vivaient partagés entre deux sentiments : l’amour de cette belle jeunesse qui fournissait au village son revenu le plus net, et la crainte des bagarres qui mettaient trop souvent le pays sens dessus dessous. On n’y jurait que par les étudiants, mais on tremblait au seul nom de la police ; et quand les officiers des régiments royaux prolongeaient leur promenade jusqu’à Ramberg et s’y arrêtaient pour faire collation, les Rambergeois se demandaient toujours si la dernière heure du village n’allait point sonner.
C’est que les échos de cette charmante colline avaient répété tant de chansons séditieuses ! c’est que les nymphes de ce paysage enchanté avaient inspiré aux poètes universitaires tant de satires contre les conseillers privés, tant de dithyrambes contre les ministres !
Paysans et paysannes étaient assurément innocents de tout cela ; mais quand la police allemande fait du zèle, tout le monde y passe.
Il y avait de vieux Rambergeois qui étaient prophètes et qui disaient qu’un jour venant les conseillers privés insultés, les ministres outragés, les chambellans vilipendés, ne laisseraient pas à Ramberg pierre sur pierre. On parlerait en ce temps de Ramberg comme de ces villes qui furent l’admiration du vieux monde et qui ne sont plus que des ruines. À la place de la maison commune, on verrait des bouquets d’érables et de hêtres, l’herbe croîtrait sur la place du tir à l’arquebuse, où tant d’illustres coups furent notés. Une forêt ou une lande, voilà tout ce qui resterait de ce charmant paradis, délice des bourgeois de Stuttgard et des étudiants de Tubingue, villa commune offrant ses treilles hospitalières à tout le monde, caressant également le civil et le militaire.
Tout cela parce que les conseillers privés sont susceptibles et que les étudiants sont fous.
Ce jour, 3 septembre 1820, c’était grande et double fête au village de Ramberg. Depuis deux semaines on avait envoyé des crieurs dans tout le Wurtemberg, la Bavière, le Tyrol et le pays de Bade, afin de convoquer les chasseurs adroits au tir de l’arquebuse, qui devait avoir lieu sur la place de l’Église. Le temps était superbe ; dès la veille au soir, les concurrents étrangers étaient arrivés leur arme sur l’épaule ; et à part les auberges qui étaient encombrées, il n’y avait guère de maison qui n’eût logé pour le moins trois ou quatre hôtes cette nuit.
Il y en avait deux pourtant : l’auberge du Renard d’or et la Maison de l’Ami, toutes deux fiefs directs de l’université de Tubingue.
Ceci regardait la seconde fête. – Cette seconde fête avait été fixée au même jour que le tir des arquebuses par une autorité qui n’était point celle du bourgmestre de Ramberg ; on ne l’avait pas annoncée si longtemps à l’avance. La nuit précédente seulement, dans toutes les villes et dans tous les bourgs du ressort de l’université de Tubingue où se trouvaient les étudiants en vacances, il s’était passé quelque chose d’absolument semblable à ce que nous avons vu naguère dans le vieux quartier de l’Abbaye, en la ville haute de Stuttgard. Partout le même mystère avait régné. À quoi bon ? nous n’en savons trop rien, mais il n’était point de bourgade où la réunion des Camarades ne se fût faite après minuit sonné.
De toutes ces réunions, la plus importante avait dû être celle de la Maison de l’Ami, dans Abten-Strass, puisque Stuttgard fournissait, à lui seul, la sixième partie des étudiants de Tubingue. Le discret maître Hiob et l’inspecteur Muller auraient pu nous dire quelles matières importantes on avait traitées dans ce conclave, où chaque membre s’engageait au secret sous les serments les plus redoutables. Il nous importe seulement de savoir qu’à Stuttgard, comme ailleurs, on avait convoqué le ban et l’arrière-ban des écoles pour le lendemain, 3 septembre, à la Maison de l’Ami de Ramberg.
Il s’agissait de disputer le prix de l’arquebuse, de fêter la rentrée solennelle et de procéder à l’admission des recrues que le nouvel an scolaire amenait.
Tel était le programme apparent ; mais c’eût été là, vous en conviendrez, une fête bien blonde et bien fade pour les Maisons moussues de Tubingue : aussi, d’un bout à l’autre du ressort, avait-on annoncé discrètement, en dehors du programme, qu’il y aurait un bel et bon scandal.
Quel scandal ? car certains Crânes voulaient qu’on leur mît le point sur l’i, – un scandal contrà de la plus recommandable espèce !
*
* *
Dès le matin, tout était en fièvre dans le village de Ramberg. L’église sonnait à volées et pavoisait son digne clocher, rond et lourd comme un bourgeois engraissé de bière ; sur la place on mettait la dernière main aux préparatifs du tir. À deux cents pas mesurés minutieusement on enfonçait les fourches de la première barre, à trois cents pas on dressait la seconde, à quatre cents pas la troisième, celle des raffinés et des maîtres. Aux côtés de chaque barre, des faisceaux d’armes étaient formés.
À droite et à gauche s’élevaient des estrades surmontées de bannières où se lisaient toutes sortes de devises en grand style, car les Allemands ont conservé le culte classique, malgré les écarts puissants de leurs poètes. Nous nous souviendrons toujours d’avoir déchiffré au fronton d’un théâtre prussien cette enseigne hyper-académique :
MUSAGETÆ HELICONIADUMQUE CHORO !…
Vis-à-vis des barres, à l’autre extrémité de la place, se dressait un grand mât, bariolé de rouge et d’or. La tête du mât disparaissait au centre d’une galerie de drapeaux ; quatre fils d’archal décrivant une légère courbe tombaient du sommet à la base ; ils étaient destinés à maintenir les oiseaux servant aux menus jeux qui précèdent le tir.
Au pied du mât, à hauteur de poitrine, une plaque de tôle ronde, divisée en six cercles concentriques, offrait à son milieu une aiguille d’acier présentant sa pointe.
Le coup plein ou maître coup devait enfiler la balle sur l’aiguille sans la tordre et sans la briser.
Tout ce que Ramberg contenait de jeunes filles et de jeunes gens était déjà sur la place où meinherr Mohl, à la fois menuisier et bourgmestre, activait l’achèvement des estrades. Il était en bras de chemise, et la sueur ruisselait de son front. Tant qu’il ne vit sur la place que des Rambergeois, il mania le rabot d’un sens assez rassis, mais lorsqu’il aperçut les premiers groupes d’étrangers déboucher derrière l’église, son visage changea.
– Mes amis, mes amis, dit-il à ceux qui l’entouraient, ne dites pas que je suis le bourgmestre… Tout à l’heure je vais aller mettre ma perruque et mon costume, et je représenterai dignement notre localité.
On s’occupait bien de maître Mohl et de son costume ! La place de Ramberg est une sorte de belvédère qui domine tout le paysage environnant ; sur toutes les routes, qui serpentaient comme de longs rubans d’or dans la vallée verte, inondée de soleil, on voyait au lointain des points noirs qui se mouvaient, qui avançaient : c’étaient de nobles cavalcades escortant des calèches découvertes, c’étaient des caravanes de paysans montés sur leurs chevaux de labour, c’étaient des voyageurs à pied, l’arme sur l’épaule, qui abrégeaient le chemin en chantant.
Et tout cela, belles dames et cavaliers, paysans et voyageurs, tout cela venait à Ramberg, au glorieux village de Ramberg, qui était en ce moment comme le centre de l’Allemagne.
C’est à des heures pareilles qu’on est fier d’être Rambergeois !
– Allons, Niklaus, disait maître Mohl, allons, mon fils, ton maillet est-il de liége ?… Enfonce-moi ce pieu, afin que je ne sois point damné par impatience !
Niklaus était en train de causer, et n’en allait pas plus vite.
– Combien y en a-t-il chez vous, Lisela, ma commère ? demandait-il à une belle grosse femme qui étalait au gai soleil son visage rubicond et souriant.
– Dix, mon compère Niklaus, et huit chez Lottchen, ma sœur.
– Et onze chez nous, reprit Niklaus.
Cinq ou six charpentiers cessèrent de raboter et de clouer, pour dire l’un après l’autre ou tous ensemble :
– Chez nous, six… Chez nous, neuf… Chez nous, quinze !
Maître Mohl essuyait son front baigné de sueur.
– Oh ! mes doux amis, mes doux amis ! suppliait-il, je souhaite que vous ayez chacun le double, car l’hospitalité est une vertu et chaque étranger vaut un florin par jour !… Mais vous ne voudriez pas me déshonorer, n’est-ce pas, mes bons enfants ? Enfonce ton pieu, Niklaus !… Assure ta banquette, Mauris… Consolide ce gradin qui ne tient pas, Michas… Et surtout, maintenant que voici les étrangers autour de nous, ne dites pas que je suis votre bourgmestre !
Niklaus, Mauris et Michas n’en perdaient pas un coup de langue.
Dans les maisons voisines, on entendait les musiciens, membres de l’orchestre, qui répétaient leur partie ; les échos des bosquets environnants renvoyaient les coups de feu des tireurs qui essayaient leurs armes, car ce nom de fête des Arquebuses est une appellation antique. Les prétendues arquebuses, au moment de la lutte, se changent en fusils de chasse pour les uns, en excellentes carabines pour les autres. Toutes les armes sont admises au concours, moyennant deux conditions : la première est un examen sous le rapport de la sécurité ; la seconde oblige le tireur qui se sert d’une arme particulière à la prêter, sur simple réquisition, à quiconque la réclame parmi ses compétiteurs déjà classés.
Les seules arquebuses qui se voient sur le lieu de la lutte sont deux énormes machines placées pour la forme aux deux côtés de la troisième barre, qui sont lourdes, presque impossibles à manier, et que l’homme le plus robuste aurait grande peine à mettre en joue.
C’était la première estrade de gauche que le bon maître Mohl, bourgmestre de Ramberg et menuisier de son état, achevait avec tant de zèle ; cette estrade appartenait à messieurs les étudiants. Comme la fille de maître Mohl avait épousé un aubergiste, comme messieurs les étudiants faisaient vivre les aubergistes de Ramberg, on ne peut dire combien maître Mohl, malgré son respect pour les autorités constituées, vénérait messieurs les étudiants.
Cependant le bruit et le mouvement augmentaient de minute en minute sur la place de l’Église : garçons endimanchés, jeunes filles parées de leurs habits de fête commençaient déjà la journée de plaisir, et ce plaisir était d’autant plus franc qu’il amenait les affaires. À chaque instant on entendait dans la foule des voix joyeuses qui constataient l’arrivée de nombreux étrangers.
– L’inspecteur Muller vient de descendre aux Quatre Nations, criait avec triomphe la servante joufflue de cet établissement ; l’inspecteur Muller, de Stuttgard !
– À l’Aigle rouge, répondait un garçon de cet hôtel ; on a retenu des lits pour le comte Spurzeim, conseiller privé honoraire, pour la comtesse Lenor, sa pupille, et pour son neveu, le noble baron de Rosenthal, colonel des chasseurs de la garde !
Ceci fit grand effet. Le comte Spurzeim passait pour être très-riche ; c’était une des illustrations du haut pays, et il avait occupé je ne sais quel poste important dans la diplomatie impériale ; la jeune comtesse Lenor était la perle de la cour, et quant au baron de Rosenthal, nous savons que son exil, causé par une méchante petite intrigue de cabinet, lui avait donné une popularité véritable.
Mais ces noms de gentilshommes et de hauts fonctionnaires, qui étaient lancés d’un bout de la place à l’autre, ne tinrent pas contre l’annonce de l’arrivée de messieurs les étudiants. Maître Mohl lui-même fit trêve à son ardent travail, pour écouter deux jeunes filles qui accouraient tout essoufflées de l’autre côté de l’église.
Ils étaient là, les fiers jeunes gens, dans la cour de la Maison de l’Ami ; ils s’étaient rencontrés au bas du coteau, sur la rive du fleuve, les uns venant de Stuttgard, les autres de Tubingue, les autres de Louisbourg et d’ailleurs, tous à pied, excepté les douze cavaliers qui escortaient la calèche à quatre chevaux de la reine Chérie.
– Et si vous saviez, disait la petite Luischen, comme elle est jolie, cette année, la reine !
– Et comme elle a de beaux chevaux ! reprenait Annette, et comme sa calèche brille aux rayons du soleil !
– Ils sont plus de trois cents ! dit Luischen en coupant, comme c’est l’usage, la parole à sa compagne ; il y en a qui se sont attelés à la calèche pour gravir le coteau.
– Et les autres étaient derrière, s’écria la petite Annette, saisissant le moment où Luischen reprenait haleine, et ils criaient : « Hourra pour notre reine Chérie ! »
Maître Mohl demanda son habit ; il ne pouvait pas rester menuisier un instant de plus !
– Mes bons enfants, dit-il, je vais aller mettre ma perruque… Ce que je vous recommande spécialement, c’est l’estrade de messieurs les étudiants… Et quand je vais reparaître tout à l’heure avec mon costume, ne bavardez pas sur mon compte, et n’allez pas dire aux étrangers : « Vous voyez bien ce maître Mohl, le bourgmestre, c’est lui qui était là, en menuisier, avec une chemise de grosse toile et le rabot à la main. »
La foule frémissante ne l’écoutait même pas. On attendait le coup de dix heures qui devait donner le signal officiel de la fête ; on regardait les tribunes se remplir lentement, et les bourgeois, armés de longues-vues, interrogeaient le lointain des routes, pour annoncer les premiers à voix haute et intelligible le nom des nobles arrivants.
Enfin, l’heure tant désirée tomba du clocher pavoisé. Une salve de mousqueterie éclata, tandis que l’orchestre rassemblé jetait dans les airs son premier accord. Au sommet du mât on hissait les trois bois de cerf et les trois lions couronnés de Wurtemberg.
En même temps, sous le royal écusson, se déployait une écharpe de soie et d’or, premier prix offert par Sa Majesté le roi Guillaume.
Le second prix, qui était un saphir monté en bague chevalière, avait été donné, comme chacun le savait bien, par la reine Chérie.
Le troisième prix enfin, dû à la municipalité rambergeoise, consistait en un baril de vin du Rhin, suspendu au mât par des rubans de mille couleurs.
Les tribunes étaient pleines, on ne traversait déjà plus la place de l’Église qu’avec une extrême difficulté, et maître Mohl venait de reparaître coiffé de sa perruque officielle, dont les marteaux retombaient sur son magnifique frac municipal.
– Allez, les arbalètes ! cria-t-il en mettant le pied sur les degrés qui conduisaient à son fauteuil d’honneur.
Quand il fut monté, il salua l’assemblée avec une grâce mêlée de tant de dignité, que personne n’aurait deviné ses récentes occupations. Et les arbalètes d’aller ! c’était en quelque sorte une petite pièce avant la grande.
Pendant que les arbalètes allaient, l’inspecteur Muller, gagnant son estrade, apercevait maître Hiob dans la foule au bras de dame Barbel, sa compagne, et lui faisait signe d’approcher.
Maître Hiob rejoignit son patron, et celui-ci lui dit à l’oreille :
– Est-ce fait ?…
– On a donné rendez-vous à monsieur de Rosenthal pour huit heures et demie… répondit maître Hiob.
– De la part de la petite ?
– Oui, monsieur l’inspecteur.
Ce fut tout : Muller tourna le dos, et maître Hiob reprit le bras de sa femme.
En tournant le dos, Muller se trouva face à face avec un petit vieillard encore plus poudré que lui, lequel tenait à son bras une ravissante jeune fille.
Ce vieillard était évidemment à Muller ce que Muller lui-même était à maître Hiob. Il le dominait, il l’écrasait.
Muller, tout inspecteur qu’il était, disparaissait littéralement devant la splendeur de ce vieillard.
Ce vieillard était un type, veuillez le croire sur notre parole ; quelque chose de fini, quelque chose de parfait : une figure effacée et grisâtre, aux traits immobiles, submergés sous une vaste coiffure à l’oiseau royal, une bouche qui voulait fermement être fine et qui cherchait le sourire de Voltaire, un œil éteint et couvert comme l’œil de monsieur de Talleyrand, un nez fallacieux comme le nez de monsieur de Metternich.
Un type sur notre honneur et notre salut ! le type tranché, le type choisi, le type trop peu connu de ces diplomates d’Allemagne qui font de l’art pour l’art, et qui passent leur vie à réaliser cet axiome du maître, lequel se moquait d’eux : « La parole a été donnée à l’homme pour cacher sa pensée. »
Fiers petits hommes ! grands comiques qui pèsent de la moitié du poids d’un moucheron dans la balance des destinées européennes !
Muller courba l’échine comme s’il avait eu une charnière à la chute des reins.
– Monsieur le comte ! murmura-t-il… Madame la comtesse !…
– Bonjour, monsieur l’inspecteur, bonjour, dit le petit vieillard de ce ton que Muller prenait lui-même lorsqu’il disait : « Bonjour, bonjour, maître Hiob. »
Alentour, on murmurait :
– Voici le conseiller privé, comte Spurzeim, et la belle comtesse Lenor, sa pupille.
Ce nom de Spurzeim était prononcé avec beaucoup d’emphase. Personne n’aurait su dire précisément pourquoi monsieur le comte était un homme illustre, mais c’était un homme illustre.
– Monsieur l’inspecteur, reprit-il tandis que Muller exécutait devant Lenor une seconde courbette, figurez-vous que nous sommes devenus des sauvages… Nous ne savons plus rien, là-bas dans nos montagnes… S’il vous plaît, comment se porte la cour ?
Ce disant, il fit asseoir la jeune comtesse Lenor sur les gradins, et se plaça derrière elle avec son interlocuteur ; mais, au lieu d’attendre la réponse de ce dernier, il cligna de l’œil en le regardant, comme s’il eût voulu dire : « Il ne faut point que ma pupille vous entende ! »
En même temps, il prononça tout haut :
– Hermann, mets-toi là, debout derrière la comtesse.
Hermann était un domestique allemand dont la grosse figure avait des tendances à singer la figure maigre de son maître : même froideur, même discrétion, même morgue sceptique, un peu de niaiserie par-dessus tout cela.
Hermann se mit debout derrière la comtesse, et sa corpulence forma un rempart bien capable de protéger la conversation secrète de l’inspecteur et du conseiller privé honoraire.
– Ah çà ! reprit le comte en changeant de ton, un bruit assez étrange est venu jusqu’à nous, dans nos montagnes… Le ministère va sauter le pas !… Rosenthal ne m’a rien dit ; Rosenthal ne me dit rien… Mais puisque le voilà revenu, mes bons amis, gare à vous.
Muller fixa ses petits yeux gris sur ceux du diplomate en chef, et le sourire qu’ils échangèrent contenait toute la science de Machiavel… toute !
– J’ai le plus profond respect pour le colonel baron de Rosenthal, votre neveu… murmura Muller à la suite de ce regard.
– Est-il toujours question de son mariage avec la noble comtesse Lenor ?
– Toujours… répliqua le comte Spurzeim, qui ne put retenir une légère grimace. Ma goutte, vous savez, monsieur l’inspecteur… ajouta-t-il pour expliquer cette grimace.
– Ah ! monsieur le comte, fit Muller pathétiquement, vous parlez à un homme qui sait compatir aux souffrances chroniques… J’ai mes douleurs de reins… Mais, s’interrompit-il en baissant la voix, me serait-il permis de demander à Votre Excellence si elle voit ce mariage d’un bon œil ?
– D’un très-bon œil, monsieur l’inspecteur… répondit Spurzeim, qui fit une nouvelle grimace.
Muller comprit.
– En ce cas, dit-il avec un sourire content, Votre Excellence pourrait bien être des nôtres…
– Y pensez-vous, monsieur l’inspecteur ?… s’écria le plus fort diplomate du royaume de Wurtemberg. Rosenthal est mon neveu… je l’ai vu naître… je l’ai fait danser sur mes genoux alors qu’il était tout petit… Je…
Le conseiller Muller prit l’audace de lui pincer légèrement la cuisse.
Entre gens si discrets, la demi-expansion de ce geste valait pour le moins la grosse tape que nos soldats citoyens s’entre-donnent sur le ventre en se disant : « Farceur ! ah ! farceur ! »
Le comte Spurzeim ne se fâcha pas. Muller se frotta les mains et ajouta :
– Si Votre Excellence est avec nous, nous resterons en place et le mariage ne se fera pas.
Une grande clameur s’éleva dans la place. On couronnait le vainqueur au jeu de l’arbalète. Un instant, le vide s’opéra autour des barres, tandis qu’on élevait sur un brancard l’adroit triomphateur.
En ce moment, et sans que personne eût remarqué son approche, un personnage qui fixa sur-le-champ l’attention de tous parut au milieu de la place ; il était monté sur un magnifique cheval bai et suivi d’un piqueur également à cheval.
Nul dans la foule n’aurait su dire son nom : il portait le costume pittoresque des chasseurs de la forêt Noire, le chapeau à plume renversée, le manteau court sur une casaque attachée à la taille par un ceinturon de cuir, la culotte de chamois collante et les bottes molles, armées d’éperons d’acier.
Il maniait son cheval fougueux en écuyer accompli ; sa taille haute était remplie de vigueur et d’élégance.