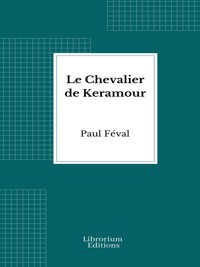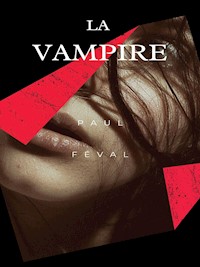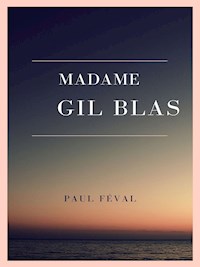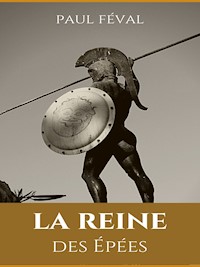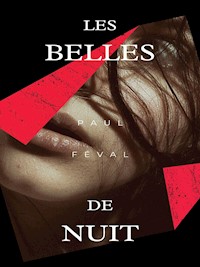Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
En 1825, les fêtes qu'organise Mgr de Quélen réunissent la meilleure société. Les discussions tournent souvent autour d'histoires de fantômes, de vampires, le surnaturel est à la mode. Lors d'une de ces soirées, deux invités se distinguent en racontant l'histoire des frères Ténèbre. À la fois bandits et vampires, les frères Ténèbre écument l'Europe pour réaliser leurs méfaits. Si l'assistance apprécie cette histoire, l'ambiance de la fête va se tendre, les frères Ténèbre seraient présents à Paris...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Chevalier Ténèbre
Le Chevalier TénèbreI. UNE SOIRÉE CHEZ MONSEIGNEUR DE QUÉLENII. LE CHÂTEAU DE CHANDORIII. LES NOCES DE VENISEIV. LE BARON D’ALTENHEIMERV. BAGATELLES DE LA PORTEVI. O FONS AMORIS !VII. DEMANDE EN MARIAGEVIII. LA FIN DE LA SOIRÉEIX. ESSAI SUR LA PHILOSOPHIE DU VOLX. LE MISSELXI. LE BORDEREAUXII. LE LEVER DE MADAME LA PRINCESSEXIII. LES TOMBES NOIRESXIV. LE GRAND ET LE PETITPage de copyrightLe Chevalier Ténèbre
Paul Féval
I. UNE SOIRÉE CHEZ MONSEIGNEUR DE QUÉLEN
J’ai ouï conter cette étrange aventure à un homme qui passait pour tenir de très près à la « police élégante » de Paris. Il était beau diseur et son histoire a grandement couru le monde sous le règne de Louis-Philippe. Je n’en garantis à aucun degré l’authenticité, mais j’affirme l’avoir entendue au commencement du second empire dans un salon politique qui eut ses jours d’éclat, en présence de l’un des éminents personnages cités dans le récit comme ayant assisté à la réunion du château de Conflans.
M… écouta fort attentivement, ne protesta point et refusa de donner les quelques explications qui lui furent demandées touchant le vrai nom du prince Jacobyi.
– Je commence sans autre préambule.
On avait dîné, au château de Conflans, chez Mgr de Quélen, archevêque de Paris ; le prélat avait une parenté très nombreuse dans le plus haut monde du faubourg Saint-Germain. À cause de cela, et aussi dans un but charitable, le château ouvrait parfois ses portes à une société fort pieuse assurément, mais tenant à la cour presque autant qu’à l’église. Un soir entre autres, il y avait quelques dames de l’intimité de Mme la duchesse de Berry.
On pouvait voir, de la route qui mène à Charenton, le long du bord de l’eau, de sévères et riches toilettes au milieu des gazons.
Je ne sais pas pourquoi cette portion de la campagne de Paris est si triste. Comment ne sont-elles pas charmantes ces prairies où la Marne vient marier ses eaux à celles de la Seine ? Le vin est la gaieté, dit-on ; comment cet océan de vin qui submerge la commune de Bercy n’égaye-t-il pas un peu ces navrants paysages ? Tout Bacchus est là ; Bacchus, chanté avec tant de constance par nos poètes ébriolants. Bacchus ne peut-il rasséréner ces horizons en deuil ? ou faut-il croire que Bacchus lui-même, ennemi de l’eau, est incommodé par le voisinage de la rivière ?
Ce qui est certain, c’est que la Seine, en ce lieu, ne sait pas sourire ; les arbres y ont des aspects dolents ; Ivry s’ennuie et boude sur l’un des bords ; sur l’autre, flanqué de guinguettes mornes, le parc, si beau pourtant à l’époque où se passe notre histoire, et qui aurait dû si joyeusement étendre ses pelouses au soleil, boudait et s’ennuyait derrière la muraille grise du saut de loup, où deux lions valétudinaires luttaient sans entrain ni courage contre deux sangliers qui bâillaient au lieu de se défendre.
C’est un sort, et cette destinée dure depuis longtemps. Les conteurs et chroniqueurs parisiens choisissaient volontiers jadis cette zone mélancolique qui commence à Charenton et va jusqu’à Bicêtre pour y placer leurs loups-garous, leurs brigands et leurs fantômes. Ces plaines, qui étaient autrefois un peu moins laides qu’aujourd’hui, avaient aussi pire renommée. Dieu merci, demandez à vos oncles : les nuits étaient là toutes pleines d’épouvantements. Il y avait un sabbat, et un très beau, non loin de l’emplacement actuel de la gare d’Ivry ; le cimetière qui portait le même nom ne possédait pas, au dire des raconteurs d’horribles choses, une seule tombe dont la pierre pût rester scellée : il n’y avait pour cela ni plâtre moderne ni antique ciment. Minuit soulevait tous ces marbres mobiles, et chacun pouvait voir, quand la lune voilée mettait parmi les ténèbres ses confuses clartés, la longue procession des morts aller, silencieuse et lente, au rebours du courant, vers les monastères de Vitry.
Mgr de Quélen, tout le monde le sait, était non seulement un prélat fort éminent, mais encore un parfait gentilhomme. Sa munificence à l’égard des pauvres, qui est désormais un fait historique, entravait ses goûts de représentation et de grandeur ; mais tenant, comme nous l’avons dit, par des liens de parenté à toute la haute noblesse, il ne pouvait clore ses salons. Ses réceptions étaient très recherchées, surtout celles qui avaient une couleur d’intimité. Toutes les nuances de l’opinion royaliste trouvaient chez lui un champ libre et neutre, bien qu’il fît au gouvernement de la Restauration une opposition assez vive, au sein de la Chambre des pairs.
Notre histoire se passe en 1825 : il avait alors de quarante-six à quarante-huit ans. C’était bien véritablement l’apogée de sa carrière, soit qu’on le prenne comme primat effectif de l’Église de France ou comme homme politique.
Pour que rien ne manquât au lustre qui l’environnait, l’Académie venait de lui ouvrir ses portes.
Il avait une habitude bien connue, ce prélat dont quelques misérables, insultant au vrai peuple en prenant le nom de peuple, devaient incendier la demeure au lendemain de la révolution de juillet ; il s’était fait une règle de distribuer aux pauvres, après chacune de ses réceptions, une somme égale aux frais de sa fête. J’ai ouï dire à bien des gens qui jamais ne donnent rien : « Il eût mieux fait de donner le double et de ne point recevoir ».
Peut-être. Il faudrait pour composer un jury capable de juger les belles âmes récuser d’abord toutes les incapacités, toutes les envies et toutes les haines. Ce serait du travail, et l’enquête préliminaire pour la constitution de pareil jury pourrait longtemps durer.
Peut-être, disais-je : donner est beau ; faire donner vaut mieux souvent, parce que le résultat est plus large. Les fêtes de Mgr de Quélen étaient fécondes au point de vue de la bienfaisance. Rarement se terminaient-elles sans que le malheur eût sa dîme prélevée abondamment sur ces graves et nobles plaisirs.
Ce n’était pas tout, cependant ; Mgr de Quélen avait encore une autre habitude dont le faubourg Saint-Germain et la cour se plaignaient parfois avec quelque amertume : c’était un déterminé protecteur ; il était entouré d’une armée de protégés, et pour ses protégés, il combattait avec une vaillance aussi méritoire que redoutée. Ses fêtes étaient de pacifiques tournois où il rompait des lances en faveur de la jeunesse ardente à parvenir, ou de la vieillesse invalide revenant de la bataille de la vie.
Je pourrais citer par leur nom des gens très haut placés qui doivent se souvenir, et pour cause des fêtes de Mgr de Quélen.
C’était donc un soir de septembre, en cette année 1825 qui avait vu le sacre de Charles X et les prodigieux enthousiasmes de Paris pour ce prince que Paris devait, sitôt après, condamner à la mort dans l’exil. Le temps était orageux et d’une chaleur accablante. Quoique la nuit commençât à tomber (on avait dîné à trois heures, selon la mode du moment), personne ne songeait à regagner les salons. Le parc était un refuge contre la température torride. Quelque fraîcheur tombait des grands arbres, et parfois une bouffée de brise, montant de la rivière, basse et lourde, essayait de balancer les feuillées.
Le gros des convives s’était réuni dans ce vaste salon de verdure qui était la joie du paysage, et que le tracé du chemin de fer de Lyon a détruit. Monseigneur, qui, par sa naissance, était comte de Quélen, avait surtout une large parenté bretonne, il appartenait à tout ce qui s’alliait aux maisons ducales d’Aiguillon, de Chaulnes et de La Vauguyon ; il cousinait avec les Chateaubriant, les Rohan, les Dreux, les Guébriant, les La Bourdonnaye, les Coislin et les Goulaine. En réunissant les noms de ceux qui étaient au château, ce soir-là, on aurait pu reconstituer l’état-major de François de Bretagne, ou de la cour de la duchesse Anne.
Et voyez le mystérieux pouvoir de certains lieux ; dans ce cercle brillant et sous ces ombrages où tant de hautes questions théologiques avaient été débattues, depuis François de Harlay, fondateur du château de Conflans, jusqu’à M. de Talleyrand-Périgord, prédécesseur de l’archevêque actuel, on parlait précisément de brigands, de loups-garous et de fantômes. On racontait, je dois le dire, au grand amusement de ces dames et même de ces messieurs, les merveilleuses histoires de revenants, dont le théâtre était tout voisin. De l’esplanade où l’auditoire était réuni, les narrateurs pouvaient faire des effets, comme disent les orateurs et les comédiens, en montrant du doigt, dans diverses directions, les champs mêmes qui avaient servi de lieu de scène à ces drames surnaturels.
Il y avait, comme toujours, des croyants et des incrédules. Sous la Restauration, le faubourg Saint-Germain possédait, aussi bien que sous Louis XV, son petit coin philosophant, et nous savons plus d’un marquis d’alors, dont la vie se passait à singer tout doucement M. de Voltaire. Nos malheurs ont eu ce bon côté de mettre pareil ridicule à la porte, au moins en matière sérieuse.
Quant au reste, le champ est libre ; pour les loups-garous, l’incrédulité se comprend ; à l’égard des fantômes, également ; mais les brigands, ceci demande une explication. Les sceptiques au sujet du brigandage se réfugiaient dans une question de chronologie. Selon eux, le vrai brigand avait vécu, le brigand romanesque, pittoresque, dramatique. Le temps présent n’avait plus que des voleurs.
En revanche, il en possédait, au dire des mêmes sceptiques, une très recommandable quantité.
Or, je vous mets au défi de prendre un rond d’arbres séculaires à deux ou trois cents mètres seulement d’un vieux château, d’y placer, par une nuit orageuse et sombre, une trentaine de personnes assemblées et causant de certains sujets effrayants ou simplement mystiques, sans qu’une sorte d’épouvante vague ne vienne à la longue se mêler à l’entretien. Je fais les concessions larges : je vous accorde deux tiers d’esprits forts ; j’irais plus loin, si vous vouliez : je vous donnerais une unanimité de sceptiques en y joignant le narrateur lui-même, pourvu qu’il fût habile, et je gagnerais encore contre vous, sûr de mon fait, en vous disant : LE FRISSON VA VENIR.
Le frisson vient toujours. Il n’est pas besoin que personne, dans ce cercle, joue à l’incrédule et soit, au fond, croyant ou même superstitieux. Rien ne frissonne si bien qu’un esprit fort. À un moment choisi, quand les poltrons ordinaires se bornent à trembler, l’esprit fort a des attaques de nerfs et perd connaissance. L’esprit fort est toujours ce bon garçon qui chante à tue-tête dans l’obscurité pour s’étourdir et avoir moins peur.
Parmi les intelligences positives qui niaient a priori l’existence de l’élément surnaturel, ce soir, au château de Conflans, il y avait une belle dame, très spirituelle et très éloquente, que nous nommerons la princesse de Montfort, parce que nous prenons seulement la liberté de garder aux personnages formant galerie leurs titres et leurs noms historiques. Mme la princesse, ayant un rôle dans notre pièce, nous paraît devoir jouir du bénéfice de l’incognito.
Elle était là avec son fils cadet, le jeune marquis de Lorgères, grand adolescent pâle et beau, qui s’était d’abord destiné à l’église, et qui, depuis peu hésitait dans sa vocation.
Mme la princesse idolâtrait son fils cadet, et ne voulait point en avoir trop l’air, elle le traitait avec une sévérité un peu affectée et se cachait de lui pour approuver à demi la voie nouvelle qu’il voulait prendre : le jeune marquis se destinait à la diplomatie.
C’était une femme un peu bizarre, avec de grandes qualités d’intelligence et de cœur.
Monseigneur de Quélen sur la question du « merveilleux », ne se prononçait point et semblait penser qu’en ces matières, il y a du pour et du contre. L’évêque d’Hermopolis, Mgr Frayssinous, qui avait le ministère des cultes à cette époque, était un chaud croyant et avait raconté lui-même des histoires admirablement dites. Il allait en commencer une nouvelle, lorsque la princesse insinua :
– Il se fait froid. N’entrerons-nous pas au salon ?
Il serait inexact de parler ici d’éclats de rire ; l’éclat de rire, surtout quand il prend une signification moqueuse, ne dépasse pas un certain niveau social. Mais le diable n’y perd rien. Il y eut, à ces mots : Il se fait froid, un gentil murmure qui chatouilla suffisamment l’oreille de Mme la princesse, car elle crut devoir s’écrier :
– Allons ! ne pensez-vous pas que j’ai peur ?
La jeune et belle comtesse de Maillé se leva et vint draper un manteau d’été sur ses épaules.
– Ma tante, dit-elle, laissez-nous trembler encore un petit peu ; c’est si bon !
Et tout le monde à la fois :
– Monseigneur ! monseigneur, votre histoire !
Au lieu d’exaucer la prière générale, l’évêque d’Hermopolis garda le silence. Puis, d’une voix contenue et dont l’intonation changée fit battre plus d’un cœur dans l’auditoire, il demanda brusquement.
– Est-ce que vous n’êtes pas ici, monsieur d’Altenheimer ?
Il y eut un autre silence. La lune montrait la moitié de son disque entre deux nuages tempétueux, opaques et lourds comme des lingots de plomb. La princesse appela auprès d’elle son fils le marquis.
– Si fait, répondit enfin une voix de basse-taille, profonde et toute pleine de métalliques vibrations ; je suis ici, monseigneur.
On ne voyait pas celui qui parlait ainsi. Sa voix semblait sortir du tronc d’un gros orme mort dont les branches sans feuilles prenaient, aux brusques clartés de la lune, des formes fantastiques.
– Approchez, je vous prie, baron, reprit Sa Grandeur (qui était aussi Son Excellence) et dites-nous, pour employer la formule de Galland, une de ces histoires que vous contez si bien.
Un homme de stature haute et grêle se montra aussitôt au milieu du cercle. La princesse, en sa qualité d’esprit fort, eût juré qu’il était sorti de terre, tant son apparition avait été soudaine. Elle eut toutes les peines du monde à ne pas renouveler sa motion de faire retraite vers le château.
La lueur de la lune tombait d’aplomb sur le nouveau venu, et il est de fait que chacun trouva dans sa personne quelque chose d’extraordinaire. C’était peut-être aussi le résultat de la prédisposition générale.
Nul ne le connaissait ; on ne l’avait point vu au dîner. Il était de ceux qu’on avait invités pour la soirée seulement, sans doute : jusque-là, rien qui pût surprendre ; plusieurs des assistants se trouvaient dans le même cas.
Son costume, noir de la tête aux pieds, était de la plus rigoureuse décence et ressemblait à celui de tous les laïques présents. Pourquoi donc avons-nous prononcé ce mot : extraordinaire ?
C’est le secret ; on n’explique pas cela.
Sauf la pâleur de son long visage tudesque, il était pareil à tous ceux qui l’entouraient, et cependant nous avons bien dit : l’assistance fut frappée comme si une trappe se fût ouverte pour laisser passer un personnage fantastique. À peine avait-on eu le temps de jeter sur lui un regard que la lune se cacha sous un gros nuage et l’enveloppa dans l’obscurité commune.
– Je suis aux ordres de Son Excellence, prononça encore la basse-taille.
– On n’est pas plus aimable, répondit l’évêque d’Hermopolis qui ajouta en prenant la main du nouveau venu :
« Mesdames, j’ai l’honneur de vous présenter M. le conseiller privé baron d’Altenheimer, directeur général de la police de S. M. le roi de Wurtemberg…
Le conseiller privé dut saluer, je pense, mais on ne le vit pas.
– … Et frère aîné, continua l’illustre évêque, d’un jeune prélat romain, en mission à Vienne qui nous est particulièrement recommandé par monseigneur l’archevêque de Gran, primat d’Autriche et de Hongrie : monsignor Bénédict d’Altenheimer…
– Ici présent, acheva une voix de ténor, douce comme un son de flûte.
Cette voix de ténor rassura un peu nos belles dames.
– Quel genre d’histoire souhaite monseigneur ? demanda la basse-taille ; fantômes ou brigands ? Nous avons de l’un et de l’autre, dans la Forêt-Noire.
– Fantômes ! vota une moitié du cercle.
– Brigands ! opina Mme la princesse, soutenue par quelques esprits forts.
Les peureuses, au contraire, désirant mourir une bonne fois de terreur, demandèrent :
– Vampires !
Et Mgr de Quélen, avec une mansuétude où perçait une légère pointe d’ironie :
– On pourrait mélanger agréablement toutes ces bonnes choses dans un plat de haut goût.
– C’est cela ! s’écria l’évêque d’Hermopolis en homme sûr du virtuose qu’il a produit. Baron, ces dames désirent une histoire à faire dresser les cheveux, où il y aurait à la fois du brigand, du fantôme et du vampire !
– Hilarius, dit le ténor doux, justement les FRÈRES TÉNÈBRE contiennent ces trois ingrédients.
– Oui, répliqua la basse, au plus creux de son clavier ; vous avez raison, mon frère Bénédict : les frères Ténèbre ! Je crois que les frères Ténèbre, en effet, pourront contenter leurs Grandeurs et l’assemblée.
– Le nom est bien choisi ! murmura Mme la princesse qui gardait son rire incorrigible, bien que sa main fût crispée convulsivement sur le bras de M. le marquis de Lorgères, son fils.
– Le nom n’est pas choisi du tout ! répartit monsignor Bénédict d’un ton un peu piqué. Tout le monde connaît les frères Ténèbre en Allemagne.
– Et tout le monde les connaîtra bientôt à Paris, ajouta le conseiller privé en baissant la voix comme malgré lui.
Si le nom n’était pas choisi à plaisir, on peut dire du moins qu’il était heureux au suprême degré. Le cercle se resserra. Ceci n’était point dans le programme de la fête qui devait se terminer par un petit concert de bienfaisance, mais ceci valait dix fois toute la fête. Le hasard donnait aux hôtes de Monseigneur une représentation inattendue, une surprise, et quoiqu’on ne puisse expliquer très clairement pourquoi, il est certain que le cœur de nos belles dames battait le tocsin des grandes émotions.
M. le baron d’Altenheimer reprit d’un ton oratoire, qui fit ressortir davantage son accent allemand :
– Excellences et très illustres personnes, nous sommes, mon frère et moi, des étrangers dans la capitale de la France, et chargés tous les deux d’une entreprise difficile. Nous chercherons à mériter l’accueil honorable qui nous est fait, ainsi que la protection qui nous est promise. Mon frère Bénédict vous chantera ce soir nos lieder de Westphalie et quelques noëls romains originaux ; moi, dont la voix est assez bonne dans les chœurs, mais qui ne peux attaquer les soli, je suis heureux et satisfait de trouver une occasion de me rendre agréable. Les souvenirs légendaires et autres compositions traditionnelles ayant trait aux choses de la supernature sont chez nous tellement abondants que seulement j’aurais à choisir entre mille pour contenter votre noble curiosité. Je préfère cependant mettre de côté nos récits populaires et vous raconter des faits du même ordre qui sont à ma connaissance personnelle, ainsi qu’à celle de mon frère. Tout à l’heure, j’entendais ici plusieurs très puissantes personnes des deux sexes raisonner sur ces questions éternellement controversées et dire : « Il n’y a plus de spectres. » Une très illustre dame ajoutait : « Il n’y a plus de vrais brigands ; les temps de Rob-Roy, de Schinderhannes, de Zawn, de Shubry, de Mandrin et même de Cartouche, sont passés. Nous n’avons plus que des voleurs ! » J’admets que nous avons une énorme quantité de voleurs, mais je suis forcé d’affirmer que nous avons aussi des brigands. Sans parler des successeurs de Fra Diavolo dans l’Italie du sud, la Hongrie, la Bohême et les provinces méridionales de l’Autriche produisent encore des bandits très dignes d’être connus. D’un autre côté, les spectres continuent comme par le passé, de soulever la pierre des tombes : rien ne change en cet univers. J’ai vu des vampires dans la campagne de Belgrade et des fantômes dans notre cimetière de Tubingen.
Nous avons fait ici appel à nos souvenirs et nous avons tâché de reproduire mot pour mot le préambule du conseiller privé baron d’Altenheimer. Son débit était remarquablement approprié à son style. Dans l’un et dans l’autre, il y avait d’abord un fond de naïveté, dont faisait partie l’emphase même de certaines expressions ; sur cette première couche se posaient des symptômes non équivoques de savoir : une mixture littéraire philosophique et scientifique ; sur le tout enfin, il y avait la prétention oratoire et je ne sais quelle bonne odeur de charlatanisme, convaincu, grave comme la robe noire d’un professeur d’université d’outre-Rhin.
Mgr de Quélen se pencha à l’oreille de sa voisine et lui dit :
– C’est l’Allemagne.
Le mot n’était pas sans profondeur. C’était l’Allemagne, en effet, cette pédanterie bonne femme, cette bourgeoise solennité, cette prédisposition naïve à faire d’un discours la chose que Paillasse appelle en place publique son boniment, tout cela accompagné, soutenu, sauvé par je ne sais quelle noblesse, qui a peut-être nom, en définitive : conviction.
Nos dames ne firent pas cette analyse, tout au long, mais la préface du baron leur plut. La séance prenait tournure de cours public, ce qui est encore allemand. On allait professer fantômes et brigands : les deux choses les plus effrayantes et les plus divertissantes qui soient au monde.
Et la lune propice, se mettant de la partie, sortit de son nuage pleinement et à propos pour empêcher la frayeur de nuire à l’attention. La clairière illuminée gagna une sorte de gaieté sans rien perdre de sa poésie ; on put voir, distinctement cette fois, le grand Allemand noir et maigre avec sa longue figure blême où brillaient des yeux fixes, et près de lui son jeune frère, monsignor Bénédict d’Altenheimer, – petit, rondelet, portant ce vêtement qui n’est ni redingote ni soutane, et qu’affectionnent les prélats romains.
Le grand avait une brochette d’ordres aussi bien nourrie que pas un conseiller privé d’Hoffmann ; le petit ne montrait point de décoration ; la seule chose qui se pût remarquer, tranchant sur la couleur sombre de sa soutanelle, c’était une longue chaîne d’acier poli, passée à son cou et retombant sur son flanc droit. Cette chaîne supportait un objet de la forme d’un carré long, également en acier poli, et qui semblait être un bréviaire ou un missel.
Alentour, le cercle sortait de l’ombre : des têtes vénérables ou charmantes, des fronts réfléchis, de blondes chevelures, des yeux avides, des bouches entr’ouvertes…