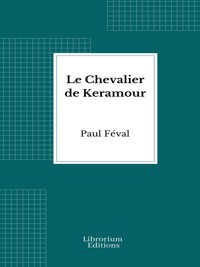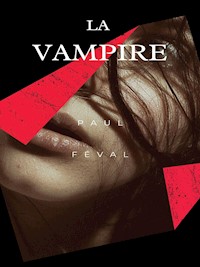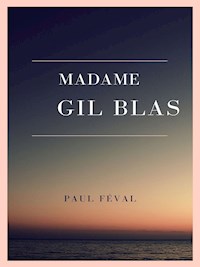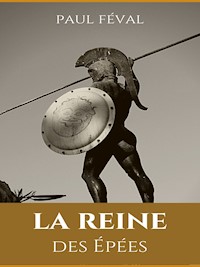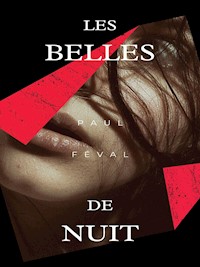Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
En ce 15e siècle, entre le Mont-Saint-Michel et celui de Tombelaine, un brouillard blanchâtre et cotonneux recouvre parfois la baie. Malheur à l'impudent égaré dans cet univers de désespérance. Le sable se dérobe lentement sous ses pieds et l'ensevelit inexorablement. Les habitants des villages voisins paysans ou pêcheurs de coques, n'évoquent pas sans frémir cette mort terrifiante dans les sables mouvants. Ils parlent aussi de la Fée des grèves, avec son manteau d'azur que certains ont vu marcher sur les eaux les soirs de brouillard. Ainsi débute une extraordinaire aventure dans un paysage d'eaux dormantes, de brumes et de sortilèges, où se mêlent l'amour et la haine, l'héroïsme et la trahison.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Fée des grèves
La Fée des grèvesI. La cavalcade.II. Deux porte-bannières.III. Fratricide.IV. Veillée de la Saint-Jean.V. Un Breton, un Français, un Normand.VI. Ce que Julien avait appris au marché de Dol.VII. À la guerre comme à la guerre.VIII. L’apparition.IX. Maître Gueffès.X. Douze lévriers.XI. Course à la fée.XII. Les mirages.XIII. Où l’on parle pour la première fois de maître Loys.XIV. Prouesses de maître Loys.XV. À quand la noce ?XVI. Amel et Penhor.XVII. La faim.XVIII. Jeannin et Simonnette.XIX. Le départ.XX. Deux cousins.XXI. La rubrique du chevalier Méloir.XXII. Frère Bruno.XXIII. Comment Joson Drelin but la rivière de Rance.XXIV. Dits et gestes de frère Bruno.XXV. Gueffès s’en va en guerre.XXVI. Avant la bataille.XXVII. Le siège.XXVIII. Où Jeannin a une idée.XXIX. Le brouillard.XXX. Où maître Vincent Gueffès est forcé d’admettre l’existence de la Fée des Grèves.XXXI. Où l’on voit revenir maître Loys, lévrier noir.XXXII. Le tube miraculeux.XXXIII. Les lises.Épilogue : Le repentir.Page de copyrightLa Fée des grèves
Paul Féval
I. La cavalcade.
Si vous descendez de nuit la dernière côte de la route de Saint-Malo à Dol, entre Saint-Benoît-des-Ondes et Cancale, pour peu qu’il y ait un léger voile de brume sur le sol plat du Marais, vous ne savez de quel côté de la digue est la grève, de quel côté la terre ferme. À droite et à gauche, c’est la même intensité morne et muette. Nul mouvement de terrain n’indique la campagne habitée ; vous diriez que la route court entre deux grandes mers.
C’est que les choses passées ont leurs spectres comme les hommes décédés ; c’est que la nuit évoque le fantôme des mondes transformés aussi bien que les ombres humaines.
Où passe à présent le chemin, la mer roula ses flots rapides. Ce marais de Dol, aux moissons opulentes, qui étend à perte de vue son horizon de pommiers trapus, c’était une baie. Le mont Dol et Lîlemer étaient deux îles, tout comme Saint-Michel et Tombelène. Pour trouver le village, il fallait gagner les abords de Châteauneuf, où la mare de Saint-Coulman reste comme une protestation de la mer expulsée.
Et, chose merveilleuse, car ce pays est tout plein de miracles, avant d’être une baie, c’était une forêt sauvage !
Une forêt qui n’arrêtait pas sa lisière à la ligne du rivage actuel, mais qui descendait la grève et plantait ses chênes géants jusque par delà les îles Chaussey.
La tradition et les antiquaires sont d’accord ; les manuscrits font foi : la forêt de Scissy couvrait dix lieues de mer, reliant la falaise de Cancale, en Bretagne, à la pointe normande de Carolles, par un arc de cercle qui englobait le petit archipel.
Quelque jour, on fera peut-être l’histoire de ces prodigieuses batailles où la mer, tout à tour victorieuse et vaincue, envahit le domaine terrestre en conquérant, puis se dérobe, fugitive, et se creuse dans les mystères de l’abîme une retraite plus profonde.
Au soleil, la digue fuit devant le voyageur, selon une ligne courbe qui attaque la terre ferme au village du Vivier.
Pour quiconque est étranger à la mer, cette digue semble ou superflue, ou impuissante. Le bas de l’eau est si loin et les marées sont si hautes ! Peut-on se figurer que cette barre bleuâtre qui ferme l’horizon va s’enfler, glisser sur le sable marneux, franchir des lieues et venir !
Venir de si loin, la mer ! pour s’arrêter, docile, devant quelques pierres amoncelées et clapoter au pied de la chaussée comme la bourgeoise naïade d’un étang !
Involontairement on se dit : Si la marée fait une fois ce grand voyage du bas de l’eau à la digue, que seront quatre ou cinq pieds de sable et de roche pour arrêter son élan ?
Mais la mer vient choquer les roches de la digue, et la digue reste debout depuis des siècles, protégeant toute une contrée conquise sur l’Océan.
Vers le centre de la courbe on aperçoit au lointain, comme dans un mirage, le Mont-Saint-Michel et Tombelène. Huit lieues de grève sont entre ce point de la digue et le Mont.
De ce lieu, qui s’élève à peine de quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, l’horizon est large comme au faîte des plus hautes montagnes. Au nord, c’est Cancale avec ses pêcheries qui courent en zig-zag dans les lagunes ; à l’est, la chaîne des collines allant de Châteauneuf au bout du promontoire breton ; au sud-est, le magnifique château de Bonnaban, bâti avec l’or des flottes malouines et tombé depuis en de nobles mains ; au sud, le Marais, Dol, la ville druidique, le mont Dol ; à l’ouest, les côtes normandes, par delà Cherrueix, si connu des habitués de Chevet, et Pontorson le vieux fief de Bertrand Du Guesclin.
Oeuvre des siècles intermédiaires, la digue semble placée là symboliquement, entre le château moderne et la forteresse antique. Au Mont-Saint-Michel, vieux suzerain des grèves, la gloire du passé ; au brillant manoir qui n’a point d’archives, le bien-être de la civilisation présente. Au milieu de ses riches futaies le roi des guérets regarde le roi tout nu des sables. Tous deux ont la mer à leurs pieds.
Mais le château moderne, prudent comme notre âge, s’est mis du bon côté de la digue.
Personne n’ignore que les abords du Mont-Saint-Michel ont été, de tout temps, fertiles en tragiques aventures.
Son nom lui-même (le Mont-Saint-Michel au péril de la mer) en dit plus qu’une longue dissertation.
Les gens du pays portent, de nos jours, à trente ou quarante le nombre des victimes ensevelies annuellement sous les sables.
Peut-être y a-t-il exagération. Jadis la croyance commune triplait ce chiffre.
La chose certaine, c’est que les routes qui rayonnent autour du Mont, variant d’une marée à l’autre et ne gardant pas plus la trace des pas que l’Océan ne conserve sur sa surface mobile la marque du sillage d’un navire, il faut toujours se fier à la douteuse intelligence d’un guide, et mettre son âme aux mains de Dieu.
On va de Cherrueix au Mont-Saint-Michel à travers les tangues, les lises et les paumelles[1], coupées d’innombrables cours d’eau qui rayent l’étendue des grèves ; on y va des Quatre-Salines et de Pontorson : ceci pour la Bretagne.
Les routes principales de Normandie sont celles des Pontaubault, d’Avranches et de Genêt.
Suivant les coquetiers et les pêcheurs, la route de Pontorson est seule sans danger.
Encore y a-t-il plus d’une triste histoire qui prouve que cette route-là même, en temps de marée, ne rend pas tous les voyageurs que sa renommée de sécurité lui donne.
Le 8 juin 1450, toutes les cloches de la ville d’Avranches sonnèrent à grande volée, pendant que les portes du château s’ouvraient pour donner issue à une nombreuse et noble cavalcade.
Il était onze heures du matin.
Tout ce qu’Avranches avait de dames et de bourgeoises se penchait aux fenêtres pour voir passer le duc François de Bretagne, se rendant au pèlerinage du Mont-Saint-Michel.
Un coup de canon, tiré du Mont, à l’aide d’une de ces pièces énormes en fer soudé et cerclé, qui lançaient des boulets de granit, avait annoncé le bas de l’eau, tout exprès pour monseigneur le duc et sa suite.
Et ce n’était pas trop faire, que de mettre ces canons au service du riche duc, car ceux qui les avaient pris aux Anglais étaient des gens de Bretagne.
Bien peu de temps auparavant, le duc François avait envoyé les sieurs de Montauban et de Chateaubriand, avec René de Coëtquen, sire de Combourg, au secours du Mont-Saint-Michel, assiégé par les Anglais. À cette époque, le roi Charles VII, de France, avait déjà regagné une bonne part de son royaume, et rejeté Henri d’Angleterre loin du centre. Mais les côtes de la Manche restaient au pouvoir des hommes d’outre-mer, et le Mont-Saint-Michel était, depuis Granville jusqu’à Pontorson, le seul point où flottât encore la bannière des fleurs de lis.
Montauban, Chateaubriand, Combourg et bien d’autres Bretons passèrent le Couesnon, pendant que cinq navires malouins, commandés par Hue de Maurever, doublaient la pointe de Cancale et entraient dans la baie. Il resta deux mille Anglais morts sur les tangues, entre le Mont et Tombelène.
À l’heure où le duc François sortait du château d’Avranches, les Anglais ne gardaient plus en France que Calais, le comté de Guines et le petit rocher de Tombelène où ils avaient bâti une forteresse imprenable.
Mais ce n’était point pour célébrer une victoire déjà ancienne que le duc de Bretagne se rendait au monastère du Mont-Saint-Michel, comblé de ses bienfaits. François faisait le pèlerinage pour obtenir du ciel le repos et le salut de l’âme de monsieur Gilles, son frère, mort à quelque temps de là au château de la Hardouinays. Un service solennel se préparait dans l’église placée sous l’invocation de l’archange. Guillaume Robert, procureur du cardinal d’Estouteville, trente-deuxième abbé de Saint-Michel, avait promis de faire de son mieux pour cette fête de la piété fraternelle.
Le service était commandé pour midi.
François, ayant à ses côtés son favori Arthur de Montauban, Malestroit, Jean Budes, le sire de Rieux et Yvon Porhoët, bâtard de Bretagne, descendit la ville au pas de son cheval et gagna la porte qui s’ouvrait sur la rivière de Sée. Les sires de Thorigny et Du Homme, chevaliers normands, l’accompagnaient pour l’honneur de la province.
Derrière le duc, à peu près au centre de l’escorte, six nobles demoiselles, trois Normandes, trois Bretonnes, chevauchaient en grand deuil. Parmi elles nous ne citerons que Reine de Maurever, la fille unique du vaillant capitaine Hue, vainqueur des Anglais.
Le visage de Reine était voilé comme celui de ses compagnes. Mais quand la gaze funèbre se soulevait au vent qui venait du large, on apercevait l’ovale exquis de ses joues un peu pâles et la douce mélancolie de son sourire.
Reine avait seize ans. Elle était belle comme les anges.
Une fois son regard croisa celui d’un jeune gentilhomme, fièrement campé sur un cheval du Rouennais, à la housse d’hermine, et qui portait la bannière du deuil, aux armes voilées de Bretagne, avec le chiffre de feu monsieur Gilles.
Ce gentilhomme avait nom Aubry de Kergariou, bonne noblesse de Basse-Bretagne, et tenait une lance dans la compagnie du bâtard de Porhoët.
Quand le voile de Reine retomba, Aubry donna de l’éperon et gagna d’un temps la tête du cortège où était sa place marquée auprès du porte-étendard ducal.
On arrivait à la barrière de la ville. Ceux qui étaient superstitieux remarquèrent ceci ; Aubry ne put arrêter sa monture assez à temps pour garder le passage libre à son compagnon, l’homme à la cotte d’hermine. Ce fut la bannière funèbre qui passa la première.
Sur les remparts et dans la rue, la foule criait :
– Bretagne-Malo ! Bretagne-Malo ! Et quatre gentilshommes, portant à l’arçon de leurs selles de vastes aumônières, jetaient de temps à autre des poignées de monnaies d’argent et répondaient :
– Largesse du riche Duc ! On dit que les bonnes gens de Normandie ont toujours fidèlement aimé le numéraire. En cette occasion, ils firent grand accueil à la munificence ducale et se battirent à coups de poings dans le ruisseau, comme de braves cœurs qu’ils étaient. Tout le monde fut content, excepté un laid païen à la tête embéguinée de guenilles, qui n’avait eu pour sa part de l’aubaine que des horions et pas un carolus. Le pauvre homme se releva en colère.
– Duc ! dit-il au moment où François passait devant lui, encore une poignée d’écus pour que Dieu t’oublie ! François tourna la tête et poussa son cheval.
D’ordinaire et pour moindre irrévérence, il eût donné de son gantelet sur la tête du pataud.
– Les six hommes d’armes du corps ! cria Goulaine, sénéchal de Bretagne, en s’arrêtant au dedans de la porte.
Les six hommes d’armes du corps étaient en quelque sorte les chevaliers d’honneur de la cérémonie. Ils devaient suivre immédiatement la bannière et mener le deuil.
C’étaient Hue de Maurever, père de Reine, qui avait été l’écuyer et l’ami du prince défunt ; Porhoët, pour le sang de Bretagne ; Thorigny, pour la Normandie ; La Hire, pour le roi Charles ; Chateaubriand, Le Bègue et Mauny.
Les cinq derniers se présentèrent.
– Où est le sire de Maurever ? demanda Goulaine. Il se fit un mouvement dans l’escorte, car cela semblait étrange à chacun que Monsieur Hue, le vaillant et le fidèle, manquât à l’heure sainte sous la bannière de son maître trépassé. Un murmure courut de rang en rang. Chacun répétait tout bas la question du sénéchal :
– Où est le sire de Maurever ? Son absence était comme une accusation terrible. Contre qui ? Personne n’osait le dire ni peut-être le penser. Mais du sein de la foule, la voix du vieux païen normand s’éleva de nouveau aigre et moqueuse.
Le grigou disait :
– Que Dieu t’oublie, duc ! que Dieu t’oublie ! Le duc François eut le frisson sur sa selle. Reine, tremblante, avait serré son voile autour de son visage. François se redressa tout pâle, il fit signe à Montauban de prendre la place vide de Maurever, et le cortège passa au milieu des acclamations redoublées.
[1] Les tangues sont généralement le sol de la grève, les lises sont des sables délayés par l’eau des rivières ou des courants souterrains, les paumelles, au contraire, sont des portions de grèves solides où le reflux imprime des rides régulières.
II. Deux porte-bannières.
Au sortir de la porte d’Avranches, ce fut un spectacle magique et comme il n’est donné d’en offrir qu’à ces rivages merveilleux.
Un brouillard blanc, opaque, cotonneux, estompé d’ombres comme les nuages du ciel, s’étendait aux pieds des pèlerins depuis le bas de la colline jusqu’à l’autre rive de la baie, où les maisons de Cancale se montraient au lointain perdu.
De ce brouillard, le Mont semblait surgir tout entier, resplendissant de la base au faîte, sous l’or ruisselant du soleil de juin.
Vous eussiez dit qu’il était bercé mollement dans son lit de nuées, cet édifice unique au monde ! et quand la brume s’agitait, baissant son niveau sous la pression d’un souffle de brise, vous eussiez dit que le colosse, grandi tout à coup, allait toucher du front la voûte bleue :
La ville de Saint-Michel, collée au roc et surmontant le mur d’enceinte, la plate-forme dominant la ville, la muraille du château couronnant la plate-forme, le château hardiment lancé par-dessus la muraille, l’église perchée sur le château, et sur l’église l’audacieux campanile égaré dans le ciel !
Mais il est des instants où l’œil s’arrête avec indifférence sur la plus splendide de toutes les féeries. On ne voit pas, parce que l’esprit est ailleurs.
Le cortège qui accompagnait François de Bretagne au monastère descendait la montagne lentement. Chacun était silencieux et morne.
Ces mots bizarres, prononcés par le grigou, coiffé de lambeaux : « Duc, que Dieu t’oublie ! » étaient dans la mémoire de tous.
Et tous remarquaient l’absence de Monsieur Hue de Maurever, écuyer du prince défunt, absence qui était d’autant plus inexplicable que les domaines de Maurever se trouvaient dans le voisinage immédiat de Pontorson, à quelques lieues d’Avranches.
Or, en ce monde, il y a presque toujours une clef pour les choses inexplicables.
Quand il s’agit de criminels ordinaires, cette clef se dépose sur la table d’un greffe. Des juges s’assemblent. On pend un homme.
Quand il s’agit des puissants de la terre, personne n’ose toucher à cette clef, et le mot de l’énigme reste enfoui dans les consciences.
Si l’escorte du duc François se taisait, ce n’était pas qu’on n’y eût rien à se dire. C’est que nul n’osait ouvrir la bouche sur le sujet qui occupait tous les esprits.
Une partie de la foule avait suivi le cortège ; la foule n’avait pas pour se taire les mêmes raisons que les hommes d’armes.
Et Dieu sait qu’elle s’occupait du riche duc pour son argent !
Il y en avait, dans la foule, qui prononçaient le mot sacrilège en parlant de ce somptueux pèlerinage.
À l’entrée de la grève, douze guides prirent les devants pour sonder les lises et reconnaître les cours d’eau.
Le brouillard s’éclaircissait. Un coup de vent balaya les sables.
La cavalcade prit le trot, comme cela se fait sur les tangues, où la rapidité de la marche diminue toujours le danger.
Aubry de Kergariou et l’homme à la cotte d’hermine, qui se nommait Méloir, tenaient toujours la tête de la procession.
– …Si mon frère me gênait, dit Méloir, continuant une conversation à voix basse, mon frère serait mon ennemi. Et mes ennemis, je les tue. Le duc a bien fait !
– Tais-toi, cousin, tais-toi ! murmura Aubry scandalisé.
Les chevaux, lourdement équipés, hésitaient sur les sables mouvants de la Sée. Les guides crièrent :
– Au galop ! messeigneurs ! La cavalcade se lança et franchit l’obstacle. Méloir était toujours aux côtés d’Aubry de Kergariou.
– Moi, dit-il, j’ai le double de ton âge, mon cousin. On me traite toujours en jouvenceau, parce que j’aime trop les dés et le vin de Guienne. Mais demain mes cheveux vont grisonner ; je suis sage. Écoute : pour la dame de mes pensées, je ferais tout, excepté trahir mon seigneur, voilà ma morale !
– Elle est donc bien belle, ta dame, mon cousin Méloir ? demanda Aubry avec distraction.
Les yeux du porte-étendard brillèrent sous la visière de son casque.
– C’est la plus belle ! répliqua-t-il avec emphase. C’était un homme de haute taille et de robuste apparence, qui portait comme il faut sa pesante armure. Sa figure eût été belle sans l’expression de brutale effronterie qui déparait son regard. Du reste, il se faisait tort à lui-même en disant qu’il commencerait à grisonner demain, car sa chevelure abondante et bouclée s’échappait de son casque en mèches plus noires que le jais.
Il pouvait avoir trente-cinq ans.
Aubry atteignait sa vingtième année.
Aubry était grand, et l’étroite cotte de mailles qui sonnait sur ses reins n’ôtait rien à la gracieuse souplesse de sa taille. Ses cheveux châtains, soyeux et doux tombaient en boucles molles sur ses épaules. Sa moustache naissait à peine, et la rude atmosphère des camps n’avait pas encore hâlé sa joue. Aubry était beau. Il avait le cœur d’un chevalier.
Méloir avait un père normand et une mère bretonne, Méloir ne valait pas beaucoup moins que le commun des hommes d’armes. La lance était légère comme une plume dans sa main. Quant à la chevalerie, ma foi ! Méloir ne s’en souciait pas plus que d’un gobelet vide.
Nous disons un gobelet d’étain. Il était brave parce que ses muscles étaient forts, et fidèle parce que son maître était puissant. En prononçant ces mots : C’est la plus belle, Méloir s’était retourné involontairement et son regard avait cherché dans la cavalcade le groupe de six jeunes filles qui suivait immédiatement le duc. Aubry fit comme lui.
Puis Aubry et lui se regardèrent.
– Elles sont six, dit Méloir, exprimant la pensée commune ; nous avons cinq chances contre une de ne pas nous rencontrer !
– Tu as dit que c’était la plus belle ! repartit Aubry à voix basse.
– Je l’ai dit. Et je te dis, mon cousin Aubry, que je serais fâché de te trouver sur mon chemin.
Les cloches du Mont s’ébranlèrent, en même temps que les portes du monastère s’ouvraient pour donner passage aux moines qui venaient au-devant de François de Bretagne.
La portion des curieux qui était restée sur les remparts d’Avranches voyait maintenant le cortège ducal, et la foule qui le suivait comme une tache sombre sur la brillante immensité des grèves.
Il restait un quart de lieue à faire pour atteindre la base du roc.
– Haut les bannières, hommes d’armes ! cria monsieur le sénéchal de Bretagne.
On était devant le Mont ; Méloir et Aubry relevèrent brusquement leurs hampes qui s’étaient inclinées dans le feu de la discussion. La bannière du couvent, qui portait la figure de l’archange, brodée sur fond d’or et l’écusson au revers, avec la fameuse devise du Mont-Saint-Michel : Immensi tremor Ocean[1], s’abaissa par trois fois. Guillaume Robert, procureur du cardinal-abbé, mit ses pieds dans le sable de la grève pour recevoir le prince, et les moines firent haie sur le roc.
En ce moment, où chacun descendait de cheval, il y eut dans l’escorte beaucoup de confusion ; la cohue qui était à la suite poussait en avant pour sortir de la grève. Le sable foulé se couvrait d’eau, et c’est à peine si les dames du deuil trouvèrent chacune un cavalier galant pour préserver leurs pieds délicats.
Aubry sentit une main légère qui touchait son épaule.
Il se retourna, Reine de Maurever était auprès de lui.
– Que Dieu vous bénisse, Aubry, dit la jeune fille dont la voix était triste et douce. Je sais que vous m’aimez… Écoutez-moi. Avant qu’il soit une heure, mon père va risquer sa vie pour remplir son devoir.
– Sa vie ! répéta Aubry ; votre père ! Et ses yeux couraient dans la foule pour chercher l’absent.
– Ne cherchez pas, Aubry, reprit encore la jeune fille ; vous ne trouveriez point. Mais écoutez ceci : celui qui défendra mon père sera mon chevalier.
– Hommes d’armes ! en avant ! dit monsieur le sénéchal. Reine sauta sur le sable et se confondit avec ses compagnes. Aubry chancelait comme un homme ivre.
– Allons, mon petit cousin, lui dit Méloir : il n’y a pas de quoi tomber malade. N’est-ce pas que c’est bien la plus belle ?
Ce grand Méloir avait sous sa moustache un sourire méchant.
– Que veux-tu dire ? balbutia Aubry.
– Rien, rien, mon cousin.
– Est-ce que ce serait ?…
– Mort diable ! tu as une épée. Quand nous serons en terre ferme, il sera temps de causer de tout cela. Aubry le regarda en face.
– Il y a deux moyens d’être heureux, reprit le porte-enseigne d’un ton doctoral : se faire aimer et se faire craindre. Un brave garçon n’a pas toujours le choix. Mais quand l’un des deux moyens lui échappe, il garde l’autre. Attention, mon cousin ; baisse ta hampe et rêve tout seul. Moi, j’ai à réfléchir.
Méloir prit les devants. On passait sous la herse. Le chœur des moines chantait le Dies irae en montant l’escalier à pic qui donne entrée dans le château.
[1] Quelques années plus tard, le roi Louis XI devait prendre cette devise pour l’ordre de la chevalerie qu’il fonda sous l’invocation de Saint-Michel.
III. Fratricide.
François de Bretagne et sa suite, arrivés à la porte d’entrée du couvent de Saint-Michel, étaient à vingt-cinq toises environ du niveau de la grève.
François prit la tête du cortège et posa le premier son pied sur les marches de l’escalier.
Cet escalier, dont les degrés de pierre vont se plongeant dans un demi-jour obscur, s’ouvre entre les deux tourelles de défense, droites et hautes, percées chacune de deux créneaux séparés par une embrasure couverte, et conduit à la salle des gardes.
Il faut parler au passé quand il s’agit des hommes. Mais, pour les pierres, on peut employer le présent, car ces merveilles en granit sont debout, et c’est à peine si les fous furieux de 93, les Vandales de tous les âges, et quatre siècles accumulés ont pu mutiler quelques statues pieuses, écorcher quelques saints contours. Par exemple, le plâtre, plus fort que les révolutions et que les années ; le plâtre, arme favorite d’Attila-directeur, et d’Erostrate-entrepreneur de maçonnerie ; a rafraîchi bien des vieilleries.
Mais il n’est pas besoin d’aller si loin de Paris pour voir de quoi le plâtre est capable !
Laissons le plâtre. Et pour cela, décidément, parlons au passé.
Vis-à-vis de l’escalier, une vaste cheminée que surmontait l’écusson abbatial, tenait le centre de la salle des gardes.
L’écusson du cardinal Guillaume d’Estouteville, trente-deuxième abbé de Saint-Michel, existe encore dans la nef et dans la salle des chevaliers. Il était écartelé : aux premier et dernier, burellé d’argent et de sable, au lion rampant du même, accolé d’or, armé et lampassé de gueules sur le tout ; aux deuxième et troisième, de gueules à deux fasces d’or, – l’écu timbré d’un chapeau de cardinal de gueules et lambrequins de même, surmonté de la croix archiépiscopale. En cœur, l’écu de France à la bande de gueules pour brisure.
Dans cette salle des gardes, monseigneur l’évêque de Dol, qui devait officier, attendait son souverain avec le prieur de Saint-Michel et les chanoines de Coutances.
Le prieur prit la gauche de Guillaume Robert, qui représentait le cardinal-abbé, et livra les clés au servant chargé d’ouvrir les portes.
Pour arriver à l’église de l’abbaye de Saint-Michel, on ne marchait pas, on montait toujours.
Il fallut d’abord traverser le grand réfectoire, énorme pièce de style roman, où la sobriété des détails fait naître une sorte de grandeur pesante qui impose et qui étonne, les dortoirs, de même style, qui règnent au-dessus, et la salle des chevaliers.
Elle était bien nommée, celle-là ! fière et robuste comme ces géants qui s’habillaient de fer ! lourde, mais bien campée sur ses vigoureux piliers et respirant, du sol à sa voûte, la majesté rude du soldat chrétien.
Comme style, c’était le roman arrivant au gothique, le pilier obèse se faisant plus musculeux, le cintre caressant la naissance de l’ogive.
Ils montèrent encore, lentement, les moines chantant les hymnes de mort, les hommes d’armes silencieux et recueillis, les femmes voilées, le duc pâle.
Le duc pâle, qui tremblait sous les voûtes froides, et qui murmurait au hasard une prière.
Son cœur ne savait pas que sa bouche parlait à Dieu.
Et Dieu n’écoutait pas.
Au-dessus de la salle des chevaliers, le cloître.
L’Aire de Plomb, comme on l’appelait, parce que la cour, comprise entre les quatre galeries, était recouverte en plomb, pour protéger la voûte de la salle inférieure.
À mesure qu’on montait, le roman disparaissait pour faire place au gothique, car l’histoire architecturale du Mont-Saint-Michel a ses pages en ordre, dont les feuillets se déroulent suivant l’exactitude chronologique.
Le soleil de midi éclairait le cloître, qui apparut aux pèlerins dans toute sa riche efflorescence : Un carré parfait, à trois rangs de colonnettes isolées ou reliées en faisceaux qui se couronnent de voûtes ogivales, arrêtées par des nervures délicates et hardies.
Le prodige ici, c’est la variété des ornements dont le motif, toujours le même, se modifie à l’infini dans l’exécution, et brode ses feuilles ou ses fleurs de mille façons différentes, de telle sorte que la symétrie respectée laisse le champ libre à la plus aimée de nos sensations artistiques : celle que fait naître la fantaisie.
Aussi, cette échelle de soixante pieds que nous venons de gravir, depuis la base des tourelles jusqu’à l’aire de plomb, en passant par la salle des gardes, le grand réfectoire, le dortoir, la salle des chevaliers, le cloître, avait-elle reçu, des visiteurs éblouis, le nom générique de la Merveille.
À l’angle nord du cloître, il y avait un tronc de bois sculpté, devant lequel monsieur le prieur s’arrêta en faisant sonner son bât.
– Monsieur Gilles de Bretagne dit-il, dont Dieu ait l’âme en sa miséricorde, mit dans ce tronc quarante écus nantais, en l’an trente-sept, le quatrième jour de février.
François prit une poignée d’or dans son escarcelle, la jeta dans le tronc, se signa et passa.
La procession tourna l’angle du cloître pour gagner la basilique.
Mais ce n’est pas le grand soleil qu’il faut à cette architecture sarrasine pour qu’elle répande tout ce qui est en elle de mystérieux et de pieux. Ses grâces un peu bizarres, ses effets imprévus en quelque sorte romanesques, ont plus besoin d’ombre encore que de lumière.
Et cela est si vrai, que nous assombrissons à plaisir les vitraux de nos cathédrales, afin que le jour glisse à la fois moins clair et plus chaud dans ces forêts de granit qui ont leurs racines sous le marbre de la nef et qui entrelacent à la voûte leurs branches feuillées ou fleuries.
La basilique de Saint-Michel n’était pas entièrement bâtie à l’époque où se passe notre histoire. Le couronnement du chœur manquait ; mais la nef et les bas côtés étaient déjà clos. L’autel se dressait sous la charpente même du chœur qui communiquait avec le dehors par les travaux et les échafaudages.
Le duc François s’arrêta là. Il ne monta point l’escalier du clocher qui conduit aux galeries, au grand et au petit Tour des fous et enfin à cette flèche audacieuse où l’archange saint Michel, tournant sur sa boule d’or, terrassait le dragon à quatre cents pieds au-dessus des grèves[1].
Les tentures funèbres cachaient la partie du chœur inachevée. Les moines se rangèrent en demi-cercle, autour de l’autel.
La grosse cloche du monastère tinta le glas.
Les six dames du deuil s’agenouillèrent sur des coussins de velours, derrière le dais qu’on avait tendu pour le duc François.
Jeanne de Bruc et Yvonne-Marie de Coëtlogon occupèrent les deux premiers coussins. Elles représentaient madame Isabelle d’Écosse, duchesse régnante et Françoise de Dinan, veuve du prince décédé.
Parmi les gentilshommes, Malestroit représentait monsieur Pierre de Bretagne, frère du duc, et le vaillant Jean Budes, souche de la maison de Guébriant, se mit aux lieu et place d’Arthur de Bretagne, connétable de Richemont, absent pour le service du roi de France.
Aux frises tendues de noir, la devise de Bretagne courait en festons sans fin, montrant, tantôt l’un, tantôt l’autre de ses quatre mots héroïques : Malo mori quam faedari.[2]
La foule emplissait les bas côtés.
Dans la nef, les hommes d’armes étaient debout, séparés de leur souverain et des religieux par la balustrade du chœur.
Cette obscurité que nous demandions tout à l’heure pour les œuvres de l’art gothique, la basilique de Saint-Michel l’avait à profusion ce jour-là. Le noir des tentures, couvrant la demi-transparence des vitraux, laissait à peine passer quelques rayons, et la lueur des cierges luttait victorieusement contre ces pâles clartés.
Il régnait sous la voûte une tristesse grave et profonde.
Et aussi, mais nul n’aurait su dire pourquoi, une sorte de mystique terreur.
L’office commença.
François était juste en face du cercueil vide qui figurait la bière absente, pour les besoins de la cérémonie.
On dit qu’il tint les yeux baissés constamment et que son regard ne se tourna pas une seule fois vers le drap noir où des lettres d’argent dessinaient le chiffre de son frère.
Les moines récitaient les oraisons d’une voix lente et cadencée. La foule et les chevaliers répondaient.
On dit que pas une fois les lèvres décolorées de François ne s’ouvrirent pour laisser tomber les répons.
On dit encore qu’à plusieurs reprises son corps chancela sur le noble siège que lui avaient préparé les moines.
On dit enfin que lors de l’absoute sa main laissa échapper le goupillon bénit…
Mais ce fut pendant l’absoute que se passa la scène étrange et mémorable qui sans doute fit oublier les détails qui l’avaient précédée.
Cette scène, la basilique de Saint-Michel en gardera éternellement le souvenir.
Le doigt de Dieu toucha ce front que ne pouvait atteindre le doigt de la justice humaine.
Au moment où le duc François se levait pour jeter l’eau sainte sur le catafalque, et comme monsieur le sénéchal de Bretagne jetait ce cri sous la voûte sonore :
– Hommes d’armes ! à genoux ! Au moment où les six chevaliers du deuil, baissant la pointe de l’épée, entraient dans le chœur pour se ranger autour du cénotaphe, un moine parut tout à coup derrière le cercueil vide. Personne n’aurait su dire d’où sortait ce religieux, car toutes les stalles restaient remplies et nul mouvement ne s’était fait à l’entour du chœur. Le moine se dressa de toute sa hauteur, développant la bure raide de sa robe et ne montrant qu’une main qui tenait un crucifix de bois.
– Arrière, duc ! prononça-t-il d’une voix retentissante. Le duc François s’arrêta. Reine de Maurever trembla sous son voile. Aubry tressaillit. Il avait reconnu cette voix. Dans le chœur et dans la nef on se regardait. La stupéfaction était sur tous les visages. Cependant monseigneur l’évêque de Dol ne bougeait pas. Procureur, prieur et religieux durent imiter son exemple. Le moine inconnu tourna le cénotaphe et vint à la rencontre du duc.
– Que veux-tu ? balbutia ce dernier.
– Je viens à toi de la part de ton frère mort, répondit le moine. Un frisson courut dans toutes les veines.
Méloir seul semblait curieux plutôt qu’effrayé. Il s’avança jusqu’à la balustrade pour mieux voir. Aubry l’y avait précédé.
– Qui es-tu ? prononça encore le duc François, dont la voix défaillait.
Le moine, au lieu de répondre cette fois, jeta en arrière le large capuchon de son froc et découvrit une tête de vieillard, énergique et calme, couronnée de longs cheveux blancs.
Un nom passa aussitôt de bouche en bouche. On disait :
– Hue de Maurever ! l’écuyer de M. Gilles ! Méloir hocha sa tête coiffée de fer, comme on fait quand le mot longtemps cherché d’une énigme vous apparaît à l’improviste. Aubry, qui respirait à peine, se tourna vers l’endroit de la nef où les dames étaient agenouillées. Reine était immobile. Les draperies de son voile semblaient taillées dans le marbre. Le prétendu moine, cependant, avait le front haut et l’œil assuré. Il regardait en face François de Bretagne dont les paupières se baissaient. Sa voix se fit grave, et son accent plus solennel.
– En présence de la Trinité sainte, reprit-il, et devant tous ceux qui sont ici, prêtres, moines, chevaliers, écuyers, hommes-liges, servant d’armes, bourgeois et manants, moi, Hugues de Maurever, seigneur du Roz, de l’Aumône et de Saint-Jean-des-Grèves, parlant pour ton frère Gilles, assassiné lâchement, je te cite, François de Bretagne, mon seigneur, à comparaître, dans le délai de quarante jours, devant le tribunal de Dieu !
Le vieillard se tut. Sa main droite, qui tenait un crucifix, s’éleva. Sa main gauche sortit du froc entrouvert et jeta aux pieds de François un gantelet de buffle que chacun put reconnaître pour avoir appartenu au malheureux prince dont on fêtait les funérailles.
Pour se rendre compte de l’effet foudroyant produit par cette scène, il faut quitter le milieu sceptique où nous vivons et secouer l’atmosphère de prose lourde qui nous entoure ; il faut se reporter au lieu et au temps. Le quinzième siècle croyait : la religion entrait alors dans la vie de tous, et il n’était guère de cœur qui ne se serrât au seul mot de miracle.
Cela se passait au Mont-Saint-Michel, le rocher lugubre, cerné par la mort.
Cela se passait dans la basilique en deuil, devant le cercueil de celui-là même qui appelait son frère assassin aux pieds de la justice suprême.
Autour du cénotaphe, flanqué de ses quatre rangées de cierges, cinquante moines s’alignaient, impassibles, montrant leurs rigides visages dans cette ombre étrange que fait la profonde cagoule.
L’autel seul rayonnait sur le fond mat des draperies noires.
Et dans la nuit de la nef, parmi la cohue confuse des colonnes, sous les ogives enchevêtrant à l’infini leurs nervures, éclairées vaguement par quelques rayons rougeâtres échappés aux vitraux, l’acier des armures jetait çà et là ses austères reflets…
Il y eut deux ou trois secondes de silence morne, pendant lesquelles une terreur écrasante pesa sur l’assemblée.
Allait-on voir le spectre soulever ses funèbres voiles ?
Puis il se fit un grand mouvement. Les armures sonnèrent dans la nef ; les six chevaliers escaladèrent la balustrade, et les moines quittant leurs stalles en désordre, s’élancèrent au milieu du chœur.
Cela, parce que le duc de Bretagne, après avoir chancelé comme s’il eût reçu un coup de masse sur le crâne, était tombé à la renverse sur le marbre.
On le releva.
Quand il rouvrit les yeux, Hue de Maurever avait disparu ; et tout ce que nous venons de raconter aurait pu passer pour un songe, sans le gantelet de buffle qui était toujours là, témoin irrécusable du terrible ajournement.
Par où le faux moine s’était-il enfui ?
Chacun se fit cette question, mais nul n’y sut répondre.
Le duc François, livide comme un cadavre, parcourut des yeux sa suite frémissante.
– Cet homme a menti, messieurs, dit-il, je le jure à la face de Saint-Michel ! Une voix tomba de la voûte et répondit :
– C’est toi qui mens, mon seigneur, je le jure à la face de Dieu ! On vit un objet sombre qui se mouvait dans la galerie conduisant à l’escalier du clocher. Le sang monta aux yeux de François qui se redressa.
– Cent écus d’or à qui me l’amènera ! s’écria-t-il.
Reine sentit son cœur s’arrêter. Personne ne bougea. Le duc repoussa du pied le gantelet avec fureur. Son regard qui cherchait un aide, tomba sur Aubry de Kergariou, debout derrière la balustrade.
– Avance ici, toi ! commanda-t-il.
Aubry ficha sa bannière dans les degrés qui séparaient la nef du chœur et franchit la balustrade.
– Mon cousin de Poroët, reprit le duc, m’a dit souvent que tu étais la meilleure lance de sa compagnie. Veux-tu être chevalier ?
– Mon père l’était ; je le deviendrai avec l’aide de mon patron, répliqua Aubry.
– Tu le seras ce soir, si tu m’amènes cet homme mort ou vivant.
Les yeux d’Aubry se tournèrent vers la nef. Il vit Méloir qui souriait méchamment. Il vit les deux blanches mains de Reine qui se joignaient sous son voile.
Aubry tira son épée, la baisa et la jeta devant le duc. Après quoi, il croisa ses bras sur sa poitrine. Le duc recula. Ce coup le frappa presque aussi violemment que l’accusation même de fratricide. On entendit glisser entre ses lèvres blêmes ces mots prophétiques :
– Je mourrai abandonné ! Mais avant qu’il eût eu le temps de reprendre la parole, le bruit d’une seconde bannière, fichée dans le bois des marches, retentit sous la voûte silencieuse.
Méloir franchit la balustrade à son tour.
Il mit un genou en terre devant le duc.
– Mon seigneur, dit-il, celui-là est un enfant ; moi je suis un homme ; je poursuivrai le traître Maurever, et je le trouverai, fût-il chez Satan !
– Donc tu seras chevalier ! s’écria le duc.
Le soir, en traversant les grèves pour regagner Avranches, le futur chevalier Méloir avait pour mission de garder le pauvre Aubry qui était prisonnier d’État.
– Mon cousin, disait-il, nous voilà en partie. Elle t’aime, mais elle me craint. Je ne changerais pas mes dés contre les tiens.
[1] Le campanile et l’archange qu’il supportait ont été détruits par la foudre.
[2] Allusion au blanc écusson d’hermine : J’aime mieux mourir que me salir.
IV. Veillée de la Saint-Jean.
Le manoir de Saint-Jean-des-Grèves était situé entre le bourg de Saint-Georges, sur le Couesnon, et le bourg de Cherrueix.
Sous le manoir, comme c’était la coutume, quelques maisons se groupaient.
Le manoir occupait le faîte d’un petit mamelon. Un taillis de chênes le séparait du village.
Le Bief-Neuf coulait derrière le manoir.
On nomme biefs les ruisseaux marneux à berges escarpées, au cours manquant de pente, qui dorment tristement dans l’étendue du Marais.
La principale maison du village appartenait à Simon Le Priol, laboureur et fermier de Maurever.
C’était une bâtisse en marne battue et séchée, que soutenaient des pans de bois croisés en X. La toiture de roseaux était haute et svelte, comme si elle eût essayé de relever le style épais de la maison.
Dans ce pays plat et gras, le pittoresque fait défaut ; alors comme aujourd’hui, c’était du blé dru et bien venu sous des pommiers difformes et sur de la marne labourée.
Terre grisâtre comme du savon de ménage ou noire comme du brai en fusion ; moulins à vent qui ne tournent guère ; masures ennuyées derrière leur haie jaune et portant leur toiture de roz près du sol, comme un gars innocent et frileux qui rabat jusqu’au menton son gros bonnet de laine.
Bon pain, cidre gluant, sang de Bretagne mêlé à sang de Normandie, querelles au bâton, querelles à l’écritoire : deux hommes de loi pour un médecin, un médecin pour un quart de malade, quatre malades pour un homme en santé.
Tournez la tête, faites trois cents pas, vous quittez la boue, vous trouvez le sable, la grève, le vent vif, les pêcheurs découplés comme des héros : la vraie Bretagne.
On est enfoui sous ces odieux pommiers. Mais ils sont si bas ! Pour voir l’horizon immense, il suffit de se hausser sur un trou de taupe.
Dol ! heureux pays de gros marrons et des procès incurables ! Contrée sans prétention, à l’abri de toute poésie ! Dol ! ville naïve qui possède un joyau pour cathédrale, et qui entend la messe dans une grange ! Dol ! cité druidique d’où les épiciers raisonnables ont chassé les bardes fous !
Salut et prospérité ! Bon pain, cidre gluant, pommes de terre guéries, voilà les souhaits qu’on forme pour ton bonheur !
Le village de Saint-Jean était trop près de la grève, bien qu’il ne la vît point, aveuglé qu’il était par six châtaigniers et trois douzaines de pommiers, pour ne pas secouer cette torpeur lymphatique qui endort le Marais. Il y avait autant de coquetiers que de garçons de charrue au village de Saint-Jean, et le Bief-Neuf y amenait l’eau de la mer aux grandes marées, jusqu’à la porte de la grange.
Simon Le Priol était à la tête du village de plein droit et sans conteste. Après lui venait maître Gueffès, être hybride, moitié mendiant, moitié maquignon, un peu clerc, un peu païen, Normand triple avec un nom breton.
Après maître Gueffès, le commun des mortels.
C’était une quinzaine de jours après le service célébré au Mont-Saint-Michel pour le repos et le salut de monsieur Gilles de Bretagne.
Il y avait grande veillée chez Simon Le Priol pour la fête de la Saint-Jean, qui était en même temps la fête de manoir et celle du village.
On avait brûlé vingt-cinq fagots de châtaignier sur l’aire, des fagots qui pétillent gaiement dans la flamme et qui lancent au vent des fusées de folles étincelles.
Le souper cuisait dans le chaudron massif, suspendu à la crémaillère.
Dans l’unique pièce qui composait le rez-de-chaussée de la ferme, le village entier était réuni.
Dix à douze gars, autant de filles, deux ménagères et maître Vincent Gueffès, lequel n’appartenait à aucun sexe : ce n’était pas un homme, en effet, puisqu’il ne savait ni labourer, ni pêcher, ni se battre ; ce n’était pas une femme, puisqu’il s’appelait maître Vincent Gueffès, et qu’il mendiait à Dol ou à Avranches dans un vieux sac d’échevin.
L’assemblée était présidée par Simon Le Priol et sa métayère Fanchon la Fileuse, bonne grosse Doloise, rouge, forte, franche, buvant son coup de cidre comme une luronne qu’elle était, et ne disant jamais non quand un pauvre quémandait à sa porte.
Fanchon la Fileuse était, ma foi, la fille d’un valet de notre sieur le pro-secrétaire de l’évêché, ce qui lui donnait un peu d’orgueil.
Simon Le Priol, lui, avait une honnête figure un peu sèche sous une forêt de cheveux gris. C’était un grand bonhomme ayant la conscience de sa valeur, et sachant garder son quant à soi parmi les petites gens du village.
Il tenait sa ferme à fief, non à bail, et comme Hue de Maurever était bien la perle des maîtres, Simon Le Priol avait de quoi dans quelque coin. Il passait pour riche. Quand un homme est riche, on l’accuse d’être avare : Simon subissait le sort commun.
Cela n’empêchait pas sa fille Simonnette de rire et de chanter comme une bienheureuse, et d’aller, plus rouge qu’une cerise, toujours courant, toujours sautant, babillant ici, là, mordant une pomme, grimpant au talus, passant pardessus les haies, se signant au-devant des croix, et rêvant parfois, quand son grand œil noir plongeait à l’horizon.
Du reste, Simonnette ne rêvait pas souvent.
Elle avait autre chose à faire.
Elle avait deux belles vaches à soigner, une rousse et une noire : cornes évasées, mufle court, regards fixes ; gaies toutes deux et bonnes laitières : des vaches qu’on aurait payées trois anges d’or la pièce au marché de Pontorson !
Des vaches comme il en fallait pour fournir la crème exquise du déjeuner de mademoiselle Reine.
Car Reine de Maurever habitait presque toujours le manoir de Saint-Jean.
Pas maintenant, hélas ! Maintenant Reine était Dieu savait où, depuis que son vieux père menait la vie d’un proscrit.
Pauvre demoiselle ! si douce, si charitable, si aimée !
Quand Simonnette allait par les chemins, les bras passés autour du cou de la Rousse ou de la Noire, elle pensait bien souvent à mademoiselle Reine.
Elles étaient du même âge, la fille du gentilhomme et la fille du paysan. Elles avaient joué ensemble sur la pelouse du manoir. Ensemble elles étaient devenues belles.
Reine avait la noble beauté de sa race. Plus tard, nous la verrons bien plus belle encore sous son voile de deuil.
Simonnette… franchement, vous n’avez jamais pu rencontrer de plus mignonne créature ! Un sourire contagieux, un sourire irrésistible. À la voir les fronts se déridaient. Simonnette ! Simonnette ! rien que ce nom-là, c’était de la gaieté pour ceux qui l’avaient vue.
Excepté pourtant pour ce pauvre petit Jeannin, le coquetier.[1]
Jeannin pleurait quand les autres souriaient.
Il se cachait pour voir passer Simonnette, et quand Simonnette était passée, il se prenait le front à deux mains.
S’il avait osé, le petit Jeannin, il se serait vraiment cassé la tête contre un pommier. Mais il aurait eu peur de se faire trop de mal.
Figurez-vous une tête de chérubin avec des cheveux bouclés à profusion, des grands yeux bleus, tendres et timides, et sous sa peau de mouton, hélas ! bien usée, cette gaucherie gracieuse des adolescents.
Il était fait comme cela, le petit Jeannin, et il allait avoir dix-huit ans.
Par exemple, pas un denier vaillant ! Des pieds nus, des chausses trouées, pas seulement une devantière de grosse toile pour remplacer sa peau de mouton qui s’en allait.
Simon Le Priol ne l’avait jamais peut-être regardé. Ce n’était pas un parti. Simon voulait pour sa fille un homme de cinquante écus nantais.
Cinquante écus, grand Dieu ! Chaque écu valant douze livres de vingt sols royaux, à douze deniers tournois le sol (s’il n’est rogné).
Le petit Jeannin n’avait jamais vu tant d’argent, même en songe.
Et, en conscience, est-ce bon pour faire des maris, ces séraphins aux yeux de saphir et aux cheveux d’or ?
Maître Vincent Gueffès disait non.
Parlons de maître Vincent Gueffès.
Front étroit, vaste nez, bouche fendue avec une hallebarde. Dans cette bouche, une mâchoire monumentale, haute, large, solide et ressemblant à ces belles mâchoires antédiluviennes, à l’aide desquelles, quatre cents ans plus tard, les savants devaient reconstruire tout un monde.
La mâchoire de maître Vincent Gueffès, retrouvée par hasard, a dû conduire tout droit à l’idée du mastodonte.
Beaux petits yeux ronds, doucement frangés de rouge, cheveux couleur de poussière, longue taille maigre et droite dans une houppelande faite pour autrui : tel se présentait maître Vincent Gueffès.
Simon Le Priol avait coutume de dire qu’il n’était point laid. Simon Le Priol avait raison, en ce sens que maître Gueffès était affreux.
Du reste, point d’âge. Vous savez, ces bonnes gens ont de vingt-cinq à soixante ans. Passé soixante ans, ils rajeunissent.
Eh bien ! avec cela, maître Gueffès était bas-normand des pieds à la tête. Il avait de l’esprit comme quatre malins de Domfront, sa patrie. Or, un malin de Domfront vaut quatre finauds de Vire qui valent chacun quatre citrouilles de Condé-sur-Noireau, ville où les huîtres naissent à vingt lieues de la mer !
Maître Gueffès était le rival du petit Jeannin, le coquetier. Il trouvait Simonnette charmante, et quand il songeait à la dot de Simonnette, sa mâchoire toute entière se montrait en un épouvantable sourire.