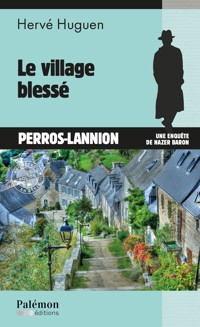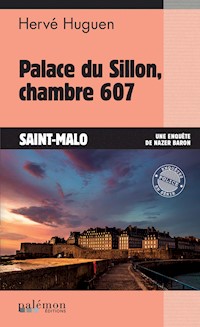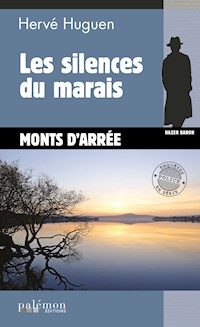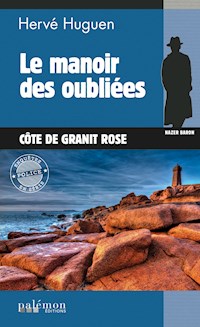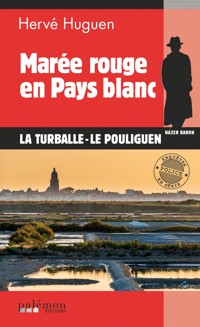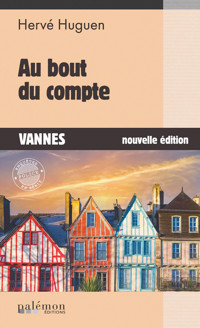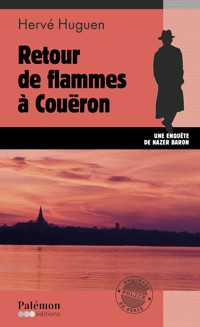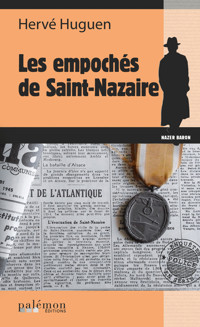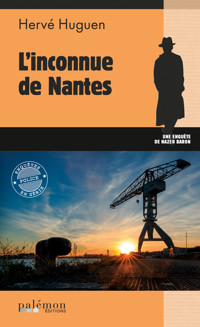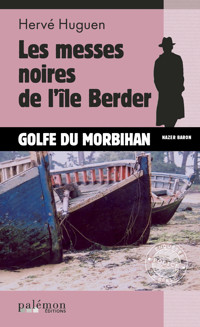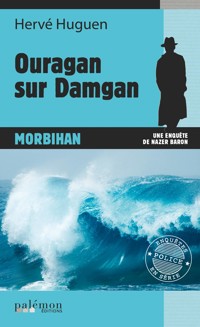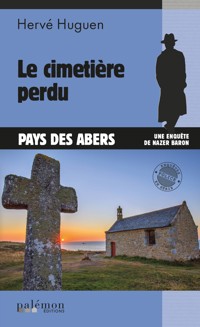Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palémon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Une enquête de Nazer Baron
- Sprache: Französisch
Mathias Montbrun n’avait plus donné signe de vie depuis une semaine lorsque son corps est découvert dans les immenses dunes de la presqu’île de Quiberon. Curieusement, les premières investigations établissent que la mère de la victime avait disparu au même endroit trente ans plus tôt, dans des circonstances jamais élucidées. Mathias, qui s’était disputé avec elle ce soir-là, avait été mis en cause avant d’être finalement relâché. La disparue n’a jamais été retrouvée. Élucider ce vieux dossier pourrait permettre de résoudre l’énigme de la mort de Montbrun. Le commissaire Nazer Baron enquête donc parmi les anciennes relations de Mathias. Ses amis de l’époque, son demi-frère devenu moine dans l’abbaye voisine, son épouse qui est loin de tout dire, une mystérieuse relation féminine, une vieille photo découverte dans un livre… Trente ans plus tard, la vérité est enfouie au milieu des souvenirs cachés.
Un savoureux roman d’atmosphère d’Hervé Huguen, qui nous livre une fois de plus une excellente enquête, à la Simenon, où rien n’est laissé au hasard... Du travail d’orfèvre de la part de cet auteur dont les ouvrages se sont déjà écoulés à plus de 160 000 exemplaires.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Hervé Huguen - Ce nantais, avocat de profession, consacre aujourd’hui son temps à l’écriture de romans policiers et de romans noirs. Son expérience et son intérêt pour les faits divers, événements tragiques ou extraordinaires qui bouleversent des vies, lui apportent une solide connaissance des affaires criminelles.
Passionné de polar, il a publié son premier roman en 2009 et créé le personnage du commissaire Nazer Baron, enquêteur rêveur, grand amateur de blues, qui se méfie beaucoup des apparences…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
CE LIVRE EST UN ROMAN. Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
« Avec un mensonge, on va très loin,Mais sans espoir de revenir en arrière. »
À Marcel Hibert,qui m’a fait découvrir l’ocytocine,Bien amicalement.
PROLOGUE
La femme se tenait debout, à bonne distance de la fenêtre, comme si elle craignait d’être aperçue par quelque passant se promenant le long de la route.
Elle regardait dehors.
Les lueurs rosées du crépuscule irisaient l’herbe grasse du terrain vague, de l’autre côté de la chaussée, au fond duquel se dressait le muret de pierre sèche marquant la limite de Manélio.
De sa place, la femme apercevait le toit d’ardoises de l’ancienne ferme, percé de deux fenêtres en chien-assis, et le sommet des ouvertures du rez-de-chaussée au-dessus de la muraille. Une voiture stationnait dans la cour. Aucune lumière ne brillait au fronton du bâtiment.
La femme n’était pas surprise. Elle savait que la maison était inoccupée. Pourtant elle paraissait guetter en fumant sa cigarette de tabac blond, dont elle tirait paisiblement de longues bouffées qu’elle soufflait ensuite, les lèvres arrondies, pointées en avant, comme si elle s’amusait.
Elle attendait.
Une voix, derrière elle, parlait au téléphone. Une voix d’homme. Elle entendait des bribes de conversation, des demi-mots entrecoupés de silences. Il était question d’un rendez-vous. La femme ne s’intéressait pas vraiment à ce qui se disait…
Elle observait la bâtisse.
Elle rêvait… Il lui arrivait de se souvenir encore, des images flottaient dans sa mémoire, et pourtant tout s’était passé il y avait si longtemps, dans une autre vie, à des années-lumière.
Par une belle nuit d’été…
Elle n’avait pas oublié les cascades de rires qui montaient du jardin… Elle se remémorait l’odeur de la peau du garçon, une odeur de soleil et de chaleur, et le goût salé de ses lèvres lorsqu’il l’avait embrassée… Elle revoyait la chambre, plongée dans une demi-pénombre, comme un îlot perdu au milieu des chahuts de la fête qui battait son plein… Elle ressentait toujours la brûlure de ses épaules rougies lorsqu’elle s’était allongée sur le drap rêche. Le garçon lui avait dit qu’elle avait les seins aussi blancs que ses dents…
Elle l’avait saisi aux reins pour l’attirer…
Et puis la porte s’était ouverte…
Il y avait eu des cris. De la fureur. De la violence… Rien n’avait plus été pareil…
Comme toujours lorsqu’elle revivait ces instants, la femme sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle n’était jamais parvenue à oublier.
Elle regarda la campagne qui ne sentait pas encore la belle saison. Ses pensées s’évaporèrent lentement sous son front, devinrent aériennes et futiles. Elle ne cherchait plus à les retenir. Le soir tombait, l’ombre des arbres s’allongeait sur le remblai.
Elle souleva le bras pour passer une main dans son épaisse chevelure brune. Le geste la fit se cambrer et elle resta ainsi de longues secondes, fourrageant dans les mèches qui lui couvraient la nuque, tout en continuant de tirer sur sa cigarette qu’elle finit par écraser dans un cendrier de verre posé sur la commode.
Elle se rapprocha alors de la vitre.
Qui donc aurait pu la voir ?
Elle habitait à la sortie du village, dans l’une des dernières maisons avant le lacet que traçait la route pour contourner la petite baie des Anges. L’été, la circulation était infernale, mais en ce soir paisible de mars, il ne passait que de rares véhicules filant pour la plupart en direction de la presqu’île. Et puis les branches des pins la protégeaient sûrement, il aurait fallu épier pour l’apercevoir.
Elle se colla presque au carreau, sentit la fraîcheur sur sa peau nue.
Elle avait commencé à se déshabiller tout à l’heure, elle avait ôté sa robe pour ne plus conserver sur elle que sa culotte et son soutien-gorge de dentelle. Son compagnon n’avait pas eu le temps de les lui enlever. Le téléphone avait sonné. L’homme s’était écarté. Depuis elle attendait…
Elle devina que l’échange se terminait enfin.
— À demain…
La femme laissa passer quelques secondes. Le ciel étirait une pelote de filaments roses au-dessus de Plouharnel. Il ferait encore beau demain…
Elle se retourna.
L’homme l’observait depuis le fond de la chambre, les paupières légèrement plissées, le masque encore concentré. Il lui fallait sans doute du temps pour reprendre contact. Pour oublier les mots échangés au cours des minutes précédentes. Pour sentir de nouveau le désir lui agacer les reins.
La femme était quasiment nue. La fine broderie épousait les courbes de son corps comme une seconde peau, transparente. Il discernait les pastilles brunes dessinées sur sa poitrine, et l’ombre au sommet de ses cuisses.
Elle le rejoignit, pinça ses doigts sur sa chemise, défit un premier bouton.
Elle le connaissait depuis si longtemps…
— Alors ?
— Je le vois demain matin, confirma-t-il.
Elle avait compris. Elle posa ses lèvres sur les siennes, fit mine d’hésiter, chercha. Il lui rendit son baiser. Ses mains aux longs doigts fins se plaquèrent sur le dos de la femme. Elle se laissa caresser. Elle sentait son envie.
La chemise était ouverte. L’agrafe de son soutien-gorge venait de se libérer. Elle baissa les bras pour s’en débarrasser. La pointe de ses seins se colla à la poitrine de l’homme. Elle le poussa vers le lit.
*
L’ombre avait noyé la chambre.
L’homme avait ouvert les yeux et s’était retourné pour presser la poire de la lampe de chevet. Puis il avait repris sa position, allongé de tout son long, les épaules collées au drap, les jambes légèrement écartées, les paupières de nouveau baissées. Il semblait dormir.
La femme s’était blottie contre lui, la main posée sur son torse qu’elle caressait d’une manière distraite, le regard ailleurs. Elle rêvassait, détendue, les traits paisibles.
Ils étaient nus tous les deux.
Le silence avait envahi la maison. On n’entendait rien, sinon parfois un léger ronflement de moteur, celui d’une voiture passant sur la route et qui se laissait porter dans les virages. Le bruit s’estompait dans le lointain, au-delà de la baie des Anges. Ou au contraire de l’autre côté, dans les rues du village… Des éclairs blancs transperçaient le rideau de pins et venaient courir sur les murs de la chambre, puis tout s’effaçait… Le noir collait de nouveau un filtre sur les vitres froides, la nuit se faisait de plus en plus épaisse…
La femme frissonna. La fraîcheur picotait sa peau.
Elle se souleva sur le coude et considéra longuement le visage de son compagnon qui paraissait toujours sommeiller, apaisé. Il était brun, avec des cheveux courts surmontant un visage carré, un nez fort, des lèvres fines… Elle se souvenait qu’il avait porté la moustache autrefois, une moustache épaisse qui lui donnait un air trop sévère. Ils étaient ensemble lorsqu’il l’avait rasée, un jour où il ne s’aimait pas. Il voulait changer de tête…
Elle s’approcha de sa bouche, lui fit un baiser léger tout en lui caressant la joue du bout de ses doigts.
— Tu restes avec moi cette nuit ?
Il ouvrit les yeux, examina le décor avec l’attention étonnée d’un enfant brusquement réveillé.
— Je voudrais partir de bonne heure demain matin…
Son regard accrocha celui de la femme penchée vers lui.
— Et je n’ai pas apporté mes affaires…
Elle rit doucement. Il y avait bien longtemps qu’il disposait de tout le nécessaire ici.
— Tu n’auras pas à aller bien loin pour te changer, murmura-t-elle.
Elle poussa sur ses bras, se mit à genoux. Elle était belle, grande, mince, avec des cuisses fuselées et des hanches légèrement arrondies, un ventre plat que soulignait une fine toison, des seins toujours parfaitement galbés… Son corps s’était à peine transformé malgré les années. Il tendit la main pour faire glisser ses doigts sur la peau élastique, en songeant que leur vie aurait pu être tellement différente…
— Tu es certain qu’il te parlera ?
La femme avait osé ces mots. Elle n’était pas inquiète, elle s’interrogeait simplement. C’était à son compagnon qu’elle songeait, à cet homme qu’elle s’était remise à aimer.
Lui non plus n’avait rien oublié, il survivait depuis avec le souvenir atroce d’avoir un jour été soupçonné de meurtre. D’un meurtre inqualifiable.
— Peut-être qu’il ne sait rien, finalement… insista-t-elle avec douceur.
Elle cherchait seulement à le préparer à l’éventualité d’un échec. Tellement d’années plus tard… Tout avait changé. Les choses, les gens… Les souvenirs s’étaient estompés. Les parenthèses honteuses avaient été refoulées. Les mensonges avaient tout recouvert…
Elle vit ses pupilles sombres qui se relevaient, glissaient sur sa peau nue, accrochaient les reflets de lumière dans ses cheveux.
Il resta silencieux. Il ne voulait pas en parler.
La femme se laissa admirer quelques secondes avant de bondir brusquement sur ses pieds.
— Je nous prépare quelque chose.
Il ne protesta pas. Il n’avait pas vraiment envie de rentrer chez lui et de s’y retrouver seul.
— Je te sers un verre ?
Elle se penchait pour ramasser un carré de dentelle qui traînait par terre, et se contenta d’enfiler sa robe dont elle ne referma qu’un bouton sur deux. Il la suivait des yeux. Elle disparut.
Une voiture passait sur la route. Une lumière blanche balaya le mur au-dessus de lui. Il ne vit rien. Il avait de nouveau baissé les paupières.
1
Le chien s’était mis à courir.
C’était la meilleure heure, au jour à peine levé, lorsque le vent marin achevait de sécher la rosée de la nuit qui recouvrait les dunes.
Céliart avait suivi le chemin sablonneux après avoir dépassé la tour de tir du Bégo, hérissée de ses pointes d’acier. L’édifice dominait la côte déserte et sa centaine de bunkers et d’ouvrages bétonnés qui la parsemaient de leurs verrues de mortier. Les vestiges d’un Mur inutile destiné à protéger la base sous-marine de Lorient, depuis l’embouchure de la Laïta jusqu’aux falaises de Belle-Île.
Louis Céliart n’y faisait plus attention. Son père lui avait raconté l’histoire autrefois, lorsqu’en 1941 l’Occupant avait érigé là la plus redoutable des batteries côtières. Le maréchal Rommel avait foulé cette grève. L’ombre du « Renard du Désert » planait toujours sur un site stratégique devenu témoin de la folie des hommes…
Céliart depuis le temps connaissait parfaitement les lieux. Il s’était contenté de rouler à vitesse lente entre les monticules de sable et la végétation rase, la vitre entrouverte pour permettre à son chien d’y glisser sa truffe et de respirer l’air salé. La presqu’île à cet endroit mesurait moins d’un kilomètre de large. La voie butait sur une aire d’arrêt. Céliart y avait abandonné sa voiture auprès d’un camping-car solitaire. À cette époque de l’année, le secteur était merveilleusement sauvage. On entendait le grondement de l’océan invisible de l’autre côté de la dune.
Céliart avait emprunté en soufflant le passage qui permettait de franchir la bosse pour atteindre la côte, avant de libérer son chien qui avait filé en direction de la mer. L’immense plage de la Guérite était en grande partie découverte par la marée basse. Un groupe de marcheurs avançait au loin, vers la plage du Mané Guen et le fort de Penthièvre posé sur l’horizon. Il faisait frais, le soleil allait finir par se lever…
Louis Céliart resta une longue minute immobile, laissant à sa respiration le temps de s’apaiser. Il suivait son chien des yeux sans chercher à le rappeler. La bête n’était pas agressive et connaissait le parcours.
Céliart s’avança finalement jusqu’à la langue de sable humide et se mit à cheminer le long du rivage. Il venait ici plusieurs fois par semaine, depuis des années, déambulant jusqu’à la plage du Mentor avant de revenir sur ses pas à travers les dunes. Ses vieilles jambes ne l’auraient pas porté plus loin, mais cette distance lui convenait encore.
Il resserra le col de son manteau, eut pour son labrador qui pataugeait un coup d’œil qui le rassura et poursuivit tranquillement sa progression le long de l’estran. Le vent se contentait de souffler à petites goulées, faisant à peine frissonner les buissons éparpillés dans les dunes. Seul au monde, Céliart goûtait l’instant. Il aperçut un cavalier qui se rapprochait dans le lointain, venant de Penthièvre, et s’arrêta pour observer. Le cheval trottinait au ras des vagues, dans la lumière changeante qui faisait scintiller les premiers miroitements du soleil.
Les beaux jours comblaient enfin les vides d’un hiver trop long et trop pluvieux.
Tranquillisé, Louis Céliart reprit sa progression, jusqu’à atteindre la trouée qu’il empruntait pour s’engager dans la direction inverse en traversant les étendues de sable. Il émit un petit sifflement auquel le labrador répondit aussitôt. Le chien était docile. Depuis le temps, il connaissait l’itinéraire par cœur…
Céliart repartit sans se tracasser. Son sang s’était réchauffé, il écarta le col de son manteau, laissant la brise légère lui caresser le cou. Il humait l’odeur de la mer toute proche…
Il rêvassait…
Il stoppa son cheminement lorsque le chien se mit à aboyer dans son dos. C’était inhabituel. Il se retourna. Le labrador avait quitté le sentier et se tenait tout près d’une casemate enfoncée dans le sol, protégée par un boudin sablonneux qui la rendait presque invisible.
Le vieil homme siffla un appel auquel l’animal ne répondit pas. Il était en arrêt, le museau tiré en avant, la truffe pointée vers le béton gris du bunker.
Céliart fronça ses sourcils blancs et laissa son regard errer sur le paysage qui l’entourait. Il était seul au milieu d’un univers de sable et de bouquets d’arbustes. Presque un désert.
Il apercevait seulement la route de la presqu’île et les drapeaux signalant le grand blockhaus transformé en musée de la Chouannerie, de l’autre côté des dunes. Pas une silhouette en vue.
Il était trop tôt, trop tôt dans la journée, trop tôt dans la saison.
Le lieu était abandonné.
Louis Céliart effectua quelques pas. Le labrador refusait toujours d’obéir.
Céliart quitta lui aussi le sentier pour fouler le sable vierge. Il se rapprocha. Le chien avait flairé quelque chose. Une bête morte sans doute…
Le cri d’un goéland le fit presque sursauter. Il se traita d’idiot, souffla en escaladant le monticule et plongea aussitôt dans un bain d’eau glacée. Son cœur s’affola. Il ne sentait brusquement plus rien, ni ses jambes ni ses doigts.
Le corps d’un homme était allongé sur le ventre, coincé entre la pente de la dune et le béton gris de la casemate, invisible depuis la piste. Céliart ne voyait que son dos, encore dissimulé par les restes de pelletées de sable, les cheveux bruns qui couvraient sa nuque, sa veste en partie remontée sur ses reins, ses jambes tordues protégées par un pantalon de velours.
Il se recula. L’inconnu n’avait plus besoin d’aide. Il était mort.
Tétanisé, le vieil homme avala une grande goulée d’air, la poitrine soulevée par un brutal jet de bile. Le goéland continuait de crier au-dessus de sa tête. Des appels perçants. Des plaintes d’agonie. Peut-être qu’il avait été témoin de quelque chose…
Céliart avait les genoux flageolants. L’idée d’appeler du secours lui traversa l’esprit. Il gronda, énervé par les criailleries de l’oiseau…
— Phénix !
Avant d’attraper fermement le collier du chien et d’y agrafer la laisse. Il tira pour ramener l’animal vers le chemin.
Son téléphone… Le cerveau engourdi, Céliart ne se souvenait plus du numéro d’urgence. Il sélectionna celui de Suzanne qui l’attendait chez eux.
— Préviens les gendarmes… ahana-t-il. Appelleles. Je suis au Bégo… Il y a un mort dans le sable.
*
Il était arrivé…
Le commissaire Nazer Baron tourna la clé de contact et le silence se fit dans la voiture.
Il avait encore les pensées égarées ailleurs en débouclant machinalement sa ceinture. Il ne bougea pas. Son regard sombre prenait la rue en enfilade, examinait les pavillons dispersés au milieu de pelouses dont certaines conservaient les traces broussailleuses de l’hiver finissant.
Il faisait beau. Un soleil encore timide, à cette heure de la matinée, éclairait le quartier résidentiel. Pas de commerces, pas d’usines. Plus de champs ni de tracteurs. Des villas, des haies, des bouquets d’arbustes piqués dans les jardins… Des allées toutes droites… Une cité-dortoir, à quelques encablures de l’hippodrome de Cano et des rives du Golfe du Morbihan…
Baron se décida à ouvrir sa portière et posa le pied sur le trottoir. Il était garé pratiquement en face de l’adresse qu’il cherchait. Une construction trapue, carrée, aux murs blancs égayés par des volets en bois recouverts d’un bleu grec. La pelouse avait été tondue récemment, l’air diffusait une vague odeur d’herbe fraîchement coupée, tout était propre, rangé. Une petite Nissan rouge stationnait dans l’allée menant au double garage.
Baron traversa la chaussée et emprunta le chemin dallé conduisant au perron, avant de sonner à la porte, qui s’ouvrit pratiquement aussitôt. Il était attendu, la femme devait guetter.
Âgée d’une cinquantaine d’années, elle était blonde, avec des cheveux tirés en arrière qui lui dégageaient les oreilles, des yeux vert pâle, une bouche aux lèvres rougies. Elle était plutôt petite, malgré ses chaussures à hauts talons.
— Madame Montbrun ? vérifia-t-il.
Il la sentait tendue, inquiète sans doute.
— Commissaire Baron…
Il l’avait appelée pour la prévenir de sa visite. La procureure, la veille, le lui avait demandé comme un service. La magistrate ne savait pas quoi penser, elle avait besoin d’être renseignée…
La femme opina avant de laisser Baron entrer, et de le guider dans un salon dont la fenêtre donnait sur la rue.
— Asseyez-vous.
Elle parlait d’une voix légèrement pointue, comme éraillée. Une voix fatiguée, à l’élocution lente. Ses gestes aussi paraissaient freinés par une force invisible.
Elle se posa en face de lui et il en profita pour l’observer. Elle clignait des paupières dans un visage fripé, elle avait les mains serrées, les épaules tombantes… L’allure démantibulée d’un pantin sans énergie. Elle ne dormait probablement plus depuis plusieurs jours. C’était elle qui avait donné l’alerte. Sa démarche auprès de la gendarmerie locale n’avait pas été couronnée de succès, il fallait attendre. Alors elle avait appelé la procureure qu’elle connaissait…
Cela faisait exactement une semaine que Mathias Montbrun avait totalement disparu. L’homme s’était évaporé. Sans laisser traîner derrière lui la moindre trace, sans abandonner le moindre indice. Sans adresser depuis le moindre signe.
— Voulez-vous boire quelque chose ? Un café ?
Il accepta. Il était dix heures à peine… Il resta silencieux pendant qu’elle s’activait dans la cuisine. Le soleil réchauffait doucement la pièce. La transparence de l’air, dehors, annonçait sans doute une belle journée, mais la couleur du ciel demeurait indécise.
L’été ne frappait pas encore aux portes et mettrait du temps avant de franchir le seuil. Baron était désormais impatient. Il avait besoin de chaleur pour dégeler sa propre vie. L’hiver avait été très long.
— Servez-vous en sucre…
Christèle Montbrun retrouvait sa place. Elle lissait machinalement sa jupe avant de se poser sur le coussin du fauteuil, les genoux serrés, les avant-bras placés sur les cuisses.
— C’est vous qui êtes chargé des recherches ?
Il opina avec une légère retenue. Il n’y avait pas vraiment de recherches, pas encore. La procureure hésitait à ouvrir une enquête officielle. Des disparitions, on en comptait des milliers chaque année. Mais compte tenu de la personnalité de Mathias Montbrun, l’hypothèse d’une simple fugue ne la convainquait pas vraiment… L’homme ne donnait plus de nouvelles depuis des jours, ni à son employeur, ni à sa famille. Son téléphone était coupé, sa voiture introuvable. Il s’était volatilisé.
Il en avait le droit… Rien n’était impossible.
— Nous ignorons ce qui a pu arriver à votre mari, madame Montbrun, préluda Baron en se saisissant d’une des tasses. J’ai besoin de le connaître mieux.
Il s’était laissé aller en arrière, le regard attentif posé sur la femme qui ne changeait pas d’attitude. Il se forgeait simplement sa première impression. Celle qui resterait. Beaucoup de gens disparaissaient, la plupart étaient retrouvés. Pas tous… Alors ? Mathias Montbrun ? Accident, fugue, suicide… Autre chose ?
— Vous êtes mariés depuis vingt-sept ans, c’est ça ?
C’était la première hypothèse, celle à laquelle tout le monde pensait. Une crise. Montbrun avait fui le domicile conjugal.
— En juin prochain.
— Et vous avez deux enfants, un garçon et une fille, majeurs, qui vivent à Vannes… Eux non plus n’ont aucune nouvelle de leur père depuis une semaine ?
— Aucune.
Il laissa filer un temps de silence. Il continuait de la fixer.
— Vous avez ouvert un cabinet de podologie, rue du Mené, poursuivit-il finalement sur un ton de récitation, et votre mari est employé depuis une vingtaine d’années par la Sogotec, à Rennes.
— C’est un laboratoire pharmaceutique. Il est chercheur.
— Mais vous habitez toujours Vannes. Donc votre mari fait le déplacement toutes les semaines ?
Elle acquiesça d’un léger mouvement du menton.
— Mathias a toujours vécu au bord de la mer, confirma-t-elle, il ne se voyait pas s’installer à Rennes. Et de toute façon il voyage beaucoup pour son travail, à Paris, à l’étranger parfois, il participe à des colloques… Ça ne le dérange pas de vivre ici. Et j’aurais dû céder mon cabinet pour recommencer ailleurs… Mathias a préféré cette solution.
— Donc il s’absente toute la semaine ?
— Il part le lundi en fin de matinée et rentre généralement dans l’après-midi du vendredi. Les autres jours, il n’hésite pas à travailler très tard.
— Il dispose d’un logement, à Rennes ?
— Un appartement, dans le quartier de Bréquigny.
Une patrouille s’était déplacée à Bréquigny. Montbrun n’y était pas, les voisins ne se souvenaient pas de l’avoir vu depuis plusieurs jours.
Baron bougea dans son siège, donna l’impression de déplacer le cours de ses pensées.
— Votre mari a quitté votre domicile lundi dernier, le 20 mars. Comme il le fait chaque début de semaine. Sans vous annoncer quoi que ce soit de particulier.
— Il repartait à Rennes.
— Je suppose qu’il avait une valise avec lui ?
— Il emportait de quoi faire sa semaine.
— Rien d’autre n’a disparu ?
— Je ne crois pas.
— Et vous étiez là lorsqu’il est parti ?
— J’étais à mon cabinet. J’avais des rendez-vous. Mathias se préparait lorsque je l’ai quitté, un peu avant neuf heures…
— Vous ne l’avez pas senti préoccupé… ? Ou inquiet, simplement différent des autres jours.
— Je n’ai rien remarqué…
Baron hocha la tête. Il voyait une rougeur sur le front de Christèle Montbrun, une marque entre les sourcils. Signe de stress.
— Il est dépressif ? questionna-t-il brusquement.
C’était la seconde hypothèse.
— Non.
Le mot avait jailli un peu vite. Un réflexe. L’expression du visage de la femme s’était transformée, les joues s’étaient creusées de rides.
Elle avait les yeux rapetissés par une sorte de pressentiment. La peur, songea Baron, la peur de ce que cela pouvait impliquer. Dépressif… Elle avait dû y songer très fort.
— Il suit un traitement médical ?
— Aucun.
— Il aime son travail ?
— Il est passionné.
— Et tout se passe bien entre vous ?
— Il n’y a aucun problème…
L’effort la laissait essoufflée. Le besoin de convaincre.
— Tout était normal pendant le dernier week-end ?
— Mathias est arrivé le vendredi, comme d’habitude… Il est sorti pour une promenade en mer le samedi, et nous étions chez notre fils le dimanche. Tout s’est bien passé. Nous sommes rentrés assez tard, nous nous sommes couchés aussitôt. Mathias a mis son réveil… Il ne m’a parlé de rien qui aurait pu le contrarier.
Baron avait vidé sa tasse tout en l’écoutant, la mine songeuse. Il observait toujours du coin de l’œil le faciès tendu de Christèle Montbrun. Il se demandait si elle mentait.
Elle avait déjà raconté tout cela, avec les mêmes mots, les mêmes phrases teintées d’hésitations. Seulement depuis, les contrôles de routine déclenchés par la procureure avaient un peu fait évoluer la perspective. Pas assez, mais le commissaire avait au moins une certitude. Le bornage du téléphone de Mathias Montbrun prouvait qu’il n’avait sûrement pas consacré son samedi à une promenade en mer. Il était ailleurs…
Elle pouvait l’ignorer… Mais elle était aussi la dernière à avoir vu Mathias vivant le lundi matin.
— Que s’est-il passé ensuite ? demanda-t-il sans insister pour l’instant. Votre mari est parti et vous n’avez eu aucune nouvelle de lui au cours des premiers jours de la semaine. Ça aussi, c’était normal ?
— Ça n’avait rien de surprenant, se justifia-t-elle. Mathias est très occupé…
— Mais vous avez cherché à le joindre le mercredi.
— À cause d’un courrier que j’avais reçu le matin. Je voulais en discuter avec lui. Seulement son téléphone était coupé. Alors j’ai appelé le laboratoire, j’ai demandé à lui parler.
— Et c’est comme ça que vous avez appris qu’il n’y avait plus mis les pieds depuis la semaine précédente.
Elle hocha doucement la tête.
— La secrétaire a été surprise que je ne sois pas au courant. C’est elle qui m’a annoncé que Mathias avait pris quelques jours de congé, il avait prévenu qu’il ne serait pas là avant mercredi ou plus probablement jeudi. Il n’avait pas dit pourquoi…
— Vous avez insisté ?
— Je l’ai rappelé plusieurs fois au cours de la soirée, mais c’était toujours la messagerie. Alors j’ai recommencé jeudi matin, sans succès. J’étais inquiète. C’est pour ça que je suis passée à la gendarmerie dans l’après-midi. Personne n’avait revu Mathias au laboratoire.
— Que vous a-t-on dit ?
— Qu’il fallait attendre, que quelques jours d’absence n’étaient pas alarmants. Mathias pouvait avoir été retardé.
— Ça lui est déjà arrivé, de disparaître comme ça sans vous avertir ?
— Non…
Elle avait encore répondu trop vite. Elle hésita à poursuivre en grimaçant ses doutes.
Elle s’était mise à regarder ses doigts comme si elle les voyait pour la première fois.
— En fait…
Elle avait dû y songer durant des heures, ressasser les souvenirs, découvrir des épisodes qui ne l’avaient pas alertée sur l’instant mais qui pouvaient désormais prendre un tout autre sens.
Des retards… Des oublis. Des silences… Peut-être pas anecdotiques.
Des idées sombres avaient dû lui traverser la tête.
— Nous vivons chacun de notre côté pendant toute la semaine depuis des années, se désola-t-elle.
Elle laissa les mots s’éteindre. Elle n’avait pas du tout l’air serein.
— Je ne sais pas toujours où il est. Et lorsque je l’appelle, il peut me répondre n’importe quoi depuis n’importe où.
— Vous pensez que ça a pu être le cas ?
Elle ne répliqua pas tout de suite. Elle avait remué les épaules.
— Je ne crois pas…
Sa voix depuis le début paraissait buter sur les mots. Baron en avait entendu beaucoup, des voix comme celle-là, il avait appris à les distinguer. Des voix fragiles, mal maîtrisées, qui à elles seules signifiaient autant que les phrases qu’elles prononçaient.
Des mensonges peut-être…
Ou des incertitudes simplement.
Christèle Montbrun ne savait pas. Elle ne savait plus.
— Je me dois de vous poser la question, madame Montbrun, formula-t-il.
Il laissa planer le silence. Elle se doutait de ce qu’il allait dire.
— Pensez-vous que votre mari puisse avoir une liaison ?
Elle lui lança un regard froid et ne réagit pas.
— Il a dépassé la cinquantaine, insista Baron. Vous êtes mariés depuis vingt-sept ans, il vit seul à Rennes toute la semaine…
Les yeux de Christèle Montbrun ressemblaient à un paysage lunaire, désespérément vide. Le vert pâle avait viré au gris, un gris poussière. Elle avait la chair de poule.
— Il n’est pas impossible qu’il ait rencontré quelqu’un.
— Je sais… opina-t-elle presque à contrecœur. N’importe quelle femme y aurait songé… Une maîtresse. Je me suis dit qu’il avait pu avoir l’envie de s’accorder trois jours avec elle dans un hôtel discret, à l’abri du monde, téléphone coupé…
Pourtant elle n’y croyait pas tout à fait. Elle hocha la tête, peu convaincue.
— Mais pourquoi aurait-il annoncé à la Sogotec qu’il serait de retour jeudi ? Il serait effectivement rentré depuis, non ? Personne n’a de nouvelles de lui au laboratoire… Et il n’aurait pas coupé son téléphone ! Il m’aurait menti peut-être, mais il serait revenu ce week-end ! Ou il m’aurait appelée, il aurait appelé ses enfants.
Elle se massa le front, juste au-dessus des sourcils, là où se situait la tache rouge, comme pour chasser la tension nerveuse.
— Mathias ne nous aurait pas quittés comme ça.
Elle en était persuadée.
Baron évita de commenter. Il traduisait le sens des mots qu’elle assénait, leur véritable signification. « Comme ça… » Elle voulait simplement dire d’un coup, sans prévenir, sans discuter. Elle acceptait l’idée que Mathias avait peut-être rencontré une autre femme, mais jamais l’homme qu’elle avait épousé ne serait parti comme ça… !
Il aurait pu lui répondre qu’il avait connu des gens qui avaient tout abandonné du jour au lendemain, sans signes avant-coureurs. Ils avaient disparu. On les retrouvait. Ils ne voulaient pas que leurs proches soient informés de leur nouvelle vie…
Il reposa la tasse vide qu’il avait conservée à la main.
— Que pensez-vous qu’il soit arrivé à votre mari ?
— Je n’en sais rien. Ça fait huit jours maintenant… Lorsque j’ai vu qu’il ne rentrait pas vendredi, j’ai appelé la procureure. Je la connais un peu, il nous arrive de jouer au bridge ensemble.
On aurait dit qu’elle parlait du bout des lèvres, sans grande conviction, parce qu’elle avait la tête ailleurs.
Baron se pencha vers elle.
— Nous sommes certains qu’aucun accident dans lequel il aurait pu être impliqué n’a été signalé, dit-il en la fixant. Nous avons contacté les services d’urgence, les hôpitaux… Il n’y est pas.
C’était la troisième hypothèse. Depuis une semaine, une voiture sortie de la route ou tombée dans un ravin quelconque aurait été découverte.
— L’opérateur nous a transmis le relevé détaillé de ses appels.
— Et alors ?
— Son téléphone a borné pour la dernière fois à Plouharnel mercredi dernier.
Cette fois elle réagissait, après un temps de silence, la mine concentrée.
— Je m’en doutais ! souffla-t-elle en gonflant la poitrine. Je me doutais qu’il était allé là-bas !
— Où ?
— Chez lui !
— Il possède une résidence dans la presqu’île ?
— Il en a hérité de ses parents lorsqu’ils sont morts…
Elle remua la tête, découragée.
— Il y va parfois… Seulement si ce que vous dites est vrai et qu’il y est allé, il n’y est plus. J’ai vérifié.
Elle se tut. Un ange avait balayé la poussière dans ses yeux. Elle observait le commissaire d’un regard attentif, plus précis.