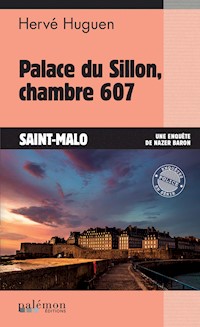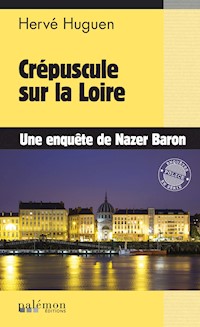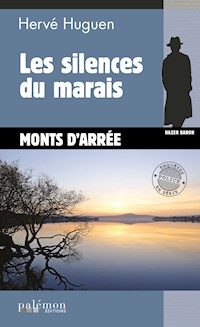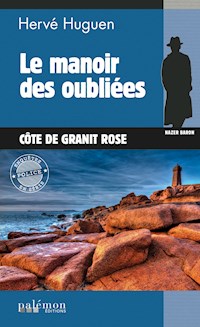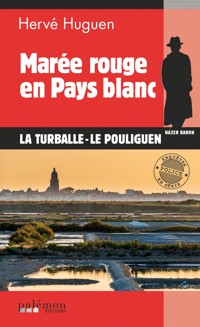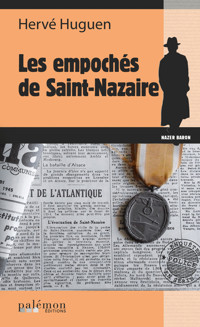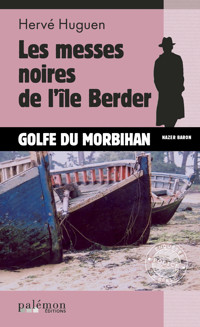Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du commissaire Baron
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
La découverte d'un couple mort va lancer le commissaire Nazer Baron dans une nouvelle enquête palpitante !
Un couple d’artistes est retrouvé mort à son domicile, dans le centre-ville de Nantes. La femme était animatrice d’ateliers théâtre, l’homme acteur, metteur en scène, auteur.
L’hypothèse d’un cambriolage qui aurait mal tourné ne retient pas l’attention des enquêteurs. La maison n’a pas été fouillée par l’assassin, seuls les ordinateurs ont disparu.
Qui était visé ?
Pour le découvrir, le commissaire Nazer Baron va suivre la piste de Nantes à Anvers, sans jamais perdre de vue qui étaient les victimes dans la réalité : des saltimbanques rompus à l’art du mensonge et de la dissimulation, des comédiens formés pour vivre des dizaines de vie…
Et peut-être des acteurs capables de mettre en scène leur propre existence… ou leur propre mort…
De Nantes à Anvers, découvrez les secrets que cachait le couple d'artistes retrouvés morts dans une formidable enquête pleine de rebondissements.
EXTRAIT
Le commandant respira, tendu, et par gestes, fit comprendre à Conny qu’ils devaient d’abord contrôler les deux dernières pièces. Celle de gauche en priorité, qui donnait sur la rue. Volets ouverts, il l’avait noté depuis l’extérieur. Ils se positionnèrent de part et d’autre de l’entrée, Arneke manœuvra brusquement la poignée et poussa avec force. La porte rebondit sur la butée. Une chambre vide, équipée d’un lit double.
Ils se tournèrent vers l’ultime ouverture. Mêmes gestes. Une salle de bains, déserte également. Il souffla et rengaina lentement son Sig Sauer avant de revenir vers le bureau, dans lequel il n’entra pas.
L’homme mort avait une bonne soixantaine d’années, et des cheveux gris encore épais encadrant un visage carré, dans lequel des plis formaient comme des cicatrices. Il avait dû être beau, les années lui avaient creusé des rides qui ne l’enlaidissaient pas. Une gueule…
Il était assis par terre, les épaules collées aux étagères, la jambe droite repliée sous lui. Il y avait eu bagarre, des dossiers et des livres s’étaient écroulés, un synthétiseur appuyé contre le mur avait été renversé.
Arneke plia les genoux. L’homme était torse nu, il s’était contenté d’enfiler un pantalon dont il avait simplement accroché le bouton, la ceinture pendait de part et d’autre de la braguette qu’il n’avait pas pris le temps de refermer. Il ne portait rien dessous.
Sa poitrine était couverte de sang. Et dans la lumière intense chutant du plafonnier, on distinguait nettement les marques de coups et les coupures qu’il portait aux bras.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Hervé Huguen - Ce nantais, avocat de profession, consacre aujourd’hui son temps à l’écriture de romans policiers et de romans noirs. Son expérience et son intérêt pour les faits divers, événements tragiques ou extraordinaires qui bouleversent des vies, lui apportent une solide connaissance des affaires criminelles. Passionné de polar, il a publié son premier titre en 2009 et créé le personnage du commissaire Nazer Baron, enquêteur rêveur, grand amateur de blues, qui se méfie beaucoup des apparences…
La dernière mise en scène est le quinzième volume de cette série aux intrigues bien ficelées et aux protagonistes attachants…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
CE LIVRE EST UN ROMAN.
Si ce roman tire son action de faits authentiques, les personnages et les lieux sont fictifs, de sorte que nul ne pourrait prétendre désigner qui que ce soit dans les protagonistes de cette histoire. La part de création ne saurait non plus prêter à interprétation. Ce livre est un roman, dans lequel l’auteur apporte au lecteur une solution qui reste le fruit de son imagination.
À Manon, mon interprète…
Celui qui dit un mensonge ne prévoit point le travail qu’il entreprend, car il faudra qu’il en invente mille autres pour soutenir le premier
Alexander Pope
Aucun homme n’a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge
I
La porte se referma avec un claquement sec dans le dos d’Anne Jouanet.
Le chat, lové sur le rebord de la fenêtre, se contenta d’écarter les paupières pour voir qui le dérangeait. Il eut pour la jeune femme un regard empreint d’une certaine pitié et replongea aussitôt dans son sommeil. Il allait être 11 heures, une heure raisonnable pour refermer une porte un peu sèchement un samedi matin.
Son regard bleu pâle brillant d’une lueur indécise, Anne Jouanet ne bougea pas tout de suite. Debout sur le perron, elle prit le temps d’ajuster le foulard qui lui protégeait le cou, tout en observant d’un œil critique les marbrures dessinées par le ciel d’hiver.
Elle se contenta de hocher la tête. Le temps resterait beau, froid sûrement mais sec, au moins dans l’heure qui venait. Peu de risques de prendre la pluie avant d’être rentrée.
Tranquillisée, Anne Jouanet se décida à descendre les trois marches menant à l’allée du jardin et avança résolument vers le portillon fermé de la cour. Le quartier était encore à moitié endormi, l’air ne vibrait que du bruit des moteurs filtrant depuis la rue Paul Bellamy, au-delà des immeubles.
Machinalement, le regard d’Anne Jouanet s’était porté en direction de la propriété voisine, en partie cachée par les frondaisons de la haie, de l’autre côté du muret mitoyen. Elle ne vit personne, mais la lumière brûlait à l’étage, dans la pièce qui servait de bureau à Axel Puggioni.
Anne n’enregistra aucun mouvement, en dehors des roucoulades d’un couple de pigeons prenant la pose sur les tuiles faîtières, en ébrouant leurs têtes rondes comme un sémaphore signalant des dangers inaudibles. Pas un bruit ne sortait de la maison.
Elle atteignit la grille, qui pivota sur des gonds bien huilés, et tourna franchement les yeux au moment de sortir dans la rue, espérant apercevoir son voisin pour le saluer de la main. Elle aimait bien Axel. L’homme, avec son côté artiste et l’existence un peu marginale qu’il avait menée, avait toujours un tas d’histoires à raconter.
Peine perdue. Le rideau en partie tiré ne laissait entrevoir qu’une portion de plafond et le haut d’une cloison couverte de livres, mais aucune silhouette ne se dessinait derrière les vitres.
Anne referma le portillon.
Le ciel bouché diffusait une lueur grise dans laquelle elle n’aperçut pas le moindre passant arpentant les trottoirs de la rue des Capitaines de Clerville. L’artère, à sens unique, était bordée de véhicules en stationnement pour la nuit. Anne resserra une nouvelle fois son col et partit sur la gauche, adoptant aussitôt un pas pressé destiné à la réchauffer. L’air froid lui piquait les joues.
Ce fut en remontant la rue de Savenay, en direction du marché de Talensac, que son imagination vagabonde la fit soudain s’interroger. Elle regarda le trafic s’écoulant lentement vers la place de Bretagne et ralentit machinalement l’allure, ses sourcils fins légèrement froncés. Même si elle n’y avait pas prêté attention sur l’instant, elle était maintenant parfaitement certaine de ce qu’elle avait vu.
Aucun doute ! Les volets du rez-de-chaussée de la maison d’Axel Puggioni n’étaient pas ouverts.
Étrange tout de même… Une légère crispation d’étonnement parcourut le visage d’Anne Jouanet l’espace d’une seconde.
Ni Axel ni Pauline n’étaient des lève-tard, d’autant plus qu’Axel aimait se promener dans le jardin après avoir avalé son petit-déjeuner. Il y fumait sa première pipe du jour en respirant l’air du matin, c’était, disait-il, sa manière à lui de s’ouvrir l’esprit et de pénétrer dans les mondes imaginaires qu’il explorerait dans les heures suivantes.
À 11 heures passées…
Anne s’adressa une grimace perplexe. Bizarre… Elle reprit sa marche rapide. Après tout, ce n’étaient pas ses 66 printemps qui empêchaient Axel d’être toujours attiré par sa compagne. Il avait parfois des regards qui ne trompaient pas. Pauline Cariou était une belle femme, d’une dizaine d’années plus jeune qu’Axel… Un retard d’affection à rattraper peut-être. C’était une chance…
Anne traversa la rue de Bel Air.
Il y avait du monde sur la place. La tour Bretagne dressait en point de mire ses 144 mètres de béton inhumains. Un doigt d’honneur en direction des avions qui survolaient parfois d’un peu trop près les toits du centre-ville, à l’approche de Nantes Atlantique.
Anne pénétra sous la halle du marché de Talensac et se perdit dans la foule qui se pressait le long des boutiques. C’était devenu un rituel. Elle erra sans se presser d’un étal à l’autre. Les commerçants la connaissaient. Elle acheta ce qu’elle avait prévu, se laissa tenter par deux ou trois extras qui lui faisaient envie et après une dernière flânerie dans le marché en plein air, décida qu’il était temps de rentrer. Elle fit un détour par le débit de tabac de la rue Paul Bellamy pour y prendre le journal et entama le chemin du retour.
Il allait être midi. Jacques devait toujours être occupé à remplacer un bout de tuyau légèrement poreux, sous l’une des vasques de la salle de bains. Le bricolage n’avait jamais été son fort. Quant à leur fille Caroline, 16 ans d’âge et le caractère qui allait avec, Anne espérait quand même la trouver enfin levée.
Elle poussa le portillon et ne put s’empêcher de regarder une nouvelle fois par-dessus le muret et la haie. Rien n’avait bougé depuis une heure. Les volets du rez-de-chaussée de la maison voisine étaient bien clos, et la lumière brûlait toujours à l’étage. Anne traversa la cour, emprunta l’allée, grimpa les trois marches et souffla en pénétrant enfin dans sa cuisine.
Elle avait vu juste. Caroline, en gros pull-over de laine enfilé sur sa chemise de nuit, tripotait son téléphone en agitant les pouces à une vitesse vertigineuse. Elle releva à peine la tête. Anne posa son sac sur la table et se débarrassa de son foulard et de son manteau.
— Papa est toujours là-haut ? s’inquiéta-t-elle.
Caroline haussa les épaules.
— Ça fait une heure. Je n’ai toujours pas pris ma douche.
Donc il y était. Anne embrassa sa fille sur le front.
À peine parti, le message recevait déjà une réponse. Désormais, on ne se parlait plus, on s’écrivait. Si possible en langage codé. Anne Jouanet avait abandonné l’idée d’émettre un avis sur le sujet, c’était un combat déjà perdu.
Elle rangea ses courses, plia le sac, eut envie de se faire chauffer un thé. Caroline râlait, la tête toujours penchée.
Ses doigts s’agitèrent avec frénésie. Les nouvelles devaient être mauvaises. Anne renonça à s’y intéresser.
— Tu as entendu, cette nuit ? demanda soudain Caroline, libérée pour un temps de l’ultra priorité des réseaux sociaux.
— Quoi ? questionna sa mère, dressée sur la pointe des pieds pour sélectionner une boîte de thé vert Britley sur une étagère haute.
— Il y a eu du bruit à côté.
— Quel bruit ?
Caroline se contenta de remuer les épaules. Elle n’avait pas le temps d’expliquer. Le portable bipait de nouveau. Une urgence, très certainement.
— Tu as entendu quelque chose ? insista Anne.
— Comme du verre cassé… Et puis je ne sais pas quoi après…
Anne contracta légèrement les sourcils. La conversation était hachée. Caroline tapait une réplique qui ne pouvait attendre.
— Chez Axel ? s’irrita sa mère.
— Ben oui !
— À quelle heure ?
— Je ne sais pas, moi, 1 heure…
Anne resta silencieuse. Elle ne risquait pas d’avoir entendu. Leur chambre donnait de l’autre côté, et de toute façon, ils dormaient. Mais celle de Caroline ouvrait sur la cour, donc directement sur la maison d’Axel Puggioni.
Elle posa une tasse devant elle. Un bruit de verre brisé… à 1 heure du matin ! Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée de la villa étaient protégées et lorsqu’elle était sortie, elle n’avait rien remarqué d’anormal aux ouvertures de l’étage. Elle défit un sachet de thé, la mine songeuse. Sans trop savoir pourquoi, la question la tarabustait.
— Je vais voir s’il y a du courrier, décida-t-elle.
Elle prit la clé et ressortit pour traverser le jardin. La boîte était vide. Depuis le portillon, ses yeux se portèrent sur la façade de l’habitation voisine. Pas un frémissement dans les pans du rideau que personne n’avait écartés. Et cette lumière toujours allumée, ces persiennes closes au rez-de-chaussée… Décidément étrange. Anne remonta la cour en longeant le muret. La haie n’était pas épaisse, elle voyait distinctement toute l’étendue de la cour voisine.
Elle s’immobilisa.
La voiture du couple était à sa place, garée dans l’allée, un Volvo break assez ancien, de couleur noire. L’unique fenêtre du pignon, en partie dissimulée derrière un buisson, était elle aussi obstruée par ses volets fermés, de gros vantaux de sapin que Puggioni avait lui-même repeints l’été précédent.
Anne reprit sa progression. Du fond de son jardin, elle ne voyait l’arrière de la bâtisse qu’en diagonale, mais c’était suffisant pour constater que là aussi, tout était fermé. Pas de vitre accessible. Donc pas de carreau cassé. Caroline avait rêvé.
Sûrement.
Ou alors…
Le regard clair d’Anne Jouanet s’était fait plus aigu. De sa position, elle distinguait mieux l’ouverture du pignon, derrière le feuillage touffu du buisson. Et ce qu’elle observait maintenant lui paraissait tout à fait singulier. Une grosse pierre avait été posée sur le rebord de la fenêtre, sans autre utilité que de maintenir les deux panneaux fermés de l’extérieur ! Incompréhensible.
Elle respira plus fort.
Une sorte d’angoisse sourde montait maintenant au creux de son ventre. Elle fixa la maison. Inhabitée. Vide. Morte, eut-on dit…
Il y avait pourtant de la lumière dans le bureau, la voiture stationnait dans l’allée… les signes d’une présence. Et ce bruit entendu par Caroline. L’imagination d’Anne faisait le reste.
Elle rentra chez elle. Jacques en avait terminé avec son bricolage.
— C’est fait, dit-il lorsqu’elle pénétra dans la cuisine. Plus de fuite…
Il était satisfait. Il tourna la tête, ravala son sourire.
— Ça ne va pas ?
Non, ça n’allait pas. La crainte prenait de la consistance. Une espèce de prémonition. Son mari la fixait.
— Caro t’a dit ? articula-t-elle précipitamment. Elle a entendu du bruit chez Axel cette nuit, une vitre cassée.
— Et alors ?
— Il y a de la lumière à l’étage, mais tous les volets sont fermés. La voiture est dans l’allée. Je n’ai vu personne.
Il resta un peu confondu. Axel Puggioni n’était pas son ami… Et il était loin de partager l’opinion de sa femme sur le prétendu attrait de leur voisin.
— Et alors ? répéta-t-il.
Il jugeait l’homme hâbleur et probablement mythomane, sous le prétexte nébuleux qu’il lui était arrivé de croiser quelques célébrités qui ne devaient même pas se souvenir de lui.
Il haussa les épaules.
— Ils ont le droit de partir en week-end, émit-il finalement avec une indifférence appuyée.
— En laissant allumé ?
— Ils n’ont pas fait attention.
— Et ils sont partis à pied ?
Il fit la moue, conciliant.
— En taxi, en bus, en tram, chérie… souffla-t-il en s’accompagnant d’un balayage de la main… Ou ils continuent de dormir. Où est le problème ?
— Je te dis que Caro a entendu du bruit ! Et les volets de la cuisine sont retenus par une pierre, à l’extérieur.
Jouanet remua la tête, un peu navré. Chacun chez soi. Il n’aurait pas aimé que ses voisins se mêlent de sa vie privée pour une ampoule qu’il aurait laissée allumée ou un caillou posé sur le rebord d’une fenêtre… ni pour un bruit de verre brisé qui pouvait provenir de n’importe où dans un quartier urbain tel que le leur…
Il ne comprenait pas qu’Anne se mette dans un état pareil pour quelques bizarreries qui s’expliqueraient probablement parfaitement.
— Tu ne veux pas aller voir ?
— Voir quoi ?
Elle se contenta d’une grimace. Il se décolla du plan de travail contre lequel il s’appuyait.
— J’y vais, soupira-t-il, complaisant. Appelle-les pendant ce temps-là, tu verras bien…
Il sortit sans enthousiasme pour constater qu’Anne n’avait rien inventé. Il longea le muret. La maison paraissait effectivement vide. Rien d’anormal un samedi midi. Bien sûr, il y avait cette lumière qui brûlait à l’étage, mais ça ne signifiait pas grand-chose. Un oubli… Ça lui était arrivé à lui aussi. Et à Anne probablement… La pierre qui bloquait les vantaux par contre… Axel Puggioni n’était pas un crétin. Si les ferrures du volet avaient lâché alors qu’il devait s’absenter, il aurait bricolé une attache à l’intérieur, pas posé un simple pavé qui, évidemment, ne protégeait rien. Autant laisser ouvert…
— Ça ne répond pas, affirma Anne en le rejoignant. J’ai appelé deux fois.
Il hocha la tête avant de répéter :
— Ils sont sortis, c’est tout…
Il n’en était plus vraiment certain.
Son indifférence laissait quand même la place à un sentiment mitigé.
— Je vais sonner… décida-t-il.
Cette fois, il agissait.
Il passa dans la rue en laissant le portillon ouvert, s’approcha de la grille de la propriété voisine et pressa le bouton de la sonnette, l’œil rivé sur la fenêtre éclairée. Rien ne bougea. Pas même un frémissement des rideaux. Il s’y attendait. Si les occupants des lieux avaient été en train de dormir, la sonnerie du téléphone les aurait réveillés, ils auraient fini par répondre.
Anne l’avait suivi sur le trottoir. Jacques essaya d’ouvrir la herse, qui résista, fermée à clé. Escalader relevait de l’impossible. Le mur d’enceinte, haut de près de deux mètres, se hérissait de vieux tessons de bouteilles scellés par un ancien propriétaire. Quant à la grille elle-même, elle était surmontée de pointes de lance sur lesquelles on risquait tout simplement de s’embrocher.
Restait le muret mitoyen, facilement franchissable.
— Tu vas voir ?
Il hocha la tête. Ils se faisaient probablement des idées. Il serait toujours temps de s’expliquer si Puggioni, arrivant d’on ne sait où, le surprenait dans son jardin.
Jouanet repassa le portillon et enjamba résolument le muret. Il traversa sans peine la haie aux ramures décharnées et marcha vers le buisson. L’ouverture donnait sur la cuisine, il le savait pour avoir répondu à deux ou trois invitations du couple. Il souleva la pierre et tenta d’attirer à lui l’un des volets de sapin. Libéré de sa cale, le vantail pivota sans peine et Jouanet ressentit une brutale contraction dans la poitrine.
L’une des vitres avait bien été brisée.
Il se pencha. La lumière extérieure éclairait suffisamment l’endroit pour permettre de distinguer le mobilier. Dans le fond, la porte entrouverte laissait passer un rai de lumière tombant de l’étage.
— Il y a quelqu’un ?
Sa voix parut se heurter aux cloisons et rebondir dans l’espace vide.
— Ohé ! insista-t-il. Axel, vous êtes là ? … C’est Jacques, votre voisin !
Efforts inutiles. Les murs ne renvoyaient aucun écho. Ni murmure ni craquement. Seulement une quiétude épaisse, une atmosphère presque palpable, un silence de…
Jacques Jouanet se redressa avec une anxiété subite. Un silence de tombe !
Pourquoi pensait-il ça ? Il s’écarta du pignon.
— Il faut prévenir, non ? pressa Anne depuis la cour voisine.
Le carreau explosé, les volets refermés de l’extérieur et bloqués par une pierre… Quelqu’un était entré et ressorti. Un cambrioleur.
Jacques opina en silence. Anne marchait déjà vers la maison. Il la rejoignit et s’empressa de former le 17.
*
Ils étaient deux, un homme et une femme en uniforme bleu, qui se dirigèrent aussitôt vers le portillon de la cour.
Jouanet passa sur le perron et dévala les marches.
— Monsieur Jouanet ?
— C’est moi qui vous ai appelés.
— Brigadier Trécastin, se présenta l’homme, et l’agent Médouni.
Il referma derrière eux et resta planté à la lisière de la cour, dans un angle lui permettant d’examiner la façade de la construction voisine.
— C’est là ?
— Cette maison-là, oui… Quand ma femme est sortie ce matin, elle a été surprise de voir de la lumière à l’étage alors que le rez-de-chaussée n’était même pas ouvert.
— Quelle heure était-il ?
— 11 heures à peu près… Elle a pensé que les occupants dormaient encore. Comme la voiture est dans l’allée… À midi, c’était pareil.
— Vous les connaissez bien, vos voisins ?
— Ça fait six ans qu’ils ont emménagé ici.
— Et ils ont l’habitude de se lever tard ?
— Pas du tout. Mais bon… Notre fille nous a dit qu’elle avait entendu du bruit cette nuit, un bruit de verre cassé… Alors comme rien ne bougeait, on a fini par les appeler. Et j’ai sonné à la grille, ça ne répond pas.
Le brigadier s’était mis à prendre des notes, tout en observant par-dessus le muret.
— Comment s’appelle-t-elle, votre fille ?
— Caroline, elle a 16 ans.
— Et à quelle heure a-t-elle entendu du bruit ?
— 1 heure environ.
Il nota. 1 heure. Effraction possible. Son attention se porta vers le pignon, là où un buisson dissimulait partiellement la fenêtre dont il devinait les volets de bois écartés.
— C’est vous qui avez ouvert ?
— Les panneaux étaient maintenus par une pierre, je suis allé vérifier.
— Ça s’est ouvert et le carreau était cassé, c’est ça ?
— C’est ça. J’ai appelé, mais personne ne répond.
— Par où êtes-vous passé ?
— Par là, répondit Jouanet en pointant le lieu approximatif, à mi-distance.
— Il y a des traces dans la terre, intervint l’agent Médouni.
Elle avait profité de l’échange pour longer le muret, et s’était immobilisée à deux mètres du portillon. Trécastin la rejoignit. On distinguait nettement l’empreinte de pas sur le sol meuble, au pied des arbustes de la haie.
— On préserve, dit-il avant de s’adresser de nouveau à Jouanet. Vos voisins ont l’habitude de s’absenter ?
— Lui, assez souvent. Il part pour son travail, à Paris…
— Qu’est-ce qu’il fait ?
— Il est artiste. Il fait du cinéma, il chante, il écrit des livres…
— Et elle ?
— Elle donne des cours d’art dramatique dans une association.
— Quand les avez-vous vus pour la dernière fois ?
— Avant-hier, répondit Anne. En rentrant le soir, Axel était dans le jardin.
— Vous lui avez parlé ?
— On s’est salués. Il pleuvait, il a couru vers la maison, je crois qu’il était juste sorti pour prendre quelque chose dans la voiture.
— Et hier ?
— Je n’ai vu personne.
Artiste, avait transcrit Trécastin sur une nouvelle page blanche. Il ajouta un S.
— Je suppose qu’ils ont un téléphone portable ?
— Sûrement, opina Anne, mais ils ne nous ont jamais donné le numéro.
C’était elle qui répondait aux questions désormais. Jacques se contentait d’écouter.
— Si quelqu’un est entré chez eux en leur absence, formula le brigadier, nous allons devoir les prévenir. Ils ont des enfants ?
— Une fille chacun, d’un premier mariage.
— Qui vivent avec eux ?
— Non. Il a 66 ans, et elle une bonne cinquantaine d’années…
— Ils ne sont pas mariés ?
— Je ne crois pas. Il s’appelle Puggioni, elle, Cariou.
Trécastin écrivait toujours en remuant consciencieusement la tête. Il referma finalement son calepin et s’approcha en silence du point désigné le long du muret. De cette place, il faisait face à l’ouverture creusée dans le pignon. Il voyait la vitre brisée et le contour des meubles plongés dans la pénombre. L’agent Médouni s’était positionnée à son côté, elle aussi observait l’endroit, le mur aveugle au niveau de l’étage, la cour goudronnée, l’allée sur laquelle avait été garé le break Volvo.
Quelqu’un s’était introduit dans la maison par cette fenêtre, et en était sorti en passant par le même chemin. Une seule personne. Les empreintes sculptées dans la terre n’étaient pas nombreuses. Le visiteur n’avait pas pris le risque d’escalader la grille ou de s’écorcher sur les tessons de bouteilles scellés dans le mur d’enceinte, il avait emprunté le portillon du jardin voisin et franchi aussitôt le muret. S’il savait les propriétaires absents… Il avait eu tout le temps de se servir.
Seulement, il n’avait pas dû emporter grand-chose, songea Maryam Médouni en détournant le regard vers l’ouverture étroite. Toutes les autres, en façade comme sur l’arrière de la demeure, étaient condamnées. Donc, bijoux, argent liquide… Rien d’encombrant.
Le brigadier Trécastin se décida à franchir la clôture. Assis à califourchon sur le muret, il passa avec précaution sa seconde jambe de l’autre côté et sauta entre deux pieds de la haie. L’agent Médouni le suivit en effaçant l’obstacle avec plus de légèreté, ils se retrouvèrent dans la cour d’Axel Puggioni.
La première chose que remarqua Trécastin fut les lamelles de verre étalées dans le parterre qui cernait le buisson. La fenêtre avait été refermée, probablement en passant le bras par le vide du carreau explosé. Trécastin se voûta, prenant garde de ne pas s’aider de l’appui.
La lumière pénétrant par la porte entrouverte éclairait une cuisine parfaitement rangée. Pas de vaisselle sale traînant sur l’évier. Lui aussi lança un appel : « Police ! Il y a quelqu’un ? » Les mots se perdirent. Il n’insista pas et fit l’effort de se redresser. La maison était vide. Ses yeux balayèrent le montant de la fenêtre, il suspendit ses gestes.
L’empreinte était parfaitement nette : trois marques parallèles de doigts posés sans précaution, des traces brunes dont la pointe s’atténuait en filant vers l’arête du châssis.
Du sang ?
Il projeta le faisceau de sa lampe torche sur le bois.
Du sang… Celui d’un rôdeur qui s’était coupé en brisant la vitre et avait laissé la lumière allumée derrière lui…
Trécastin hésita à entrer, au risque de polluer la scène. Non. Son rôle s’arrêtait là. Constater et rendre compte. Il recula de quelques pas.
*
La tête levée, le tout nouveau commandant Hubert Arneke considéra la façade de la maison habitée par Axel Puggioni et sa compagne, Pauline Cariou. Il n’avait repéré aucune trace de tentative d’effraction sur les fenêtres.
Son regard se promena au niveau de l’étage. On distinguait un coin de plafond et le sommet d’une cloison couverte de livres.
Arneke cessa son examen pour se tourner vers le lieutenant Conny Nochet. Elle scrutait chaque pouce de terrain, entre le carreau brisé et le carré de terre dans lequel s’étaient gravées les empreintes de pas. Le brigadier Trécastin avait figé le lieu à l’aide de rubalises.
— J’ai vu quelqu’un à la fenêtre d’à côté, formula Arneke en se rapprochant. Ils ont peut-être entendu quelque chose cette nuit… Et on va avoir besoin de témoins.
Trécastin opina et fit signe à Maryam Médouni. Tous deux franchirent le muret et disparurent par le portillon. Arneke se rapprocha de la haie. Les Jouanet observaient la scène depuis leur jardin, rejoints par Caroline qui s’était contentée d’enfiler un pantalon sous sa chemise de nuit.
— Les pompiers sont en route, leur dit-il. Ils vont nous ouvrir… Vous connaissez la disposition des pièces de la maison ?
Anne Jouanet considéra l’homme qui la questionnait : un trentenaire aux cheveux blonds tombant bas sur la nuque, vêtu d’un bomber en peau de mouton dont il avait relevé le col. Des yeux clairs, des joues ombrées par une barbe de trois jours. Il s’était présenté : Commandant Arneke. Pas Arnek’, il avait insisté sur la dernière syllabe.
— Celles du rez-de-chaussée, répondit-elle, je ne suis jamais montée à l’étage. La cuisine à droite, sur la moitié de la surface à peu près, l’escalier, et dans le fond, les toilettes et sans doute une buanderie. Salle à manger et salon sur la gauche, sur toute la largeur de la maison.
Il remua la tête. Une disposition classique.
— C’est un bureau, au-dessus ?
— Oui, on y voit Axel de temps en temps lorsqu’il ouvre la fenêtre, l’été. Je crois qu’ils ont deux chambres.
— La leur, c’est celle de la façade ?
— Je ne crois pas, les volets ne sont jamais fermés.
Conny avait cessé d’examiner l’allée, elle s’était rapprochée de la fenêtre du pignon et de sa vitre brisée. Là aussi, Trécastin avait figé le lieu, inutilement sans doute. Jouanet n’avait pas pris de précautions, le parterre était écrasé.
— Qu’est-ce qu’ils foutent, bon sang ? … Ah !
La sirène se faisait enfin entendre. Dix minutes à peine depuis la réquisition, la caserne n’était pas très éloignée. Conny marcha vers la grille. Elle était impatiente. Arneke la suivit des yeux. Lui non plus n’aimait pas l’atmosphère. Cambriolage, avait imaginé Trécastin. Mais ce sang, cette voiture dans l’allée, ces gens que personne n’avait vus depuis 48 heures…
Arneke trompa son agacement en se dirigeant vers l’arrière de la maison. Le jardin n’était pas vraiment entretenu. Un amas de branches et de buissons, une table ronde et deux chaises de plastique blanc que personne n’avait songé à rentrer pour l’hiver. Les volets du rez-de-chaussée et de la fenêtre de l’étage, celle qui devait correspondre à la chambre du couple, étaient fermés. La quatrième ouverture, sur la droite, était de dimension plus modeste et protégée par un verre granuleux. Une salle de bains…
Arneke revint sur ses pas. Les pompiers avaient débouclé la grille sans grande difficulté. Ils s’attaquaient à la porte d’entrée. Trécastin revenait, accompagné du voisin.
— Ils n’ont vu personne depuis deux jours, dit-il, mais ils n’ont pas vraiment fait attention non plus. Et il fait nuit à 18 heures.
L’homme à côté de lui, quinquagénaire rondelet, se contenta d’un signe de tête. Arneke s’approcha du perron.
— C’est bon…
Le pompier s’écarta après avoir poussé le battant, découvrant un couloir plongé dans la pénombre. Arneke entra avec précaution. La porte sur la droite était entrouverte. Cuisine. Vide. Il le savait. À gauche, un espace envahi par l’obscurité. Ses doigts cherchèrent l’interrupteur sur le mur, illuminèrent un vaste salon. Désordre normal. Une pièce de vie. Pas de meubles renversés ni de tiroirs éventrés. Et le silence, partout…
Le commandant poursuivit sa progression. De la lumière tombait de l’étage par la cage d’escalier, une faible clarté en provenance de la pièce en façade. Il s’arrêta au pied des marches, la main brusquement levée pour imposer à Conny de rester immobile.
Elle le vit écarter le pan de son bomber pour saisir la crosse du Sig Sauer, dont il déverrouilla le cran de sécurité. Son regard escaladait les marches une à une. Présence de traces brunes, des marques de pas évidentes, les stries d’une semelle imprégnée de sang…
Il voyait une douille à mi-hauteur, deux degrés avant le coude que formait l’escalier.
Il se remit à avancer lentement, collé au mur, la tête levée pour anticiper la découverte de l’espace. Personne. Le palier intermédiaire. Un couloir au-dessus de lui. Quatre portes en enfilade, les deux premières entrouvertes, de chaque côté du passage. La lumière provenait bien de celle de gauche, l’entrebâillement de la seconde était plongé dans le noir.
Et pas un bruit pour venir troubler le murmure de la ville, dans le lointain.
Avec une odeur… Arneke la devinait, maintenant. Il savait.
Les traces de pas ensanglantées se faisaient plus nettes au fur et à mesure de sa progression. Il monta encore, contracté, la respiration lente. Un couloir en parquet. Du coude, il écarta totalement le battant.
L’homme était là.
Mort.
Effondré sur le sol, torse nu, la poitrine couverte de sang.
Arneke balaya la pièce d’un regard fulgurant. Un bureau. Des rayonnages. Personne. Conny Nochet atteignait elle aussi le palier, son arme de service tenue à deux mains. Il lui adressa un signe silencieux et se retourna.
Arneke se positionna le long du mur et poussa le battant de sa main gauche. L’éclairage du bureau dessina un carré de lumière sur le parquet, remonta le long d’une commode de bois clair, envahit finalement une chambre. Le panneau butait sur un obstacle et refusait de s’ouvrir entièrement. Arneke passa de l’autre côté. Il vit.
Le corps de la seconde victime était en partie dissimulé derrière la porte, étendu par terre, c’était lui qui empêchait le battant de s’ouvrir totalement. Le corps d’une femme. Elle était nue et lui tournait le dos, en appui sur son bras et sur sa jambe gauches. Une mare de sang s’était étalée sous elle.
Le commandant respira, tendu, et par gestes, fit comprendre à Conny qu’ils devaient d’abord contrôler les deux dernières pièces. Celle de gauche en priorité, qui donnait sur la rue. Volets ouverts, il l’avait noté depuis l’extérieur. Ils se positionnèrent de part et d’autre de l’entrée, Arneke manœuvra brusquement la poignée et poussa avec force. La porte rebondit sur la butée. Une chambre vide, équipée d’un lit double.
Ils se tournèrent vers l’ultime ouverture. Mêmes gestes. Une salle de bains, déserte également. Il souffla et rengaina lentement son Sig Sauer avant de revenir vers le bureau, dans lequel il n’entra pas.
L’homme mort avait une bonne soixantaine d’années, et des cheveux gris encore épais encadrant un visage carré, dans lequel des plis formaient comme des cicatrices. Il avait dû être beau, les années lui avaient creusé des rides qui ne l’enlaidissaient pas. Une gueule…
Il était assis par terre, les épaules collées aux étagères, la jambe droite repliée sous lui. Il y avait eu bagarre, des dossiers et des livres s’étaient écroulés, un synthétiseur appuyé contre le mur avait été renversé.
Arneke plia les genoux. L’homme était torse nu, il s’était contenté d’enfiler un pantalon dont il avait simplement accroché le bouton, la ceinture pendait de part et d’autre de la braguette qu’il n’avait pas pris le temps de refermer. Il ne portait rien dessous.
Sa poitrine était couverte de sang. Et dans la lumière intense chutant du plafonnier, on distinguait nettement les marques de coups et les coupures qu’il portait aux bras.
Arneke balaya le sol du regard. Maintenant qu’il s’était baissé, il voyait mieux sous les meubles. Une seconde douille avait roulé sous la table de travail, avant de buter contre l’un des pieds. Il se releva.
Conny s’était contentée d’avancer légèrement dans la chambre, en évitant les traces parfaitement nettes imprimées sur le plancher. La mare de sang étalée le long du corps conservait la marque des souliers qui l’avait piétinée sans aucune précaution. La femme avait été frappée dans le dos.
— Elle a été poignardée, dit-elle en reculant. Plusieurs fois.
— L’homme aussi, opina Arneke.
Ils empruntèrent l’escalier en veillant à ne rien toucher. Le brigadier Trécastin les attendait au bas des marches, Maryam Médouni était derrière lui. Tous les deux avaient la main posée sur la crosse des armes qu’ils étaient prêts à dégainer.
— Ils sont là-haut, les renseigna Arneke. L’homme dans le bureau, la femme dans la chambre. Ils ont été poignardés à plusieurs reprises.
Il longea le couloir et s’immobilisa dès qu’il fut dehors. L’air frais lui fit du bien. Le couple Jouanet et l’autre voisin le regardaient sans dire un mot. Il vérifia l’heure et sortit son téléphone.
II
— Maintenant que tu as trouvé, annonça le commissaire Baron en souriant, le plus difficile reste à faire, les cartons…
D’un ultime coup de fourchette, il avait achevé de vider son assiette et se laissait aller tranquillement en arrière. Il avait mangé comme un homme affamé. Il tendit le bras pour attraper son verre, prit le temps de humer le saint-nicolas-de-bourgueil avant d’en avaler une gorgée, le regard égaré sur les pierres et les poutres apparentes de l’auberge. Les miroirs, mêlés aux horloges anciennes, lui renvoyaient le panorama de la place de l’église à laquelle il tournait le dos.
Il vérifia dans le même mouvement que le temps se maintenait au beau, froid sûrement mais suffisamment clair pour donner l’impression d’une belle journée. Il reposa son verre.
En face de lui, Odile avait les joues roses dans l’éclairage des abat-jour fleuris posés le long des tables.
— On n’est pas à la rue, objecta-t-elle sans se tracasser.
Un parcours de deux années s’achevait là, le temps qu’il lui avait fallu pour repérer la maison introuvable qu’elle avait finie par dénicher. Ils avaient gagné l’Auberge de l’Erdre pour fêter ça, sitôt quitté l’office notarial.
— J’ai parlé avec Valérie, hier soir, dit-elle en se penchant vers lui. Elle m’a appelée, tu n’étais pas rentré.
— Et alors ?
— Quand je lui ai confirmé que je signais ce matin, elle m’a demandé si j’avais décidé de te quitter…
— Elle est adorable, répondit Baron.
Valérie, 20 ans et l’envie, parfois, d’en découdre avec ce flic avec lequel elle devait partager sa mère.
— Tu as confirmé, j’espère ?
— Je lui ai dit que j’hésitais encore.
— Elle a dû être déçue.
Baron lui serra les doigts avant de tourner la tête.
— Tout s’est bien passé ? intervint le serveur.
— C’était parfait.
— Je vous apporte la carte des desserts ?
Odile n’en avait pas besoin, elle était prête à commander. Le téléphone vibrant dans la poche de Baron la fit hésiter. Il s’excusa d’une moue à l’adresse du serveur.
La conversation ne fut pas longue. Il écoutait simplement des mots qui marquaient irrémédiablement la fin de l’intermède.
— Désolé, articula-t-il après avoir raccroché. L’addition plutôt…
Il hésitait à relever les yeux. Le serveur s’éloigna.
— Je vous prépare ça, dit-il.
— Un problème ?
— C’était Arneke.
Odile ne commenta pas. Il entendait son silence. Ils avaient prévu autre chose.
— Bien… s’inquiéta-t-elle après un long moment, en commençant à repousser son siège. Et moi ? Tu me déposes où ?
— Je suis navrée, chérie… Dans le quartier de Talensac. Ça ira ?
Elle se débrouillerait ensuite, elle n’était plus très loin en coupant par la place Bretagne.
— Valérie a peut-être raison, finalement, grinça-t-e lle après avoir enfilé sa veste.
Il lui entoura les épaules de son bras pour l’accompagner.
— Qu’est-ce qui se passe ?
— Un couple agressé. Ils sont morts tous les deux.
Ils sortirent sur la place de l’église après avoir réglé. La voiture était garée devant, museau pointé vers le mur du presbytère. Le soleil de février blondissait les dalles de l’esplanade.
Ils s’installèrent. Baron manœuvra pour se dégager et contourna le giratoire pour emprunter la rue Martin Luther King en direction de la poste. Il réfléchissait à l’itinéraire à suivre pour éviter les bouchons du samedi après-midi. Par la Noue Verrière. Il longea le golf Bluegreen et pénétra dans Nantes à hauteur de la mosquée Arrahma. Les voitures se traînaient dans la descente du Pont du Cens. Il emprunta la voie des bus en utilisant la sirène, remonta l’autre versant à vive allure, jusqu’à la rue de Bel Air et les grilles du collège Victor Hugo. Il s’immobilisa sur le trottoir, devant une succession de portes de garages, pour permettre à Odile de descendre. Elle n’avait pas prononcé un mot de tout le trajet. Il la regarda s’éloigner en direction de Talensac. Elle ne tourna pas la tête. Mauvais temps.
Il était arrivé. Quelques centaines de mètres encore, dans la rue Jules Polo terminée en cul-de-sac. Il ne pouvait pas virer sur sa gauche.
La rue des Capitaines de Clerville avait été fermée, un gardien en tenue interdisait l’accès à cette voie étroite bordée de pavillons individuels, sans immeuble ni commerce. Les trottoirs étaient encombrés sur toute leur longueur par des véhicules en stationnement, le fourgon de la PTS bouchait le milieu de la chaussée.