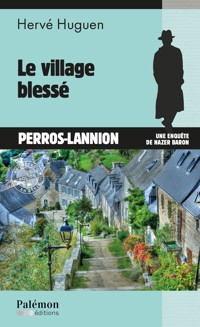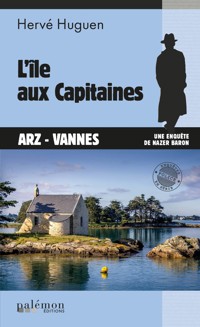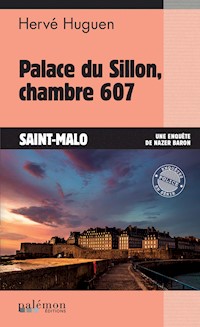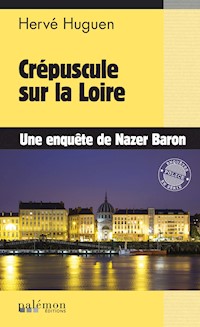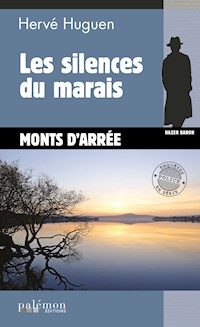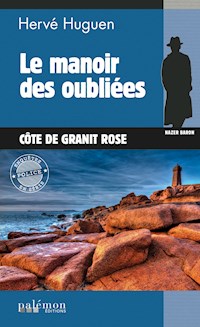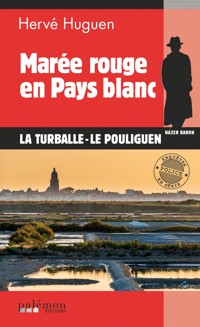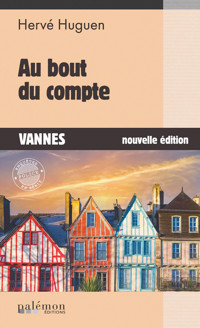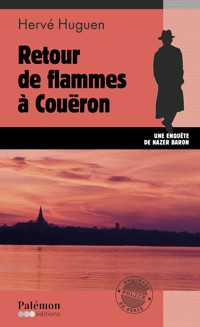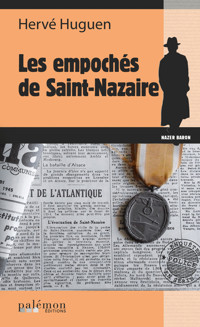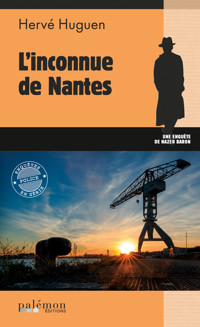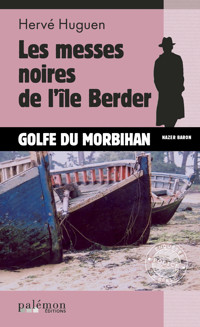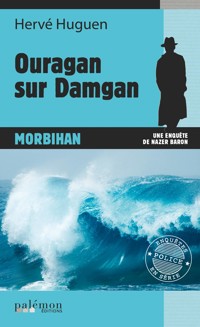
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Une enquête du commissaire Baron
- Sprache: Französisch
10 ans après une sombre affaire jamais élucidée, le dossier est rouvert.
« On n’a pas été en mesure de reconstituer exactement le scénario du drame, avait admis le commissaire Droniou. Pourquoi deux armes ? Je n’en sais rien, ce que je sais, c’est que Caroline tenait encore le fusil dans les mains, il n’y avait pas beaucoup de questions à se poser. » L’enquête s’orientait vers une tragédie familiale à huis clos, derrière les murs d’une villa en bordure d’un océan déchaîné cette nuit-là. La meurtrière souffrait de troubles psychiatriques… Un crime limpide en effet.
L’inspecteur Kervilin va pourtant douter de ce qu’il découvre, et s’acharner à prouver que la tuerie ne s’est pas déroulée comme on voudrait le faire croire. Il paiera au prix fort son obstination…Dix ans après la mort de Kervilin et la clôture des investigations sur le massacre, le commissaire Baron se voit chargé de rouvrir le dossier. Avec une question : que faisait l’inspecteur Kervilin la nuit où il est décédé ? Une enquête sur l’enquête qui obligera Baron à déchirer le voile des apparences, celles dont il faut toujours se méfier, pour enfin faire éclater une vérité inattendue. Un roman inspiré d’un fait divers authentique.
Inspiré d'un fait divers authentique, ce roman retrace une nouvelle enquête palpitante du commissaire Baron en plein coeur de ce qui semble être une tragédie familiale.
EXTRAIT
De la grande baie vitrée, il était possible d’apercevoir les voitures stationnées en épis sur le parking payant, à l’extrémité du port, lumineuses dans la poussière de soleil. En face, le kiosque à musique et son manège garni d’ampoules. Des enfants y tournaient déjà, alors que traînait encore la fin de matinée. « Promenade dominicale, sortie de messe… » songea Kervilin.
Il se retourna et choisit le fauteuil le plus proche de la lumière pour s’y glisser et croiser les jambes. De là, il pouvait encore distinguer les eaux grises de la Rabine. Il fit mine de s’y intéresser, de chercher dans la forêt de mats plantés le long des quais un détail auquel accrocher son regard.
Il ne perdait pas une miette de ce que disait Cédric Devheer dans son dos, de cette voix aux inflexions éraillées racontant la mort de Julius avec des mots pudiques. Il était au téléphone lorsque Simon Kervilin avait sonné et il avait ouvert sans cesser de parler, jeté un œil sur la carte tricolore, fait signe d’entrer jusqu’au salon. Depuis, il effectuait un lent va-et-vient sans plus se tracasser de son visiteur, le combiné collé à l’oreille, articulant des phrases pénibles de ce timbre un peu cassé des gens épuisés. Il tutoyait son interlocuteur, un homme s’il fallait en croire les échos qui transperçaient parfois. Il conclut enfin sur un remerciement adressé à Bruno et raccrocha.
— Excusez-moi…
— Je m’appelle Kervilin, prononça Simon. Je vous présente toutes mes condoléances, monsieur Devheer.
— Merci. Vous êtes allé là-bas ?
— Cette nuit. Je suis arrivé au moment où l’on vous emmenait à Chubert. Ça va aller ?
— Ça va…
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Super roman, une enquête palpitante, où la vérité n'apparaît que dans les dernières pages.
J'ai beaucoup aimé. - domdu84, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Le nantais Hervé Huguen est avocat de profession, mais il consacre aujourd’hui son temps à l’écriture de romans policiers et de romans noirs. Son expérience et son intérêt pour les faits divers - ces évènements étonnants, tragiques ou extraordinaires qui bouleversent des vies - lui apportent une solide connaissance des affaires criminelles. Passionné de polar, il a publié son premier roman en 2009 et créé le personnage du commissaire Nazer Baron, un enquêteur que l’on dit volontiers rêveur, qui aime alimenter sa réflexion par l’écoute nocturne du répertoire des grands bluesmen (l’auteur est lui-même musicien), et qui se méfie beaucoup des apparences…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HERVÉ HUGUEN
Ouragan sur Damgan
DU MÊME AUTEUR
1. Dernier concert à Vannes
2. Les messes noires de l’île Berder
3. Ouragan sur Damgan
4. Le canal des innocentes
5. Retour de flammes à Couëron
6. Les empochés de Saint-Nazaire
7. L’inconnue de Nantes
8. Le cimetière perdu
Retrouvez ces ouvrages surwww.palemon.fr
AVERTISSEMENT
Cet ouvrage n’est qu’une œuvre de pure fiction. Les lieux, les personnages, les événements ne sont que le fruit de l’imagination de l’auteur. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé ne serait que coïncidence, même si l’affaire Jeremy Bamber a pu être un aiguillon de cette imagination et, parfois, le fil rouge de cette fiction.
Mis hors de cause dans un premier temps, Jeremy Bamber a ensuite été condamné pour le quintuple meurtre de Chelmsford. Bamber a toujours nié. Vingt-cinq ans après, ses avocats ont continué à présenter des recours étayés par de nouvelles preuves tendant à infirmer celles présentées par les enquêteurs. L’histoire aura peut-être à dire si Bamber était ou non innocent des crimes pour lesquels il a été condamné.
Pour l’instant, laCriminal Cases Review Commission, l’autorité britannique chargée d’étudier les dossiers d’éventuelles erreurs judiciaires, a toujours rejeté les arguments développés par les avocats de Jeremy Bamber, incarcéré depuis 1986.
CE LIVRE EST UN ROMAN.
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres,
des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant
ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation…) sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d’Exploitation du droit de Copie (CFC) - 20, rue des Grands Augustins - 75 006 PARIS - Tél. 01 44 07 47 70/Fax : 01 46 34 67 19 - © 2015 - Éditions du Palémon.
Les apparences peuvent être vraies.
Eugène Guillevic
Avant-propos
Le 7 août 1985, vers trois heures trente du matin, les services de police de Chelmsford, dans le comté d’Essex, reçurent l’appel agité d’un habitant de Goldhanger, un jeune homme du nom de Jeremy Bamber.
Bamber venait d’enregistrer un message affolé de son père Nevill, qui n’était plus en mesure de maîtriser sa fille Sheila, la sœur de Jeremy, plongée dans une brutale crise de démence meurtrière. Bamber prétendait avoir entendu un coup de feu avant que la communication ne soit coupée. Il avait rappelé en vain.
Les policiers se rendirent sur place et encerclèrent un paisible bâtiment du XVIIIe siècle, isolé du village, entièrement verrouillé et plongé dans le silence. Personne ne réagit aux appels. La décision fut prise d’enfoncer la porte de la cuisine et de pénétrer en force dans la bâtisse.
À l’intérieur, les enquêteurs découvrirent les corps sans vie de cinq personnes, les parents adoptifs de Jeremy, Nevill et June, sa sœur Sheila et les deux enfants de celle-ci, des jumeaux âgés d’à peine trois ans. Tous avaient été abattus par balles.
Sheila gisait sur le dos avec encore, coincé entre les cuisses et posé sur son ventre, le fusil Anschutz de calibre 22 avec lequel avait été perpétré le carnage. Elle s’en était appliqué le canon sous le menton avant de presser une ultime fois la détente et de se suicider.
Bouleversés par l’ampleur de la tuerie et l’évidence du scénario qui s’était déroulé dans la maison, les enquêteurs négligèrent certaines précautions et limitèrent les relevés d’indices sur les lieux. Tout évoquait la folie meurtrière. Jeremy Bamber se disant incapable de pénétrer dans le bâtiment tant que subsisteraient les traces du drame, les murs furent lavés, les draps, couvertures et tapis furent emportés avant d’être brûlés deux jours plus tard par les policiers.
L’enquête établit que Sheila souffrait de graves déséquilibres psychologiques, qu’elle était en proie à des hallucinations délirantes et qu’elle se droguait. Atteinte de schizophrénie paranoïde, elle avait séjourné plusieurs semaines en hôpital psychiatrique quelques mois avant les meurtres, mais avait arrêté de suivre son traitement.
L’inspecteur divisionnaire Tom Jones, directeur d’enquête, n’arriva sur les lieux qu’après les premières constatations et entérina très rapidement les conclusions de ses subordonnés.
Les corps de Nevill et June Bamber et de leur fille Sheila furent incinérés dès le 16 août, au terme d’une cérémonie à laquelle se pressa une foule immense venue leur rendre un dernier hommage, devant un impressionnant parterre de journalistes qui assistèrent aux manifestations de douleur qui agitèrent Jeremy Bamber pendant les obsèques. Tous notèrent l’exceptionnelle présence à ses côtés de sa petite amie Julie Mugford, intervenant pour le soutenir au moindre signe de détresse.
Un mois plus tard, Jeremy Bamber gagna la France avec l’intention de s’y reposer quelque temps. La justice s’apprêtait à prononcer un non-lieu dans le dossier de l’effroyable carnage de White house farm, l’auteur des faits, mentalement malade, s’étant donné la mort après avoir perpétré ses crimes.
Le village s’efforça de tourner la page.
Pas tout le monde cependant. Quelques-uns doutaient du scénario retenu par les enquêteurs, un peu trop rapidement à leur goût… La fortune de Nevill Bamber était considérable…
Ils s’intéressèrent alors au seul survivant de la famille, Jeremy Bamber.
L’homme qui avait appelé la police.
Chapitre 1
« Le corps de Kervilin a été découvert le long d’un trottoir… »
Un corps brisé par la violence du choc. Éclatement de la boîte crânienne, enfoncement de la cage thoracique, multiples fractures aux membres inférieurs, contusions diverses, hémorragie interne.
On était fin janvier et il pleuvait cette nuit-là. Dans un quartier désert en attente de rénovation, une ruelle étroite et dépourvue d’éclairage comme un boyau percé dans un mur de banlieue. Kervilin était mort depuis au moins deux heures lorsque son corps avait été trouvé par un noctambule de passage, un type trop saoul pour s’identifier mais pas encore assez pour passer son chemin. Il avait téléphoné d’une cabine et rôdé dans le quartier pendant l’intervention, attirant l’attention des gendarmes qui lui avaient mis le grappin dessus. Avant de le relâcher. Il n’avait plus de permis depuis des années et ce soir-là, il avait fait la fermeture d’un bar de la place du Four Mollet.
C’était à ça que songeait le commissaire Baron en remontant les allées du cimetière de Calmont, laissant derrière lui la silhouette trapue du fossoyeur qui l’avait renseigné.
— Kervilin ?
L’homme avait des sourcils broussailleux qui se rejoignaient au-dessus d’une cloison nasale écrasée, des joues sillonnées de veinules éclatées. Il mâchouillait une cigarette roulée.
— Je crois bien avoir vu passer la petite dame…
Il tendait un bras aux muscles noueux et depuis, Baron marchait à travers les tombes, évitant les flaques dans lesquelles se reflétait un soleil timide, tout juste bon à tiédir l’atmosphère entre deux averses. On approchait du 15 août d’un été définitivement pourri.
« Ça fera dix ans en janvier prochain », avait calculé Madame le procureur adjoint.
On était jeudi, les Fêtes d’Arvor allaient débuter, le centre-ville était bouché, les rues grouillaient de touristes écœurés par le sable humide et le vent incessant qui balayait les grèves alentour, le bagadig d’Er Melinerion sonnait sur le parvis de la Poste et Baron avait dû se garer sur une place réservée aux magistrats. Il était en retard.
Elle lui avait résumé l’essentiel, d’un ton un peu précieux qui collait bien à son allure bourgeoise.
« Les gendarmes n’ont découvert sur les lieux que des débris de phare. Aucune trace de freinage. Pas de témoin, la nuit le quartier était désert. Personne ne savait ce qu’il faisait là, sa voiture était garée à cent mètres. L’enquête a conclu à un accident de la voie publique. L’inspecteur Simon Kervilin a été tué par un chauffard non identifié… »
Baron tourna dans l’allée indiquée et aperçut alors la femme voûtée au-dessus d’une pierre tombale dont elle frottait le marbre. Il ralentit l’allure, il avait besoin de se remémorer tout l’entretien.
Il avait demandé pourquoi ressortir un tel dossier dix ans après.
« Vous vous souvenez de la tuerie de Penerf ? » avait rétorqué le magistrat.
Un carnage… Il ne gardait en mémoire que des bribes de comptes-rendus lus dans les journaux de l’époque. L’affaire Devheer… Le dossier ne l’avait intéressé que par son ampleur et parce qu’il connaissait Penerf.
Quatre cadavres exécutés par arme à feu et découverts dans une maison isolée en bordure d’océan un soir d’ouragan.
« Kervilin avait été en charge du dossier, avait-elle complété, jusqu’à un mois avant sa mort. Mais l’enquête lui avait été retirée et on n’a jamais fait le lien entre les deux. »
Madame le procureur adjoint était assise dans une flaque de lumière, devant les fenêtres que transperçaient les pâles rayons. Elle s’appelait Roselyne Véron de Kermarec, quarante-cinq ans, divorcée. Pas d’échos sur son existence antérieure, pas de vie privée connue. Juste un détail dont on disait qu’il lui ouvrait quelques portes à la mairie : un père conseiller général dans le Finistère, Véron de Kermarec, ancré dans la glaise bigoudène. Roselyne avait donc repris son nom de jeune fille. Pour le reste une juriste attentive et fine.
« On n’avait d’ailleurs aucune raison d’imaginer un lien entre les deux affaires… À part le fait que son ex-femme discutait la version de l’accident », avait-elle dit d’une voix dubitative.
Le doute de la veuve… Le refus du destin dans ce qu’il a d’implacable, la quête ailleurs de raisons qui n’existent pas.
« Pourquoi m’en parlez-vous ? s’était-il étonné. Ça fait dix ans, l’affaire Devheer a bien fait l’objet d’un non-lieu ? »
Elle avait approuvé en remuant la tête, ce qui avait accroché des éclairs châtains dans les boucles qui lui couvraient les oreilles.
Il s’était demandé où elle avait pu bronzer comme ça, avec l’épuisant printemps qui refusait de céder la place.
« Vous avez raison, Commissaire, l’auteur s’était suicidé. La fille de la famille, vous vous souvenez ?… Crise de démence. »
Julius Devheer, le patriarche, était à la tête d’un petit empire qui comptait, sa disparition avait menacé de rompre des équilibres.
« Vous dites que Kervilin avait été dessaisi de l’enquête ? »
« Sur ordre du procureur de l’époque, avait certifié Roselyne de Kermarec. Les constatations sur les lieux, l’autopsie des victimes, les analyses effectuées, les mobiles, tout confirmait la culpabilité de la fille Devheer, Caroline, qui s’était ensuite donné la mort. Elle était sérieusement perturbée. Mais il restait évidemment des interrogations auxquelles les investigations n’apportaient pas de réponses totalement satisfaisantes et Kervilin s’était mis en tête que la tuerie avait pu être orchestrée par le seul survivant de la famille, le frère de Caroline. »
« Et son point de vue ne reposait sur rien de solide ? » s’était inquiété Baron.
« Le flair… L’instinct du flic… Seulement il n’apportait aucune preuve et il s’acharnait au-delà du raisonnable, l’enquête a été bouclée sans lui. Faites sortir le dossier des archives, vous verrez, c’est intéressant, » avait-elle conclu avant de paraître se décider d’un coup.
Elle avait pris le temps d’un silence et planté son regard sur son interlocuteur, comme pour donner davantage de poids à ses mots :
« La prescription va intervenir. »
« Parce que vous doutez vraiment de la thèse de l’accident ? »
Elle avait eu un soupir. Des volutes de dentelle se dessinaient sous son chemisier. Sa main avait balayé l’air, accroché un éclair de diamant à l’annulaire droit.
« Un policier retrouvé mort sur le bord de la route, à vingt kilomètres de chez lui, pas de témoin, pas de traces, pas de raison d’être là… »
« Une femme… avait-il suggéré. Mariée. Qu’est-ce que vous attendez de moi ? Si longtemps après. »
« Je n’ai rien vu qui permette de relier l’affaire Devheer à la mort de Kervilin, mais dix ans après, les gens ont changé, les rapports entre les êtres ont évolué, la vérité d’hier peut se teinter de doute… Essayez de découvrir ce qu’il faisait rue du Buréno le soir où il y a été tué. »
Baron était reparti avec le dossier de l’accident et le sentiment diffus que Roselyne de Kermarec était cachottière. Elle n’avait pas ressorti par hasard une affaire poussiéreuse à laquelle personne ne pensait plus.
Il était à trois mètres de la femme penchée lorsqu’elle devina sa présence et releva la tête.
— Madame Kervilin ?
Elle approuva, juste curieuse.
— Mon nom est Baron, dit-il en lui présentant sa carte. Je suis passé chez vous, c’est votre compagnon qui m’a dit que j’avais des chances de vous trouver ici.
— La police ?
— J’aimerais vous parler de Simon.
Il avait eu un regard vers la stèle. Deux noms y étaient gravés. Yohan Kervilin, décédé treize années plus tôt à l’âge de dix-huit ans, et au-dessus, creusé en lettres d’or, celui de son père, Simon Kervilin, mort depuis dix ans. Elle s’étonna :
— De Simon ? Depuis le temps !
Elle devait faire un effort pour se redresser et il remarqua alors le bandage qui lui enserrait le mollet.
— Vous êtes blessée ?
— Une bêtise, fulmina-t-elle. Je me suis fracassé le tibia contre la porte ouverte d’un lave-vaisselle. Huit points de suture.
Elle avait les cheveux gris, mais d’un gris très doux, coiffés en carré autour d’un visage à peine ridé. Avec des yeux toujours pétillants qui ne reflétaient pas la tristesse mais plutôt l’apaisement. Debout, elle observa Baron pendant un instant, fixa le regard sombre, se perdit dans la chevelure en broussaille, évalua la silhouette mince, le ventre plat.
— Pourquoi voulez-vous me parler de Simon ? demanda-t-elle enfin.
— Le dossier n’est pas refermé.
Elle eut un geste sec pour balayer les mots. Paroles, paroles…
— Tiens donc ! Je suis pourtant allée vous voir, se souvint-elle avec une pointe d’acrimonie, la police je veux dire, Simon n’était même pas encore enterré.
— Je sais.
— J’ai été reçue par un certain Blainot. Une petite frappe celui-là… Il a commencé par me demander à quel titre je me croyais autorisée à intervenir. Nous étions divorcés. Je lui ai expliqué que Simon était venu me voir un mois avant sa mort et qu’il m’avait parlé de ses intentions. Il s’est moqué. « L’affaire Devheer ? Mais l’affaire Devheer est terminée, Madame. Et votre ex-mari en avait été déchargé ! » Je crois qu’il jubilait.
Elle se tourna vers la sépulture. Les fleurs qu’elle y avait déposées marquaient le marbre d’une touche colorée dans le maigre soleil.
— Yohan a emporté avec lui une partie de son père, dit-elle, Simon avait perdu le goût de vivre. C’est pour ça que je l’ai quitté, c’est pour ça aussi que les autres ne l’aimaient pas. Ils ne comprenaient pas.
— C’est de ce qu’il vous a dit que j’aimerais que vous me parliez…
— À quoi bon, monsieur Baron ? Pour le ressusciter ?
— Je n’ai malheureusement pas ce pouvoir.
— Alors ?
Elle lui refit face. Elle ne pensait pas ce qu’elle disait. Elle parlait rarement de Simon, même avec sa fille ou ses petits-enfants, le temps avait fait son œuvre de paix.
Pourtant elle devina qu’évoquer tout cela avec cet homme qui semblait généreux lui ferait du bien. Même si c’était inutile.
Elle lui sourit en s’excusant :
— Ce n’est pas votre faute. Vous êtes venu en voiture ?
— Je suis garé devant la grille.
— Et ça vous ennuierait de me ramener chez moi ? Si j’accepte de partager un thé avec vous… Nous bavarderons. Mais donnez-moi le bras…
Elle s’appuya sur lui et se mit à remonter l’allée en claudiquant.
Elle devait souffrir réellement.
— Je vais vous montrer quelque chose, décida-t-elle soudain en bifurquant à la croisée.
Il se laissa entraîner sans un mot jusqu’à un caveau surmonté d’une croix de granit aux dimensions conséquentes, un monument en parfait état d’entretien, fermé par une grille d’un noir luisant.
— Comme ça, vous aurez au moins fait connaissance.
Famille Devheer. La liste des corps inhumés dans l’endroit était terrible. Cinq personnes, Fabienne, décédée dix-neuf ans auparavant, et quatre autres noms, Julius, Anita, Caroline, et un enfant âgé de trois ans, Aurélien. Tous morts le même 17 décembre, dix ans plus tôt.
— J’ai appris à les connaître, vous savez, enchaîna Nicole Kervilin d’une voix douce. Fabienne était la première épouse de Julius, Anita la seconde, Aurélien leur fils, et Caroline la fille adoptée.
— L’auteur du massacre.
— Ce n’était pas l’avis de Simon. Venez.
Elle l’entraîna de nouveau et cette fois ils franchirent la grille sans apercevoir le gardien. Baron l’aida à s’installer dans la voiture et prit la direction du centre en redescendant vers le port. Nicole Kervilin vivait dans le quartier Bécel, pas très loin de la place de Mons, au second étage d’un petit collectif dont les fenêtres ouvraient sur un parc.
Ils furent accueillis par le compagnon, grand et chauve, un peu gras, les yeux lourdement soulignés de bistre.
— Vous vous êtes trouvés, finalement !
— Monsieur Baron voulait me parler de Simon.
— Il me l’a dit. Et tu as accepté ?
— J’ai accepté de bavarder en buvant un thé, à condition qu’il me ramène.
— Et il l’a fait. Allez vous asseoir, je m’en occupe.
Ils s’installèrent dans le salon, autour d’une table basse qui supportait une pile de revues. Les rideaux avaient été écartés pour laisser pénétrer davantage de lumière. Une radio fonctionnait en sourdine dans le meuble hi-fi. Radio Classique. Le compagnon s’activait dans la cuisine, cognant de la vaisselle, refermant un placard. Il s’appelait Jean Guinhut, il était veuf lorsqu’il avait rencontré Nicole, nettement plus jeune que lui mais qui s’ennuyait ferme dans son ménage. Ils étaient devenus amants et Nicole avait quitté Simon. Jean Guinhut n’était pas jaloux, il trouvait que la vie avait enfin décidé de se montrer plus clémente avec lui et Nicole ne l’avait pas déçu. Il prépara le thé. Trois tasses. Pas question de laisser ces deux-là évoquer en cachette l’histoire de Simon. Il voulait tout savoir et Nicole n’en parlait jamais.
— Voilà…
Il déposa le plateau, approcha un fauteuil et s’installa, attentif. La conversation roulait banalement sur le temps exécrable d’un été sans chaleur. Nicole, la jambe allongée devant elle, ne donnait pas l’impression de vouloir aborder d’autres sujets.
— Madame Kervilin… commença alors Baron en profitant d’un silence. Vous savez que j’aimerais bien que vous me parliez de Simon…
— Oui, je sais… J’ai simplement besoin d’un peu de temps pour me remettre les détails en mémoire. C’est vieux tout ça. De me souvenir du 17 décembre… Il m’a tout raconté, vous savez.
— Il est passé vous voir ?
— Un soir, oui. Il n’était pas bien, il avait un peu bu et ça ne lui arrivait pas souvent. On venait de lui retirer l’affaire.
— Le dossier Devheer ?
— Le carnage de Penerf. L’enquête allait être bouclée sans lui, on l’évinçait.
— Parce qu’il refusait les conclusions officielles ?
Nicole Kervilin remua simplement le menton.
— Alors racontez-moi… insista Baron. Dites-moi ce qui s’est passé le 17 décembre…
Chapitre 2
Dimanche 17 décembre - dix ans plus tôt.
Nuit d’encre, hachée par la tempête. La voiture se traînait, durement secouée par les rafales et noyée sous les trombes d’eau. Les phares ne perçaient pas le rideau de pluie au-delà de vingt mètres. Un pur, un authentique suicide à quatre-vingts kilomètres heure.
Ils étaient trois à bord et ils ne disaient pas un mot, Corbey crispé sur son volant, buste en avant comme s’il voulait aider la carrosserie à vaincre la bourrasque, et Blainot la main agrippée à la poignée au-dessus de la portière, côté passager. Corbey le gras, le chauve au nez épais dans un visage sanguin, et Blainot la fouine, râblé, magouilleur, franc comme un âne qui recule.
À l’arrière, Simon Kervilin plongeait le regard dans l’épaisseur de la nuit, indifférent au déchaînement. Le gyrophare peignait des éclairs bleutés sur la lande et ça lui suffisait pour suivre la route. Il anticipa le virage au moment de quitter la nationale et se pencha d’instinct pour ne pas être déporté. Corbey allait trop vite, beaucoup trop vite. Il négligea de le lui dire, il n’aimait pas parler dans le vide.
La voiture chassa à l’arrière, propulsa une gerbe d’eau en traversant une mare qui couvrait la chaussée et fit une embardée. Corbey jura. On devina son pied qui se faisait plus léger sur la pédale, il patina pour reprendre sa trajectoire et souffla en abordant le rond-point du centre commercial. Sur l’immense parking désert, la pluie hachurait la lumière pâle des lampadaires.
La Peugeot filait vers l’obscurité. De nouveau la campagne, un virage sur la gauche et les derniers kilomètres en serpent étroit. Ils avaient ralenti, les arbres le long de la voie brisaient les assauts du vent et Corbey se laissa aller doucement contre le dossier de son siège.
« Il a eu peur », jugea Simon Kervilin méprisant. « Flic de mes fesses… »
Ils arrivaient. Le bourg de Damgan était éclairé et ils slalomèrent entre les plots et les ralentisseurs plantés au milieu de l’avenue Pasteur. Ils ne croisaient personne, l’horloge du tableau de bord allait bientôt marquer trois heures du matin. L’océan grondait sur leur gauche, un gouffre insondable aux crêtes écumantes, assassin sûrement par ce temps.
Simon Kervilin tourna la tête, fasciné, les yeux à demi fermés sans parvenir à percer complètement l’obscurité brouillée. Le terre-plein longeant la plage était maintenant ceint d’un muret. Kervilin le regarda défiler en laissant affluer les souvenirs d’une belle fille qui bronzait sur le sable lorsque la voiture avait dévalé la rampe pierreuse qui reliait alors le parking à la grève, sans protection. Elle n’avait pas eu le temps de se jeter de côté. Elle vivait dans un fauteuil maintenant.
Il se demanda ce qu’elle était devenue.
— Vie de merde… grommela-t-il tristement sans penser à personne sinon à tout le monde.
Il en voulait à la terre entière depuis que sa femme était partie. Non pas qu’elle lui manquait vraiment, il y avait bien longtemps qu’ils limitaient leurs échanges au strict minimum et le silence ne le gênait pas, mais il l’avait vécu comme un abandon de poste, une désertion impardonnable.
À l’avant, ni Corbey ni Blainot n’avaient réagi, soit parce qu’ils n’avaient pas entendu, soit parce que les soliloques de Kervilin les laissaient de marbre. De toute façon ils ne l’aimaient pas, Simon Kervilin savait depuis longtemps que les autres ne l’aimaient pas, et il s’en moquait. Son monde intérieur lui suffisait amplement.
Ils approchaient de la pointe de Penerf et les mugissements du vent, que plus rien ne freinait, semblaient avoir encore pris de l’ampleur. La voiture tanguait sur ses roues, le sable arraché aux dunes venait se coller au pare-brise. « An ifern yen », songea Kervilin, « l’Enfer Froid », cela devait ressembler à quelque chose comme ça…
La maison leur apparut enfin au détour d’un virage. Vision de cauchemar brouillée par le ciel en furie, illuminée par les gyrophares qui découpaient les murs d’éclairs lugubres. Kervilin ne compta pas moins de cinq fourgons. Il ouvrit la portière dès que Corbey eut arrêté la voiture et posa le pied à terre, aussitôt assailli par les violentes rafales de pluie contre lesquelles il se courba avec la peur d’être emporté. L’agressivité des éléments lui coupa le souffle. Les bords de son feutre, conservé sur la tête pendant tout le voyage, frémirent sous le vent et il pinça le col de son imperméable, resserré à la taille par une ceinture.
Des ombres allaient et venaient dans ce décor de fin du monde, comme des spectres enveloppés dans des capes imprécises zébrées de flashs bleus ou orangés. Personne ne faisait attention à eux. Un gendarme à la vareuse trempée, collé au mur en quête d’un abri dérisoire, esquissa un bref salut auquel il ne répondit pas. Il avait du mal à avancer, courbé dans la tornade, la respiration courte.
L’ambulance, la première sur son chemin, avait ses portières ouvertes et il vit un corps allongé dans la lumière glauque, autour duquel s’activait une jeune femme en tenue d’urgentiste. Elle branchait un appareil respiratoire sur un visage dont Kervilin ne pouvait discerner les traits. Il s’approcha, toujours cinglé par la pluie mordante.
— Qui est-ce ?
Ses mots ne portaient pas, le grondement de l’océan de l’autre côté du bâtiment, mêlé aux mugissements de la tempête, avala sa question. La fille vit qu’il lui parlait et indiqua d’un geste qu’elle n’avait pas compris. Il grimpa dans le véhicule, s’accrocha à la civière.
— On m’avait dit qu’il n’y avait pas de survivant !
— Je crois que c’est le fils, il est arrivé il y a dix minutes.
— Celui qui a appelé ?
— Je n’en sais rien… Il a fait un malaise. On l’emmène.
Un médecin à la tête ruisselante faisait signe qu’ils devaient partir. Simon Kervilin sauta à terre et les portières claquèrent dans son dos. Scène d’apocalypse. L’ambulance lança sa sirène dans le bruit infernal et Kervilin rentra les épaules pour mieux lutter contre le vent. Il avait le souffle court, le visage en feu griffé par les cristaux glacés qui tourbillonnaient presque à l’horizontale.
Il photographia le site entre ses cils à demi collés, fixa son regard sur un pandore planté dans l’allée sableuse et qui semblait monter la garde à l’arrière d’un fourgon, derrière les vitres duquel se dessinaient deux silhouettes. Il fronça les sourcils, s’enfonça dans les sables.
— Vous avez interpellé quelqu’un ?
Il devait hurler.
— Non, beugla l’autre, la mine gelée… Ils sont venus tout à l’heure, on leur a dit de se mettre à l’abri et d’attendre.
Deux jeunes, vingt-quatre, vingt-cinq ans, qui regardaient le plancher d’un air hagard, coudes posés sur les genoux, les vêtements trempés. Kervilin manœuvra la poignée.
— Vous étiez avec le fils Devheer ?
Ils hochèrent la tête. Ils étaient pâles comme des linceuls, les yeux vitreux, les mèches collées au front, la mâchoire bloquée.
— Vous étiez là quand il a appelé ?
De nouveau une secousse du menton. Ils avaient l’air frigorifié.
— Putain… ponctua Kervilin.
Ces deux-là avaient largement dépassé le taux autorisé.
— Ne bougez pas ! gueula-t-il.
Il claqua la portière et s’éloigna d’une démarche que le vent rendait hésitante. Corbey l’attendait à la porte de la maison, à l’abri sous un auvent d’ardoise, en parka dont il avait relevé le col. Blainot avait disparu. Simon Kervilin s’arrêta à mi-course pour observer la bâtisse à travers le déluge, une solide construction en pierre de taille, sur deux niveaux, dont les murs extérieurs dessinaient une courbe face aux assauts venteux venus de l’immensité océane. Un double garage sur la droite, puis l’entrée, et des fenêtres étroites aux vitres jaunies par les ampoules intérieures.
La porte n’avait pas été complètement refermée, juste poussée, et le battant oscillait dans les courants d’air. Kervilin enfila des gants de latex avant de se glisser à l’abri. Il souffla. La chaleur, après la furie de l’ouragan, lui fit mal aux oreilles. Il était dans un hall étroit, encombré d’un porte-manteaux chargé. À droite, un couloir desservant des toilettes et en bout, une porte ouverte sur le garage. L’entrée n’était qu’un appendice de l’immense salle dont l’espace avait été divisé en deux par un escalier de trois marches, avec table monastère dans la première partie et grand salon exotique dans la seconde, autour de la cheminée dans laquelle rougeoyait une bûche oubliée.
Du monde partout. Kervilin en resta interloqué. C’était les gendarmes qui avaient procédé aux premières constatations, ils allaient et venaient, un peu désœuvrés dans l’attente des techniciens de la Police Scientifique, posant des traces mouillées sur les tommettes claires. L’atmosphère puait l’humidité, le sang, la tragédie brutale. Kervilin serra la main d’un sous-officier au visage défait.
— Quatre… dit l’homme, je n’ai jamais vu ça ! Elle a tué tout le monde…
Il était anéanti, le cœur au bord des lèvres.
— Le gosse…
— Ne touchez à rien ! ordonna Kervilin.
Il grimpa les trois marches et s’approcha de la femme qui gisait dans le salon, dans une mare de sang. Son corps avait pris une pose presque indécente. Elle était étendue sur le dos, en jupe noire et chemisier blanc, souliers à talon. Elle portait des bas dont l’ourlet de dentelle s’était découvert dans la chute, jusqu’à une bande de peau nue très haut sur la cuisse. Son bras gauche reposait à l’équerre près des restes brisés d’un téléphone cellulaire.
Simon Kervilin s’accroupit avec précaution. La poitrine n’était plus qu’un amas de chair sanguinolente, labourée par la décharge de chevrotine qui lui avait éclaté le cœur. Il remonta vers les traits du visage, la masse de cheveux auburn, les yeux éteints. Des yeux en amande, avec des sourcils fins, des pommettes bien marquées. Une jolie femme sans nul doute. Jeune. Elle fixait le plafond de son regard mort.
— Qui est-ce ? dit-il en maîtrisant sa voix.
— Anita Devheer, l’épouse de Julius, le renseigna l’adjudant de gendarmerie. Elle allait avoir trente ans.
— Vous la connaissiez ?
— Un peu. Julius Devheer vivait sur la commune depuis une douzaine d’années, il nous arrivait de le rencontrer, surtout en saison.
— Elle aussi ?
— On la connaissait moins. Il l’avait épousée depuis. En secondes noces.
Kervilin se releva avec effort. Il entendit ses os craquer, les sentit se remettre en place. Il avait repoussé son feutre sur la nuque, des gouttes glacées lui roulaient dans le cou. Il bougea la tête. La pièce était très haute de plafond et dans l’espace salle à manger s’élevait un escalier menant à une mezzanine avec au-delà, desservies par un long couloir, toute une série de chambres au-dessus des garages. Il interrogea le militaire du regard mais l’autre l’entraîna dans la direction opposée, vers la cheminée à la droite de laquelle était creusé un passage.
— Venez…
L’espace réservé au couple, auquel on accédait par un escalier descendant de trois courtes marches.
— Julius, dit-il, il a été abattu ici.
Dans la chambre, vaste, éclairée par des appliques murales, et faisant face à l’océan par une double porte vitrée, à l’arrière de la maison.
— C’était ouvert, indiqua l’adjudant, l’orage entrait à seaux. C’est nous qui avons refermé.
Le sol était trempé et des débris divers jonchaient toute la pièce traversée par une tornade, des photos avaient été arrachées des murs par la violence des rafales, le couvre-lit s’était soulevé, tout était humide. La pluie mêlée d’embruns frappait les carreaux dans un déchaînement de violence absolue. Leurs silhouettes se découpaient sur les vitres nues, déformées par les rigoles mouillées.
L’homme tué dans la chambre avait été abattu alors qu’il se trouvait probablement assis au pied du lit. Le corps avait été projeté sur le côté dans un geyser de boîte crânienne et de matière cervicale qui maculait la courtepointe. On lui avait tiré dans la tempe et la balle était ressortie, faisant éclater l’arrière de la tête. Un acte de sang-froid.
Julius Devheer.
Simon Kervilin fit quelques pas pour s’approcher. Il reconnaissait ces traits aperçus au hasard d’articles de presse, la mâchoire carrée, le nez fort, le front dégarni. Un visage buriné, marqué de rides, un cou épais.
— Il avait trente ans de plus qu’elle, non ? nota-t-il.
C’était la première pensée qui lui venait à l’esprit.
— Pas loin…
Il se pencha, sans rien toucher, examinant simplement les contours de l’horrible blessure, puis se releva :
— À bout touchant, dit-il, une véritable exécution.
La pièce était moquettée et maculée de traces noirâtres. L’homme portait des mocassins aux pieds, un épais pantalon de velours et une veste de cuir par-dessus un pull-over de laine.
— Vous avez trouvé l’arme… ?
— Probablement un 7,65 que nous avons découvert là-haut, nous n’y avons pas touché. Il y a un fusil aussi.
— Chez la fille ?
Le gendarme hocha la tête. On devinait qu’il n’avait pas envie de parler, que tout cela le meurtrissait profondément.
— Comment s’appelle-t-elle ?
— Caroline.
— Et vous la connaissiez, elle ?
— De vue, seulement. Elle ne se mêlait pas aux gens du pays. Elle était un peu bizarre, on dit qu’elle avait des problèmes.
— De quel genre ?
Il haussa les épaules.
— Un peu folle, allez savoir…
— C’est-à-dire ? s’impatienta Kervilin.
Il ne comprenait pas. L’un des bleus était assis sur une chaise, la mine désabusée, inerte. Il observait le corps d’Anita Devheer et Kervilin se demanda si ce n’était pas entre les cuisses qu’il regardait. C’était quoi, ce cirque ?
— Une droguée, disait l’adjudant. Pas de boulot. Elle piquait des crises. Julius n’était pas son père. Elle avait été adoptée après le décès de ses parents, je crois qu’elle avait cinq ou six ans. Son véritable père était le frère de Julius, elle n’a jamais été bien après…
Simon Kervilin tripotait son briquet de laque noire, au fond de la poche de son imperméable. Il avait envie de fumer.
— Elle était suivie ?
— Médicalement, vous voulez dire ? Il me semble, mais ça reste à vérifier.
Évidemment. Il demeura un moment immobile à fixer le corps de Julius Devheer, puis remonta les marches vers le salon au moment où entraient les techniciens de la Police Scientifique, lourds d’humidité. Le vent ne désarmait pas, ni la pluie, ni les grondements abrutissants de l’océan.
Par instants, l’éclairage montrait des signes de faiblesse avant de retrouver son intensité première. On était en bout de ligne, il faisait froid dans cette grande maison, tout y était mouillé avec la porte extérieure ouverte et refermée sans cesse.
— Salut Kervilin.
— Salut.
— On commence par qui ?
Kervilin haussa les épaules. Il s’en foutait, autant prendre dans l’ordre.
— Par elle… Lui ensuite, dans la chambre, les deux autres sont à l’étage.
Il fit signe à l’adjudant de le précéder dans l’escalier qui formait un coude à mi-hauteur, ils émergèrent sur la mezzanine. L’espace avait été aménagé en salle de billard – bibliothèque, un billard français dont l’une des queues avait été retirée du râtelier et reposait sur le tapis. Des fauteuils de cuir, des rayonnages, une table basse, un bureau dans l’angle, éclairé par une lampe à abat-jour de verre, un parquet ciré, avec pour horizon au travers de la rambarde, le coin salon du rez-de-chaussée et sa cheminée de pierre. Un décor pour gens fortunés.
Simon Kervilin plongea les yeux vers cet espace qu’il dominait. De là-haut, l’idée que l’on se faisait du drame évoluait. Le corps d’Anita Devheer n’était plus qu’un élément parmi d’autres et il devenait évident que le téléphone brisé se rattachait à elle. Il était facile d’imaginer qu’elle s’était éloignée, qu’elle reculait tout en hurlant sa terreur. Elle avait été abattue à quelques mètres, projetée en arrière, elle s’était effondrée en lâchant l’appareil qui s’était déboîté.
Elle avait eu le temps de lancer un SMS au frère de Caroline.
« Peut-être… », songea Kervilin qui n’aimait pas se faire forcer la main.
Sûrement. Quoi d’autre ?
Il se retourna vers l’adjudant resté planté à l’angle du billard.
— C’était sa seconde épouse, vous savez ce qu’est devenue la première ?
— Elle est décédée, Julius Devheer était veuf lorsqu’il a rencontré Anita.
— Et le fils, c’était leur fils ?
— Pas davantage. Ils n’avaient pas d’enfant, ils avaient adopté le frère et la sœur.
Simon Kervilin marcha d’un pas lourd vers l’ouverture qui menait aux chambres, dans le mur du fond, des pièces en enfilade, de part et d’autre du couloir. Toutes les portes étaient ouvertes. Il fit quelques pas dans la première mais resta bloqué dans l’entrée.
La chambre du petit. Un bambin d’à peine trois ans figé en pyjama sous les draps blancs de son lit placé près d’une table de chevet. Ce fut le seul instant de réelle émotion ressentie par Kervilin. Il haïssait les meurtriers d’enfants. S’il voulait bien comprendre toutes les rancunes des hommes, il ne supportait pas l’idée d’accorder la moindre indulgence à l’assassin d’un gosse.
Quelles qu’aient été ses raisons, quelles qu’aient été ses souffrances.
— Elle a tiré d’ici, énonça l’adjudant qui lisait dans les pensées de Simon, à cinq mètres.
Il s’efforçait de conserver une tonalité neutre. Kervilin pensait à son propre fils, à sa fille, aux petits qui devaient avoir approximativement l’âge d’Aurélien Devheer. Il ne les voyait plus que de loin en loin, les choses sont ainsi, ça ne l’empêchait pas de les aimer.
— Il devait dormir…
Il se décida à s’avancer plus avant et se pencha au-dessus du gamin, à le toucher, respirant l’odeur qui sourdait du corps étendu. Une seule décharge. C’était au fusil que Caroline avait abattu son frère. Il se redressa avec difficulté. Un frère qui était aussi son cousin… Comment avait-elle accepté l’arrivée de ce petit bout ?
Il regagna le couloir en silence. Salle de bains en face, une brosse à dents. La dernière chambre sur la gauche était celle de la fille.
— Caroline… murmura l’adjudant.
La responsable de ce massacre.
Quel âge avait-elle ? Vingt-deux ou vingt-trois ans, pas davantage. Elle aussi avait dû être une jolie fille, avec des cheveux longs d’un blond très clair hérité sans doute d’une lointaine ascendance nordique. Devheer… Elle était étendue sur son lit. De ce qui restait du magma sanglant qu’avait été sa tête, on pouvait encore deviner ses yeux d’un bleu tendre fixant le plafond. Elle était vêtue d’un jean et d’un gros pull-over de laine à col roulé, en chaussettes. À son côté, posé à hauteur de l’épaule, un pistolet Mélior 7,65, une arme ancienne.
Kervilin fit trois pas. Avec le recul, le fusil avec lequel Caroline s’était fait exploser le menton lui avait glissé des mains, mais il était resté bien droit, la crosse coincée entre les cuisses. Le mur, à la tête du lit, était éclaboussé de matière cervicale.
Kervilin saisit le canon du fusil entre pouce et index pour l’approcher de ses narines et respira :
— Ouais… dit-il.
Pas de doute. On retrouverait les empreintes de la jeune femme sur le canon, la crosse, la détente… Elle s’était allongée, avait posé l’arme entre ses seins, tendu le bras, glissé le pouce sur l’acier froid, la gueule noire du fusil collée à sa gorge. Elle avait appuyé.
— Vous savez si Devheer avait un port d’arme ?
— Non. Je veux dire que je ne sais pas.
Pourquoi Caroline avait-elle utilisé le fusil pour abattre sa belle-mère et Aurélien ? Le Mélior avait pu s’enrayer. Ce qui sous-entendait que Julius avait été tué le premier. Simon Kervilin ne voulait rien déplacer, pas tant que la scène n’avait pas été photographiée.
Il fut surpris en se retournant de découvrir la silhouette de Blainot encadré dans le chambranle, en ciré boutonné jusqu’au cou, la tête enveloppée d’une capuche dont le rabat lui masquait presque les yeux. Il ne dit rien.
La chambre de Caroline ressemblait à une chambre d’étudiante, avec ses livres, sa chaîne, sa télé dans un coin, ses photos aux murs. Un portrait d’elle, de la taille d’un poster, en noir et blanc, sans décor, assise sur une chaise de paille tressée, en jean et pieds nus, sans rien d’autre, les bras croisés sur la poitrine, mains aux épaules. La lumière latérale jetait des ombres douces. Un cliché de studio, professionnel. Signé. Kervilin déchiffra l’incrustation, dans l’angle droit.
— Vous savez ce qu’elle faisait de ses journées ?
L’adjudant hocha la tête.
— Non, on la voyait très peu sur la commune.
— Rien, articula Blainot. Une droguée, un peu pute et à moitié cinglée.
Kervilin le fixa d’un regard dur.
— Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?
— Je viens de passer un quart d’heure dehors avec la femme de ménage. Elle travaille ici depuis douze ans et elle habite à côté, c’est son mari qui a aperçu les gyrophares et qui l’a réveillée. Elle est arrivée en courant.
— Où est-elle ?
— Je lui ai dit de rentrer et de vous attendre, j’ai pensé que vous aimeriez la voir.
« Minable… » songea Kervilin sans frémir. « Mets-toi sur ma route une fois, rien qu’une fois, donne-moi l’occasion de balancer tes petites magouilles… »
Il empocha sans même la lire la feuille arrachée à un carnet que lui tendait Blainot et fit le tour sur lui-même. Tout paraissait tellement simple. Sur le bureau, un ordinateur sous tension affichait une vue marine en fond d’écran. Il toucha la souris du bout de l’index et le mot s’inscrivit en lettres grasses : « PARDON ».
Il sortit de la chambre sans plus se tracasser des autres, refusa de jeter en passant un regard vers l’enfant et attaqua les marches pour descendre. C’était l’agitation en bas, des allées et venues entre le salon et la chambre d’Anita et Julius Devheer, des éclairs de flash, des recherches de traces, d’indices, et toujours dans le fond la colère de l’océan et les hurlements déchaînés du vent.
Le parquet était arrivé, le procureur lui-même, appuyé des reins contre la table monastère, en lourd manteau d’hiver, le regard las posé sur le corps étalé d’Anita Devheer. Il n’était pas venu seul. André Droniou, le commissaire Droniou, était à ses côtés, visage émacié mangé par une barbe naissante, petites lunettes aux verres épais, front dégarni. L’air ennuyé.
— Quel bordel ! murmura-t-il en guise d’accueil. Blainot vient de nous dire que c’est la fille qui a fait ça ?
— À première vue, mais il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions, objecta Kervilin. Elle aussi est décédée.
— Suicide ?
— Coup de fusil en pleine tête.
— Putain… Vous savez qui c’était, Devheer ?
Il n’attendait pas vraiment de réponse. Le groupe Devheer était un empire, des centaines de salariés, de fournisseurs, de sous-traitants. Thalasso, hôtels de charme, centres de loisirs. C’était à ça que songeait le magistrat.
— C’est son fils qui nous a alertés ?
— Le frère de Caroline, oui. Il a fait un malaise, il est à l’hôpital.
— Manquerait plus que ça… La presse va nous assaillir, pronostiqua le procureur. Et les élus. Et le préfet. Et les syndicats qui vont s’inquiéter.
Il agita la tête, ulcéré d’avance.
— Il faut que nous réussissions à joindre les dirigeants du groupe.
Un dimanche à quatre heures du matin.
— Il était absent ? insista Droniou qui suivait son idée.
— À une soirée avec des copains. Chez lui. Anita Devheer lui a passé un texto avant d’être abattue, elle écrivait que Caroline était devenue folle et qu’elle voulait tuer tout le monde. Il l’a appelée, elle n’a pas décroché. Il a donné l’alerte et ils sont venus ici.
— Les deux dans le fourgon ?
— Oui.
— Vous les avez interrogés ?
— Pas encore.
— Allez-y. Et informez-moi, minute par minute s’il le faut.
Kervilin les laissa, soulagé de sortir de cette maison. Il se planta sous l’auvent et alluma enfin la cigarette que réclamaient ses poumons. Pas la peine d’espérer la fumer tranquillement en marchant sous l’averse, les trombes d’eau qui continuaient de se déverser auraient tôt fait de la transformer en chique dégoulinante. Il rajusta le bord de son feutre, se massa les globes oculaires et considéra les abords de la propriété plongés dans l’obscurité déchaînée.
C’était un bout du monde ici, l’océan sur trois côtés, une route étroite qui serpentait entre les dunes, du sable, de la caillasse, de la lande, le village un peu plus loin sur la gauche, encore endormi. La maison se dressait comme un phare à la pointe de la langue de terre, isolée du reste, les pieds presque léchés par les vagues.
Kervilin sortit de sa poche le morceau de papier et lut à la lumière de l’ampoule extérieure : Jocelyne Deville, rue Guervert. Il faudrait prendre la voiture, il n’avait pas envie de marcher sous le déluge.
Il mâchouilla son mégot jusqu’à la rue et ne le jeta qu’au moment d’ouvrir le fourgon. Les deux jeunes paraissaient toujours aussi mal en point, exsangues dans l’éclairage glauque, les yeux nébuleux. Ils devaient avoir froid.
— On aimerait bien aller se coucher, entama l’un d’eux.
— Je comprends ça, compatit Kervilin en s’asseyant. Votre copain est à l’hôpital, mort peut-être s’il était un peu fragile du cœur. Au fait, vous vous appelez ?
— Pascal Tesson, et lui Max Caravel. Il ne se sent pas trop bien.
Il bavait en effet, la tête appuyée à la paroi, le regard presque vitreux.
— Vous devriez lui dire de ne pas dégueuler ici, conseilla Kervilin, croyez-moi, une telle abstention serait appréciée.
— On est entrés avec Cédric tout à l’heure, c’était…
— Je sais. Alors ne perdons pas de temps. Voilà comment je vois les choses, Pascal : vous me racontez dans le détail et spontanément votre emploi du temps depuis l’instant où vous avez retrouvé Cédric Devheer, je vous appelle un taxi et vous rentrez tranquillement vous mettre au lit. Ou alors vous ne vous souvenez plus précisément, vous hésitez, et je vous fais placer en cellule de dégrisement en attendant un interrogatoire en règle.
— Nous n’avons rien à cacher.
— C’est ainsi que je l’entendais. Je vous écoute…
Il avait sorti un calepin et extrait un stylo de sa poche. À côté, Max Caravel s’était mis à grincer des dents. Il ne tiendrait plus longtemps dans ce froid, avec une simple veste trempée sur les épaules.
— À quelle heure avez-vous retrouvé Cédric ?
— Vers dix-huit heures, chez lui, nous avions projeté de passer la soirée ensemble.
— Tous les trois ?
— Au début, oui. On a traîné un peu, en écoutant de la musique, en buvant une bière ou deux, et puis on est sortis.
— Il habite où, Cédric ?
— Rue Ferdinand Le Dressey, un appartement qui donne sur le port. On a pris sa voiture pour monter jusqu’à la mairie et on a dîné rue des Halles, peut-être jusqu’à vingt et une heures trente. On n’avait pas d’intentions bien précises, alors on a décidé d’aller faire un bowling et de boire un verre au Bar-bi, Parc du Golfe.
— Cédric, coupa encore Kervilin, vous le connaissez depuis longtemps ?
— Quinze ans au moins, on a fait toutes nos études secondaires ensemble à SFX, on ne s’est jamais perdus de vue.
Il se rendait compte que Tesson devait forcer la voix, abruti par le martèlement incessant des gouttes qui claquaient contre la carrosserie. Par instants, une rafale plus violente venait secouer leur prison et on ne voyait rien au-dehors, derrière les vitres noyées.
Kervilin frissonna.
— Et maintenant, vous faites quoi ?
— Je travaille dans la grande distrib’, au Poulfanc, à la comptabilité.
— Continuez. Vous étiez au Bar-bi.
— Oui… On a joué une heure ou une heure et demie, je ne sais pas très bien, avant de retrouver des copines. Elles traînaient aussi, sans trop savoir quoi faire, on les a invitées à se joindre à nous. La tempête se levait, il commençait juste à pleuvoir. Cédric a proposé de finir la soirée chez lui.
— Avec elles ?
— Évidemment. Elles n’étaient pas contre. Elles étaient trois, c’était parfait. On a pris les voitures et on est rentrés rue Le Dressey.
— Quelle heure ?
Pascal Tesson remua les épaules. À ce moment-là, il devait commencer à être bien chargé, les souvenirs se diluaient dans la brume. Il hésita :
— Minuit et demie… Plus peut-être, une heure…
— Qu’est-ce que vous avez fait ensuite ?
— Cédric a débouché une bouteille. Et on a roulé quelques joints. Ça devenait chaud. Une des filles s’est mise à danser, elle était complètement stone. Elle disait qu’elle voulait se mettre nue au soleil et on la regardait faire. Il y avait un vent terrible dehors. C’est alors que le téléphone de Cédric a vibré.
— Une heure et demie ? Deux heures ?
— Je ne sais pas. Désolé, mais je n’en ai aucune idée.
Simon Kervilin lui fit signe de poursuivre.