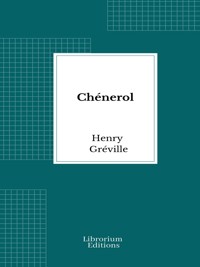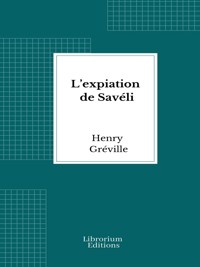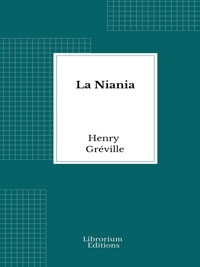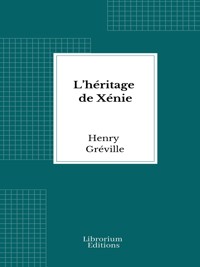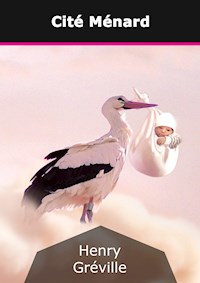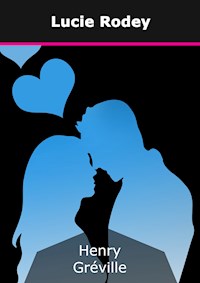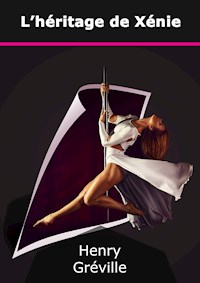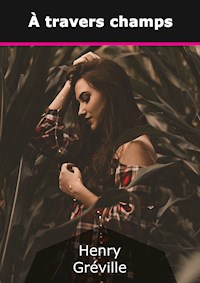2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Vous le voyez, ma chère dame, j'ai eu bien des peines, conclut la veuve en s'essuyant les yeux, et encore, je crains bien de n'être pas au bout. - Pourquoi ? demanda innocemment madame Aubier. - Parce que les affaires d'argent ne sont pas terminées, et je crois bien que la famille de mon défunt mari ne les arrangera pas à mon avantage. - On ne peut pas leur demander ça ! fit observer la vieille dame, non sans quelque apparence de bon sens : votre mari vous avait épousée malgré eux ; ils n'ont aucun motif de vous avantager dans ce partage. - Depuis deux ans que cela dure, il me semble pourtant qu'ils auraient pu en finir ; mais... Madame Philomène Crépin laissa sa phrase inachevée, et sa confidente essaya de la terminer pour elle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Les mariages de Philomène
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXPage de copyrightHenry Gréville
Les mariages de Philomène
Henry Gréville, pseudonyme de Alice Marie Céleste Durand née Fleury (1842-1902), a publié de nombreux romans, des nouvelles, des pièces, de la poésie ; elle a été à son époque un écrivain à succès.
I
– Vous le voyez, ma chère dame, j’ai eu bien des peines, conclut la veuve en s’essuyant les yeux, et encore, je crains bien de n’être pas au bout.
– Pourquoi ? demanda innocemment madame Aubier.
– Parce que les affaires d’argent ne sont pas terminées, et je crois bien que la famille de mon défunt mari ne les arrangera pas à mon avantage.
– On ne peut pas leur demander ça ! fit observer la vieille dame, non sans quelque apparence de bon sens : votre mari vous avait épousée malgré eux ; ils n’ont aucun motif de vous avantager dans ce partage.
– Depuis deux ans que cela dure, il me semble pourtant qu’ils auraient pu en finir ; mais...
Madame Philomène Crépin laissa sa phrase inachevée, et sa confidente essaya de la terminer pour elle.
– Mais ils espèrent lasser votre patience par leurs lenteurs ?...
– Non ! répliqua énergiquement Philomène, c’est moi qui les arrête, et ils finiront par céder d’ennui, sinon de bonne grâce !
– Ah ! fit madame Aubier, en regardant la veuve avec une certaine admiration, mêlée de surprise, pour cette forte conception dont elle ne la croyait pas capable.
Les deux femmes restèrent un moment silencieuses, et la confidente de Philomène profita de ce temps de repos pour regarder discrètement par la fenêtre qu’elle avait contre son coude gauche.
Cette fenêtre, garnie de petits rideaux en calicot blanc, laissait filtrer un jour blafard ; les galons rouges qui relevaient les plis mous du calicot sans apprêt ne parvenaient pas à lui donner un aspect hospitalier, pas plus que les fleurs posées à l’intérieur sur une tablette de sapin, faite tout exprès et posée sur deux traverses. Ces fleurs, il faut l’avouer, n’étaient pas de celles dont l’aspect engageant sollicite le regard et l’odorat ; c’étaient de superbes cactus de toute espèce : en boule, en poire, en raquette, en cierge, mais toujours hérissés de pointes et d’épines menaçantes. La nature n’a pas voulu que les cactus fussent attrayants quand ils ne sont point en fleur ; peut-être une certaine affinité mystérieuse était-elle le motif de la passion qu’éprouvait madame Crépin pour les plantes grasses.
La commode, surmontée d’une glace perchée à une hauteur qui la rendait parfaitement superflue, servait d’étagère, et une quantité prodigieuse d’objets bizarres et inutiles l’encombrait depuis le mur jusqu’à l’extrême bord : coquillages exotiques, figurines de porcelaine, petits paniers de paille tressée, noix de coco sculptées, en un mot tout le fatras qu’on trouve dans les ports de mer chez les marins et leurs parents ou amis. L’inspection de cette commode suffisait amplement à prouver que M. Crépin, de son vivant, avait été capitaine au long cours.
Le reste du mobilier, propre et simple, ne différait pas de ce qui se voit chez la petite bourgeoisie de province ; le sol était en pierre ; de larges dalles de schiste, usées par les pieds de plusieurs générations, se rejoignaient inexactement, formant de petites cavités où le balai de la ménagère livrait tous les jours à la poussière de redoutables combats ; des rideaux de perse violette au lit, une grande et belle armoire de vieux chêne, une table ronde, recouverte d’une toile cirée, quelques chaises, et un gros chat dans l’immense cheminée à manteau de sapin noirci par la fumée, complétaient l’arrangement de cette pièce correcte et peu avenante.
– Il pleut, n’est-ce pas ? demanda madame Crépin, en suivant le regard de son amie.
– Oui ; pas bien fort, pourtant. Voilà M. Lavenel qui passe.
La veuve réprima un très léger mouvement qui la portait vers la fenêtre, puis elle essuya encore une fois ses yeux avec son mouchoir.
– Ah ! ma pauvre dame, reprit-elle, qu’on a de malheur dans la vie !
– Vous en avez eu votre part, Philomène, dit madame Aubier d’un ton conciliant ; vous pouvez espérer de meilleurs jours. Et puis, ce n’est pas pour faire un reproche à la mémoire du capitaine, mais, depuis sa mort, vous êtes plus tranquille que vous ne l’avez jamais été.
Madame Crépin soupira.
– Les femmes de marins sont bien malheureuses, dit-elle ; si leur mari est à terre, elles tremblent qu’il ne s’en aille, et quand ils sont en mer, c’est bien pis.
– Mais, Philomène, je n’ai jamais su comprendre pourquoi vous aviez épousé un marin ? Votre père tenait un petit commerce, vous auriez pu le reprendre et entrer en ménage avec un brave garçon qui vous eût donné un coup de main ; on fait fortune de la sorte, tandis qu’avec un marin, on mange tout ce qu’on a !
– Je n’ai jamais aimé le commerce, madame Aubier, dit confidentiellement la veuve en appuyant la main sur le genou de sa visiteuse ; je détestais la cassonade, le poivre moulu et la chicorée : je m’étais juré de sortir de la boutique, et j’en suis sortie.
Madame Aubier se dit en elle-même : – Je ne vois pas ce que vous y avez gagné ! Mais, comme c’était une femme prudente et avisée, elle garda sa réflexion pour elle.
– Celui qui vous a acheté le fonds après la succession de votre frère a fait de bonnes affaires ; il a agrandi la boutique de moitié, et voilà qu’il s’est mis à vendre du lard.
– Pouah ! fit dédaigneusement Philomène, n’est-ce pas un beau métier que de vendre de la graisse et d’avoir les mains sales !
– Ils ont pourtant joliment marié leur fille, repartit madame Aubier plus vivement, et leur gendre n’a pas trouvé leur argent malpropre !
– À qui m’avez-vous dit qu’ils l’ont mariée ? demanda Philomène d’un air distrait ; son regard sournois suivait attentivement les mouvements de la physionomie de la bonne dame, sans que celle-ci s’en aperçût.
– À un membre de la chambre de commerce du Havre, le fils du père Martinet, qui a gagné quinze mille francs de rente dans le commerce des eaux-de-vie ; un notable commerçant, tout ce qu’il y a de bien.
Madame veuve Crépin indiqua par un mouvement dédaigneux des épaules qu’un notable commerçant du Havre ne pesait pas plus qu’un fétu dans sa balance.
– Il y en a pour tous les goûts, dit-elle ensuite ; je sais bien que si j’avais été homme, je n’aurais pas épousé la fille d’un marchand de graisse.
– Votre mari a bien épousé la fille d’un épicier, répliqua madame Aubier, provoquée jusqu’à la malice par les propos de Philomène. Allons, ma chère, ne faites pas la renchérie ; vous savez bien qu’il n’est pas de sot métier, et, d’ailleurs, votre beau-père était un simple pêcheur de Grandville ; il n’y a donc pas à médire de ceux qui, partis d’en bas, gravissent l’échelle. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur ; il n’y a que nos vertus ou nos fautes qui font une différence.
Madame veuve Crépin ne répondit pas ; elle devait cinq cents francs à madame Aubier, et lui accordait d’autant plus de considération qu’elle n’avait pas une intention arrêtée de les lui rendre avant une époque extrêmement lointaine. D’ailleurs, madame Aubier était la femme d’un capitaine d’infanterie en retraite employé du gouvernement ; elle était riche, – du moins comparativement à sa médiocrité peu dorée ; madame Aubier n’avait pas d’enfants, et sa bonne faisait d’excellente cuisine. Or, Philomène aimait les bons morceaux, et puis on voyait bien du monde chez ces gens-là, et toujours du monde très comme il faut : il ne fallait pas se brouiller avec des personnes si recommandables.
– Alors, reprit madame Aubier, désirant pallier par une remarque d’intérêt ce que la semonce récente pouvait avoir d’amer, vous quitterez le deuil dimanche ?
– Hélas ! quitter le deuil ! Ce n’est pas quitter le deuil que de mettre du blanc et du noir à son chapeau, au lieu de crêpe tout uni ! Je ne porterai jamais de couleurs claires, bien sûr ! Mais le noir est si salissant !
– Et puis deux ans de deuil sont tout ce qu’on peut exiger, conclut madame Aubier en souriant. Savez-vous, Philomène ? j’ai dans l’idée que vous vous remarierez !
– Moi ! Seigneur Dieu ! Ah ! si jamais l’idée m’en venait, il faudrait que j’eusse perdu la raison. Après tous mes chagrins, la mort de mon mari et celle de mes cinq enfants !. Ah ! madame Aubier, je vous croyais meilleure opinion de moi.
Il n’y a pas de mal à vouloir se remarier, répondit l’honnête femme sans s’émouvoir ; le mal serait à ne pas vouloir se remarier et à se faire courtiser par des galants : ce n’est pas votre cas, Philomène ; mais ne vous défendez pas du mariage ; sinon, on pourrait vous demander pourquoi vous soulevez le coin de votre rideau quand M. Lavenel passe le matin et que votre chambre n’est pas faite.
– Qui est-ce qui vous a dit... ? commençait la veuve, rouge de confusion, et probablement aussi de colère ; mais elle se souvint fort à propos que madame Aubier demeurait en face d’elle, de l’autre côté de la rue, et qu’elle n’avait pas eu besoin de prendre des informations sur ce chapitre.
La bonne dame sourit, et son double menton frémit avec complaisance sur le foulard blanc qu’elle portait invariablement au cou.
– C’est bien naturel, reprit-elle ; Lavenel n’est pas vilain, il n’est pas bête ; on le dit un peu dur au monde ; mais les maris ne sont pas toujours pour leurs femmes ce qu’ils sont pour les autres gens ; il se pourrait qu’il fît un bon époux.
– Ah ! madame Aubier, cessez votre discours, ou bien je croirai que vous voulez me faire de la peine ! Après avoir tant aimé mon pauvre Crépin, pouvez-vous croire que je voudrais épouser un Lavenel ? Mon mari était cent fois plus beau et plus aimable, – et ce n’est pas Lavenel qui me le fera oublier.
– Comme vous voudrez, Philomène, comme vous voudrez. C’est votre affaire, et non la mienne ; d’ailleurs, l’affection ne se commande pas, ni la haine non plus. Voilà la pluie qui a cessé ; je m’en retourne chez nous. Bonsoir.
– Voulez-vous un parapluie, madame Aubier ? dit la veuve avec empressement.
– Mais non, je vous remercie, puisqu’il ne pleut plus ; et d’ailleurs, pour traverser la rue, ce ne serait pas bien nécessaire. Allons, bonsoir, Philomène ; à tous ces jours.
– À tous ces jours, madame Aubier ! merci de votre visite !
Sur cette formule normande qui ne précise point de date, les deux dames se séparèrent. Philomène rentra chez elle, pendant que la grosse madame Aubier, essoufflée et souriante, répondait de la tête aux commères sur leurs portes et se hâtait de traverser la rue.
– Lavenel ! dit la veuve avec mépris tout haut quand elle se vit seule ; Lavenel ! beau parti pour moi ! Il me faudra mieux que cela quand je me déciderai.
Le soir était venu. Philomène, qui, nous l’avons dit, ne détestait pas les bons morceaux, était en train de retirer du feu une côtelette de veau avec son accompagnement de petits pois, et elle humait avec une volupté mélancolique le parfum appétissant de son souper : volupté, cela se comprend ; mélancolie, parce que la viande est si chère ! Une main indiscrète frappa deux coups à la porte, et aussitôt un visiteur entra.
– Ah ! c’est vous, monsieur Lavenel ? dit Philomène d’un ton qui n’avait rien d’engageant.
– Mais oui, voisine, c’est moi ; est-ce que je vous dérange ?
La veuve avait eu le temps de recouvrir la casserole et de la déposer sur l’âtre ; elle se dirigea vers l’intrus en lui disant : – Mais non, mais non, exactement comme elle eût dit : Mais oui, mais oui !
– C’est que j’ai cueilli tantôt des cerises avant la pluie, madame Crépin ; elles ne sont pas mouillées, soyez tranquille, et je vous en ai apporté quelques-unes.
Les quelques cerises remplissaient tout un panier, que leur propriétaire déposa sur la table avec cette sorte d’orgueil qu’on est convenu d’appeler modestie.
– Mais, monsieur Lavenel, je ne mangerai jamais tout ça ! s’écria la veuve un peu radoucie.
– Vous ferez des confitures, repartit le galant visiteur.
– Le sucre est si cher ! murmura Philomène en contemplant les cerises d’un œil triste.
– Bah ! fit le célibataire d’un air dégagé, – on peut se procurer bien des douceurs dans votre position !
– C’est ce qui vous trompe, répliqua vivement madame Crépin ; il ne faut pas vous figurer que je suis à mon aise, – j’ai à peine de quoi nouer les deux bouts, et encore à condition de me priver de tout.
– Dans tous les cas, ne vous privez pas de cerises ; en voilà qui ne demandent qu’à être mangées.
Lavenel, d’un air distrait, fourra ses doigts dans le panier et en retira une poignée de fruits qu’il se mit à grignoter lentement, gardant les queues et les noyaux dans sa main gauche. Philomène le regardait d’un regard curieux ; il leva la tête et rencontra ce regard, qui devint aussitôt plein de douceur.
– Heureusement, pensa Lavenel, je te connais, – sans cela je te croirais douce comme miel. Voilà ce qui serait une illusion !.. Comme cette phrase ne pouvait se traduire en langage civilisé, il ajouta tout haut :
– Vous vous ennuyez bien, n’est-ce pas, madame Crépin ?
– De quoi, mon cher monsieur ? demanda prudemment la veuve.
– Mais de tout ! D’être seule, d’être veuve, d’avoir perdu vos enfants (Philomène s’essuya les yeux), – de voir vos affaires traîner sans vouloir finir. Voulez-vous que je vous dise ? Il faudrait un homme pour mener tout ça ! Jamais vous n’en sortirez à vous toute seule !
– On me l’a dit, fit observer Philomène d’un air sage. Après une demi-seconde, elle ajouta : Mais je n’ai pas de parents assez proches pour les charger de mes affaires.
– Il n’est pas besoin d’être parents pour s’entraider, voisine, repartit Lavenel, après avoir laissé s’écouler un temps appréciable, comme s’il avait médité sa réponse. Je ne vous suis pas parent ; mais si je puis vous être utile à quelque chose.
– Oh ! monsieur Lavenel, vous savez bien que cela ne se peut pas ! Que dirait-on dans le pays ? fit pudiquement Philomène en baissant les yeux.
– On dirait ce qu’on voudrait, voisine ; et puis, tout ce qu’on pourrait dire ne s’éloignerait peut-être pas beaucoup de la vérité.
Philomène, qui était restée debout jusque-là, s’assit, tournant le dos à la lumière, et Lavenel, pour mieux gouverner son éloquence, posa sur le coin de la table le petit tas de queues et de noyaux qu’il avait dans la main gauche.
– On dirait que vous avez de l’amitié pour moi et que j’en ai pour vous. En ce qui me concerne, du moins, on ne mentirait pas, car j’en ai, de l’amitié pour vous, madame Crépin, et beaucoup !
Madame Crépin sourit faiblement, et son interlocuteur s’assit en face d’elle.
– Si vous vouliez, continua-t-il confidentiellement, nous pourrions faire une paire d’amis ; vous êtes dans une jolie position...
– Ah ! voisin, je suis bien pauvre, je ne sais pas qui a pu vous parler de ma position ; certes, elle n’est pas enviable !
– Eh bien, voisine, il faut la changer contre une autre, conclut triomphalement Lavenel.
– Vous en parlez bien à votre aise, murmura Philomène en faisant à son tablier de petits plis qu’elle enfermait dans sa main gauche.
– Vous n’avez qu’un mot à dire, madame Crépin, proféra Lavenel en se levant et en mettant la main sur son cœur ; Théodore Lavenel, marchand de grains et farines à Diélette, vous offre sa main et sa fortune !
Philomène continua à rassembler encore deux ou trois plis d’étoffe, puis elle ouvrit la main et les lâcha tous à la fois.
– C’est beaucoup d’honneur que vous me faites, voisin, répondit-elle d’une voix câline.
– Vous acceptez ? s’écria le marchand de grains et farines en faisant un pas vers elle.
– Excusez-moi, voisin, je n’aime pas le commerce, dit Philomène de la même voix douce.
Lavenel resta stupéfait, la bouche entrouverte ; rien ne lui avait fait prévoir cette réponse.
La veuve n’avait pas pour habitude d’être, suivant l’expression du pays, plus aimable qu’il ne faut, et certainement elle avait jusqu’alors très bien reçu son voisin ; celui-ci avait donc pu se targuer d’une bienveillance spéciale : d’où venait ce refus imprévu ? C’est ce qu’il lui demanda aussitôt que la surprise lui permit de parler.
– Je n’aime pas le commerce, répéta madame Crépin avec un aimable sourire, vous le savez bien, voisin ; car, depuis que je suis au monde, je n’ai jamais cessé de le répéter.
– Ce n’est pas une bonne raison, voisine, répliqua Lavenel ; on peut ne pas aimer le commerce et pourtant ne pas détester le commerçant.
Madame Crépin sourit encore et baissa les yeux, puis son visage reprit une expression de tristesse résignée.
– Voisin, dit-elle, après tous les chagrins que j’ai eus, après avoir aimé mon pauvre mari comme je l’ai aimé, il m’est bien pénible de songer seulement au mariage ; – et puis, ajouta-t-elle sans regarder son poursuivant, mon deuil n’est pas seulement fini.
– Comme vous voudrez, voisine, répliqua le marchand de grains et farines ; ce n’est peut-être pas votre dernier mot.
Il se dirigea vers la porte, accompagné par Philomène, qui le regardait en dessous. La main sur le loquet, il se retourna.
– J’ai dans l’idée, répéta-t-il, que ce n’est pas votre dernier mot.
– Peut-être bien ! fit la veuve avec un signe de tête.
Avant que Lavenel ahuri eût eu le temps de dire un mot, il était déjà dans la rue, et la porte s’était refermée.
– La drôle de femme ! murmura-t-il en regagnant sa boutique ; si elle n’avait pas ses quelques sous, c’est moi qui l’enverrais promener, la mijaurée !
Pendant que l’objet de ce discours retournait à sa côtelette avec un sourire aussi énigmatique et moins doux que celui de la Joconde, M. Lavenel rentra chez lui, où sa mère l’attendait, derrière le comptoir, en tricotant un bas de laine indigo qui lui déteignait sur les doigts.
– Eh bien ? dit la vieille femme en poussant sa cinquième aiguille sous le bandeau de sa coiffe normande aux ailes relevées.
– Elle a refusé ! dit son fils d’un air bourru.
– Refusé, mais pas à fait ? répliqua la vieille paysanne rusée.
– Non ! pas tout à fait. Comment pouvez-vous savoir, ma mère, qu’elle ne m’a refusé qu’à moitié ?
– Parce que je connais la Crépine : c’est une fieffée coquette et une vaniteuse.
– Il n’y a pourtant pas de quoi, murmura Lavenel en songeant aux cheveux jaunes et au nez pointu de la dame de ses pensées.
– Mais si, fils, il y a de quoi. Le petit clerc à maître Toussaint a passé par ici tantôt, pendant que tu étais en ville ; la Crépine a, en bonnes terres du côté des Pieux, quinze mille écus au moins, et de plus, une fois ses comptes de succession réglés avec les débiteurs de son mari, elle aura cinq ou six mille francs d’argent comptant. La famille de défunt Crépin a consenti à lui laisser les créances à condition que c’est elle qui les recouvrera.
Lavenel resta pensif ; sa mère le regardait tout en tricotant, et attendait patiemment le fruit de ses réflexions.
– Le sait-elle ? demanda-t-il enfin.
– Je ne crois pas. Le petit clerc m’a dit que la lettre n’était arrivée que de ce matin.
– Elle va être encore plus fière, gronda Lavenel. Ah ! si je n’avais pas besoin d’argent !.
Il jeta son chapeau sur le comptoir d’un air bourru.
– Il y a d’autres filles ou veuves dans le monde, fit observer sa mère.
– Oui, mais le diable a voulu que j’eusse un goût pour celle-là, autrefois. Je veux être pendu si je sais pourquoi. Elle était jolie, dans le temps, avant son mariage.
– Ça lui a bien passé ! fit observer philosophiquement madame Lavenel. La beauté est un don périssable.
– Oui, c’est vrai, ça lui a passé ; et pourtant, je ne sais pas... quand je la vois, toute fanée qu’elle est, il y a quelque chose qui me remue le cœur : c’est peut-être parce que je l’ai tant aimée autrefois. Si je l’épousais à présent, ce serait pour la battre, la battre, oui, tout à mon aise, pour me venger de ses sottises...
– Elle ne t’a dit ni oui ni non ? demanda madame Lavenel, en allant fermer la porte de la boutique.
– Elle a dit non ; et puis après elle a dit : Peut-être. Vous connaissez bien sa maudite habitude de ne jamais rien dire de positif.
– C’est une sage habitude, mon fils, répondit la vieille Normande ; il vaudrait mieux l’imiter que la blâmer.
– Elle est sage quand elle nous profite ; mais elle est bien désagréable quand elle nous nuit, répondit son fils en la suivant dans l’arrière-boutique pour souper. Ça ne fait rien, je la rattraperai, la veuve Crépin, je la rattraperai, bien sûr, et quand elle sera ma femme, elle me payera toutes mes courbettes.
II
Le dimanche suivant, madame Crépin fit son apparition à l’église de Diélette avec un chapeau orné de marguerites lilas et blanches ; une belle cravate lilas toute neuve s’étalait sous son menton et proclamait à tous que le deuil était fini. Les deuils de campagne, bien plus sévères que dans les grandes villes, prescrivent le noir pendant deux ans ; les couleurs de demi-deuil n’osent apparaître qu’à l’expiration de cette période, et comme madame Crépin avait beaucoup aimé son mari, quelques personnes rigoristes déclarèrent qu’elle aurait dû attendre au moins six mois avant de quitter le noir absolu.
– Laissez donc cette pauvre femme tranquille, dit la grosse madame Aubier à un groupe de matrones qui habillait de la belle manière les marguerites de la veuve ; qu’est-ce que cela peut vous faire qu’elle ait du lilas ou du vert à son cou ? En a-t-elle moins pleuré son mari ?
– Il n’y avait pas tant de quoi le pleurer, proféra une voisine anguleuse. De son vivant, elle s’est assez plainte de ce qu’il ne venait jamais à terre sans lui laisser un enfant sur les bras !
– Laissez les morts en paix, continua la bonne âme ; le capitaine et ses enfants dorment tranquillement sous leurs croix ; il leur est bien indifférent à cette heure que madame Crépin porte le deuil deux ans ou dix !
– Elle se remariera bientôt ! dit une autre voisine et amie ; Lavenel y va tous les jours.
– Eh bien, quand elle se remarierait ?
Après toutes les simagrées qu’elle a faites lors de l’enterrement du capitaine !
– C’est qu’elle a le cœur tendre, glissa sournoisement une troisième voisine et amie ; elle a bien aimé son premier mari, elle aimera encore mieux le second.
– Ah ! mais, c’est que le premier avait un bien grand mérite que le second n’aura peut-être pas : il n’était presque jamais avec elle !
– Mon Dieu ! s’écria madame Aubier, qui ne put s’empêcher de rire, que les femmes ont mauvaise langue !
Loin de prendre cette remarque comme une injure, les voisines et amies se groupèrent autour de la grosse dame.
– On n’en dit pas autant de vous, fit la plus hardie ; c’est que vous n’êtes ni fière ni méchante, vous, madame Aubier. Si tous les gens étaient comme vous, le monde irait mieux.
– Allons, allons, c’est bien, dit l’excellente créature, pour l’amour de moi, puisque je suis si bonne, tâchez donc de dénigrer un peu moins votre prochain.
– Il y a prochain et prochain, cria une dernière bonne langue, derrière madame Aubier, qui s’en allait tout essoufflée du côté de sa maison, et qui ne put répondre.
L’objet de ces propos était majestueusement rentrée chez elle au milieu des regards curieux ; lorsque la porte fut fermée, elle s’approcha de la glace verdâtre pour y contempler l’effet de ses rubans, non sans se hausser sur la pointe de ses grands pieds. Le lilas lui allait bien, c’était incontestable ; sous les ruches et les fleurs de son chapeau, son visage prenait une douceur inaccoutumée. Philomène avait été plutôt belle que jolie ; ses traits réguliers, fins autrefois, avaient grossi, et le hâle avait endurci sa peau. Telle qu’elle était, lorsqu’une expression aimable animait son visage, elle était encore fort bien ; mais au repos, dans son costume de tous les jours, rien ne l’empêchait d’avoir trente-huit ans, et de les porter hardiment.
Avec une certaine complaisance, elle dénoua les brides de son chapeau et le posa sur un chandelier garni de sa bougie, en guise de champignon, puis elle mit un bonnet de mousseline blanche et procéda aux apprêts de son dîner.
Tout en prenant solitairement son repas, Philomène repassait dans son esprit les événements de sa vie ; ce jour était pour elle une sorte de solennité, une espèce d’ère nouvelle dans son existence. Aucune des remarques chuchotées à voix basse dans l’église, aucun des coups d’œil narquois et curieux lancés à son chapeau ne lui avait échappé, et avec la sûreté de mémoire qui caractérise les gens à longue rancune, elle avait tout classé dans son esprit afin de s’en venger à loisir, suivant le temps et l’occasion. Mais l’important résultat qu’elle avait obtenu détruisait l’amertume de tous les quolibets ; en quittant le deuil ouvertement, elle avait préparé les esprits à l’annonce d’un second mariage, et quand cet événement se produirait, il ne serait une surprise pour personne.
– Oui, je me remarierai, disait-elle à demi-voix, pour s’entretenir elle-même, oui, certes ! Après avoir passé les plus belles années de ma vie à attendre un mari toujours absent, je me remarierai et j’épouserai un homme bien gentil, bien aimable, qui restera toujours avec moi.
Cette pensée lui donna l’idée d’aller chercher dans son cellier une bouteille de vin ; d’ordinaire elle buvait du cidre ; mais, pour festoyer avec elle-même la solennité de ce jour, elle se versa un verre de vieux bordeaux, rapporté jadis par le capitaine, et reprit le cours de ses méditations.
– Mais il me faut un mari d’un autre acabit que Lavenel. Bel oiseau, vraiment, que ce pauvre homme avec ses yeux de pruneau et son nez de polichinelle ! Il n’a pas seulement cinq pieds de haut ! Il me faut un grand bel homme, comme était mon défunt, mais plus jeune. – C’est que je ne veux pas prêter à rire !
Sur cette réflexion, Philomène trempa un biscuit dans son vin, et cessa de se parler à elle-même pour réfléchir en silence.
Le souvenir du capitaine, brusquement jeté au milieu de ses projets d’avenir, avait évoqué bien des pensées lointaines. Elle avait toujours été fière, et dans le petit bourg on la déclarait « immariable ». Plusieurs prétendants, agréés par ses parents, acceptés tacitement par elle, s’étaient vu évincer au bout de quelques semaines, sans que rien de leur part eût motivé cet outrage ; chaque mariage rompu ne tardait pas à être suivi d’une nouvelle demande, et certains avaient cru remarquer que le nouveau venu avait quelque avantage sur l’ancien ; Philomène faisait de ses prétendus une sorte d’échelle sociale dont elle brisait sans pitié les échelons lorsqu’elle en trouvait un plus haut.
Cette manière originale de s’élever lui avait valu nombre de critiques, les unes innocentes, d’autres sanglantes, de la part des gens évincés et de leurs familles ; on parlait en riant des « mariages de Philomène », et bientôt il ne se trouva plus dans le pays de garçon assez hardi pour lui faire la cour. D’ailleurs, les jeunes gens avaient reconnu l’inutilité de leurs efforts ; bien que la dot de la jeune fille, enfant unique et héritière de ses parents, fût assez modeste, même pour le pays, il était clair qu’elle n’épouserait ni un marchand, ni un cultivateur, et ces deux classes étaient les seules à peu près auxquelles elle pût prétendre. Il y avait bien encore à Diélette un notaire, plusieurs capitaines au long cours en retraite, quelques petits caboteurs... ; mais le premier cherchait femme en plus haut lieu, les seconds étaient trop vieux, et d’ailleurs, pour la plupart mariés ; les derniers étaient trop peu de chose ; Philomène entra dans sa vingt-septième année sans avoir trouvé le mari de ses rêves.
Elle possédait à Granville une cousine beaucoup plus jeune, aimable fille, jolie, rieuse, pleine d’inventions drôles ; celle-ci eut une destinée bien singulière. Elle avait à peine dix-huit ans, lorsqu’un romancier encore inconnu vint prendre des bains de mer sur leur plage. Le jeune homme, dévoré du besoin d’écrire, fit alors le meilleur de ses romans, car il devint éperdument amoureux de la jolie pêcheuse de crevettes et l’épousa au bout de trois mois. Jamais folie n’eut un plus heureux dénouement. La jeune femme était intelligente ; elle comprit qu’elle devait à son mari de ne jamais le faire rougir d’elle, et apprit tout ce qu’elle ignorait. Avec une sagesse rare, et qu’on n’eût pu exiger d’elle, elle voulut rester à Granville tant qu’elle ne serait complètement policée ; son mari s’était prêté à ce désir ; que lui importait Granville ou Paris, pourvu que sa femme fût avec lui ? La petite fortune personnelle qu’il possédait lui permettait de vivre largement en province, tandis qu’à Paris elle lui donnait à peine le nécessaire. Un séjour de trois années dans ce pays intéressant, au sein d’une application continuelle, fut au moins aussi utile à Charles Verroy qu’à sa femme, car il en rapporta un talent mûri et original qui lui fit bientôt une place.
Au moment où Philomène, lassée d’attendre à Diélette un mari qui ne venait pas, se décidait à aller le chercher ailleurs, elle apprit le mariage projeté de sa jeune cousine. C’était une belle occasion de voir du pays : Philomène se fit faire une robe et un bonnet, et partit pour assister à la noce.
Ce fut une noce magnifique ; tout Granville y assistait, car le mariage de la petite fille sans fortune et sans éducation avec un monsieur de Paris qui avait quatre mille livres de rente semblait aussi fabuleux aux gens du pays que si un roi eût épousé une bergère. N’oublions pas qu’il y a trente ans ce pays était encore vierge de pas mondains. Parmi les invités se trouvait un capitaine au long cours, récemment arrivé du Brésil pour voir sa mère ; Philomène fut aimable, elle était jolie, on lui connaissait quelque fortune, le mariage fut conclu en un clin d’œil ; trois mois après, elle était madame Crépin.
Elle tenait enfin cet idéal rêvé toute sa vie : être la femme d’un personnage marquant !
C’est quelque chose que d’avoir atteint son but, et beaucoup d’entre nous s’en vont de ce monde sans pouvoir se vanter de l’avoir fait ; mais le but que l’on poursuit dans la vie n’est pas un couvert d’argent au haut d’un mât de cocagne ; c’est un nuage qui se déplace et change de forme à mesure que l’on fait du chemin sur la route de l’existence. Le but de madame Crépin avait été d’être madame Crépin ; mais quand elle fut en possession de ce titre, il lui fallut autre chose.
Il aurait fallu d’abord ne pas être encombrée d’une nichée d’enfants ; le ciel, dans sa bonté, lui en accorda cinq : il est vrai qu’elle en perdit trois dans une épidémie, et deux peu après, ce qui lui rendit le repos ; mais c’étaient huit années de perdues pour son bonheur et son ambition, car on vit bien peu pour soi quand on est entouré de berceaux. Comme elle commençait à s’occuper d’arrondir son bien et d’embellir sa demeure, le capitaine fit une chute malheureuse et se fractura le crâne ; Philomène se trouva veuve.
Son chagrin fut grand ; cette femme au cœur sec avait aimé son mari. Son amour était bien un peu matériel : le meilleur de nous-mêmes, cette tendresse désintéressée, cette bonté naïve que nous apportons dans nos affections, quand nous avons l’âme élevée, avait peu de rapport avec la passion jalouse et emportée qui caractérisait Philomène ; mais cette passion était de l’amour, et madame Crépin pleura sincèrement son mari. Puis, au bout de quelques mois, un sentiment tout particulier, une sorte de bien-être l’envahit doucement. Il était douloureux d’avoir vu la terre recouvrir le cercueil du capitaine, mais c’était quelque chose d’entendre le vent rugir autour de la maison avec la douce inquiétude de n’avoir personne à la mer. – Rage, tempête ! rage ! disait Philomène, qui avait l’habitude des monologues ; tu ne me troubles plus maintenant. Quand les enfants des autres piaillaient à lui fendre les oreilles, elle promenait un regard tranquille sur son petit ménage bien arrangé ; là, pas de doigts malins pour écrire sur les meubles avec des confitures, pas de joujoux à terre, pas de linges pendus aux fenêtres, pas de bouillie à faire le soir, pas de petits bas à raccommoder la nuit, et une sorte de frisson agréable passait dans le dos de Philomène quand elle pensait à sa tranquillité présente.
Le lecteur bien pensant et plus encore la lectrice mère de famille vont s’indigner contre l’auteur et crier bien haut que de tels monstres n’existent pas. – Mille pardons, lecteur et lectrice, ils existent, ils sont partout : c’est votre tailleur, votre cordonnier, votre blanchisseuse, le gendre de votre cousine, chère madame, quand elle ne sera plus, le neveu de votre beau-frère, cher monsieur, qui le pleurera bien et dûment d’un cœur très sincère, qui lui fera un enterrement superbe, et un an après, en essuyant les verres de sa lorgnette à l’Opéra, pensera qu’après tout il a bien fait de mourir, puisque cela lui procure à lui de si douces jouissances. De tels sentiments ne s’avouent pas, ne se ressentent même pas d’une manière bien définie : ils restent à l’état vague et embryonnaire ; mais si les défunts même sincèrement pleurés s’avisaient de revenir et de réclamer leurs biens, comme on les renverrait devant les tribunaux, en leur contestant le droit de déranger les vivants ! Du reste, on a écrit sur ce sujet plusieurs volumes, et il n’est pas besoin d’y revenir.
Donc, Philomène était heureuse dans sa tranquillité que rien ne troublait plus, et ce bonheur avait duré environ dix mois, lorsqu’un ver rongeur se glissa dans son sein. Avec le capitaine avait disparu le prestige de sa position. Un capitaine au long cours est un personnage, et puis il rapporte de ses lointains voyages des objets extraordinaires, des cadeaux bizarres, des bibelots que « ni pour or ni pour argent on ne trouverait dans une boutique ». Chacun de ses retours est attendu, commenté ; ses départs font un événement dans le petit bourg qu’habite sa famille ; on lui donne des commissions pour l’autre côté de l’Océan. Mais quand le capitaine est mort, sa veuve est bien peu de chose ; elle retombe au rang des êtres neutres, déclassés, à moins qu’elle n’ait une grande fortune, car chacun sait qu’une grande fortune est le premier des biens.
Comment ressaisir ce prestige évanoui ? La veuve s’inquiéta d’abord de réaliser le plus d’argent possible, et grâce à diverses négociations, moitié gré, moitié force, elle obtint de la famille de son mari une part beaucoup plus belle qu’il ne convenait ; mais comment refuser à une femme qui a eu cinq enfants et tant de malheur ? N’était-il pas bien naturel de lui accorder un peu de bien-être sur ses vieux jours ? Bien que Philomène eût brouillé son mari avec tous les siens dès les premiers mois de leur mariage, la famille Crépin se conduisit honorablement. Le seul point sur lequel elle se montra récalcitrante fut celui du recouvrement des créances, et encore durent-ils céder à la fin, comme le petit clerc de notaire l’avait appris à madame Lavenel.
La fortune était donc assurée, – mais c’était une piètre fortune, quelque chose comme dix-huit cents francs de rente ; une femme qui avait les goûts élevés de Philomène ne pouvait se contenter de si peu : d’abord elle avait toujours rêvé d’acheter un piano ! Pas pour elle, car elle n’avait pas eu le loisir d’apprendre la musique ; malgré le grand désir qu’elle en avait manifesté dans les premiers temps de son mariage, le capitaine n’avait fait qu’en rire, prétendant qu’à vingt-sept ans il est trop tard pour devenir une virtuose – mais pour les personnes qui viendraient chez elle, quand ces personnes sauraient jouer du piano. Or, avec dix-huit cents francs de rente, on n’achète pas un piano, ce piano fût-il un chaudron.
Et puis, quoi ? À trente-sept ans, la vie n’est pas terminée. Il y a des femmes qui se marient pour la première fois à trente-sept et même trente-huit ans ! Ce sont de vieilles filles, il est vrai ; mais une veuve de trente-huit ans est une jeune veuve et peut prétendre à un mari jeune et bien fait, comme on disait jadis.
Le mari jeune et bien fait était une agréable perspective, mais bien plus brillante encore celle de ce qu’il pouvait apporter avec lui. Le grade du capitaine, comme autrefois les prétendus de Philomène, devenait un échelon, non plus un modeste échelon, un petit échelon de rien du tout, mais un piédestal pour monter plus haut.
Lavenel ! Beau prétendant en vérité ! Cependant, tout marchand de grains et farines qu’il était, Lavenel ne devait pas être rebuté ; le sage réserve toujours une poire pour la soif, et puis, qui ne connaît cette loi immuable, qu’une femme courtisée attire les galants, tout comme la lumière attire les papillons ? Il fallait à Philomène un pantin au bout d’une ficelle pour montrer au monde entier qu’elle possédait le pouvoir de faire bondir les cœurs ambitieux des hommes séduits par ses charmes – et son argent.
Lavenel faisait un très bon pantin ; il était assez connu dans le bourg et dans les environs pour que Philomène pût se sentir flattée d’entendre murmurer : Il voudrait bien épouser la veuve Crépin ! Elle trouvait la mère assez désagréable, il est vrai ; d’abord, la mère de l’homme qu’elle aurait pu épouser lui était naturellement désagréable, et puis madame Lavenel était trop fière, trop silencieuse, trop clairvoyante. Philomène n’aimait autour d’elle que les imbéciles ; elle les méprisait souverainement, mais elle n’avait pas besoin d’estimer son prochain. Il y a des gens qui ne peuvent vivre avec ceux qu’ils méprisent ; madame veuve Crépin, au contraire, eût voulu que la terre n’en portât point d’autres. Il est si doux de régner sur son entourage et de se dire matin et soir, en ouvrant et en fermant les yeux à la lumière : Tous ces gens-là sont des nigauds, et je les mène à mon bon plaisir !
Philomène savourait en elle-même la douceur de cette pensée, lorsque le facteur frappa à sa porte. Pensant que c’était le Phare de la Manche tout bonnement, elle se leva d’un air distrait, fit deux pas ; à sa grande surprise, le facteur déposa sur la commode le journal et deux lettres.
III
Deux lettres ! qui pouvait lui écrire ? à moins que son notaire... Mais il lui avait écrit l’avant-veille, pour lui annoncer l’heureux succès de ses négociations ; Philomène regarda longuement les deux enveloppes, les soupesa dans sa main, les flaira attentivement, et enfin commença par la plus légère et la moins élégante.
C’était un débiteur de Paris qui, prévenu qu’elle était chargée du recouvrement des créances dans la succession de son mari, lui écrivait pour lui annoncer que l’état de ses affaires ne lui permettait pas de régler immédiatement ; que d’ailleurs sa créance n’avait pas été justifiée d’une façon suffisante, et qu’enfin il porterait la chose devant un conseil de prud’hommes. Philomène fronça ses sourcils blancs comme ceux d’une albinos, remit la lettre dans l’enveloppe, l’enveloppe dans un tiroir, et envoya mentalement le débiteur à tous les diables.
Après cette opération, madame veuve Crépin revint à la seconde enveloppe, restée sur le coin de la commode, et la regarda de travers. Allait-elle aussi, cette bête de lettre, lui annoncer quelque nouvelle désagréable et gâter ainsi le plaisir d’une aussi belle journée ? Elle avait pourtant l’air assez avenant, cette épître mystérieuse : le papier était beau et lourd ; de plus, elle ne venait pas de Paris. Après un court moment d’hésitation, madame Crépin déchira l’enveloppe.
Pourquoi met-on de la gomme jusque dans les recoins les plus ignorés des enveloppes ? Pourquoi y a-t-il des lettres qu’on ne peut ouvrir qu’après une lutte acharnée ? Est-il bien nécessaire que les fabricants vous obligent à un combat corps à corps contre cet ennemi insaisissable et mou que l’on nomme une feuille de papier vergé, combat où les dents sont parfois et en dernier ressort l’instrument du carnage ? C’est une question que nous renvoyons au jury des récompenses à l’Exposition, afin qu’il déclare si le secret de la correspondance est mieux gardé par ces procédés violents que par un simple cachet.
Après tous ces efforts pour ouvrir la lettre qu’elle tenait à la main, Philomène se dirigea, de fort mauvaise humeur, vers sa boîte à ouvrage, s’arma d’une paire de ciseaux qu’elle introduisit par la pointe... et, comme il arrive généralement en pareil cas, elle coupa en deux la feuille de papier qu’elle retira enfin, glorieuse, mais mutilée, de son étui protecteur.
Ici madame Crépin envoya à tous les diables – sans doute pour tenir compagnie au créancier de Paris qui s’ennuyait peut-être – le fabricant de ciseaux, le marchand d’enveloppes et la personne qui lui écrivait, – après quoi elle regarda la signature.
« Marie Verroy ! » C’était Marie, sa cousine de Granville, qui lui écrivait ! Après cinq ou six années de mutisme absolu ! Philomène pensa qu’elle devait avoir envie de lui emprunter de l’argent, et prit sa mine la plus sévère, tout comme si la jeune femme eût été vis-à-vis d’elle en personne. Peu à peu sa figure se dérida, – autant qu’il était en son pouvoir néanmoins, pas davantage, – et elle finit par sourire tout à fait en arrivant à la signature.