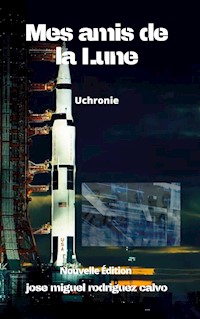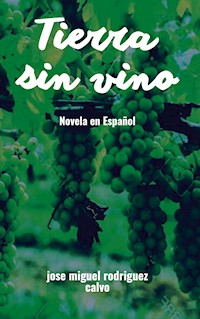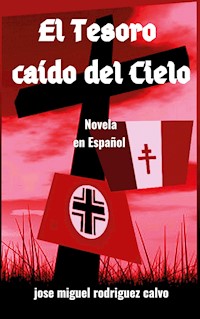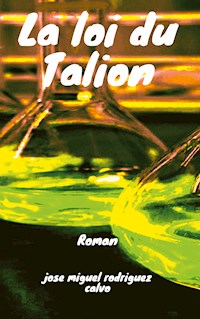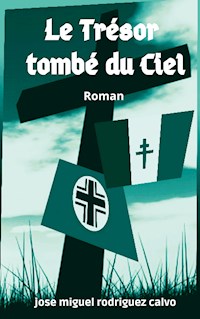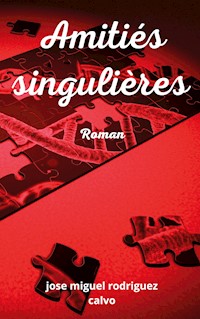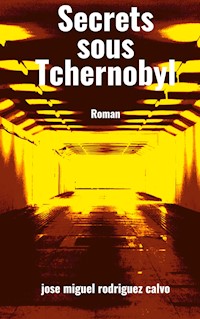Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
NOTRE PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE Récit Autobiographie Témoignage des années soixante. Enfance d'un petit Espagnol sous "Franco". et e régime Franquiste des années cinquante. Sa vie, sa famille et ses amis, entre la France et Espagne Son arrivée en France au début des années soixante L'intégration, une nouvelle vie, ses joies et ses peines, ses bonheurs et malheurs, et ses pensées philosophiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introduction
Ce récit que je vous livre sans le moindre ordre chronologique, est le fruit de mes pensées, telles qu’elles se présentaient à mon esprit au fil du temps. Pourtant ce fut une terrible et bien douloureuse épreuve qui me poussa à essayer de rassembler ces quelques pages sur mon enfance, sans que je ne sache ni pourquoi ni comment.
Je savais seulement que je devais le faire.
Mon subconscient me le demandait avec une telle assiduité, c’était tellement fort et insistant, que je me suis demandé comment j’allais m’en acquitter, moi qui n’avais jamais dépassé une double page dans mes rédactions d’école primaire.
Oui ! c’est pour toi Maxou !
jmrc
« À nos petits Anges »
Résumé
Enfance et témoignage d'un petit Espagnol sous le régime Franquiste des années cinquante.
Sa vie, sa famille et ses amis. Son arrivée en France au début des années soixante.
L'intégration, une nouvelle vie, avec ses joies et ses peines, ses bonheurs et malheurs, ainsi que ses pensées morales et philosophiques.
Sommaire
Introduction
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Chapitre 37
Chapitre 38
CONCLUSION
1
« Nuestra casita de la pradera »
Mon enfance
Octobre 1951. Lundi 29, à vingt heures exactement, ma mère m'a mis au monde, avec l’aide de ma grand-mère maternelle Ramona, et la « Comadrona », sage-femme, de la région.
Dans une maisonnette de trois petites pièces, perdue au beau milieu d'une immense prairie de centaines d’hectares, dans « la finca » de « los Tabernero ».
Un de ces immenses domaines que l'on ne trouve encore, que dans la région de l'ancien Royaume de Castille, ou dans les vastes plaines Andalouses et dont quelques-uns persistent de nos jours.
« La finca », grosse propriété de « Los Tabernero », est située sur la partie sud-ouest du plateau Castillan, dans la province de Salamanca, sur la commune de
« San Pedro de Rozados », lieu-dit Carrascal del Asno. Entièrement parsemée de « encinas », chênes verts, et « alcornoques », chênes-lièges, ainsi que de châtaigniers et d’épais et touffus buissons, qui complétaient cette vaste prairie totalement revêtue d’un épais tapis d’herbes sauvages.
Dans ce décor, nous côtoyions des « toros de lidia », taureaux de combat, des chevaux Andalous et des porcs Ibériques de « pâta negra », exclusivement nourris aux glands de chênes verts, élevés en plein air, à l’état semi-sauvage.
Tout le versant nord de la colline, était entièrement dédié à l’élevage de l’ensemble de ces animaux.
Et au beau milieu de tout cela, une petite maison blanche, qui nous abritait tant bien que mal, étant donné qu’elle ne disposait d’aucune commodité moderne comme l’eau courante, l’électricité, ou une simple salle de bain. Et bien entendu, encore moins de frigidaire, ou téléphone.
Seule une grande cheminée en granite qui trônait dans la pièce centrale, faisant objet de cuisine et salle à manger, permettait de chauffer l'ensemble du logis. Celle-ci était alimentée par du bois de chêne vert, très dur, disponible à volonté, qui par chance, ne faisait jamais défaut.
Une table en chêne avec quatre chaises, un petit buffet usagé où notre mère rangeait les quelques pièces de vaisselle ébréchées et dépareillées, et un lit dans chaque chambre, avec son sommier métallique et d’anciens matelas en laine de mouton, complétaient notre modeste mobilier.
Et comme dans chaque chambre Espagnole à cette époque, un crucifix qui trônait au-dessus de chaque lit.
Pour l'éclairage, un désuet « candil », lampe à huile d'olive, nous fournissait le soir une petite lueur tremblante dans l'obscurité de la pièce, qui projetait des ombres sur les murs blanchis à la chaux dès que quelqu'un bougeait ou se déplaçait. Mais c'est le feu de la cheminée qui nous apportait l'éclairage suffisant lorsque nous passions à table pour le dîner.
Et bien entendu, pas de radio, encore moins de télévision, celle-ci n'existait pas encore dans les provinces. Alors, lorsque nous n'avions pas encore sommeil et que le temps était au beau fixe, nous sortions nous asseoir sur les cinq ou six marches du porche, pour contempler le ciel, la lune et les étoiles filantes.
Pour nous laver la tête ou les mains, nous utilisions la« palangana », sorte de bassine en métal émaillé blanc,posée sur un trépied en fer forgé qui servait aussi à notre père pour se raser chaque matin.
C’était d’ailleurs un des seuls de la « finca », qui le faisait quotidiennement, si l'on excepte « el tio de las gafas », le mec à lunettes, surnom que je donnais à la grande désapprobation de mon père, à Don Amador, patron de la propriété, qui portait de grosses lunettes en corne de buffle.
À cette époque, à la campagne, les hommes allaient chez le barbier une fois par semaine, le samedi en règle générale. Pour le bain, chez nous, c’était « el barreño», grande bassine en zinc, dans lequel notre mère versait des brocs d'eau chauffée sur la crémaillère de la cheminée et qui lui servait aussi à d'autres moments, à faire la lessive.
Quant à l'eau, il fallait aller la chercher à quelques pas de notre maisonnette, à une petite source que notre père avait aménagée afin de permettre de remplir aisément « los cantaros », des sortes de grosses jarres en terre cuite.
C'était toujours notre mère qui s'acquittait de cette corvée, et je l’accompagnais la plupart du temps. Il fallait souvent écarter les « toros » du petit chemin, en les effrayant avec de grands gestes ou une simple baguette en bois.
Chose curieuse, puisque malgré leur comportement sauvage et d'une incroyable agressivité dans les arènes, ces imposants animaux étaient étonnamment calmes et peu farouches, lorsqu'ils gambadaient en liberté dans leur domaine, à moins bien sûr, qu’ils ne se soient battus entre eux, ou aient été piqués par une quelque guêpe ou autre insecte de ce genre.
Notre mère Antonia, portait toujours deux de ces « cantaros » : un, qu'elle tenait avec une main calée sur sa hanche gauche et un autre en équilibre sur la tête.
Je n'ai jamais su comment cette prouesse était possible, surtout en suivant le minuscule, tortueux et caillouteux chemin.
Derrière notre maisonnette, notre père avait aménagé un petit poulailler, pour abriter la demi-douzaine de poules pondeuses qui nous fournissaient les quelques œufs nécessaires à notre consommation hebdomadaire.
C'était une minuscule cabane en bois, avec à l'intérieur des branches disposées en escalier, sur lesquelles les poules, comme tout bon oiseau qui se respecte, se perchaient pour dormir, dès que le soleil disparaissait à l’horizon.
J’ai toujours été étonné de cette façon de se poser pour la nuit, qui me semblait bien incommode pour trouver le sommeil.
Notre « Casita », était située sur une petite colline, à environ deux kilomètres du reste de l'ensemble des bâtiments qui composaient le cœur de la « finca », plantés tous plus au sud, où se trouvaient outre la vaste maison des « Tabernéro », de nombreux autres bâtiments, granges et entrepôts de toutes sortes ainsi que des demeures plus modestes, destinées aux employés permanents sur le domaine. Une quinzaine environ, mais aussi d’autres plus vastes, pour les nombreux saisonniers, qui pouvaient dépasser la cinquantaine en été et qui venaient souvent en couple, au mois d’août, pendant une quarantaine de jours, des provinces limitrophes et surtout du Portugal, très proche, pour la « siega », la moisson.
« toros de lidia »
2
« Lobo »
Les Loups
Lorsque j’étais enfant, j’ai toujours entendu des histoires de loups.
Mon père aimait nous les raconter très souvent, à mes frères et à moi. Mais pas des contes ni des récits inventés, de vraies aventures qui lui étaient arrivées, lorsqu'il était « Pastor » plus jeune, avant son mariage. Comme dans tous les villages de la région, il y avait un pâtre, chargé de monter toutes les chèvres du village dans les hauts pâturages de « las Quilamas», immense chaîne de hautes montagnes, pour les nourrir d'herbes fraîches et tendres, qui leurs donnaient un meilleur lait.
L'accès à ces hauts plateaux était extrêmement pénible pour les humains, mais un véritable jeu d'enfant pour les chèvres qui ont un sens inné et très développé de l'équilibre, leur permettant de gravir des pitons les plus abrupts et atteindre les lieux les plus improbables et inaccessibles où même les chiens de garde évitaient de s'aventurer.
Le troupeau que menait mon père comptait environ 2000 et il disposait comme seule aide, de deux chiens rompus depuis longtemps à cet exercice, bien sûr.
Mais toute la « Sierra » à l’état sauvage, était colonisée à cette époque, par de véritables hordes de loups.
Mon père partait le lundi et rentrait avec son troupeau le samedi, la plupart du temps, avec cinq à six animaux en moins.
Les loups ne se contentent pas de tuer les bêtes pour se nourrir : une fois rassasiés, ils les égorgent, le plus souvent par plaisir, ou par simple jeu.
Garder un tel troupeau dans ce type de montagne était très compliqué, puisque les chèvres, parfaitement à l'aise sur les flancs rocheux et escarpés, se dispersent très facilement afin d'atteindre leurs mets préférés.
C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre elles se faisaient attraper par les loups, toujours à l'affût, même en plein jour.
La nuit, c'était encore chose plus facile pour eux, malgré les différents feux de bois que mon père allumait autour du troupeau et la présence toujours alerte des chiens, il était quasiment impossible de les protéger de ces insatiables chasseurs toujours prêts à passer à l'action.
Bien heureusement, les loups s'attaquent très rarement à l'homme, sauf en cas de famine.
Lorsqu'on se trouve en présence de l’un d’entre eux, il faut toujours lui faire face, surtout ne pas lui montrer que l’on a peur et ne jamais se mettre à courir, sinon, les chances de s'en sortir vivant sont presque nulles, et bien évidemment, ce n'est pas à une seule bête que l’on aura à faire, mais très vite à toute une meute.
Mon père avait des tonnes d'histoires, qui lui étaient arrivées pendant tout le temps où il avait exercé ce pénible métier et quand il nous les racontait, nous avions des frissons dans le dos.
3
La Siega
La « siega », moisson, était avec la « matanza », abattage des porcs, un des événements les plus importants de l'année.
Toute la collecte des blés et autres céréales se faisait entièrement à la main.
Le fauchage, la partie la plus dure physiquement, était réalisé exclusivement par les hommes, des saisonniers engagés pour un mois et demi environ, qui était le temps nécessaire pour cette tâche, ainsi que le ramassage et le battage de toute «la finca ».
C’était un travail rude et extrêmement pénible puisqu’il se réalisait, exclusivement à la « Oz », faucille, puis en règle générale, c’était les femmes qui suivaient juste derrière, qui attachaient les bottes.
Celles-ci étaient ensuite chargées sur les « carros » tirés par des bœufs et portées jusqu'à l'aire de battage. La batteuse, était la machine la plus évoluée de l'exploitation, elle servait à séparer le grain de la paille, exactement comme aujourd'hui, mais en statique, car elle ne fauchait pas, son rôle se limitait à battre les céréales.
Elle était mue par un gros moteur diesel relié par une immense courroie de transmission, qui permettait d’ébranler la multitude de pièces la composant.
J’étais toujours impressionné par cet engin qui me semblait immense, vu depuis la taille d'un enfant de quatre ou cinq ans.
Tout cela, sous le soleil brulant de Castille au mois d’août.
C'était un travail physiquement éreintant pour les hommes et femmes dont le seul moment de répit était la pause déjeuner. C’était la Señora Virginia qui préparait le repas et qui venait l’apporter sur place sur sa mule. Celui-ci était pris à l’ombre d’une opportune « encina », et toujours suivi d’une petite sieste.
Les longues et fatigantes journées d'été dans les champs écrasés par le soleil étaient interminables.
Malgré tout, les dimanches, jours de repos, après la messe et le déjeuner, c'était le temps de la détente pour tous.
Tournois de « calva », sorte de jeux de quilles, parties de cartes et même des danses folkloriques improvisées au milieu du « corral ».
J'ai encore dans mes souvenirs quelques brefs passages de « Jotas Castellanas » que tout le monde connaissait et dansait à tout va. Pour la musique, pas de problème, « una pandereta », tambourin, et une bouteille d'anis vide, que l'on frottait sur ses spécifiques flancs abrupts, avec un couvert. Les bouteilles d'anis Espagnoles ont une forme caractéristique, avec des reliefs très marqués qui produisent un son strident dès qu'on les frotte avec un objet métallique.
4
Las Jotas
Ce sont des chants et danses folkloriques très populaires du nord de l'Espagne, à l'exception de « Cataluña ». Elles ont un rythme à trois temps, comme les valses, mais plus rapide. On les danse soit en couple face à face, soit en rond avec les bras en l’air, en faisant un quart de tour sur soi à gauche puis à droite.
En voici quelques passages.
Un cojo se cayó à un pozo,
y otro cojo le miraba,
y otro cojo le decía,
mira el cojo como nada.
Etc. etc.
Ou bien
Por el puente de Aranda,
se cayó se cayó.
se cayó el tío Jacinto,
pero no se mató.
Pero no se mató,
pero no se mató.
Por el puente de Aranda,
se cayó se cayó.
Ou encore !
Esta noche llego tarde
el asno se me escapo
si sientes pisas de burro
no te asustes que soy yo
Une dernière !
Te voy a tirar una breva
que te pegue en el ombligo
si te pega más abajo
la breva te da en el higo.
« La fameuse bouteille d’Anis »
Et naturellement, je m’en souviens de beaucoup d'autres, avec leurs paroles plutôt « verdes », osées, ce qui était le plus souvent le cas et qui m’empêche de les transcrire ici.
En été, pour « la siega », chaque « finca »