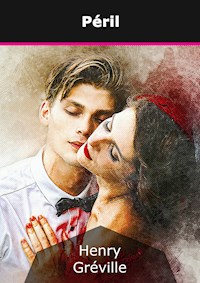
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Des pleurs jaillirent des yeux de Mme Heurtey. Elle souffrait, ah ! certes ! Fallait-il qu'il l'aimât, la femme qui l'avait gardé cette nuit-là, pour avoir obtenu de lui qu'il lui sacrifiât sa mère ! Les autres, qu'importait ! puisqu'il les avait toujours quittées pour rentrer chez lui. Mais cette fois, avait-elle trouvé sa rivale, la femme qu'on préfère à tout, à sa mère, à son art, à son honneur ? Il fallait que ce fût celle-là ! car, à vingt-six ans, André savait ce qu'il faisait ; il savait quelle indignation l'attendait au retour... Il avait pesé, d'une part, son nouvel amour ; de l'autre, le respect de sa mère, et, volontairement, il avait sacrifié celui-ci à celui-là !
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Péril
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVPage de copyrightHenry Gréville
Péril
Henry Gréville, pseudonyme de Alice Marie Céleste Durand née Fleury (1842-1902), a publié de nombreux romans, des nouvelles, des pièces, de la poésie ; elle a été à son époque un écrivain à succès.
I
Après avoir langui, la conversation tomba, et un de ces silences qui précèdent le départ s’établit dans le salon, parfumé jusqu’à la migraine par une somptueuse corbeille d’orchidées.
Niko Mélétis, sans avoir regardé depuis deux minutes autre chose qu’une belle toile de Corot, accrochée en face de lui, au-dessus de la maîtresse de la maison, comprit qu’il ne pouvait mieux faire que de s’en aller ; il se leva donc, étirant inconsciemment, d’une façon imperceptible, ses membres longs et fins lassés d’un repos prolongé.
– Il faut que je vous quitte, mademoiselle, dit-il, mentant effrontément, vous voulez bien me le pardonner ?
Les yeux de la jeune femme clignèrent un peu, comme si elle étouffait sous ses cils une gaieté intempestive.
– Déjà ? fit-elle. Il est onze heures à peine ; vous avez des affaires à cette heure-ci ?
– Hélas !
Il se pencha sur la belle main un peu forte qui s’avançait vers ses lèvres et la baisa tranquillement.
– Au revoir, André, dit-il en cherchant son chapeau, sans regarder son ami qui restait immobile.
– Mais, je te suis... répondit André Heurtey à contrecœur.
Raffaëlle l’arrêta du geste.
– Vous n’allez pas m’abandonner aussi ? fit-elle avec une pointe de raillerie. Donnez-moi une demi-heure, et je vous donnerai une tasse de thé.
André s’inclina en silence. Niko Mélétis, voyant que tout était contre lui, se décida à s’en aller seul, quoique à regret.
– À demain ! dit-il à André, avec une poignée de main fraternelle.
Mlle Solvi l’avait accompagné jusqu’au milieu du salon ; elle s’assura par la porte ouverte que le valet de pied donnait au visiteur son pardessus et sa canne, et revint joyeusement vers Heurtey.
– Enfin ! dit-elle en se pelotonnant dans son fauteuil, presque aussi profond qu’une chaise longue. Enfin ! nous voilà seuls ! Il est bien gentil, Mélétis, mais il vous garde un peu trop à vue.
– Il est amoureux de vous ! répliqua André d’un ton sombre.
Raffaëlle sourit ; elle riait rarement, étant très soucieuse de la correction de ses manières.
– Eh bien ! quand cela serait ? fit-elle avec la plus parfaite indifférence. Mais cela n’est pas, et vous le savez bien.
– Je n’en sais rien du tout ! insista le jeune peintre.
– Vous allez peut-être me dire aussi que je l’aime ?
– Cela se pourrait ; tout est possible, puisque vous ne m’aimez pas !
Elle attacha sur lui le regard de ses yeux noirs, profonds, – veloutés, quand elle le voulait.
– C’est à moi de vous dire : Vous n’en savez rien ! répondit-elle à voix basse.
Éperdu, André se laissa glisser à demi agenouillé sur les coussins, près d’elle.
– Raffaëlle, Raffaëlle, dit-il, ne me tourmentez pas... Voilà six mois que vous me tenez attaché au pied de ce fauteuil comme un petit chien au bout d’une laisse... Je vous ai dit cent fois que je vous aime, vous m’avez torturé de cent façons, mais jamais encore de celle-ci...
– Relevez-vous, dit tranquillement Mlle Solvi, François va apporter le thé, et il ne faut pas qu’il vous trouve dans cette position ridicule.
André se releva et s’assit à sa place d’un air boudeur. Son joli visage d’artiste et d’enfant gâté avait une expression de gêne et de souffrance.
Le valet de pied entra en effet, portant un plateau.
– C’est bien, François, dit Mlle Solvi ; je n’ai plus besoin de vous.
Le domestique disparut ; par la porte ouverte André le vit éteindre les becs de gaz de l’antichambre, à l’exception d’un seul, qui fut baissé ; puis ses pas décrurent dans des réglons inexplorées des visiteurs, et le silence se fit au dedans comme au dehors ; à peine entendait-on le roulement intermittent des trains sur la ligne de ceinture, et le sifflet assourdi des locomotives dans la gare de Courcelles.
André ne s’était jamais trouvé seul à cette heure avec Raffaëlle ; une émotion bizarre lui étreignait la poitrine, une sorte d’ivresse mêlée d’angoisse, qu’il n’avait plus ressentie depuis les premières années de sa jeunesse.
Elle ne semblait pas troublée ; tranquillement elle versait le thé dans les tasses.
– Voici la vôtre, dit-elle en la lui présentant.
Il la prit et la déposa sur une table sans y toucher. Elle trempa ses lèvres dans le breuvage odorant, puis remit sa tasse sur le plateau et se tourna vers lui.
– André, dit-elle, savez-vous qui je suis ?
– Qu’importe ! répondit-il, je vous aime !
Elle releva la tête avec une dignité naturelle qui lui seyait bien.
– Il importe, dit-elle, car je ne veux pas être méconnue, et l’amour que vous m’offrez me paraît se tromper d’adresse.
Il protestait du geste, elle l’interrompit.
– Vous me croyez sans doute entretenue par quelque mystérieux personnage toujours absent ? On vous l’a dit ? Ne niez pas ! Et vous vous êtes imaginé que vous pourriez prendre près de moi une place qui vous semble vacante ?
– Pourquoi m’insultez-vous ? fit André dont le visage prit une teinte livide.
– Parce que la façon dont vous m’avez dit que vous m’aimez m’y autorise !... Singulier duo d’amour, n’est-ce pas, André ?
Elle s’était adoucie et souriait. Son être, infiniment séduisant, souple et robuste à la fois, semblait se fondre en une caresse enveloppante. André la regardait, incapable de penser, incapable de toute autre chose que de subir son attrait.
– Eh bien, je ne suis pas ce que vous croyez ; vous n’y croyez pas ? Alors... ce qu’on vous a dit. Ma fortune m’appartient, et je suis libre. Mon grand-père était un célèbre ténor italien ; il n’a jamais chanté à Paris, et vous autres Parisiens, vous ne connaissez de célébrités que celles que vous faites. Il a amassé une fortune, une vraie fortune. Il était très avare et n’avait qu’une fille, ma mère. La malheureuse femme est restée pauvre toute sa vie ; elle avait épousé un Français, le baron d’Agrelles, qu’elle a perdu au bout de bien peu de temps. Elle m’a élevée de son mieux, et puis, tout d’un coup, elle a appris qu’elle héritait de son père : une grosse fortune. Elle en est morte de saisissement, je crois. Et moi, je me suis trouvée orpheline et riche.
En parlant, elle plongeait ses yeux dans ceux d’André, pour lui imposer sa pensée, et elle y réussissait.
– J’avais donné des leçons, je me préparais à entrer au théâtre... C’est pour cela que je porte le nom de Solvi, celui de mon grand-père ; mais quand je me marierai, – elle appuya sur ces mots, – ce sera sous mon vrai nom d’Agrelles. Pourquoi me regardez-vous de cet air ?
– Je ne sais pas de quel air je vous regarde, répondit André ; je vous écoute. Je ne sais pas non plus pourquoi vous me dites tout cela. Ce n’est pas votre fortune que j’aime, c’est vous.
Raffaëlle fronça un peu le sourcil, puis sa physionomie se détendit, et elle lui abandonna la main qu’il s’efforçait de prendre depuis un moment.
– Et moi, dit-elle, ce n’est pas votre génie que j’aime, c’est vous.
Il l’enveloppa de ses bras, soudain, comme s’il allait l’emporter. Elle se dégagea doucement et se tint debout devant lui sans qu’il osât essayer de la reprendre.
– Attendez et écoutez-moi, reprit-elle en continuant de le regarder, mais avec une expression plus dure et plus concentrée. Vous voulez savoir le reste ? Si j’ai aimé ? Oui, j’ai aimé, sottement, comme les jeunes filles sans expérience aiment à seize ou dix-sept ans, j’ai aimé un imbécile... Quand je l’ai reconnu pour tel, je l’ai chassé ; mais je lui avais appartenu. Il est mort. Depuis, rien ! Croyez-vous que cela m’empêcherait d’épouser un honnête homme ?
– Non, certainement, dit André sans y attacher la moindre importance et en glissant son bras autour d’elle ; mais, dites, vous m’aimez ?
– Je vous aime.
Il baisa son cou, ses joues ambrées ; il allait baiser ses lèvres, lorsqu’elle lui échappa encore. Un petit cartel suspendu à la muraille sonna douze coups très vite, comme s’il était pressé de s’enfuir ailleurs.
– Minuit, dit Raffaëlle en souriant. C’est l’heure de Cendrillon et d’André Heurtey. Allez-vous-en. Vous m’avez raconté que vous ne faites jamais attendre votre mère ; vous avez raison, c’est d’un bon fils. Prenez votre thé, qui est froid, et allez-vous-en.
On ne savait jamais quand elle cessait de parler sérieusement, son ironie étant complètement cachée par l’apparente conviction des paroles. André hésita, puis la reprit dans ses bras.
– Vous êtes un grand peintre, André, dit-elle en dénouant sans violence les mains qui s’attachaient à ses épaules. Vous avez plus que du talent, vous êtes célèbre, vous serez illustre...
Il l’écoutait, grisé autant par les louanges que par l’amour.
– Entre ma fortune et votre gloire, il n’y a pas d’inégalité ; je vous aime, André, et je suis fière d’être aimée de vous.
Elle tourna un peu la tête sur son épaule, et leurs lèvres se rencontrèrent.
– Allez-vous-en, dit-elle. Ne faites pas attendre votre mère. Voyons, André, ajouta-t-elle d’un ton plus sévère, vous êtes un enfant ! Vous allez causer de l’inquiétude à Mme Heurtey ; et pourquoi, je vous le demande ?
Mais André n’était pas disposé à l’écouter.
– Vous reviendrez demain, continua-t-elle, puisque je vous aime !
– Demain est demain, dit-il, affolé par sa coquetterie savante. Et demain, nous ne serons pas seuls, peut-être !
– Pour cela, non ! fit-elle avec un éclair de joie maligne dans les yeux. Vous êtes trop entreprenant pour que je me risque jamais à un second tête-à-tête. Allons, venez, je vais vous mettre à la porte moi-même.
Il l’avait ressaisie : elle ne se défendit pas contre son baiser, mais elle lui prit la main et voulut l’entraîner vers l’antichambre.
– Non, dit-il tout bas, si vous m’aimez, je vous en prie... attendez... pas encore... Je vous aime tant ! Depuis six mois, vous m’avez tant fait souffrir !... Puisque aujourd’hui vous êtes meilleure, soyez bonne... Laissez-moi vous parler... vous voir... vous respirer...
– Alors, fit-elle sans le regarder, décidément vous ne voulez pas vous en aller ? Vous refusez votre liberté, vous vous rendez à merci ?
Il ne répondait rien.
– Vous ne voulez pas ? Vous en êtes sûr ? Vous m’aimez donc plus que tout au monde ? Bien vrai ?
Elle l’inonda tout à coup de la lumière de ses yeux ; à demi fou, tout à fait ivre, il répondit d’une voix étouffée :
– Oui, plus que tout au monde.
– Eh bien !... alors... venez !... dit-elle en glissant ses doigts autour du poignet d’André.
De la main gauche, elle releva la portière qui cachait la porte de sa chambre, éclairée par une grande veilleuse et que le jeune homme n’avait jamais vue ; elle le fit entrer, puis laissa retomber les plis de la lourde étoffe, qui les enferma dans l’hôtel muet et sourd.
II
Mme Heurtey prit les pincettes et, d’un air préoccupé, échafauda un monument de braises incandescentes. La flamme avait consumé le bois dont il ne restait plus vestige ; tout l’âtre n’était plus qu’une fournaise ; les murs de la cheminée eux-mêmes, surchauffés, réverbéraient une lumière d’un beau rose glacé de blanc.
Il faisait bon dans le petit salon bien clos ; au dehors, par un entrebâillement des rideaux de reps marron, se devinait l’éclat d’une lune brillante, impitoyable, qui annonçait la gelée ; à l’intérieur, une lampe coiffée d’un abat-jour de porcelaine translucide répandait une lumière douce et tempérée. Le tapis qui couvrait presque en entier le parquet bien ciré, n’était ni une fine moquette française, ni un produit exotique : c’était tout bonnement un honnête tapis au mètre, cousu, doublé, bordé, fait pour tenir chaud aux pieds sans attirer l’œil.
La pendule de la cheminée sonna onze heures. Mme Heurtey regarda pendant un instant l’aiguille des minutes avancer sur le cadran, se tourna à demi vers le coffre à bois, puis renonça à ajouter une bûche à l’amas de braise en se disant que son fils ne tarderait plus beaucoup à rentrer.
Du même air indécis elle avança la main vers un tricot de laine enroulé autour des aiguilles, mais elle la retira et se pelotonna dans son fauteuil comme une femme qui a bien gagné le loisir d’une heure de paresse et qui va se l’accorder.
Le regard de Mme Heurtey fit lentement le tour du salon, glissant sur certains objets, s’arrêtant à d’autres, passant en revue les biens qu’une longue épargne avait accumulés autour d’elle et s’en réjouissant, comme seuls peuvent se réjouir les yeux qui ont longtemps contemplé froides et nues les murailles où sont maintenant accrochés des objets précieux.
Ils étaient restés bien des années privés de tout ornement, les murs de cette pièce, à présent peuplée d’esquisses, de plâtres, de meubles sinon luxueux, au moins presque tous artistiques dans leur simplicité. Elle se rappelait encore l’affreux papier chocolat à dessins jaunes qui les tapissait lorsqu’elle avait loué cet appartement, neuf ans auparavant ; leur pauvre petit mobilier de province était aussi bien sommaire et bien laid, sauf une ou deux belles armoires normandes qu’elle méprisait dans ce temps-là, et qui maintenant faisaient son orgueil et l’envie des connaisseurs.
Comme tout change pourtant ! Les habitudes, les goûts enracinés par quarante années d’existence en province, – ces habitudes et ces goûts qu’elle eût juré de ne jamais perdre au contact de cette grande Sodome de Paris, – s’étaient modifiés peu à peu ; Mme Heurtey avait cessé de préférer le cidre au vin, de manger des moules le vendredi, de mépriser les robes à volants !
La modeste lingère de la rue de la Vase à Cherbourg s’était tout doucement transformée en mère d’artiste ; elle avait relégué derrière ses grandes armoires normandes les lithographies encadrées d’un mince filet noir qui lui avaient semblé si longtemps le dernier mot de l’élégance ; elle avait quitté les fauchons de dentelle à nœuds de velours, noir la semaine, violet le dimanche, qu’elle avait toujours portées depuis son veuvage, et maintenant, à la voir passer dans la rue, aucune Parisienne futée ne se retournait plus en souriant malicieusement. Mme Heurtey n’avait plus l’air « province ».
« Province » elle était restée dans l’âme, pourtant, sur plus d’un point, et là elle avait eu raison. Elle avait continué de s’aider de ses mains dans son ménage, et longtemps, longtemps, elle s’était privée de bonne, moins par économie peut-être que par horreur du service des autres ; il lui semblait que la présence d’une bonne dans son intérieur reluisant de propreté serait une profanation.
Elle s’y était résignée cependant quand sa fille Éliette était devenue si fine, si jolie, si mince ! Comment confier à ces mains légères, le balai et le plumeau ? Et ses forces, à elle, avaient diminué à mesure que l’âge s’appesantissait sur ses épaules et que l’aisance entrait au logis, Dieu merci !
Les yeux fixés sur le foyer où s’écroulaient lentement les cavernes de braise, peu à peu envahies par la cendre grisâtre, Mme Heurtey songea à sa vie passée.
Cherbourg ! Du jour où ses yeux s’étaient emplis de lumière et d’espace, du jour où, toute petite, âgée de quelques mois à peine, elle avait regardé autour d’elle, Adèle avait toujours vu la mer, bleue, verte, ou presque noire, argentée par la lune, dorée par le soleil, couleur d’étain, couleur de plomb, rosée par le reflet des nuages ; toujours immense, vivante, mouvante ; haute, à plein bord, presque au ras du quai ; basse, découvrant des rochers mystérieux, couverts d’algues et de goémons ; calme, à peine ondulée d’un insensible gonflement, ou furieuse, jetant des paquets de varech et d’écume jusqu’au milieu de la place d’Armes... la mer, dont la nostalgie la reprenait souvent, malgré elle, dans la vie réglée et affairée de Paris.
Elle avait grandi dans le vieux Cherbourg, à l’ombre de l’église de la Trinité, dans une ancienne maison de petite bourgeoisie où ses ancêtres avaient vécu, bien des générations auparavant, d’une vie ordonnée, respectable, faite de travail sans fièvre et de joies patriarcales sans ivresse.
De père en fils on avait taillé, cerclé, douvé des tonneaux dans sa famille paternelle. Elle ne se rappelait pas avoir jamais vu dans la cour de la maison un homme qui ne fût revêtu d’un grand tablier de cuir et enseveli jusqu’aux chevilles dans les dolures fraîches de chêne, dont l’odeur envahissait jusqu’au linge blanc rangé dans les armoires.
La cour était étroite et sombre ; pourtant une bande de ciel bleu s’y montrait parfois les jours d’été, traversée par les hirondelles, et dans un coin ou il n’y avait pas de pavés, un figuier avait crû, personne ne savait comment.
Qu’elles étaient savoureuses, les figues violettes du vieux figuier ! On les mangeait avec recueillement, en famille ; on n’avait pas plus de respect pour le pain bénit rapporté de la grand-messe et partagé avec celles qui, retenues par les travaux domestiques, n’avaient pu aller qu’à la messe basse du matin. Ces figues, et les promenades du dimanche, sur la jetée ou bien au pied de la montagne du Roule, étaient restées dans la mémoire d’Adèle comme les points brillants d’une enfance grise et terne.
La jeunesse était venue sans presque rien changer ; seulement, le soir, Adèle avait eu parfois l’idée de sortir dans la cour étroite, pour voir s’il y avait des étoiles au ciel ; elle avait regardé la mer avec plus d’intérêt passionné, comme si elle en attendait quelque chose d’inconnu. Les prairies qui descendent d’Octeville vers Cherbourg lui avaient semblé plus vertes, un grand genêt dont les fleurs d’or s’éparpillaient en feu d’artifice au-dessus d’un mur, sur une route, lui avait paru deux fois par an s’illuminer comme pour une fête à son intention... mais elle s’était accoutumée à voir les fleurs décroître et se flétrir sur les minces rameaux, les prairies jaunir à l’ardeur du soleil d’août ; et sa jeunesse s’était passée...
Elle l’avait cru, du moins, et soudain sa vie s’était éclairée d’une lumière nouvelle. Adèle avait vingt-sept ans, et depuis quelque temps elle s’était accoutumée à l’idée de devenir vieille fille ; autour d’elle ses « camarades de communion » s’étaient toutes mariées, plus ou moins tôt, plus ou moins bien, mais elle n’avait jamais rencontré quelqu’un qui lui fît la cour.
Ses quatre frères, les uns aînés, les autres plus jeunes, absorbaient l’attention du père demeuré veuf, et si Adèle s’était mariée, qui donc aurait pris soin de ces cinq hommes, grands ou petits ? C’est tout au plus si, durant les heures de répit que lui laissaient les soins du ménage, elle arrivait à faire quelque travail de lingerie délicate, exécuté sur commande pour une lingère de la rue de la Vase, qui le lui payait comptant.
À cette époque déjà reculée, les filles de la petite bourgeoisie ne croyaient pas déroger en travaillant pour les dames riches de la ville ; c’est là qu’elles puisaient non seulement leur argent de poche, mais souvent aussi les éléments de leur toilette. Depuis l’âge de dix-huit ans, Adèle n’avait pas coûté un sou à son père, quoiqu’elle fût toujours vêtue convenablement, et même avec goût.
Un soir, le père, absent une partie du jour, entra dans la cuisine où la famille prenait ordinairement ses repas ; il était suivi d’un grand garçon brun, à l’air sérieux.
– C’est un cousin, dit-il, quoiqu’il soit de parenté éloignée, c’est Élie Heurtey. Il vient d’être nommé maître tonnelier au port militaire. C’est beau, ça, à trente-cinq ans ! Faut lui donner une assiette ; nous ferons connaissance à table. Asseyez-vous, mon cousin.
Adèle regarda le cousin, qui la regardait ; dans les yeux profonds de l’autre, chacun d’eux lut sa destinée. La jeune fille qu’on n’avait jamais trouvée jolie, à cause de la froideur de ses traits réguliers, un peu durs, sentit pour la première fois le rouge de la jeunesse monter à ses joues, et aux yeux d’Élie elle parut la plus belle des femmes. Trois mois après ils étaient mariés...
Le timbre de la pendule résonna et fit tressaillir Mme Heurtey en la tirant de sa rêverie. C’était une demie qui venait de sonner ?
Elle regarda le cadran, essayant en vain de s’illusionner. Non, c’était bien le coup d’une heure qu’elle avait entendu, une heure du matin. Le feu était éteint, le salon se refroidissait, et André n’était pas encore revenu. D’ordinaire, il ne tardait pas si longtemps.
Depuis quelques jours, pourtant, il était moins exact, et Mme Heurtey avait eu plusieurs fois envie de lui en faire l’observation. Mais comme il arrive souvent aux personnes d’un naturel emporté qui se sont imposé peu à peu, par grands efforts, une règle de patience, elle s’était retenue, se reprochant son excès de sévérité pour un fils qui ne lui avait jamais donné le moindre sujet de déplaisir. Elle attira à elle un châle posé sur une chaise, s’en entoura les épaules, remua les cendres pour y réveiller quelque braise endormie, et pensant qu’André ne pouvait plus tarder, elle continua de descendre le cours de ses souvenirs.
III
Elle avait été heureuse avec son mari. Leur fils André et, sept ans plus tard, une fille nommée Éliette, d’après son père, leur avaient apporté un complément de joies. Ils s’étaient installés dans une petite maison, non loin du port militaire, où il y avait un jardinet. Là, elle élevait ses enfants tranquillement, quand un malheur arriva.
En rivant un cercle, au port, Heurtey avait fait sauter une paille de fer rougie qui lui avait atteint l’œil droit. La vue était perdue, mais de ce côté seulement ; il se rassurait déjà, disant qu’on travaille aussi bien avec un œil qu’avec deux, lorsqu’un malaise bizarre l’avait saisi, une sorte de torpeur qu’il ne pouvait secouer, malgré son énergie. En peu de semaines son état empira, et il mourut un jour, après une courte agonie, heureusement pour lui, inconscient de sa fin.
Une autre femme, moins vaillante, eût été écrasée du coup. Adèle Heurtey ensevelit son mari, prit une robe noire qu’elle ne devait plus quitter et regarda sa situation en face.
Son père était mort ; de ses frères rien à attendre : les uns mariés, les autres partis, ne lui seraient d’aucun secours. Éliette avait cinq ans, André en avait douze ; ni l’un ni l’autre ne pouvaient être pour elle autre chose qu’une charge, et cette charge, comment la porter à elle seule ?
Le ménage avait fait quelques petites économies, mais moins pourtant qu’on ne l’eût supposé.
Par un orgueil paternel fréquent chez ceux qui, n’ayant pas reçu d’éducation première, ont eu grand-peine à se faire une position, Élie Heurtey avait voulu que son fils reçût une éducation de bourgeois et l’avait fait entrer au lycée. Même pour un homme qui, en dehors de ses travaux au port militaire, faisait travailler chez lui deux ou trois ouvriers, c’était une grosse dépense. Après lui, le fonds qu’il avait créé se réduisait à bien peu de chose, les hommes qu’il employait n’étant que de simples manœuvres ; Mme Heurtey le vendit sur-le-champ.
Elle avait droit à une pension, vu les circonstances qui l’avaient rendue veuve ; mais cette pension était une goutte d’eau dans la mer ! il fallait trouver quelque chose.
Elle n’hésita pas : le métier qui lui avait procuré ses toilettes de jeune fille lui donnerait à présent le pain de ses enfants ; elle retourna chez la lingère qui l’employait autrefois et lui demanda du travail.
La bonne femme avait baissé, sa clientèle s’était éclaircie ; elle proposa son fonds à Mme Heurtey, moyennant un peu d’argent comptant et une rente viagère : la veuve accepta sans hésiter et employa le reste de ses économies à remonter le fonds de commerce, déchu de son ancienne splendeur.
Elle y réussit ; on s’intéressait à elle, et les dames de la marine ne s’adressèrent plus ailleurs ; l’avenir d’Éliette était donc assuré. En grandissant elle aiderait sa mère et plus tard la remplacerait.
Restait André. Le bon sens de la veuve lui conseillait de donner à son fils juste ce qu’il lui faudrait d’éducation pour être un bon commerçant ; mais elle se trouva combattue par ceux qui l’avaient protégée dans son établissement. André donnait de brillantes espérances, il obtenait des prix, il tenait le premier rang dans les concours de sa classe. Le proviseur du lycée n’était pas d’avis de perdre un élève aussi remarquable ; une bourse se trouvait vacante, elle fut donnée à André, et Mme Heurtey ne put faire autrement que de remercier.
Ce n’est pas sans combat cependant qu’elle accepta cette faveur, dont elle prévoyait les inconvénients pour l’avenir ; dans son langage de petite bourgeoise, c’est ce qu’elle appelait « une façade avec rien derrière ». Cependant, conseillée par les uns, censurée par ceux qui ne comprenaient pas son hésitation, elle finit par se soumettre à sa bonne fortune.
André continua de se distinguer, mais plus spécialement dans le dessin, car, après sa troisième, il s’était arrêté brusquement dans la voie des succès de concours. Ses maîtres, qui avaient compté en faire un lauréat départemental, et peut-être davantage, ne voulurent pas avouer qu’ils s’étaient trompés sur son compte. Si le petit Heurtey abandonnait les humanités, c’est qu’il avait en lui plus et mieux : il était né artiste, il serait peintre, comme l’illustre Jean-François Millet.
La gloire de Millet rayonne toujours sur Cherbourg ; la ville est bonne mère pour ceux de ses enfants qui témoignent une vocation artistique. Les dessins d’André révélaient un talent réel ; on s’enthousiasma, et, afin de ne pas interrompre sa carrière, la municipalité lui procura les moyens de faire son volontariat. Quand il revint, on lui accorda une pension, afin qu’il allât à Paris continuer ses études à l’École des beaux-arts.
Mme Heurtey en fut très émue. D’une part, l’honneur était grand, et son orgueil de mère en était singulièrement flatté ; d’autre part, elle ne pouvait se décider à laisser son fils aller seul à Paris. Elle l’avait élevé avec une fermeté qui touchait à la rigueur, et se représentait Paris comme un gouffre où l’enfant se perdrait dès les premiers pas ; d’autre part, quitter sa maison de commerce, devenue florissante, pour vivre dans la grande ville du mince revenu d’un faible capital, était une alternative inacceptable.
Pendant qu’elle maudissait à part soi la générosité intempestive de la ville de Cherbourg, Mme Heurtey reçut une des plus fortes commotions qu’il soit donné de ressentir.
Un vieux grand-oncle, centenaire, qu’elle allait visiter parfois avec ses enfants, mourut, lui léguant toute sa fortune, à l’exclusion des autres héritiers, disait le testament, « parce qu’elle avait si bien travaillé ». Cette fortune se montait à quatre-vingt mille francs environ.
Comment le vieux marin avait-il pu amasser cette somme, relativement extravagante ? On répéta alors ce qu’on avait dit jadis, à savoir, qu’il avait été quelque peu corsaire en son temps, ce qui était peut-être vrai. Ce qui était certain, c’est qu’il vivait depuis une vingtaine d’années uniquement de vieux vin de Bordeaux dont il avait une provision considérable dans sa cave, et de biscuits à la cuiller, qui ne constituaient qu’une faible dépense.
Rien ne s’opposait plus à ce que Mme Heurtey suivit son fils à Paris. Poussée par l’opinion publique, si puissante en province, elle vendit sa lingerie dans de très bonnes conditions et vint se loger place Vintimille, au cinquième étage d’une maison de belle apparence, d’où elle avait vue sur les arbres souffreteux du petit square.
En repassant dans son esprit cette période de sa vie, Mme Heurtey arrêta sa pensée avec une profonde reconnaissance sur ceux qui l’avaient guidée : le préfet maritime, qui lui avait témoigné de l’intérêt ; le médecin du port, qui s’était attaché à Heurtey pendant sa courte et singulière maladie, et qui était resté l’ami de la maison ; un brave homme de notaire, qui lui avait acheté de bons fonds à bas prix, avec une imperturbable confiance, et qui avait ainsi doublé ses économies... Tous ces honnêtes visages, dont quelques-uns reposaient maintenant dans l’immobilité de la mort, furent évoqués dans sa mémoire, et à chacun elle envoya une bénédiction.
Et maintenant ?
Depuis cinq ans elle habitait l’appartement loué au début, quoique son fils eût réussi à se faire connaître. Peinture brillante, pas assez sérieuse, disaient les vrais maîtres, ceux qui ne sacrifient rien au désir de s’enrichir vite. Le public, moins difficile, avait accepté d’emblée cette couleur soyeuse, cette composition habile, ce charme d’expression, sans se préoccuper des qualités plus sévères de dessin et de modelé. Déjà, André Heurtey avait des commandes de portraits, et sans atteindre les prix fabuleux des peintres à la mode, il les faisait payer passablement cher, assez cher pour que sa mère en fût éblouie et presque effrayée.
Malgré le châle dont ses épaules étaient couvertes, Mme Heurtey frissonna à plusieurs reprises, coup sur coup, avec un malaisé qui allait jusqu’à la souffrance. Le feu était complètement mort ; une petite bise aigre soufflait par les joints de la fenêtre et sous les portes, en dépit des bourrelets. La pendule allait sonner deux heures... André ne rentrait pas ; qu’était-il arrivé ?
Jamais, depuis le jour où pour la première fois elle avait vu son fils couché dans son berceau, Mme Heurtey ne s’était endormie sans l’avoir embrassé. Qu’il allât dans le monde ou qu’il passât la soirée avec ses camarades, André s’était toujours fait un devoir de rentrer assez tôt pour que sa mère ne fût pas inquiète. Deux ou trois fois seulement, à l’occasion d’une première représentation, terminée à une heure très avancée, il avait dépassé la limite ordinaire.
Mais, ce soir, il n’y avait point de première, pas de grande soirée ; André, sorti à six heures, en redingote, avait annoncé qu’il dînait en ville, ce qui lui arrivait souvent ; il n’avait pas dit où, ce qui était plus rare, et Mme Heurtey s’aperçut que depuis six semaines ce dernier cas se présentait beaucoup plus souvent qu’autrefois.
Elle se leva avec une sourde irritation. Allait-il prendre des habitudes de débauche, ce fils jusqu’à présent respectueux ? Sans doute, elle n’avait jamais exigé qu’il vécût en cénobite ; elle savait bien qu’il faut que jeunesse se passe ! Mais une mère doit feindre d’ignorer certaines choses, et un fils doit s’arranger pour qu’elle puisse feindre. Qu’avait-elle exigé, en définitive ? Qu’il ne passât jamais la nuit hors de la maison. Ce n’était pas une exigence déraisonnable ! Toutes les mères sensées devraient en faire une loi.
Elle lui avait dit :
– Je ne te contrains en rien ; mais s’il t’arrivait de ne pas rentrer, je serais obligée de te prier de vivre seul. Le respect que tu dois à ta jeune sœur autant qu’à ta mère ne serait pas compatible avec une vie désordonnée ; Éliette ne peut pas être exposée à me demander un jour pourquoi tu n’aurais pas couché dans ton lit. Que ce soit donc une chose bien entendue entre nous.
André connaissait la fermeté de sa mère : moins ferme, eût-elle su élever si bien ses enfants et leur créer une aisance honorable ? Il savait qu’elle n’employait jamais de vaines paroles, et qu’avec elle toute discussion était inutile ; il répondit donc en l’embrassant :
– Oui, maman, c’est convenu.
Et il se conforma à cet engagement.
Alors, pourquoi ne rentrait-il pas cette nuit ?
L’imagination surexcitée de Mme Heurtey prit un autre cours. On assassinait les gens, le soir tard dans les rues... Qui lui disait qu’André n’était pas tombé dans un guet-apens ? Un beau jeune homme, bien mis, c’est une proie tentante pour les malfaiteurs... Et s’il y avait là-dessous quelque affaire de femme, un modèle peut-être...
Trois heures sonnèrent. Mme Heurtey ouvrit violemment les rideaux et la fenêtre, et regarda au dehors.
IV
La lune se couchait, jetant la clarté lugubre particulière à son décours, dans ces dernières heures de la nuit ; les arbres nus du square, immobiles, étendaient leurs bras décharnés ; de grandes ombres tristes se dessinaient sur le pavé, un souffle humide et glacé d’automne, présage de neige prochaine, mordait la peau bien plus que le froid de la gelée.
Dans les rues, sur la place, personne... Mme Heurtey se pencha sur l’appui de la fenêtre, se faisant mal à force de se plier et jouissant âprement de sa douleur physique. Un bruit de pas résonna quelque part, loin encore ; le roulement d’une voiture dans la rue Blanche le couvrit un instant, et elle sentit une furieuse colère contre cette voiture qui l’empêchait d’entendre ; puis le roulement décrut, s’éteignit ; les pas s’étaient rapprochés, plus lents, plus lourds que ceux d’André.
C’était peut-être lui, pourtant ? Blessé, sans doute. Ce ne pouvait être que lui. L’homme approchait sans hâte. Elle percevait chacun de ses mouvements, par une délicatesse d’ouïe connue seulement de ceux qui ont attendu dans l’angoisse. Qu’il allait lentement, mon Dieu ! cet homme qui était peut-être son enfant !
Il déboucha sur la place. Elle se rejeta en arrière avec un mouvement de dégoût et d’horreur. Comment avait-elle pu prendre un instant pour la démarche élégante d’André cette allure louche, cette lourdeur de mauvais aloi ?... L’homme passa, les mains dans ses poches, la casquette rabattue sur l’œil gauche. De colère Mme Heurtey ferma la fenêtre et se jeta dans un fauteuil.
Voilà ce que c’est que de trop aimer ses fils ! Ils deviennent indifférents, irrespectueux, cruels... Ah ! oui ! elle l’avait gâté, son André ! et d’autres qu’elle l’avaient gâté aussi ! Elle se rappelait, à Cherbourg, des regards de petites ouvrières, suivant le beau garçon quand, le dimanche, il escortait sa mère et sa jeune sœur dans leur promenade sur la jetée. Ils en disaient long, ces regards qu’il feignait de ne pas voir ! ils contenaient l’histoire des amours secrètes, passagères, celles qui ne laissent de trace ni dans le cœur ni même dans la mémoire des hommes...
Mme Heurtey se sentait prise de rage contre elle-même, en pensant qu’elle n’avait pas écrasé dans l’œuf cette tendance au plaisir, à présent son ennemie. Elle s’en voulait de son indulgence, taxée par elle de complaisance indigne ; elle était coupable, criminelle, d’avoir toléré cette dégradation... Son âme puritaine se révoltait contre la vie du siècle, la vie de Paris surtout, qui faisait de ce qu’elle appelait la débauche une portion rationnelle, indispensable même, de toute existence de jeune homme.
Puis elle s’attendrit. Le pauvre enfant, était-ce sa faute, s’il était beau ? Était-il possible de le regarder sans en être émue ? Les yeux noirs, les cheveux châtains, la jolie barbe blonde et frisottée qui encadrait si bien la bouche fine, dont le sourire était à la fois si fin et si séduisant ; le charme de tout cet être gracieux et bien fait, c’étaient des dons naturels, André n’en était pas responsable ! Il était fait pour être aimé, on l’aimait. Était-ce sa faute ? Et Mme Heurtey trouvait qu’elle n’était vraiment pas raisonnable de condamner son enfant pour des erreurs qui ne venaient pas de lui.
Sans doute, mais il aurait dû rentrer. Elle ne lui demandait que cela, cela seulement ! Rentrer, ne pas l’affoler de craintes et de pensées douloureuses, avoir pitié d’elle, se rappeler qu’elle était sa mère, qu’elle l’aimait, qu’elle souffrait.
Des pleurs jaillirent des yeux de Mme Heurtey. Elle souffrait, ah ! certes ! Fallait-il qu’il l’aimât, la femme qui l’avait gardé cette nuit-là, pour avoir obtenu de lui qu’il lui sacrifiât sa mère ! Les autres, qu’importait ! puisqu’il les avait toujours quittées pour rentrer chez lui. Mais cette fois, avait-elle trouvé sa rivale, la femme qu’on préfère à tout, à sa mère, à son art, à son honneur ? Il fallait que ce fût celle-là ! car, à vingt-six ans, André savait ce qu’il faisait ; il savait quelle indignation l’attendait au retour... Il avait pesé, d’une part, son nouvel amour ; de l’autre, le respect de sa mère, et, volontairement, il avait sacrifié celui-ci à celui-là !
Les larmes tombèrent drues et chaudes sur les mains, sur la robe, sur les genoux de Mme Heurtey, dans le salon froid et sombre, car la lampe baissait, à bout d’huile ; la pauvre femme ne prenait plus garde à rien qu’à sa mortelle douleur de mère outragée. Ah ! si le père avait vécu, il aurait su ce qu’il devait faire pour maintenir son fils dans la règle. Mais une pauvre veuve, que peut-elle ? Elle ignore tout. Et à Paris, encore, dans cette ville d’immoralité...
Non ! ce n’était pas possible, André n’avait pas fait cela ! Il n’avait pas crucifié sa mère douloureuse sur la croix des mères faibles ou mauvaises ; il ne pouvait pas avoir commis cette mauvaise action. S’il n’était pas rentré, c’est qu’on le lui avait tué !
Fébrilement, grelottant de froid et d’angoisse, dans sa robe de laine, elle alla vers sa chambre, ouvrit son armoire à glace et y prit un chapeau qu’elle noua sur sa tête, n’importe comment. Les bruits du réveil, si matinal à Paris, descendaient déjà par les cheminées vides, avec des sons tantôt sourds, tantôt aigus, exagérés, déformés par ce porte-voix de pierres : avant de sortir, elle entrouvrit la porte de la chambre de sa fille.
Éliette dormait, dans l’obscurité des rideaux ; sa respiration douce, presque insensible, rythma les mouvements fiévreux et désordonnés de Mme Heurtey ; involontairement, celle-ci sentit tomber la grande fougue de colère et de jalousie qui la dévorait depuis quelques heures... Devant cette enfant, les souillures de la vie rentraient sous terre, comme au lever du jour, des oiseaux impurs et nocturnes. La dignité maternelle seule restait ; et si l’on avait tué André, sa mère savait où aller le réclamer... elle irait sur-le-champ.
Elle referma doucement la porte, traversa sa chambre et rentra dans le salon. La lampe grésilla un instant, puis s’éteignit, laissant monter vers le plafond un filet de fumée nauséeuse...
Mme Heurtey ouvrit rapidement la fenêtre. L’horreur des odeurs mauvaises était un des traits saillants de son organisation physique, de même que l’horreur des choses immondes pesait sur sa vie morale.
Un pas rapide, emporté, brutal, retentit sur le pavé sourd et s’arrêta devant la porte de la maison ; Mme Heurtey entendit distinctement le cliquetis du bouton de la sonnette dans sa coupe de cuivre. Son cœur fit un mouvement si violent qu’elle crut recevoir un coup et s’arrêta net. La porte retomba, et dans l’escalier de bois elle entendit les pas qui montaient en courant, un étage, puis deux, puis trois...
Elle ferma la fenêtre par où le jour entrait maintenant, et de pied ferme, armée d’une force qu’elle ne se connaissait pas, elle attendit. Un souvenir traversa son cerveau, pareil au vol d’une hirondelle ; elle avait attendu, comme cela, debout, quand on allait emporter le cercueil de son mari. D’un geste machinal, elle ôta son chapeau qu’elle jeta sur un meuble et lissa ses cheveux de la main.
La clef tourna très doucement dans la serrure ; la porte de l’antichambre fut refermée avec infiniment de précautions, puis celle du salon s’ouvrit. André l’attira doucement à lui sans lâcher le bouton, et s’assura qu’elle tenait bien ; puis il se dirigea vers sa chambre, située à gauche du salon, et s’arrêta avec un sursaut, en voyant sa mère debout sur le seuil. Il resta immobile, consterné, bien que depuis une demi-heure il n’eût pas songé à autre chose qu’à la possibilité de cette rencontre.
– D’où viens-tu ? demanda-t-elle à son fils d’une voix où ne tremblait plus le moindre vestige d’émotion, mais qui s’était empreinte d’une inexorable fermeté.
– Tu m’as attendu ? répondit-il, s’adressant plutôt à lui-même qu’à sa mère.
– D’où viens-tu ? répéta Mme Heurtey sans changer de ton.
– Maman ! fit-il avec une sorte de colère, pour l’amour de Dieu...
– Ne réveille pas ta sœur, dit la mère d’une voix contenue. Elle ne doit pas savoir que tu viens de rentrer.
André demeura muet, immobile, frémissant d’une indignation mêlée de remords. Sans doute, sa mère avait dû souffrir durant cette nuit d’attente, mais, à son âge, était-ce raisonnable de le traiter en petit garçon ?
– Tu ne trouves rien à me dire ? reprit Mme Heurtey qui sentit le cœur lui manquer devant cette attitude.
– Que veux-tu que je te dise ? répondit-il à voix basse d’un air excédé. Tu m’interroges et tu me défends de répondre en même temps.
– Mon fils ! dit-elle entre ses dents serrées. C’était à la fois une menace et un cri d’angoisse.
André ne voulut comprendre que la menace.
– Écoute, fit-il, viens dans ma chambre, puisque tu veux que je te parle.
Elle le suivit et il ferma la porte.
– Je suis un homme, dit-il en se contenant, car il tremblait malgré lui de colère ; j’ai vingt-six ans ; à mon âge, on sait ce qu’on fait. Tu ne veux pas comprendre que je ne saurais, sans ridicule, m’assujettir à rentrer au logis, le soir, avant minuit comme... (il cherchait une comparaison, et d’une voix étranglée jeta le mot à sa mère, pareil à un outrage) comme une bonne !
Mme Heurtey tressaillit de la tête aux pieds, mais se redressa et le regarda de ses yeux sévères. Il avait détourné les siens et continua, avec l’accent mauvais de ceux qui se mettent dans leur tort et le savent :
– On se moque de moi dans le monde... reprit-il.
– Lequel ? demanda la mère, hautaine.
Il haussa les épaules.
– Impossible de causer avec toi, maman, si tu le prends comme cela. Bref, voici ce que j’ai à te dire : j’ai une clef de l’appartement, et j’en userai, désormais, pour rentrer quand il me plaira.
Mme Heurtey approuva d’un signe de tête, sans cesser d’attacher sur lui son regard inexorable.
– Et puis, continua-t-il en se montant peu à peu, devant ce silence qu’il sentait peser sur lui, ce n’est vraiment pas ma faute si tu t’amuses à passer la nuit debout pour m’attendre. Tu n’avais qu’à te coucher, comme c’était simple et naturel.
– Sans savoir si tu étais rentré ? demanda la mère froidement.
– Parbleu !
Le silence se fit. Après un moment, il reprit d’un ton moins âpre :
– Je regrette de ne pas t’avoir prévenue que je ne rentrerais pas... mes amis m’ont retenu ; quand j’ai vu l’heure avancée, il était trop tard pour t’envoyer quelqu’un, j’ai cru que tu dormais, comme une mère raisonnable.
Il essaya de sourire, mais ce fut un essai malheureux : sa mère le regardait et l’écoutait dans la même attitude. Il fit un mouvement violent et retint un juron entre ses dents.
Mme Heurtey s’assit : son énergie morale était intacte, mais ses jambes refusaient de la soutenir.
– Mon fils, dit-elle, je t’ai élevé jusqu’à l’âge d’homme, l’âge où l’on se rend ridicule en témoignant plus longtemps des égards à sa mère, paraît-il. J’ai élevé ta sœur jusqu’à sa vingtième année dans la pureté et l’affection fraternelle. Je ne t’ai jamais demandé l’emploi de tes journées ni de tes soirées ; tu as été libre d’en faire l’usage qui te semblait bon, mais les apparences étaient au moins respectées. Aujourd’hui, tu n’es pas rentré ; ma dignité de mère et mon devoir envers ta sœur m’imposent une loi très dure, mais indispensable. Il se peut que, par oubli, par erreur, par faiblesse, tu aies été entraîné ce soir et que cela ne se renouvelle pas. S’il en est ainsi, je suis prête à te pardonner, car je sais que tu m’aimes... Peux-tu me donner ta parole d’honneur que cela ne se renouvellera pas ?
Mme Heurtey s’était un peu laissé ébranler en parlant ; sa voix avait fléchi, son regard cherchait celui de son enfant.
Dans une sorte de vision, André revécut les heures inoubliables de cette nuit sans pareille : un amour véritable, né du cœur, de l’imagination, des sens, à la fois intellectuel autant que passionné, s’était révélé à lui, mille fois plus ardent qu’il ne l’avait supposé ; Raffaëlle lui avait dévoilé un coin du monde intérieur dont ses fantaisies passagères ne lui avaient jamais laissé soupçonner l’existence ; il était enivré, ébloui, il appartenait à une de ces passions où l’on trouve
...Vénus tout entière à sa proie attachée.
Mme Heurtey l’ignorait ; mieux éclairée, elle n’eût pas essayé de lutter contre cette force indomptable.
– Eh bien, mon fils ? dit-elle, espérant provoquer une réponse selon ses vœux.
André se redressa ; ce n’était plus le joli garçon aimable, bon enfant, facile à vivre, qui cédait volontiers par peur instinctive de la discussion : c’était un homme qu’elle s’aperçut avec effroi n’avoir jamais connu ; pas plus qu’avant il n’était disposé à la lutte, mais il était prêt à la violence.
– Ma mère, dit-il, tu as tort de vouloir m’imposer des conditions. Tu aurais dû penser que peu de fils sont aussi respectueux, aussi tendres que moi, et me savoir gré de ma conduite, sans chercher à me surveiller de plus près. Je n’ai rien à promettre, n’ayant pas l’intention de me soumettre plus longtemps à ta règle claustrale.
Les lèvres de Mme Heurtey, devenues pâles, frémirent pendant un instant, sans qu’elle pût proférer une parole. C’était une femme autoritaire et rude, malgré le poli qu’elle avait acquis en ces dernières années.
– Alors, mon fils, dit-elle, si bas qu’il se pencha pour l’entendre, je ne pourrai pas te garder plus longtemps chez moi.
Sans rien dire, André tira sa clef de sa poche et la mit sur la table, entre sa mère et lui.
– Tu me donneras bien huit jours pour déménager ? fit-il avec un petit rire ironique et mauvais.
– André ! murmura Mme Heurtey, tu rougiras plus tard de cette triste nuit, de ce triste matin.
Il se détourna d’un geste impatient. Elle se leva et gagna la porte.
– Tu ne prends pas la clef ? fit-il un peu ému et inquiet en même temps.
– Je te laisse huit jours pour prendre une décision, répondit-elle en se retirant.
V
Resté seul, André essaya de réfléchir, mais une extrême fatigue nerveuse lui enlevait la possibilité de concentrer ses pensées ; avec un geste de renoncement, comme en présence d’un problème trop difficile, il se déshabilla à la hâte et se mit au lit. Moins d’une minute après, il dormait.
En se réveillant quelques heures plus tard, il aperçut la clef sur la table, et le souvenir de tout ce qui s’était passé depuis vingt-quatre heures lui revint avec force. Pendant qu’il faisait sa toilette, il tourna et retourna dans sa tête les éléments du problème sans arriver à une solution.
Il connaissait sa mère ; il savait quelle impitoyable rigidité se cachait sous sa tendresse ; il savait aussi quelle fermeté de résolution l’avait soutenue durant toute sa vie, et il se rendait compte que sur le chapitre des sorties nocturnes elle ne céderait pas. Était-il indispensable vraiment qu’il se brouillât avec elle irrémédiablement à cause de cela seulement ?
Vingt fois, il maudit la rigueur puritaine et les habitudes de province ; il envoya au diable ceux qui ne comprennent pas la vie moderne ; mais ces exclamations, qui soulageaient sa colère actuelle, ne changeaient rien à la situation : fallait-il rompre et s’en aller, au lieu de céder et rentrer au logis comme devant ?





























