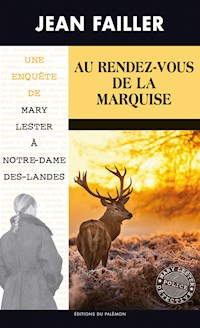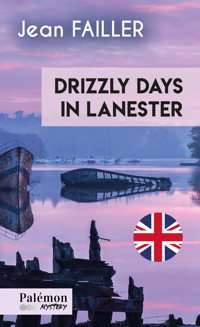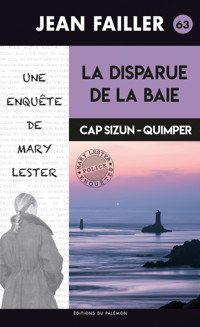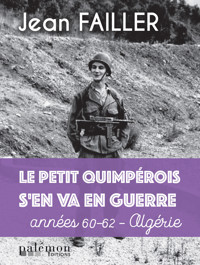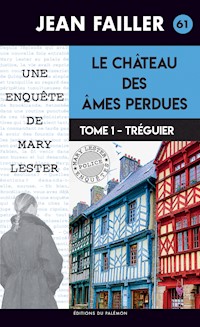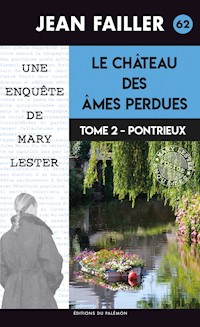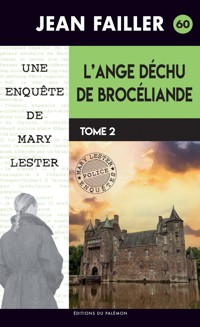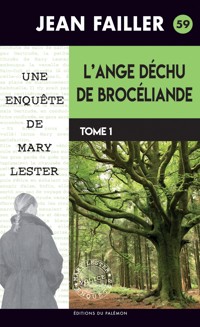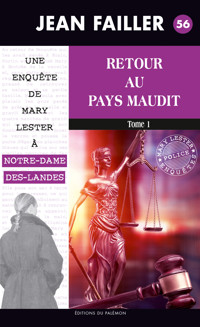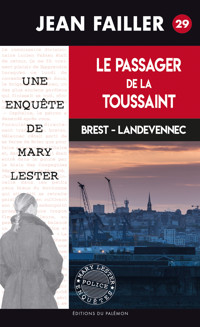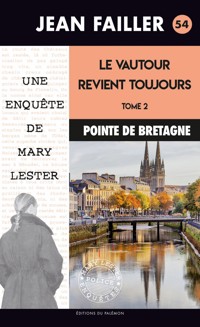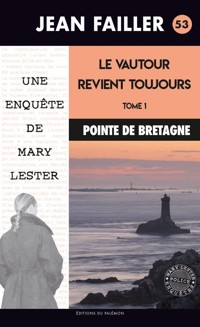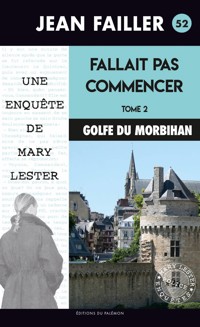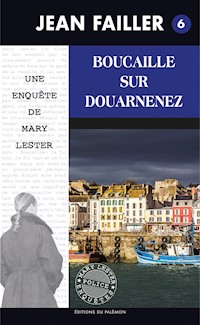
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les enquêtes de Mary Lester
- Sprache: Französisch
Dans une ambiance de carnaval, Mary Lester mène l'enquête !
Quand, en hiver, on découvre dans une mansarde une personne âgée morte de froid, personne ne s'en étonne. Mais quand ladite mansarde contient quatre cadavres de vieillards victimes des basses températures, on peut s'interroger sur les véritables raisons de ces décès.
Or, quand la police est aux prises avec l'insolite dans un coin de Bretagne, on ne tarde pas à voir paraitre Mary Lester. Cette fois, elle est accueillie comme le Messie par le commissaire Colin.
Pensez-donc le Mardi-Gras commence, et jamais le vieux patron de la police douarnaniste n'a manqué le rendez-vous des masques; Mary va devoir mener son enquête au cœur d'une bacchanale de quatre jours, dans un monde insolite et déroutant, peuplé de masques parfois mal intentionnés
Notre enquêtrice préférée est de retour pour une enquête peu banale !
EXTRAIT
Mary Lester fut tirée de son sommeil par le claquement sonore de sabots de bois sur le pavé de la venelle. Il lui sembla qu’un objet dur raclait le mur de la maison et une porte s’ouvrit sur le palier. Malmené par des pas pesants l’escalier gémit, une fenêtre grinça, et quelqu'un qui s’efforçait de chuchoter s’enquit du temps :
– Fait beau?
Une voix rude et éraillée, une voix qui ne savait pas parler doucement troua la nuit finissante d’un seul mot :
– Boucaille !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Habile, têtue, fine mouche, irrévérencieuse, animée d'un profond sens de la justice, d'un égal mépris des intrigues politiciennes, ce personnage attachant permet aussi une belle immersion, enquête après enquête, dans divers recoins de notre chère Bretagne. - Charbyde2, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Cet ancien mareyeur breton devenu auteur de romans policiers a connu un parcours atypique !
Passionné de littérature, c’est à 20 ans qu'il donne naissance à ses premiers écrits, alors qu’il occupe un poste de poissonnier à Quimper. En 30 ans d’exercice des métiers de la Mer, il va nous livrer pièces de théâtre, romans historiques, nouvelles, puis une collection de romans d’aventures pour la jeunesse, et une série de romans policiers, Mary Lester.
À travers Les Enquêtes de Mary Lester, aujourd’hui au nombre de cinquante-neuf et avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus, Jean Failler montre son attachement à la Bretagne, et nous donne l’occasion de découvrir non seulement les divers paysages et villes du pays, mais aussi ses réalités économiques. La plupart du temps basées sur des faits réels, ces fictions se confrontent au contexte social et culturel actuel. Pas de folklore ni de violence dans ces livres destinés à tous publics, loin des clichés touristiques, mais des enquêtes dans un vrai style policier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean FAILLER
Boucaille
sur
Douarnenez
éditions du Palémon
ZA de Troyalac’h
10 rue André Michelin
29170 St-Évarzec
Ce livre appartient à
xxxxxxexlibrisxxxxxx
Remerciements à :
Pierre Deligny,
Nicole Gaumé,
et au Docteur Pierre Boivin.
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
ISBN 978-2907572-16-3
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, de l’éditeur ou de leurs ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa 1er - article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. 2011/© Éditions du Palémon.
Retrouvez les enquêtes
de Mary Lester sur internet :
http://www.marylester.com
Éditions du Palémon
ZA de Troyalac’h - N° 10
Rue André Michelin - 29170 St-Évarzec
Dépôt légal 4e trimestre 1998.
Chapitre 1
Mary Lester fut tirée de son sommeil par le claquement sonore de sabots de bois sur le pavé de la venelle. Il lui sembla qu’un objet dur raclait le mur de la maison et une porte s’ouvrit sur le palier. Malmené par des pas pesants l’escalier gémit, une fenêtre grinça, et quelqu'un qui s’efforçait de chuchoter s’enquit du temps :
– Fait beau?
Une voix rude et éraillée, une voix qui ne savait pas parler doucement troua la nuit finissante d’un seul mot :
– Boucaille!
Ce fut tout. Ce fut tout et ce fut assez. Mary, qui avait eu un grand-père marin-pêcheur auprès duquel elle avait vécu toutes ses vacances, savait ce que signifiait ce mot.
Boucaille voulait dire temps gris, ciel gris, mer grise. Pas de vent mais un crachin ténu, tenace, capable de tomber sans discontinuer pendant vingt-quatre heures comme pendant une semaine. Boucaille, c’était aussi une mer calme, débonnaire, agitée seulement de grandes houles onduleuses venues des tréfonds de l’Atlantique pour bercer les bateaux.
« Boucaille » avait dit le marin de sa voix rocailleuse, et Mary avait senti une intonation satisfaite dans ce cri qui avait roulé entre les murs de granit rongés par le sel, jusqu’au bas de la venelle sombre qui débouchait sur la mer.
Les jours où l’on criait ce mot dès l’aube étaient bénis des marins. On ne pouvait rêver meilleur temps pour la pêche, le poisson se laissait prendre comme à plaisir.
Pour les estivants qui appelaient ça « le crachin breton », c’était le cauchemar des vacances, l’impossibilité d’aller se dorer sur les plages de sable fin… Les jours de gros embouteillages car les touristes qui ne trouvaient rien d’autre à faire, se hasardaient en voiture dans des rues qui n’étaient pas faites pour ça, les jours où les crêperies refusaient du monde et où les villes du littoral étaient envahies par des troupes bottées, capelées de cirés comme des terre-neuvas.
Mais on était en février et les estivants avaient reflué dans leurs métropoles depuis belle lurette et on ne les reverrait pas de si tôt. Pas avant Pâques, en tout cas. Le vieux port avait retrouvé sa quiétude d’hiver. C’était la règle, juillet-août, deux mois d’agitation, d’encombrements, deux mois de vie. Restaient dix longs mois paisibles, trop paisibles.
Mary se retourna dans son lit pour regarder l’heure à sa montre posée sur le chevet. Cinq heures et demie. Comme pour confirmer ce qu’elle venait de lire sur le cadran lumineux, deux coups grêles tintèrent dans la nuit au clocher de l’église voisine. Il sonnait un coup pour le quart, deux pour la demie, trois pour les trois quarts et quatre quand l’heure était révolue. Alors une autre cloche prenait le relais et égrenait les heures sur un ton grave. Dông… Dông… Dông…
L’hôtelière avait honnêtement signalé cette sonnerie, précisant tout de même qu’avec les doubles vitrages le bruit était si atténué qu’on l’entendait à peine. Las, Mary avait l’habitude de dormir fenêtre ouverte. Ce léger désagrément ne l’avait pas empêchée de conserver sa chambre dans le petit hôtel vieillot donnant directement sur le port, où il lui semblait qu’elle était, avec un couple de retraités, la seule pensionnaire.
Il y avait eu sous les fenêtres un conciliabule, puis les pas s’étaient éloignés, descendant la venelle. Enfin on ne les entendit plus, ils avaient gagné le port en empruntant le vieil escalier de pierres usées par des millions de pas laborieux et pressés.
Mary imagina les deux silhouettes se tenant à la rambarde de fer rouillé scellée dans le mur. Avaient-ils leur casse-croûte dans un panier d’osier tout rond? Portaient-ils le large pantalon de coton et la vareuse rapiécée, décolorée par le temps et les lessives?
Non, c’étaient des pêcheurs de plaisance; ils allaient embarquer au ponton dans un canot de plastique propulsé par un moteur hors bord, pas dans un lourd canot de bois qu’on manœuvrait à la godille.
A onze heures ils reviendraient tout farauds, avec une demi-douzaine de maquereaux et une paire d’orphies qu’ils brandiraient comme un trophée.
Désormais les marins professionnels, ceux qui restaient encore, s’embarquaient pour trois semaines sur de gros chalutiers en acier pour aller traquer le lieu noir en mer d’Irlande. Leurs familles ne s’entassaient plus dans les demeures populeuses du vieux port, elles habitaient des maisons neuves sur les hauteurs de Ploaré.
Le vieux port était voué à la plaisance comme celui de Tréboul et le Port-Rhu qui, après une intense activité de commerce et de construction navale, avait vu sa ria transformée en musée où s’ancraient les vieux bateaux encore à flot. Les conserveries désaffectées abritaient désormais des collections de maquettes et des carcasses de barques arrachées aux vasières.
Ainsi Douarnenez essayait de survivre en s’appuyant sur son glorieux passé.
Mary se retourna dans son lit. Elle était complètement réveillée maintenant. Un jour terne commençait de filtrer à travers la fenêtre. Elle se leva et écarta le rideau. Comme le marin l’avait clamé dans la fraîcheur de l’aube, tout était gris et s’il ne pleuvait pas encore, ça ne pouvait plus tarder. Là-bas un petit canot rouge et noir doublait le môle surmonté de sa lanterne encore allumée qui jetait des éclats verts sur les flots et les empierrements découverts par la marée basse. Son moteur laissait derrière lui un sillage d’écume; dans les lointains, les monts d’Arrée se perdaient dans la brume.
Mary contempla un instant le paysage, la plage du Ris bordée de cabines de bain où des rouleaux se brisaient, les villas aux ouvertures protégées par des panneaux de bois qu’on n’enlevait que trois semaines par an, puis elle laissa tomber le rideau et retourna se coucher.
Quand elle se réveilla, neuf heures sonnaient. Elle descendit prendre son petit déjeuner dans la pièce d’angle du premier étage qui servait également de salon. Une vieille dame aux cheveux blancs la salua discrètement.
Une tasse retournée sur une soucoupe marquait la place que Madame Mével avait attribuée à sa nouvelle pensionnaire devant une des portes-fenêtres de la pièce. Les battants clos donnaient sur un petit balcon auquel, en été, la patronne suspendait des potées de géraniums. Mais le temps des balcons fleuris était loin et les géraniums avaient été rentrés. Ne subsistaient plus de leur présence que les supports des jardinières aux boulons tachés de rouille.
Mary s’installa devant sa tasse et regarda le paysage en attendant son café. Il y avait peu d’animation dans la rue. Sur la cale, un marin en vareuse bleue et casquette noire s’affairait autour d’un canot. Il l’avait échoué sur les grosses dalles de granit et le vidait à présent de tout son matériel.
Il régnait dans la pièce une quiétude douillette troublée seulement par les gémissements du chien de la vieille dame, un très vieux cocker au poil blanchi qui espérait un morceau de pain grillé.
Une horloge bigoudène, cloutée de cuivre luisant, aux flancs brillants de cire, battait le temps; et son balancier, rutilant plateau d’or, passait et repassait devant une petite fenêtre ouverte comme un gros nombril dans son ventre de bois ouvré.
Sur la tapisserie un peu défraîchie étaient accrochées des toiles. Peut-être des œuvres que des rapins impécunieux avaient laissées à l’hôtesse en paiement de leur pension. Elles représentaient de grands bateaux sous voile ou encore des scènes de la vie du port, le débarquement du poisson, les ramendeuses de filets.
Le sol était fait de grosses planches de sapin si souvent passées à la paille de fer que la matière tendre du bois s’était peu à peu érodée et que de gros nœuds sombres saillaient comme des verrues.
La vieille dame tendit à son chien un talon de pain puis regarda Mary avec un sourire d’excuse :
– Il est très vieux, dit-elle, et d’une gourmandise!
Elle se pencha pour caresser l’animal qui la regarda de ses bons yeux tombants. Mary lui sourit à son tour et, comme la patronne lui apportait son café, elle n’eut pas à répondre. Le journal était posé sur le plateau. Elle le déplia et ce fut encore la vieille dame qui lui adressa la parole :
– Vous avez vu, ces quatre personnes qu’on a trouvées mortes dans la même chambre?
La patronne qui était déjà rendue à l’escalier s’arrêta net, les mains sur les hanches :
– C’est épouvantable! Il se passe des choses maintenant n’est-ce pas? Quatre morts, à même pas cent mètres d’ici!
On sentait la maîtresse femme. De taille moyenne mais à la tournure avantageuse, elle avait une façon de toiser son monde, un poing sur la hanche, l’œil noir, les lèvres serrées qui annonçait que la patronne, ici, c’était elle et personne d’autre. Il ne devait pas faire bon la contrarier.
Malgré le côté funèbre de la nouvelle, Mary eut un petit sourire provoqué par l’accent de l’hôtelière. Inimitable, pensa-t-elle. Elle se trompait puisque, après huit jours passés à Douarnenez, elle se surprit à accentuer les syllabes finales des mots comme le faisait si bien madame Mével.
Elle demanda :
– Vous les connaissiez?
– Non dame! fit la patronne. Je vois même pas qui ça pouvait être. Et pourtant, ici je connais tout le monde!
Une voix monta du rez-de-chaussée :
– Ninette!
Elle bougonna :
– Ah là là là!
Et aux deux femmes :
– C’est encore après moi qu’on est!
Elle brailla par-dessus la rampe d’une voix aiguë :
– J’arrive!
Et, avant de disparaître elle s’arrêta un instant, le temps de jeter d’un air excédé :
– J’ai pas une seconde à moi!
L’escalier gémit sous ses pas. Mary regarda sa voisine en souriant et la vieille dame se crut obligée de traduire :
– Elle veut dire qu’elle est très sollicitée!
Mary hocha la tête. C’était bien ce qu’elle avait cru comprendre.
– Vous n’êtes pas d’ici? demanda encore la vieille dame.
C’était plus une affirmation qu’une question. Mary répondit par la négative et la dame aux cheveux blancs précisa :
– Quelquefois vous aurez du mal à comprendre ce que les gens veulent dire. Il y a des mots, des tournures de phrase qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.
– Et vous les comprenez, vous?
La vieille dame se rengorgea :
– Bien sûr, moi je suis née à Douarnenez!
Dans cette phrase il y avait autant d’accent que dans toutes celles qu’avait prononcées la nommée Ninette avant elle.
Au-dehors, le ciel n’arrivait pas à se dégager. L’air semblait saturé d’eau. Sur la rambarde de fer rouillé de la vieille cale, de gros goélands attendaient on ne sait quoi. Parfois des marins passaient à deux mètres d’eux sans qu’ils se soucient de bouger.
– Vous êtes en vacances? demanda poliment Mary.
– Oui, nous habitons la région parisienne… En fait, nous sommes en retraite…
– Et vous prenez vos vacances hors saison?
– Tous les ans on vient pour la Toussaint et pour le Mardi-gras.
Elle regarda la colline des Plomarch’ qui dominait le fond de la baie, et à laquelle on accédait par un interminable escalier de granit :
– Tenez, je suis née dans la petite maison blanche qu’on voit là-haut, face à la mer. Quand les parents sont morts, mes frères l’ont mise en vente. Enfin, quand je dis mes frères, c’est surtout mes belles-sœurs qui ont poussé à la roue… A l’époque nous avions encore un emprunt sur le dos, nous n’avons pas pu l’acheter.
Il y avait dans sa voix une telle nostalgie que Mary s’attendit à lui voir des larmes aux paupières.
– Vous auriez aimé l’habiter? demanda-t-elle.
– Oh oui! dit la vieille dame avec ferveur, nous y aurions vécu toute l’année!
Elle ferma les yeux, s’imaginant sans doute la maison de son enfance maintenant occupée par des étrangers. Puis elle soupira et ajouta avec une véhémence et une trivialité qu’on n’aurait pas imaginées chez une personne aussi élégante, paraissant si distinguée :
– Ah, pour emmerder le monde, il n’y a pas comme les morceaux rajoutés!
A nouveau elle avait retrouvé tout l’accent de son enfance et une vigueur de ton surprenante. Mary supposa que les « morceaux rajoutés » devaient être ses belles-sœurs, qui avaient fait vendre la maison familiale. Ayant fini son café, elle repoussa sa tasse et se leva. En passant devant le chien, elle le caressa.
– Au revoir madame.
– Au revoir, dit la vieille dame perdue dans ses souvenirs.
Mary déboucha au rez-de-chaussée, dans la salle du bar déserte à cette heure. La patronne balayait d’une main vigoureuse la sciure qu’elle avait répandue sur le carrelage.
– Vous déjeunez là?
– Je ne sais pas encore…
– C’est parce que Corentin va aller au marché…
– Ne vous souciez pas de moi, je me contente volontiers d’un sandwich à midi…
Et comme la grosse femme la contemplait d’un air réprobateur, elle ajouta sur un ton plaisant :
– Vous aurez toujours un morceau de pain et quelques tranches de jambon dans votre frigo?
La patronne donna trois coups de balai avec une vigueur superflue et, s’arrêtant net, dit avec humeur :
– Sûr! Et puis du beurre, et des cornichons. Mais tout ça ne vaut pas un bon repas!
Mary haussa les épaules et sortit. Qu’avaient donc les gens à la considérer comme leur fille, à lui donner des conseils sur son alimentation, sur sa façon de s’habiller, quand ce n’était pas sur sa façon de conduire? A croire qu’elle ne leur semblait pas adulte!
L’hôtel n’était séparé du bassin que par une chaussée d’une dizaine de mètres de large. L’été cette rue devenait piétonne et les bistrots faisant face à la mer étalaient là leurs terrasses pour le plus grand plaisir des estivants.
La mer continuait de descendre et les bateaux amarrés au quai s’échouaient les uns après les autres dans la vase noire du port. Sur la cale, le marin avait fini de vider son canot et avait rangé son matériel le long d’un mur de pierre. Il y en avait tant que Mary se demanda comment tout ce bazar avait pu tenir dans cette coque de noix. Aidé de trois badauds, il avait entrepris de retourner le canot afin qu’il se trouve quille en l’air. Les goélands les regardaient faire, toujours impassibles, les palmes jaunes de leurs pattes largement étalées sur la main courante de fer rouillé.
Un crachin ténu tombait sans discontinuer et à peine voyait-on à présent le bout de la vieille digue. Mary mit la capuche de son duffle-coat et remonta vers le centre ville. Elle avait trouvé, la veille, une place de parking derrière son hôtel et, le commissariat se trouvant à quelques centaines de mètres de là, elle préférait s’y rendre à pied.
Les rues remontant vers le cœur de la ville étaient pentues et désertes. On y marchait sur des pavés irréguliers et il fallut qu’elle atteigne la place des halles pour trouver un semblant d’animation. De là, elle n’était plus très loin du commissariat.
Chapitre 2
Le commissaire Colin devait approcher de la retraite. C’était un gros bonhomme, au visage fatigué, qui leva sur Mary ses paupières lourdes quand elle fut introduite dans son bureau.
Il resta assis à son entrée mais lui montra une chaise d’un signe de tête, la regarda s’installer et dit enfin d’une voix rocailleuse :
– Inspecteur Lester… J’ai entendu parler de vous, ma fille!
La familiarité du propos surprit Mary, ce que ne manqua pas de remarquer le commissaire Colin qui sourit :
– Ça t’étonne que je t’appelle ma fille? demanda-t-il.
Se faire appeler « ma fille » par un commissaire dès le premier contact n’était pas courant, se faire tutoyer dès la seconde phrase non plus. Elle ne sut que répondre, alors le commissaire Colin poursuivit :
– Des filles, j’en ai six. Tu as quel âge?
– Vingt-six ans, monsieur le commissaire.
– Ma fille aînée en a trente, et la dernière dix-neuf. Alors, tu vois…
Mary ne voyait pas en quoi cette paternité autorisait une telle familiarité, mais l’accent du bonhomme la mettait en joie : c’était ce même accent qu’avaient Ninette la patronne de l’hôtel et la vieille dame quand elle évoquait la maison de son enfance.
– Vous êtes douarneniste, monsieur le commissaire.
Le commissaire sourit de nouveau :
– Ça se voit tant que ça?
Elle sourit à son tour :
– Ça s’entend surtout!
– Ah…
Il y eut un silence pendant lequel ils se regardèrent puis Colin dit :
– Comme ça on t’a envoyée ici pour les quatre pauvres vieux qui sont morts…
Il sortit de la poche de son veston avachi un paquet de Boyards maïs et une boîte d’allumettes format ménage.
– Je ne t’en offre pas, s’excusa-t-il, les filles n’aiment pas ça. Elles ne fument que des Anglaises ou des Américaines.
– Je ne fume pas du tout, dit-elle.
– Ah, fit-il de nouveau avec indifférence en exhalant un nuage de fumée bleue.
–… Mais la fumée ne me dérange pas.
– Tant mieux ma fille, tant mieux.
La pièce était silencieuse, sur le bureau il y avait les deux journaux locaux, le « Télégramme » et l’« Ouest-France », mal repliés. Le commissaire devait être en train de les lire quand Mary était arrivée.
– Alors, dit Mary, on les tue quatre par quatre chez vous?
Colin la regarda gravement.
– On a trouvé quatre morts dans la même chambre, c’est vrai. Mais personne n’a encore prouvé qu’ils avaient été tués.
Mary fit une petite moue et le commissaire trouva que ça lui faisait une fossette absolument charmante.
– Mort naturelle? Vous y croyez?
Et comme Colin ne disait rien, elle ajouta :
– On m’aurait fait venir ici pour quatre morts naturelles?
– Qu’est-ce que tu fais dans la police? demanda Colin tout à trac.
Comme Mary le regardait, surprise par la question qui tombait comme un cheveu sur le potage il affirma :
– Il n’y a pas une de mes filles qui aurait eu idée de faire ce métier!
– Et qu’est-ce qu’elles font vos filles?
Il toussa en rejetant sa fumée :
– Des gosses!
– Elles sont toutes mariées?
– Mariées, pas mariées, est-ce qu’on sait maintenant? en tout cas, je suis dix-huit fois grand-père!
Mary avait une formidable envie de rire mais elle parvint à se retenir :
– Mes compliments!
– Il n’y a pas de quoi, dit Colin d’une voix lasse.
– La petite dernière aussi?
– Aussi quoi?
– Je veux dire, elle aussi elle a des enfants?
– Pfff! fit Colin, c’est la pire! Elle en a quatre!
Mary s’exclama :
– Quatre enfants à dix-neuf ans?
– Ouais, deux fois des jumeaux!
Il la regardait d’un air tout à la fois fier et accablé, un air si comique que, n’en pouvant plus, Mary éclata de rire.
Colin la regarda de telle manière qu’elle sentit que ce rire l’avait blessé. Elle mit sa main devant la bouche :
– Excusez-moi, monsieur le commissaire.
– Tu te moques de moi hein, dit-il d’une voix lasse.
Ce n’était même pas un reproche, mais une simple constatation.
– Mais non, commissaire, je ne me moque pas de vous…
– Pourtant tu rigoles.
– Ben oui. Avouez que votre histoire n’est pas commune. Et puis, les enfants c’est la vie, c’est la joie!
– Si on veut, dit Colin mi-figue mi-raisin.
Il eut un geste de la main qui projeta de la cendre sur le verre de son bureau. Il souffla dessus pour la chasser et dit :
– Enfin, je suis bien content que tu sois là, parce que cette histoire des quatre macchabées dans la même chambre, elle tombe plutôt mal!
– Ah, fit Mary encore égayée.
– Le Mardi-gras commence demain.
Mary le fixa, sans comprendre. Que venait faire le Mardi-gras là-dedans? Le commissaire la regarda aussi, comme on regarde une demeurée.
– Tu n’as pas entendu?
– Si, mais je ne vois pas…
– Tu ne vois pas quoi?
– Ce que le Mardi-gras vient faire là-dedans!
Du coup le commissaire se leva. Il était beaucoup plus grand que Mary se l’était imaginé en le voyant courbé sur le sous-main de son bureau.
– Il ne vient rien faire le Mardi-gras! Tous les ans il est là, en février ou début mars. Ce sont ces quatre macchabées qui me tombent dessus en plein Mardi-gras, comme la misère sur le pauvre monde!
Mary faillit se frotter les yeux, les propos du commissaire devenaient franchement surréalistes. Elle se promit de trouver, dans le commissariat, quelque inspecteur qui puisse lui passer le décodeur.
Enfin, elle demanda :
– Pouvez-vous me parler de cette affaire?
– Moi? dit Colin, sûrement pas!
La réponse la laissa sans voix. Le commissaire ouvrit la porte et beugla dans le couloir :
– Fanchic!
Puis il lui fit, à l’adresse de Mary, un geste de connivence qui semblait dire : « Attends un peu… »
Un homme entra sans se donner la peine de frapper :
– Tu m’as appelé, Jean-Louis?
– Ouais, grogna le commissaire.
Il montra Mary de la main.
– Voici l’inspecteur Mary Lester qu’on nous a détachée pour l’affaire des quatre macchabées de la rue Obscure. Raconte-lui tout ce que tu sais.
Il se dirigea vers la porte :
– Moi, j’ai à faire… Excuse-moi petite, mais c’est pressé!
Mary regarda la porte se refermer, les yeux écarquillés par l’incompréhension.
Chapitre 3
L’inspecteur Le Meunier s’en vint prendre la place du commissaire. Au passage il tendit la main en souriant à Mary qui la serra.
– Bienvenue au village!
François Le Meunier, dit Fanchic, était un petit quadragénaire rondouillard d’un abord fort sympathique. Mary le regardait, perplexe et, devant son air intrigué, il se mit à rire.
– Ça vous la coupe hein, un accueil pareil!
Mary dut convenir qu’en effet, comme disait l’inspecteur François Le Meunier, ça la lui coupait, en effet. Elle jeta un regard vers la porte pour s’assurer qu’elle était bien fermée et dit à mi-voix, en se penchant vers le bureau :
– Ecoutez, Le Meunier, je n’aime pas tirer des conclusions prématurées ni dire du mal de mes supérieurs, mais votre commissaire, il n’est pas un peu… bizarre?
– Mais non, dit Le Meunier avec rondeur, c’est le meilleur type de la terre!
– Je n’en doute pas, mais…
– Laissez, il est un peu contrarié. Pensez donc, ça fait des mois qu’il prépare son costume pour le Mardi-gras, et le voilà avec quatre morts sur les bras!
Mary mit son front dans sa main et ferma les yeux. Ça y était, Le Meunier remettait ça avec le Mardi-gras. Sûr, il y avait quelque chose qui lui échappait.
– Je peux vous dire, poursuivit l’inspecteur, que ce brave Jean-Louis a été drôlement soulagé quand Quimper lui a annoncé votre venue.
Ça aussi c’était nouveau. D’ordinaire, les patrons auxquels on adressait Mary avaient plutôt tendance à l’accueillir fraîchement, quand ce n’était pas avec une hostilité déclarée. Et puis, cette façon qu’avaient ces hommes de s’appeler par leur prénom, de se tutoyer. C’était fréquent entre inspecteurs que l’âge et la fonction rapprochaient, mais entendre un inspecteur relativement jeune entrer sans frapper dans le bureau d’un commissaire au bord de la retraite en l’appelant Jean-Louis, ça la surprenait tout de même un peu.
– Inspecteur Le Meunier, dit Mary, je voudrais que vous m’éclairiez sur ces quatre morts, mais d’abord, qu’est-ce que c’est que cette histoire de Mardi-gras?
– D’abord, dit Le Meunier, ce n’est pas une histoire, c’est une fête. Que dis-je c’est LA fête. A partir de demain et pendant quatre jours, la ville va être en folie. Pendant les Gras tout le monde se déguise.
– Vous voulez dire que le commissaire aussi…
– Surtout le commissaire! Pour rien au monde il ne manquerait les Gras, c’est un vrai douarneniste!
– Et vous?
Le Meunier eut une moue :
– Moi non.
Et il ajouta comme en s’excusant :
– Je suis de Tréboul.
– C’est où ça Tréboul?
Il eut un geste vague de la main :
– De l’autre côté de l’eau.
Elle fronça les sourcils. Derrière le bureau du commissaire il y avait un plan de la ville. L’inspecteur Le Meunier se retourna sur son siège pivotant et, armé d’une règle, montra la carte.
– Là, c’est Tréboul.
– Mais, dit Mary, c’est un quartier de Douarnenez!
– C’est le Maroc! dit Le Meunier en refaisant face à Mary.
– Le quoi? demanda-t-elle de plus en plus éberluée.
– Le Maroc. C’est ainsi que les vrais douarnenistes appellent Tréboul.
Il sourit :
– On n’est pas douarneniste quand on est né au Maroc!
Mary ne comprenait pas bien. Enfin, elle dit :
– Et c’est parce que vous êtes né à Tréboul que vous renoncez aux réjouissances?
– Non. Mais il faut bien que quelqu’un reste garder la boutique! Et puis, franchement, me déguiser c’est pas mon truc.
– Donc pendant quatre jours…
– Et quatre nuits, compléta Le Meunier, ça va être la fête totale.
– Et le commissaire?
– Ne comptez surtout pas le voir!
– Bon, dit-elle après un silence, si vous me parliez un peu de ces quatre cadavres?
– Ouais, dit Le Meunier en se grattant sous l’oreille.
Il paraissait embarrassé et Mary dut l’encourager :
– Commencez donc par le commencement!
– Ouais, dit encore Le Meunier en la regardant de biais, comme s’il se méfiait. Voilà, mardi matin, donc hier, madame Bernadette Perchec demeurant rue Obscure toque à la porte de ses locataires, comme elle le fait tous les matins, pour leur demander s’ils veulent du pain…
Il y eut un silence comme s’il cherchait ses mots, et il reprit lentement :
– Madame Perchec est une vieille femme qui habite une vieille maison dans une vieille rue qui descend vers le vieux port.
Mary se cala sur sa chaise :
– Tout est vieux dans votre histoire, dit-elle.
– Plus que vous ne le croyez… Madame Perchec prend des locataires plus pour avoir de la compagnie que pour agrémenter sa pension qui est d’ailleurs confortable. Feu son mari était maître principal…
– Ah… Et ça gagne gros un maître principal?
Le Meunier eut un bref sourire :
– Vu ce que dépense madame Perchec, oui. Elle ne doit pas bouffer le quart de sa demi-pension!
– Radin?
– Même pas. Des besoins réduits à l’extrême. Des cousines de la campagne qui lui apportent des légumes, des pêcheurs qui la fournissent en poisson et une sobriété de chameau…
– Donc elle doit avoir un magot.
– Probablement… Mais là n’est pas la question. Madame Perchec n’est pas la victime dans cette affaire. Les victimes ont pour nom monsieur et madame Lobek, monsieur et madame Le Marc.
Il ouvrit un dossier et en sortit une fiche.
– Winceslas Lobek, né en 1919 à Poznan.
– Un Polonais.
– Naturalisé Français en 39, a fait toute la guerre dans l’armée française. Puis a travaillé à la régie Renault comme fraiseur-outilleur jusqu’à sa retraite. Époux de Antonine Baron, née à Ploubezre en 1917.
– Et ils habitent?
Il corrigea :
– Ils habitaient à Ploubezre…
Il consulta sa fiche et précisa :
– Rue des Fontaines. Il n’y a pas de numéro.
– Ça en fait deux, dit Mary, et les autres?
– J’y viens. Francis Le Marc, né à Lesconil, Finistère, en 1913, époux de Paulette Chausson, née à Saint-Pol-de-Léon en 1915.
– Dites donc, c’était pas des perdreaux de l’année!
– Pardon? dit Le Meunier en fronçant les sourcils.
– Je veux dire qu’ils n’étaient pas de première jeunesse!
L’inspecteur émit un rire bref, qui aurait pu passer pour un éternuement :
– En effet.
Puis il regarda Mary :
– Voyez, tout est vieux dans cette histoire!
– Et que faisaient ces braves gens à quatre dans la même pièce?
– Ils dormaient.
– En effet. D’un sommeil éternel. Mais pourquoi étaient-ils dans la même chambre?
– Par mesure d’économie.
– Ah…
Devant l’air étonné de Mary, Le Meunier précisa :
– Hé, une chambre coûte moins cher que deux…
– Soit… Mais pourquoi étaient-ils à Douarnenez?
– La religion, ma chère, dit Le Meunier en se croisant les doigts.
– Ah… des intégristes? demanda Mary.
– Non, des protestants, tout simplement. Il y a dans notre ville un temple protestant et c’est une religion qui n’est pas courante en Bretagne.
– Terre éminemment catholique comme chacun le sait, compléta Mary.
– Ouais, dit Le Meunier, encore que…
– Encore que quoi?
– Encore que la religion de nos bons douarne-nistes soit un peu plus complexe qu’elle peut l’être ailleurs.
Il regarda Mary :
– Ici, voyez-vous, on est plutôt catho-coco.
Elle soupira :
– On dirait que rien n’est simple chez vous!
– Comme vous dites. Et quand je dis catho, j’entends catho intégriste, tendance monseigneur Lefèvre en plus dur… Et quand je parle de coco, c’est de la période stalinienne…
Mary éclata de rire :
– Le mélange des genres doit être plaisant!
– Plus encore que vous croyez, dit Le Meunier, car tout ceci est teinté de paganisme, vous allez vous en apercevoir au cours des jours à venir.
– Ah, ce fameux Mardi-gras!
– Voilà!
– Eh bien dites donc! fit-elle admirative, en plus on y trouve des polaks protestants?