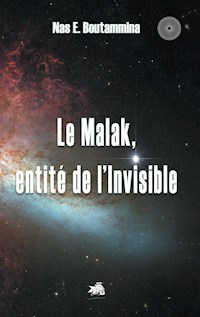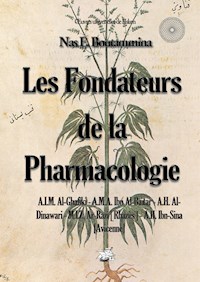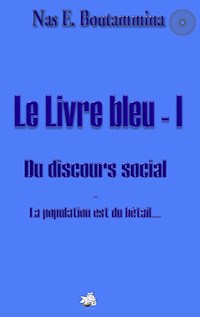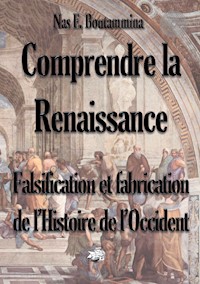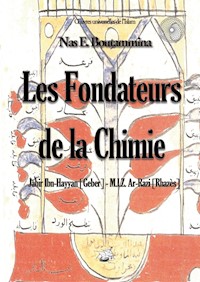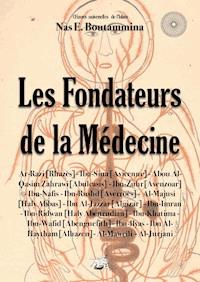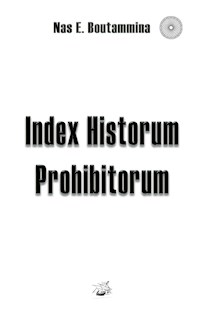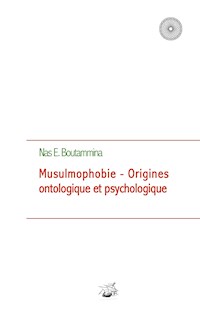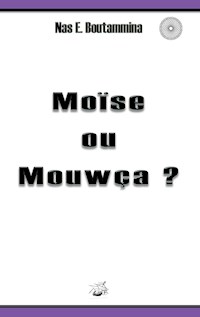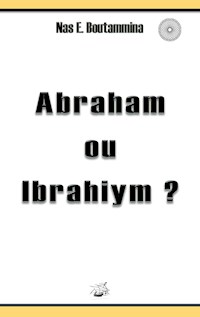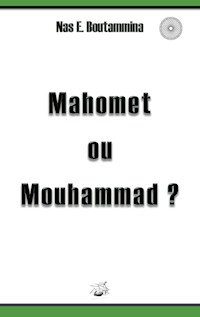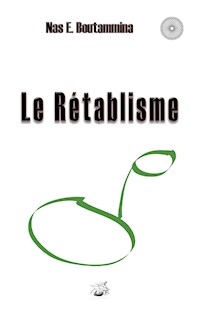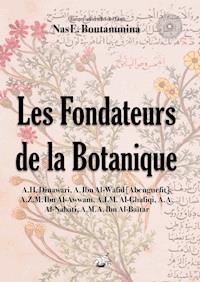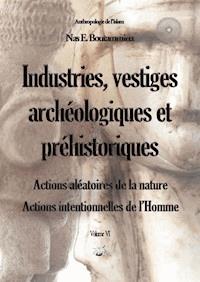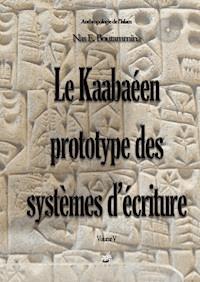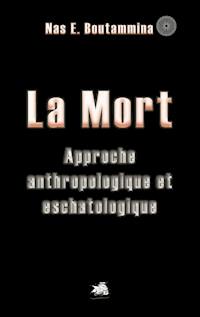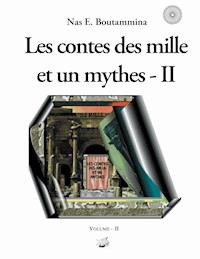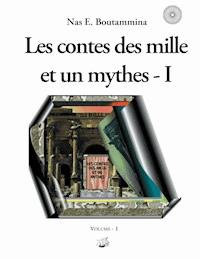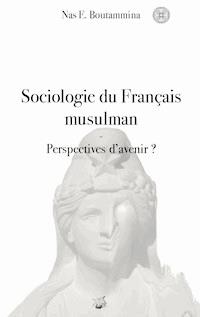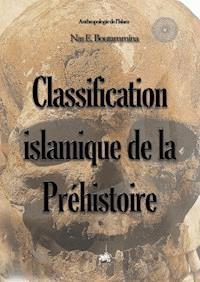
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Il est essentiel de disposer d’une vision historique globale du monde, d’une connaissance générale des disciplines et des thèmes utilisés pour argumenter des théories, d’un jugement impartial, d’une étude de tous les supports historiques et surtout, le point fondamental, de réviser tous les dogmes historiques, préhistoriques, archéo-paléontologiques inculqués sur les bancs des Ecoles, des Universités, des Facultés et des Instituts. L’ambition aventureuse de la Préhistoire, de l’Archéologie, de l’Anthropologie et de la Paléontologie est de défier le temps et l’espace et pire, en retraçant le périple de la Vie, elles se placent en témoin de la Création. Elles créent, tel Dieu, le déroulement de la Vie ! Erigée sur des bases fragiles et errant dans une mauvaise direction, ces diverses disciplines [Préhistoire, Archéologie, Anthropologie, Paléontologie, Histoire, etc.] titubent due à l’ivresse de leur suffisance ou de leur ignorance. Les restes matériels « préhistoriques » [débris osseux, de poteries, d’outils, etc.] demeurent les seuls éléments d'études dont s’accommodent les spécialistes de l’Histoire [Préhistoriens, Archéologues, etc.]. Ces vestiges souscrivent l’imagination fertile de ces derniers à inventer l’origine de l’Homme, à reconstituer son mode de vie et sa métamorphose dans son environnement. Faire des reconstitutions « absolues » des caractères humains sur des restes aussi anciens afin de pratiquer des comparaisons avec les espèces simiennes actuelles relève de l’imaginaire. Cet embarras est à l’origine de débats sur les mécanismes de l’Evolution qui a pour fondement l’interprétation des fossiles conservés dans les schistes de Burgess. L’archéologie est proclamée la science des débris et s’écrit alors aussi rapidement que les débris sont ramenés au jour. En conséquence, une autre classification de la Préhistoire cerne l’Homme dans son ensemble selon un tableau fort différent. Une chronologie de grandes périodes et subdivisions archéologiques révèle, d’une part une aire de distribution géographique, et d’autre part, caractérise la genèse de l’Homme [son développement social, économique et culturel] est minutieusement décrit dans cet ouvrage. Animaliser l’Homme afin de lui soustraire toute notion de responsabilité, c’est égarer l’Humanité. Quoi de plus sournois que de faire croire que l’Homme est un animal descendant d’un Pongidae [grand singe] et que sa présence sur Terre est un accident ! Il est temps de réfléchir et d'inculquer des disciplines en accord avec la raison humaine, de confronter les idées sur des bases scientifiques, de permettre à l’Homme d’appréhender son Histoire et surtout d’échapper à un monolithisme monoscripte des sciences du passé actuellement en vigueur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans les mêmes Editions
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Jinn bâtisseurs de pyramides…? », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2010.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Jinn, créature de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], janvier 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Français musulman - Perspectives d’avenir ? », Edit. BoD, Paris [France],mai 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Judéo-Christianisme - Le mythe des mythes ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Y-a-t-il eu un temple de Salomon à Jérusalem ? », Edit. BoD, Paris [France], aout 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les contes des mille et un mythes - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les ennemis de l’Islam - Le règne des Antésulmans - Avènement de l’Ignorance, de l’Obscurantisme et de l’Immobilisme », Edit. BoD, Paris [France], février 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le secret des cellules immunitaires - Théorie bouleversant l’Immunologie [The secrecy of immune cells - Theory upsetting Immunology] », Edit. BoD, Paris [France],mars 2012.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Le Livre bleu - I - Du discours social », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2014.
N
AS
E.B
OUTAMMINA
, « Le Rétablisme », Edit.BoD,Paris [France],mars 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Comprendre la Renaissance - Falsification et fabrication de l’Histoire de l’Occident »,Edit.BoD,Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, «Connaissez-vous l’Islam? », Edit. BoD, Paris [France], avril 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « LeMalāk, entité de l’Invisible », Edit. BoD, Paris [France], mai 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Jésus fils de Marieou Hiyça ibnMāryām ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Index Historum Prohibitorum », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, «Moïse ou Moūwça ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Mahomet ou Moūhammad ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Abraham ou Ibrāhiym ? », Edit. BoD, Paris [France], juin 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Musulmophobie - Origines ontologique et psychologique », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
Collection Anthropologie de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Apparition de l’Homme-Modélisation islamique - Volume I », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « L’Homme, qui est-il et d’où vient-il ? - Volume II », Edit. BoD, Paris [France], juillet 2015. 2
e
édition.
Collection Œuvres universelles de l’Islam
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Médecine », Edit. BoD, Paris [France], septembre 2011.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Chimie », Edit. BoD, Paris [France], octobre 2013.
N
AS
E. B
OUTAMMINA
, « Les Fondateurs de la Pharmacologie », Edit. BoD, Paris [France], novembre 2014.
Table des matières
Introduction
I - Archéologie, Paléontologie, Anthropologie, Préhistoire et Histoire
A - Archéologie
1 - Récentes dispositions
2 - L'archéologie actuelle
a - La prospection
b - La fouille
c - La description et l’examen
d - L’interprétation ou exposé
3 - L’archéométrie
a - La prospection et l’archéométrie
b - L’analyse et l’archéométrie
B - Paléontologie
1 - Paléontologie stratigraphique
a - Fossiles et stratigraphie
b - Les fossiles et leur signification
c - Les espèces disparaissent
2 - Stratigraphie
C - Anthropologie
1 - Anthropologie physique
a - « Evolution » de l’Homme
D - Préhistoire
1 - Paléo-environnement
a - Habitat préhistorique ?
II - Géologie - Géographie
A - Erosion et isostasie
1 - La déformation des roches
2 -Dynamique terrestre externe
a - Le nivellement par les glaces
b - L’eau de ruissellement [d’écoulement]
c - Les séismes
d - Les séismes et la tectonique des plaques
e - Le raz de marée [tsunami]
§ Les continents
§ Le littoral : une zone tampon entre l’océan et le continent
§ Le système deltaïque
B - Décrypter la Vie sur la terre
1 - Les extinctions en masse [en bloc]
2 - Les disparitions en masse pendant les périodes géologiques
a - Causes de la disparition en masse
C - Ere «Quaternaire »
1 - Les variations du niveau de la mer
2 - Les variations des niveaux lacustres
a - Exemples des lacs d’Afrique orientale
b - Les lacs du Sahara
3 - La flore
4 - L’Homme
5 - Cycles astronomiques et insolation
D - Les modifications du niveau terrestre et aquatique
1 - Les vents et les grandes zones de végétations
a - Zone subtropicale, subarctique et arctique
III - Classification traditionnelle de la Préhistoire
A - Chronologie actuelle des temps géologiques
1 - Le Paléozoïque : ère primaire
a - Le Cambrien
b - L'Ordovicien
c - Le Silurien
d - LeDévonien
e - LeCarbonifère
f - Le Permien
2 - Le Mésozoïque : ère secondaire
a - Le Trias
b - Le Jurassique
c - Le Crétacé
3 - Le Cénozoïque : ères tertiaire et quaternaire
a - Le Paléocène
b - L'Éocène
c - L'Oligocène
d - Le Miocène
e - Le Pliocène et le Pléistocène
B -Classification actuelle de la Préhistoire
1 - Suppositions de la paléontologie
a - L’évolution de la distinction biologique ou biodistinction [biodiversité]
b - Les disparitions de masse est le réacteur de l'Evolution
c - La faune de Burgess
§ Caractéristiques de la faune de Burgess
d - Le Hasard et l'Evolution
§ Un interminable mouvement vers le progrès : l'Evolution ?
§ Théories évolutives
2 - Classificationdes espèces
a - Degrés hiérarchiques
§ Espèces
§ Degrés supérieurs
b - Rapports évolutifs
§ Dénomination
c - Origine de la Vie et l'Evolution
3 - Notions de Préhistoire
a - Le Paléolithique
b - Paléolithique inférieur
§ Abbevillien
§ Acheuléen
c - Paléolithique moyen
§ Moustérien
d - Paléolithique supérieur
§ Classification des industries [ou savoir-faire]
° Prémices de l’art
° Activités des hommes du Paléolithique supérieur
e - Néolithique
§ Le mode de vie au Néolithique
° Graminacée et hybrides
° Instruments lithiques
° Matériels osseux et en bois
° La céramique
§ Succession des cultures
° L’Europe occidentale
° LeNéolithique africain
° Le Sahara -8000 ans
° Afrique saharienne et subsaharienne
° LeNéolithique des régions forestières
f -Chalcolithique
g - Age du Bronze
§ Proche-Orient
§ Europe
° L’art à l’Age du bronze
§ L’Asie du Sud-Est
° Culture Shang
° Cultures limitrophes
h - Age du Fer
§ Sidérurgie
§ Age du fer en Europe
° Vie ordinaire
° Pratiques funéraires
° Pratiques religieuses
§ L’Age du Fer en Asie
§ L’Age du Fer en Afrique
i - Protohistoire
§ Acquis culturels
§ Acquis sociaux
Classification islamique de la Préhistoire
I - Appréhender la Préhistoire
II - Stratégies de la Préhistoire
III - Préhistoire classique : fondements conjecturaux
IV- Classification islamique de la Préhistoire : une autre approche
A - L’Homme « débarque » sur Terre
B - Ethnie - population
1 -Divisions archéologiques
a - Tho-hor
§ Tho-hor Kaabaéen Inférieur : -50 000 ans
° Mode de vie
° Religion
° La religion : garante des conventions
° Écriture
° Système d'écriture complet par excellence
° Alphabet kaabaéen
° Le Kaabaéen inférieur
§ Tho-hor Kaabaéen Supérieur : -45 000 ans
° Mode de vie
° Vie économique
° Lamétallurgie
° Travail du métal
° Art et spiritualité
° Déplacement de populations
° Expansion sur la Terre par mouvement ondulatoire
° Organisation sociale
° Le Kaabaéen Supérieur
b - Tawassou
§ TawassouHedjazéen Inférieur : -30 000 ans
§ Tawassouique Hedjazéen Supérieur : -20 000 ans
° Sidérurgie
° Travail du fer
° Écriture
° Systèmes d'écriture par mots ou logogrammes
° Systèmes syllabiques
° Alphabet
° Modifications alphabétiques
c - Ahtilal : -15 000 ans
§ Ahtilal Birr perse
§ Ahtilal Birr mésopotamien
§ Ahtilal Birr égyptien
§ Ahtilal Birr abyssin
§ Conquête de la Terre
° L’influence du climat
§ Écriture : système limité
§ Pratiques funéraires
§ Religion
° Religions traditionnelles ou croyances Ahtilaliques
° Rituel
° Explication de l’Univers : mythe et mythologie
° Taxinomie des mythes
° Langage et mythe
° Connaissance et mythe
° Le mythe et la société
§ Ligne Ahtilalique
Types d’hominidés
Galets aménagés [Industrie d’Oldoway]
Tableau résumant la classification islamique de la Préhistoire
V -Les découvertes archéo-paléontologiques
Les principaux sites préhistoriques les plus connus
Les « découvertes » fossiles
Les fossiles simiens
A -Découvertes anthropo-paléontologiques
Illustration des« découvertes » fossiles
VI - Les industries lithiques
A -Origine naturelle de l’industrie lithique
1 - Actions thermiques
a - Actions mécaniques
VII - Techniques de datation
A -Datation
1 - La méthode de datation relative
2 - La méthode de datation absolue
a - Archéomagnétisme
b - Dendrochronologie
c - Thermoluminescence
d - Hydratationde l’obsidienne
e - Racémisation des Acides Aminés
f - Résonance de spin électronique
g - Echantillonnage
§ Radiocarbone
§ Potassium-Argon
Conclusion
Index alphabétique
Table des matières
Introduction
La pratique de l'archéologie était l’apanage des antiquaires et de riches collectionneurs qui se bornaient à amasser les œuvres d'art et ne se posaient que peu de questions sur leur signification. Cela perdura longtemps. Ainsi, la genèse de l’archéologie et de beaucoup d’autres champs d’études [anthropologie, paléontologie, etc.] s’est basée longtemps sur l’interprétation et les élucubrations de bourgeois excentriques qui utilisent leur fortune pour des expéditions et des fouilles lointaines forts coûteuses.
Tels des témoins évidents, les professionnels de la préhistoire [préhistoriens, archéologues, anthropologues, paléontologues] expérimentent des techniques de fabrication des « outils» et des « objets » préhistoriques et l'usage qui en était présumé fait. De plus, on calque à la nature de l'habitat présumé préhistorique d’après l’architecture actuelle de certaines peuplades isolées des pays sousdéveloppés [abris de branchages, tente de peaux, etc.].
Il est essentiel de disposer d’une vision historique globale du monde, d’une connaissance générale des disciplines et des thèmes utilisés pour argumenter des théories, d’un jugement impartial, d’une étude de tous les supports historiques et surtout, le point fondamental, de réviser tous les dogmes historiques, préhistoriques, archéo-paléontologiques inculqués sur les bancs des écoles, des Facultés et des Instituts.
L’ambition aventureuse de la paléontologie n’est plus la simple description et restauration des fossiles, mais la reconstitution de l’Histoire de la Vie. Elle défie ainsi, le temps et l’espace et pire, en « retraçant » le périple de la Vie, elle se place en témoin de la création. Elle crée, tel Dieu, le déroulement de la Création !
A la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours, dans de très nombreux pays, la paléontologie s’est transformée et s’est armée d’un arsenal pluridisciplinaire [sciences physiques, biologie, chimie, etc.]. En effet, la perspective de l’Histoire de la Vie l’a considérablement embarrassée car peu de réponses sont satisfaisantes. Erigées sur de piteuses bases et errant dans une mauvaise direction, la paléontologie, l’archéologie, la préhistoire, l’anthropologie et l’histoire titubent due à l’ivresse de leur suffisance.
Entre les années 1970 et 1980, la trouvaille de reliquats fossilisés véhicule l’idée de l’existence du genre Homo en Afrique de l’Est, il y a 1 à 3millions d’années [Ma], voire 4,5 millions d’années, à proximité d’autres formes avancées « d’hommes singes » baptisés Australopithécus [Australopithèques]. Selon les auteurs, ces deux hominidés dégringolent probablement d’un fossile éthiopien : l’Australopithécus Afarensis, âgé de 3 à 3,7 millions d’années [la célèbre Lucy, des débris d’os découverts en 1974].
La Préhistoire est, selon les professionnels de l’Histoire, la période historique de l'Humanité qui s'étale des origines à la venue de l'écriture. On a vulgarisé toute une chronologie dont la première durée s’inscrit sous l’appellation de Paléolithique ou l'âge de pierre [taillée]. Puis d’autres dénominations retraçant le temps comme le Mésolithique puis le Néolithique ; enfin la Protohistoire est la période finale de la préhistoire, celle de l’âge des métaux [du bronze et du fer].
Les restes matériels préhistoriques comme les débris d’os, les poteries, etc. demeurent les seuls éléments d'études dont s’accommodent les préhistoriens. Ces objets souscrivent leur imagination fertile à reconstituer les modes de vie des hommes préhistoriques et leurs métamorphoses dans leur environnement.
La nécessité d’une assise chronologique dans laquelle s’inséreraient les différentes époques préhistoriques s’impose pour les professionnels de l’Histoire. Les fouilles devenant plus confuses, les études d’outillagesplus farfelues, les données plus quantitatives, il était nécessaire d’appeler au secours les sciences de la terre et les sciences de la vie en tant que branches salutaires pour soutenir des commentaires.
Les « découvertes » actuelles remettent constamment en question les convictions au sujet de l'origine de [et] la Vie. La paléontologie qui a eu la prétention de nous apprendre la nature des premières traces de Vie et leur développement demeure désespérément dans les conjectures.
Les fossiles que renferment les roches sédimentaires composent les « archives » de la Vie ancienne et son développement. Les historiens de la Terre que sont les géologues et les paléontologues tentent de les décrypter avec l’acharnement du désespoir.
D’après les spécialistes de l’Histoire et les géologues, en dehors des phénomènes climatiques, le Quaternaire caractérise, le développement du genre humain. Les contraintes infligées aux hominidés par les transformations climatiques survenues pendant cette phase ont sans aucun doute façonné l’Evolution de la lignée humaine.
On prétend que la Sélection naturelle est un processus qui actionne l'Evolution. Si elle était le seul mouvement à organiser l'Evolution, celle-ci serait prévisible. Dès lors, certains spécialistes perçoivent dans l'Evolution une finalité qui a pour résultante triomphante l'espèce humaine. D’autres estiment qu’indéniablement des événements accidentels, imprévisibles, aléatoires, non contrôlés par la dynamique biologique ont modifié le cours de l'Evolution en supprimant de la planète des groupes entiers et obligeant la nature à une réorganisation.
Faire des reconstitutions exactes sur des restes aussi anciens afin de pratiquer des comparaisons avec les espèces actuelles relève de l’imaginaire. Cet embarras est à l’origine de débats sur les mécanismes de l’Evolution qui a pour fondement l’interprétation des fossiles conservés dans les schistes de Burgess.
Aménagé par la communauté scientifique des pays industrialisés, ce système de classement est appliqué aux organismes vivants. Les biologistes pour imaginer les systèmes de classification étudient et comparent les modèles anatomiques, écologiques et comportementaux des espèces actuelles. Ils superposent ces données sur des ancêtres fossiles.
Les scientifiques avouent que l'origine de la Vie estimée être apparue à peu près vers 3,5 milliards d'années demeure un phénomène mystérieux voire inextricable. Dès lors, les théoriciens imaginent que la clé des problèmes de l’Origine de la Vie est le « jaillissement spontané » d'entités chimiques capables de se reproduire. Ainsi, selon les auteurs, peutêtre qu’une opération similaire s'est produite sur la Terre primitive où la surface de la planète submergée formait ainsi une sorte de soupe primitive de composés organiques précurseurs de la Vie ? La Terre primitive apparaît de nulle part emportant avec elle tous les ingrédients qui vont servir un grand dessein : la soupe primordiale. Cette dernière est une expression ésotérique dont personne ne s’en fait une idée. Dans ce décor énigmatique surgit le Hasard qui pense créer des molécules.
Les spécialistes soutiennent que l’Homme découle du groupe des primates, tels que les singes et qu’il est actuellement l'unique représentant d'une famille apparue lors d'une rapide pression évolutive, aidé par le Hasard et la Sélection Naturelle pendant les quelques derniers millions d'années ! On attise cette idée par l’utilisation intempestive de la biologie moléculaire qui avance que notre dernier ancêtre commun avec les Pongidæ [grands singes] existait il y a 6 à 8millions d'années !
Des auteurs exposent leur théorie sur l'émergence de l'espèce humaine et postulent que l’Homme est africain et descendant d’un singe africain. On fait des travaux où on imagine une échelle biostratigraphique pour les grands Mammifères.
Quelle date peut-on fixer à l’apparition de l’Homme ? N’est-ce pas en répondant à cette question, que certains auteurs se sont taillés unvéritable succès ? En entassant pelions sur ossa de millénaires, ils ont ébloui quelques naïfs.
Il est temps de reconsidérer l'étrange classification préhistorique et archéologique actuelle érigée par les archéo-anthropo-paléontologues, préhistoriens et historiens. Etablie pendant la révolution industrielle en Europe, cette division chronologique [paléolithique, mésolithique, néolithique, chalcolithique, âge des métaux, etc.] est une erreur et une source d’intérêts démesurée pour « ceux » qui ont d’autres projets pour l’Humanité.
Dans l’Univers, l’Homme demeure le grand problème par excellence et il est indécemment « résolut » par les « hommes de l’abstrait ». La Préhistoire est surnaturelle car leurs adeptes sont capables de répondre à de bons problèmes par de mauvaises réponses. Dès lors, les fragments d’os appartiennent-il à l’Homme ou au Primate ? Les soins que les préhistoriens et archéologues prennent à déterrer les matériaux, les techniques de nettoyage et de conservation qu’ils utilisent, leur classification, leur numération, leur réparation et leur restauration, en font réellement des artistes.
L’archéologie est proclamée la « science des débris » et s’écrit alors aussi rapidement que les débris sont ramenés au jour !
Selon les auteurs, la taille des galets [ou silex] caractérise l’évolution du Pongidæ jusqu’à l’Homme. Les affirmations d’un travail intentionnel et réfléchi [intelligent] sur de tels matériaux reposent-elles sur des preuves tangibles ?
En conséquence, il est essentiel qu’une autre classification de la Préhistoire qui cerne l’Homme dans son ensemble soit établie selon un tableau fort différent et qui caractérise la genèse de l’Homme et son développement civilisationnel [social, économique et culturel].
I - Archéologie, Paléontologie, Anthropologie, Préhistoire et Histoire
A. R. Ibn-Khaldun1, père fondateur des Sciences Humaines définit la notion générale de ces disciplines : « Les caractéristiques internes de l’Histoire sont l’examen et la vérification des faits, l’investigation attentive des causes qui les ont produits, la profonde connaissance de la façon dont les évènements se sont déroulés et dont ils sont nés.
L’Histoire n'incarne que le récit des faits qui sont en relation avec une époque distincte ou avec une population distincte. Dès lors, l’historien doit nous procurer des notions générales sur chaque pays, chaque peuple et chaque époque, car telle est la base ferme sur laquelle il doit ériger. Ainsi, rendra-t-il compréhensibles les informations qu’il va produire.
En effet, ne pas imposer à un examen vigilant et à une critique intelligente les évènements de l’Histoire, c’est donc s’éloigner de la vérité pour errer dans le champ des conjectures et des inexactitudes ».
A.R. Ibn-Khaldun déclare : « Le mensonge s’engouffre naturellement dans les récits historiques ; il est indispensable de signaler ici les causes qui inévitablement l’engendrent. Mentionnons parmi celles-ci :
Le penchant des hommes à certaines positions et doctrines. Tant que l’esprit maintient son impartialité, il étudie le récit qui lui est présenté et l'examine avec toute l’attention que le sujet réclame. Ainsi, il parvient à discerner la fausseté ou la véracité du renseignement. À partir du moment où il s’est laissé influencer par son inclination à certains jugements et doctrines, il saisit sans hésitation le récit qui s'accommode avec elles. Cette attitude à cet attachement lance un voile sur la clairvoyance de l’intelligence. Elle le détourne de l’observation des choses et de leurs examens attentifs, de manière à ce que ce mensonge admis, on le transmet aux autres.
La confiance que l’on place à tort dans la parole de ceux qui les ont communiqués. Pour prévenir ceci, le recours au tahdil et au tadjrib
2
est essentiel.
L’ignorance de l’objectif. Les narrateurs ignorant dans quel but les choses qu’ils ont examinées ou dont on leur a parlé ont été produits, relatent chaque fait comme ils supposent le percevoir. Ils se laissent égarer par leur imagination et s'écartent de la vérité.
La commodité de l’esprit humain à croire qu’il détient la vérité. Cela arrive fréquemment et l’origine en est généralement un surcroît de confiance dans les individus qui ont transmis les renseignements.
L’ignorance de la conformité entre les faits tels qu’on les appréhende et les circonstances réelles. Les éléments des récits subissent des remaniements et des altérations. Les faits sont rapportés tels qu’on les a compris, mais les informations qui les relatent y ont subi dans l’esprit de l’intéressé des transformations qui s'écartent de la vérité.
Le penchant habituel des hommes à conquérir la faveur des personnages célèbres et élevés en dignité. Ils se servent alors de louanges, d’éloges et enjolivent les évènements en les propageant. Ces discours obtiennent bien une large publicité, mais n’en sont pas plus vrais pour autant. En conséquence, les esprits sont enthousiastes par l’aspiration à être glorifiés et les hommes mettent leurs ambitions en ce bas monde : titre et richesses. Habituellement, ils sont peu zélés à se distinguer par le mérite et sont peu enclins à côtoyer les gens qui en possèdent.
Parmi les causes qui nécessitent le mensonge : l’ignorance de la nature des choses que la civilisation engendrent. Tout ce qui survient, soit par essence, soit à la suite d’une influence extérieure dispose d’un caractère qui lui est propre, intrinsèque ou extrinsèque dans les circonstances qui le conduisent. En conséquence, celui qui entend les récits, les informations, etc. et qui sait d’avance les caractéristiques qu’exposent dans la réalité les faits ; ainsi que ce qui les détermine obligatoirement, détient d’une aide au moyen de laquelle il peut vérifier les rapports en question, en distinguant le vrai du faux.
Si tel est la situation des choses, voici la formule qu’il est nécessaire d’utiliser pour distinguer dans les récits la vérité de l’erreur. Méthode fondée sur l'évaluation du possible et de l’impossible, elle consiste à étudier la société humaine, c’est à dire la civilisation. Elle permet de différencier d’une part, ce qui est indissociable à l’essence et à la nature de celle-ci ; d’autre part, ce qui est fortuit et dont on ne doit pas tenir compte, puis à reconnaître ce qui est impossible. Si nous accomplissons cela, nous avons un procédé sûr au moyen d’une méthode démonstrative pour séparer la vérité de ce qui est vain et le vrai du mensonge. Ainsi, cela ne laisse aucune prise au doute. Si quelque fait était arrivé dans la société même, nous concéderons à les tenir pour vrai ou de le rejeter comme faux. Donc, nous possédons un instrument qui permet d'estimer les faits avec exactitude et peut servir aux historiens dans leurs écrits lorsqu’ils tentent d’avancer sur la voie de la vérité ».
A - Archéologie
Le terme Archéologie naît au XIXe siècle du jeux de mots grecs, archaios « ancien » et logos « discours ». Ainsi, en s’aidant de certaines disciplines scientifiques, c’est le discours sur les cultures et les modes de vie du passé par l'analyse de certains débris matériels. L'archéologie se sert actuellement de la somme des vestiges disponibles [œuvres d'art, dépôts de détritus, ossements fossiles, grains de pollen, etc.]. Elle ne se limite ni à des périodes géologiques [de l’origine de l'homme à l'époque moderne] ni à des espaces géographiques.
Conséquemment, l'archéologie associe la paléontologie, l'anthropologie, l'ethnologie, la géologie, l'écologie, les sciences physiques, l'histoire de l'art, etc. afin d’étayer son discours pluridisciplinaire. Les archéologues utilisent des méthodes de datation établies par des chercheurs d'autres disciplines : la datation par le carbone C14 mise au point par des spécialistes de la physique nucléaire,la datation stratigraphique par des géologues, l’appréciation des faunes fossiles par des paléontologues, etc., pour construire une chronologie. Quant aux procédés issus de la sociologie, de la démographie, de la géographie, de l'économie et des sciences politiques, les archéologues s’en servent pour reconstituer les modes de vie du passé.
A l’origine [qui demeure encore une tradition] la pratique de l'archéologie fut l’apanage des antiquaires et de riches collectionneurs qui se bornaient à amasser les œuvres d'art et s’interrogeaient peu sur leur signification. Cela perdurera longtemps.
Ainsi, la genèse de l’archéologie et de beaucoup d’autres champs d’études [anthropologie, paléontologie, etc.] est fondée sur l’interprétation et les élucubrations de bourgeois excentriques qui utilisent leur fortune pour des expéditions et des fouilles lointaines forts coûteuses.
Ne négliger aucune des sources d'informations disponibles pallia l’absence de documents écrits et permit, au début du XIXe siècle, à l'archéologie d’acquérir de nouveaux moyens par l'utilisation des études des cultures préhistoriques.
C. Thomsen, en 1819, afin de répertorier les objets trouvés dans des fouilles fournit le système des trois âges : âge de Pierre, âge du Bronze et âge du Fer. Fraîchement et hâtivement, on les attribue aux premiers hommes.
J. Boucher de Perthes, en 1844, mis à jour et étudie des pierres « primitives » réunies à des restes d'animaux fossiles dans les dépôts gravillonnaires de la vallée de la Somme, près d'Abbeville. Ses travaux s’aidant des progrès des géologues de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. L’auteur décide du concept de l'existence d'êtres humains antédiluviens par référence aux textes bibliques.
C. Lyell3 affranchit du joug chronologique biblique l'étude de l'histoire de la Terre qui la limitait à une durée de 6 000 ans en la débutant avec la création divine en 4004 av. J.C.
Ch. Darwin et A. R. Wallace, leurs théories respectives sur l'évolution des êtres vivants, avec des implications incontestables pour l'évolution culturelle accrurent encore l'importance accordée à la chronologie et à la stratigraphie.
G. de Mortillet par ses travaux sur le Paléolithique établit la chronologie de la préhistoire.
La mode de la fouille prit de l’essor. De nombreuses fouilles s’effectuèrent au Proche-Orient et en Europe. C’est le cas de P. E. Botta à Ninive et à Khorsabad [1843-1845], H. Schliemann à Troie [1871] et à Mycènes [1876], A. Mariette en Égypte [1851-1881] ; l'École française d'Athènes à Délos et à Delphes. J-F. Champollion déchiffre des hiéroglyphes égyptiens de la pierre de Rosette [1822] et H.C. Rawlinson l'écriture cunéiforme persane de l'inscription de Behistun. Tout cela contribua à donner une base historiographique à l'étude des cultures correspondantes.
1 - Récentes dispositions
Déterrer s’affirme comme un art. Ceci est du à la mise au point, au début du XXe siècle, de méthodes stratigraphiques soigneuses et de techniques de fouille crédibles à partir des travaux de F. Petrie en Égypte et de R. Koldewey à Babylone.
En Méditerranée orientale et au Proche-Orient, on mena des recherches importantes. L'Oriental Institute of Chicago entreprit de très nombreux chantiers de fouilles, tels ceux de Persépolis et de Megiddo.
L. Woolley fit des fouilles à Ur, A. Evans à Cnossos, H. Carter en Égypte, A. Parrot à Mari et C. Schaeffer à Ougarit. Ils mirent au jour divers produits. En Europe, le projet le plus important fut sans contexte les fouilles de l'agora d'Athènes par une équipe américaine.
Les méthodes de collecte d'informations sur le passé sont améliorées, comme la photographie aérienne pour la recherche et l'exploitation des sites et l'examen du pollen pour la reconnaissance de la végétation. L'invention de la datation au carboneC14 par le chimiste W. Libby révolutionna l’archéologie en lui procurant la possibilité d’estimer une date à partir de matériaux organiques et donc, pour la première fois, une chronologie. Mais celle-ci demeure néanmoins très peu fiable.
2 - L'archéologie actuelle
Une nouvelle dimension perça la procédure des fouilles et leur interprétation avec A. Leroi-Gourhan pour les sites « paléolithiques » d'Arcy-sur-Cure et de Pincevent ; ainsi que la « nouvelle archéologie » de l'école nord-américaine. Dorénavant, les archéologues devancent l'examen et la classification de divers objets pour anticiper des opinions sur les prétendus « êtres » qui les ont réalisés. Aussitôt, ils s’instruisent de leurs hypothétiques modes de vie. Ne plus se contenter de les décrire et de les dater, mais participer pleinement à la dynamique « créationniste », c’est interpréter comment et pourquoi se sont déclenchés les changements culturels. En conséquence, on pénètre dans l’univers de la spéculation et de l’imagination. Une juxtaposition d’épisodes et d’historiettes fantaisistes prend forme.
Quatre phases subdivisent l'archéologie : la prospection, la fouille, la description et l’examen, l’interprétation ou exposé.
La diversité des démarches intellectuelles prend des tendances différentes. Beaucoup, peu enclins à réviser les méthodes acquises de leurs prédécesseurs, s’efforcent de s’en remettre au hasard du soin d’en montrer la légitimité. Certains, inquiets de l’avenir de leur discipline s’activent à s’ériger un esprit plus scientifique. Pour cela, ces derniers empruntent aux sciences expérimentales des procédés et des démarches qu’ils transforment avec plus ou moins de bonheur ; mais la plupart, sont ballottés entre les deux tentations.
La prospection qui recherche et borne les vestiges ; la fouille qui les dégage de leur gangue de sédiments ; l’examen qui les décrit et tente de les commenter. Enfin, la publication qui diffuse l’ensemble des résultats à la communauté scientifique puis du grand public.
Les procédés utilisés diffèrent d’une étape à l’autre, mais la sélection qui en est faite et le commentaire qui en émane génèrent des problèmes méthodologiques qui sont toujours les mêmes.
a - La prospection
Une étude des sources d'information disponibles [documents anciens, travaux historiques modernes, études géologiques, etc.] précède parfois le travail sur le terrain. Les découvertes accidentelles, les recherches historiques et les explorations à pied sur le terrain dirigent habituellement les archéologues. Actuellement, la photographie aérienne devient une méthode intéressante d’inspection.
De nouvelles techniques sophistiquées renforcent l'arsenal de l'archéologue, tels que des méthodes électromagnétiques utilisant des ondes radar pénétrant le sol, la mesure de la résistivité électrique, la thermographie par scanner décelant les radiations infrarouges, les magnétomètres à protons et la télédétection par satellite. Quant à l'archéologie sous-marine, l'emploi du sonar et de capteurs électroniques a permis l’exploration des fonds sous-marins et ainsi, de trouver des objets et des bateaux engloutis. Pour les vestiges archéologiques enterrés, l’objectif est de repérer des endroits qui offriront des dépôts dont la stratigraphie n'a pas été chambardée [disposition extrêmement rare].
Ainsi, les couches sédimentaires échafauderont une sorte de chronologie et selon une quantité de renseignements disponibles, d’imaginer le système culturel intégral correspondant à chaque niveau.
Beaucoup de sites archéologiques sont décelés accidentellement lors de travaux de terrassement. Aussitôt, on ordonne une « fouille de sauvetage » pendant une certaine période afin de rassembler le maximum d’éléments. La reprise des travaux ou son classement comme site historique dépend de l'importance présomptive du gisement ainsi découvert.
b - La fouille
Noter le plus grand nombre possible d'objets et d'observations contextuelles a lieu essentiellement lors de la collecte en vrac des données pendant la fouille. Paradoxalement, la recherche archéologique c’est la destruction [par la fouille] de l'objet qu'elle examine. Dès lors, toute information laissée de côté lors de la fouille est irrémédiablement perdue.
La position de chaque objet lié ou non à l'activité humaine [os animal ou humain, éclat de galet, trou de poteau, morceau de charbon de bois, trace de cendres, etc.] est consignée. L’endroit et chaque élément sont marqués par un numéro et un croquis sur un plan ; puis, une photographie de l'ensemble du site parachève chaque degré de la fouille.
L’environnement [zoologique, botanique et géologique] présumé correspondre aux diverses époques d'occupation révélées au premier abord par les fouilles souscrira à ajuster la présentation de la nature du sol et du climat.
c - La description et l’examen
Orienter la fouille doit s’effectuer normalement par des observations préliminaires. Autrement, elles s’exposent, par exemple, à des omissions dans l’estimation de la chronologie ou dans la distribution spatiale des objets. Cependant, l'examen se réalise en laboratoire bien après la fouille. Il a deux objectifs, l'un chronologique, permettant de forger la datation « absolue ou relative » du site et de l’ajuster selon les cultures habituelles ; l'autre contextuel, agençant les données dans leur emplacement culturel pour discerner les modes de vie et les comportements.
Diverses méthodes de datation comme le carbone C14, la dendrochronologie, la thermoluminescence ou le paléomagnétisme peuvent ériger une sorte de chronologie « absolue ».
On reconstitue témérairement le mode de vie et l'environnement des occupants du site par des contextes culturels et écologiques. Chaque objet passe alors de marqueur chronologique à un résultat d'une activité humaine.
Par une approche pluridisciplinaire, les archéologues énoncent avec audace l’endroit de la provenance des matériaux nécessaires à la production de l'objet [en ce qui concerne du silex ou galet d'une pointe de flèche, de l'argile d'une poterie, des pigments d'une peinture rupestre ou du métal d'une pièce de monnaie]. Plus fort encore, cette démarche leur permet même de fabriquer des corrélations qui « existaient » entre la culture étudiée et son écosystème [emploi des ressources, déplacements, etc.]. Dès lors, reconstituer des circuits d'échanges entre groupes humains est une aventure intellectuelle forte agréable. Par la composition et la distribution des déchets [restes d’« outils », ossements, morceaux de poteries, etc.], on véhicule des renseignements sur l'aménagement de l'habitat [zones d'activité, de circulation ou de repos]. Au même titre que les traces de feu ou les débris architecturaux, on évoque la caractéristique saisonnière ou permanente de l’habitation. Les rites funéraires et les reliquats des « tombes » sont interprétables par les «arts-chéologues [ou « artisteschéologues »]» en termes de pratiques religieuses, de statut social, de parenté.
d - L’interprétation ou exposé
L'explication des indications recueillies lors de la fouille s'opère à plusieurs échelons. Au niveau du site aussi pauvre soit-il en vestiges, on se lance dans un déchiffrement à savoir quelles étaient les activités d'un groupe d’individus donné à une époque donnée. Quelques individus pendant quelques heures si c’est une pause de chasse « paléolithique » ou des milliers d'individus pendant des décennies s'il s'agit d'une ville de l'Antiquité !
Tels des témoins évidents, les professionnels de la préhistoire inventent expérimentalement des techniques de fabrication des outils et des objets d'art, l'usage qui en était présumé fait ; l'hypothétique origine et le mode supposé d'obtention des matériaux ainsi que les soi-disant procédés de chasse ou de culture. On calque à la nature de l'habitat présumé préhistorique d’après ce que l’on connaît de l’architecture actuelle de certaines peuplades isolées des pays sousdéveloppés [abris de branchages, tente de peaux, etc.] ; à sa disposition et à ses agencements intérieurs [endroit du foyer, lieu d'activités permanentes, etc.], aux rituels funéraires, aux vestiges humains enterrés [ils le sont tous] individuellement ou collectivement, avec ou sans objets.
A la dimension régionale, le rapprochement de différents sites permet de produire des chronologies conçues sur l'évolution de l'environnement et des activités humaines. Cela demeure néanmoins vague et incomplet car limité dans l’espace et bien entendu dans le temps [on découpe le temps et on choisit le plus adéquat]. On peut reconstituer des routes de migrationou des circuits commerciaux ou en suivant la diffusion de techniques, de styles ou de matériaux à partir de centres de production ou de foyers culturels.
L’assemblage de toutes ces spéculations permet d’échafauder des hypothèses aléatoires sur des faits invérifiables car il aurait fallu être témoin ou posséder des témoignages impartiaux. Les traces archéologiques à proprement parler ne sont que des discours plus ou moins éloquents compilés actuellement par des procédés interdisciplinaires afin d’habiller «scientifiquement » la coquille vide archéo-paléontologique.
Conséquemment, il est essentiel de disposer d’une vision historique globale du monde, d’une connaissance générale des disciplines et des thèmes utilisés pour argumenter des théories, d’un jugement impartial, d’une étude de tous les supports historiques et surtout, le point fondamental, de réviser tous les dogmes historiques, préhistoriques, archéo-paléontologiques inculquées sur les bancs des écoles, des Universités, des Facultés et des Instituts.
3 - L’archéométrie
D’une façon générale L’archéométrie définit toutes les études cherchant à s‘appuyer les techniques scientifiques au domaine archéologique. L’objectif de ces méthodes est de procurer des données quantitatives et objectives aptes à établir le positionnement et la dimension des gisements, à essayer de dater les occupations ; l’origine des mobiliers, l’évaluation des techniques anciennes et le milieu des sites.
Liée aux sciences exactes, l’archéométrie s’est dirigée dans quatre voies importantes : la prospection, la datation, l'examen des matériaux et le traitement des données. Ajoutons à ces méthodes d’observations celles qui sont attachées à l’environnement [la faune et la flore], à l’anthropologie, etc. Dès lors, la collaboration d’archéologues repose sur divers spécialistes au sein d’équipes pluridisciplinaires. Dans cette coopération en relation avec les archéomètres et d’après les potentialités techniques, l’archéologue se définit une problématique. On définit un programme de mesures et après son exécution, l’exploitation des données est accomplie parallèlement par les archéologues et les archéomètres. Ces derniers sachant bien les limites d'explication.
On retrouve là le danger lié à la science archéologique qui assure seule la constitution des échantillonnages ou l’interprétation des mesures. De même, il est tout aussi périlleux que l’archéomètre définit seul ses objectifs de recherche.
La quête de techniques scientifiques par l’archéologie, c’est l'apparition de nouvelles méthodes d’analyse, de datation ou de prospection après 1945 précipitant l’éclosion de l’archéométrie. L'accroissement des connaissances des phénomènes radioactifs a eu pour conséquence la datation par le radiocarbone ou par thermoluminescence, l’analyse par activation, etc. Par ailleurs, l’amélioration des techniques radioélectriques et électroniques a débouché sur la conception d’appareils divers de prospection, de traitements des données de base.
a - La prospection et l’archéométrie
L’archéologie est vorace de techniques modernes pour déceler, à partir de la surface du sol, des ruines enfouies dans le sous-sol proche. Des opérations réalisées généralement suivant un quadrillage régulier appliqué horizontalement sur le sol, donnent des cartographies faciles à lire. Habituellement, on construit des courbes de valeur analogue à la grandeur mesurée, similaires aux courbes de niveau en topographie. Ces courbes sont notées automatiquement selon un traitement direct des données rédigées sur le terrain.
Une panoplie large de détecteurs de métaux est proposée par les méthodes électromagnétiques, procédés utilisant les sources à grande distance. Ainsi, la méthode Slingram permet de mesurer conjointement la conductivité électrique et la sensibilité magnétique. Elle est meilleure que la méthode magnétique car elle procure immédiatement une valeur de la susceptibilité apparente du sol. Lorsque l’absorption du signal électromagnétique est faible les radars sol acceptent d’avoir une reproduction fine de la structure verticale des sols.
Dorénavant, certains appareils réalisent régulièrement ces mesures avec différentes dispositions quadripolaires des électrodes. Ainsi, un courant électrique est administré par deux électrodes, et la différence de potentiel, due à la conductivité du sous-sol, est inscrite aux bornes de deux autres électrodes. La réalisation est difficile, longue et les effets sont perturbés par les conditions climatiques. Depuis que l’enregistrement automatique des paramètres est pratiqué sur des quadripôles mobiles en contact continu avec le sol, le procédé donne des résultats. Des prospectives d’application récente utilisent des électrodes électrostatiques [sans contact].
L’observation de structures archéologiques enfouies a permis le développement des magnétomètres à protons qui accèdent à la sensibilité de 0,1 nanoTesla, c’est à dire 2millionièmes du champ magnétique terrestre [C.M.T.]. En conséquence, la différence des susceptibilités magnétiques du sol et du sous-sol, évaluée change localement le C.M.T. Le calcul précis et méthodique du champ total local décèle ces anomalies attachées aux structures. Les explications des cartographies sont habituellement délicates. Les compositions d’argile cuite pourvues d’une importante sensibilité magnétique, comme les fours, peuvent être localisées avec ces magnétomètres. Il existe des appareils performants qui accèdent à une sensibilité de 0,2 milliardièmes duC.M.T.
La diffusion de l’aviation de tourisme et le développement d’émulsions photographiques hypersensibles dans les spectres visibles et infrarouges sont à la source de l’évolution de la prospection aérienne. Celle-ci voit une continuation plus technique dans la prospection thermographique. L’analyse dans certaines conditions pédologiques, climatiques, horaires et par un scanner de l’émission infrarouge du sol, on peut mettre en évidence l’existence de structures archéologiques.
Une technique qui n’a connu quelques bonheurs que pour l’exploration de zones habitées ou d’aires de nécropole d’après des cartographies de sels de phosphore est la prospection chimique. Des tentatives ont été expérimentées en vue de la prospection gravimétrique, mais la faible dissemblance des masses spécifiques et la sensibilité peu performante des appareils de mesure limitent son emploi au domaine archéologique.
b - L’analyse et l’archéométrie
Selon les professionnels de l’histoire, les premiers outils de l’homme préhistorique étaient des pierres dont la consistance pouvait couper des matières plus tendres. Avec la « survenue » du feu, il a travaillé les argiles, il les a dégraissées avec d’autres minéraux, afin de parvenir aux poteries. Toujours d ‘après les auteurs, il s’est servi des pierres pour réaliser les foyers, ériger des monuments, construire des édifices. La période historique, il s’est servi de différents minéraux pour l'équipement des habitats, à leur décoration. On imagine à partir de là l’importance à accueillir les matériaux minéraux archéologiques ; de plus ils sont le mieux conservés. Conjointement, les éléments métalliques [ustensiles, monnaies, etc.] présentent un éventail d’étude analogue, chronologiquement plus limité mais comprenant des questions technologiques et économiques fortes intéressantes.
Des migrations de populations, des relations entre des habitants, des aires de distribution ou d’influence, des données économiques et technologiques, etc., peuvent les mettre en évidence ; de plus, que les procédés les plus modernes d’analyse promettent de très grandes sensibilités. L’évolution de l’archéométrie se joint ainsi à la révolution due aux techniques d’analyse physique en chimie.
En face d’une difficulté d’identification, on affirme que tout procédé d’analyse assez discriminant peut être admis. Ainsi, les courbes de thermoluminescence étaient utilisées pour ranger en groupe des pierres marbrières. Depuis peu, apparaît une modification centrée vers des moyens d’analyse plus performants. Néanmoins, le microscope optique témoigne d’un intérêt réel.
On a tenté par l’appel aux procédés d’analyse chimique d'acquérir des classifications significatives. Pour les obsidiennes, par exemple, où des changements de concentration des éléments alcalins ou alcalinoterreux ont été observés, on a employé un combiné des analyses chimiques, des densités et des indices de réfraction. D’autre part, l'étude chimique des métaux ou de leurs alliages donne d’importants renseignements à la connaissance de la métallurgie antique.
Le passage fut prompt quant à l’étude des éléments à l’état de traces pour une meilleure détermination des matériaux minéraux ou métalliques. Dorénavant, des concentrations de quelques fractions par million [ppm] peuvent être mesurées. Est-ce que pour autant cela nous informe de l’état de l’échantillon : artéfact ou naturel ?
Identifier un produit lithique homogène à une source géologique constitue l’obstacle le plus commode, aucun mélange ou alliage ne venant embarrasser l'explication des examens. Pourtant, disposer d’un élément élaboré embarrassant est plus pratique qu’une mine ancienne reconnue. Les investigations dépendent de la dissémination ou de la concentration des éléments chimiques à confronter et de leurs nombres examinés. Les collectes, plus ou moins importantes offrent plus ou moins de sens à la conclusion, encore faut-il que l’archéomètre se garde des « coïncidences » heureuses.
Aujourd'hui, différentes techniques sont utilisées pour tenter de dénouer des problèmes archéologiques. Par le procédé de la spectrographie optique d’émission, l’échantillon transformé en poussière est vaporisé dans un arc, l’émission de chaque élément est interprétée par des raies. Des progrès dans les années quatre-vingts proviennent de l’utilisation de lasers ou de sources à plasma. Ainsi, la spectrométrie d’absorption atomique est basée sur l’absorption sélective spectrale de la lumière par des atomes libres de l’échantillon étudié.
La spectrométrie de fluorescence X, quant à elle, sa détection limite arrive 1 à 6 ppm pour approximativement tous les éléments allant du fluor à l’uranium. Ce procédé est non destructif, cependant il exige des échantillons de grande taille, ce qui est exceptionnel pour la quasi-totalité des échantillons intéressant la paléontologie humaine. On essaye malgré cela d'user de microscopes électroniques et d’excitateurs protoniques allant jusqu’à réduire les tailles des échantillons. En définitive, dans l’analyse par activation, on soumet pendant une certaine durée le spécimen à un intense faisceau neutronique ou protonique qui va constituer ainsi des isotopes instables d’une variété d’éléments.
Pendant la décroissance radioactive de ces isotopes, le spectre de rayons δ [gamma] ainsi émis peut être confronté à des tables d’émission de référence. On soutient que les concentrations décelables sont parfois inférieures au ppm.
Les moyens les plus employés sont pour la méthode la plus sensible, l’activation neutronique. La fluorescence X est d’une sensibilité appréciable. Selon l’intérêt et la cuisine recherchés et c’est là, la problématique archéologique, celle-ci opte pour telle ou telle technique, au vu des discriminations nécessaires. On imagine pour la cause des échantillons étalons qui sont sans aucun doute essentiels pour comparer les résultats obtenus avec différentes méthodes d’analyse.
B - Paléontologie
La Paléontologie est l'interprétation audacieuse de la vie dans les temps préhistoriques par l'examen des restes fossiles. Les paléontologues se hasardent par l'étude des fossiles à retracer l'histoire de l'évolution ou transformation des espèces vivantes ou disparues. Ils octroient un âge aux roches par l’utilisation de différentes méthodes de datation. Afin d’établir des cartes géologiques, ils compilent des informations sur la répartition des fossiles dans ces couches rocheuses. C’est au début du XIXe siècle, par l’utilisation des travaux de la géologie moderne que les fossiles s'expriment. Selon les écrits bibliques et jusqu’au XVIIIe siècle, il était communément admis que les fossiles étaient des reliques d'animaux ayant vécu avant leDéluge.
1 - Paléontologie stratigraphique
La paléontologie stratigraphique est une branche importante de la paléontologie. Ainsi, il est plus rarement identifié à la chrono stratigraphie ou stratigraphie pure. Vers le XIXe siècle, une méthode paléontologique apparaît et qui tente de fixer l’âge des terrains selon les fossiles qu’ils retiennent et les correspondances qu’ils agencent. Notons les travaux de G. Cuvier4 [1769-1832] sur les vertébrés, de C. Lyell5 [1797-1875] sur les invertébrés, de J. Hutton6 [1726-1797], de M.V. Lomonossov [1711-1765]. La notion de succession atteint son paroxysme avec A. Dessalines d’Orbigny7 [1802-1857] qui découpe les dépôts fossilifères en vingt-huit étages distribués en groupes hétéroclites et définis par un univers organique autonome.
Les idées de « fossile caractéristique» et de « zone » que bon nombre de géologues adoptent encore se développent depuis le début du XXe siècle. On distingue un excellent fossile caractéristique par rapport à un mauvais fossile appelé encore « fossile de faciès ». Ce dernier doit posséder un accroissement vertical réduit [temps de vie brève], un accroissement horizontal large, une grande autonomie en regard des faciès. Il doit être en nombre important et en excellent état pour aider à sa détermination [graptolites, trilobites, inocérames, échinides]. Un mauvais fossile ne montrera pas ces propriétés [conditions de vie courtes : température, profondeur, milieu lagunaire, récifal]. Dorénavant, les auteurs retiennent essentiellement le concept d’association caractéristique par opposition au fossile caractéristique. Cette nuance ramène nécessairement à celle de zone qui paraît d’abord être une unité chronologique. Ainsi, la durée qui en découle est plus petite que celle de l’étage déterminé par des fossiles ou d’associations caractéristiques. Par extension, c’est également une unité bio stratigraphique, quand ce sont des formations contenant certains aspects zonaux [faunizone, de bio zone, etc.].