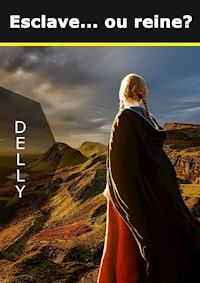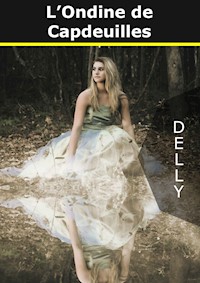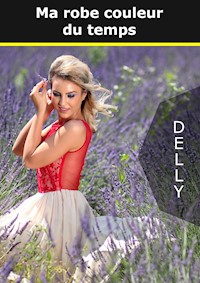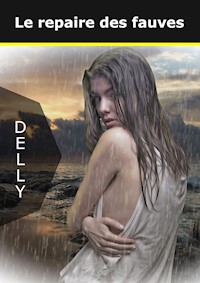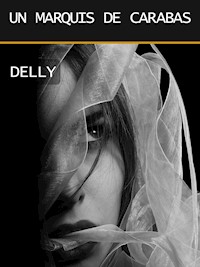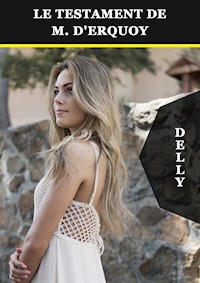2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il est superbement, virilement beau. Ses traits n'ont pas la perfection classique, mais ils ont bien mieux que cela : un charme d'expression, de vie, que je n'ai jamais rencontré encore. Je ne crois pas qu'il soit possible d'imaginer un homme plus séduisant. Il a tout pour lui. C'est le vrai prince charmant. Mais je n'ai pas l'esprit romanesque. Si peu expérimentée que je sois, je me doute que les petites bourgeoises comme moi doivent se défier des princes charmants - surtout quand ils sont de véritables princes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dans l'ombre du mystère
Pages de titrePremière partieDeuxième partieTroisième partiePage de copyrightDelly
Dans l'ombre du Mystère
Première partie
4 juillet. – Je suis reçue au brevet supérieur, avec félicitations. En dépit de la lourde chaleur d’orage, j’étais plus légère en sortant de la préfecture, et c’est d’un pas alerte que j’ai gagné la rue Saint-Louis. Nous habitons là une petite maison étroite, décrépite à l’extérieur, mal agencée intérieurement, qui date du règne de Louis XV, et semble n’avoir reçu depuis lors qu’un minimum de réparations indispensables. Bertha, la servante, m’ouvrit la porte jadis brune, devenue d’une indéfinissable nuance. Elle me demanda, sans que d’ailleurs sa voix, empâtée par l’accent germanique, et son large visage placide témoignassent d’aucun intérêt :
– Eh bien ?
Tranquillement, comme elle, je répondis :
– Reçue, Bertha.
Elle murmura un : « Ça va bien ! » Et je montai l’escalier usé, qui craquait sous mes pas, j’entrai dans le salon, grande pièce à boiseries grises, à peine meublée de quelques sièges, d’une table et d’une armoire. Près de la fenêtre ouverte, ma tante tricotait. Elle leva la tête et demanda :
– Avez-vous réussi, Odile ?
– Très bien, ma tante, avec félicitations du jury. Je suis contente, mais j’ai bien chaud !
Je m’assis en face d’elle et enlevai vivement mes gants, mon chapeau. Elle me regardait, en faisant glisser l’une contre l’autre ses longues aiguilles. Ses yeux pâles clignotaient un peu, sous ses paupières ridées. De nouveau, je ressentis cette impression désagréable qui m’a plus d’une fois saisie, quand ce regard se pose sur moi. Très droite par nature, j’ai la sensation d’un mensonge se cachant sous la douceur étudiée de cette physionomie, de cette parole lente, teintée d’accent allemand. Jamais je n’ai aimé Mme Holden. Et j’ai l’intuition qu’elle, non plus, ne m’aime pas. Nous vivons néanmoins en bons termes, mais froidement, sans intimité. Et si parfois l’impression d’antipathie s’augmente chez moi, j’ai toujours réussi à n’en laisser rien paraître. Car enfin, quelle que soit la nature de ma tante, je lui dois de la reconnaissance. Elle m’a recueillie tout petit bébé, à la mort de mes parents, et m’a élevée de ses deniers, bien qu’elle soit peu fortunée. Voilà des choses qui ne se peuvent oublier, quand on a un peu de noblesse dans le cœur. Aussi me suis-je toujours efforcée d’entourer d’attention Mme Holden, surtout depuis deux ou trois ans où je la vois vieillir, devenir rhumatisante. En outre, elle est la seule parente qui me reste, seconde considération propre à m’inciter aux devoirs qui ne me sont pas toujours faciles à son égard, je l’avoue.
Pendant un long moment, nous sommes restées silencieuses. J’éventais avec un mouchoir mon visage empourpré. Ma tante me regardait toujours de cet air de côté que je n’aime pas. Elle dit enfin :
– Il va falloir aviser à trouver des élèves, maintenant.
Je fis oui de la tête. Puis j’ajoutai :
– Jeanne Durve m’a donné une idée : c’est de mettre une annonce dans les journaux locaux. Beaucoup d’étrangers s’installent à Versailles pendant l’été. Je pourrais peut-être trouver quelques leçons de français, ou bien accompagner des jeunes filles pour les faire causer tout en visitant le parc et les Trianons. Ensuite, je tâcherai d’avoir une situation stable, pour l’hiver.
Ma tante approuva :
– Oui, ce serait bien ainsi. Préparez la note, vous la porterez demain aux principaux journaux.
– Je crois qu’il serait bon de la mettre dans quelques quotidiens anglais. C’est une dépense, mais elle pourra me rapporter.
J’ai gagné ma chambre au second étage, sous les toits. Elle n’est qu’à demi mansardée. Bien qu’elle soit très simplement meublée, glaciale en hiver, trop chaude en été, je m’y plais, parce qu’elle donne sur des jardins, et que j’ai ainsi tout au long de l’année de l’espace devant moi. Des hirondelles, au printemps, viennent loger sous le rebord du toit, et chaque soir elles animent le silence de leurs petits cris perçants. Des roses s’épanouissent dans le parterre voisin, une glycine s’allonge sur un mur roux, et toutes ces fleurs m’envoient leurs parfums, à l’heure où le soleil s’éteint.
J’ai rapidement changé de robe, et me suis recoiffée. Dans la petite glace entourée de bambou, j’ai considéré un moment mon visage, encadré de la masse légère des cheveux, couleur d’or foncé qui tombaient sur mes épaules. Mes yeux, d’un bleu d’eau profonde, éclairent la blancheur délicate du teint. Je me sais jolie. Personne ne me l’a dit ; mais, bien souvent, au dehors, des regards admirateurs se sont attachés sur moi. J’en suis infiniment plus gênée que satisfaite. Au nombre de mes défauts, je ne compte pas la coquetterie ni la vanité, et, si jeune que je sois, je sais déjà que la beauté est une entrave et un danger pour la femme obligée de gagner sa vie, surtout quand elle est dépourvue de famille, comme moi. Mais je pense avec confiance : « Dieu me gardera. Il me fera passer sans dommage au milieu des périls, si je garde mon cœur honnête et droit. »
J’ai commencé à tordre mes cheveux d’une main distraite. Et voici que ma pensée s’est évadée un instant. J’ai revu deux grands yeux sombres, deux yeux superbes et vifs, dans un beau visage d’homme. C’était hier matin. Pour reposer un peu mes nerfs fatigués par la somme considérable de travail fournie en ces derniers temps, je me promenais dans le jardin du roi. Devant moi, en sens inverse, un jeune homme s’avançait. Je remarquai machinalement qu’il était grand, svelte, et fort élégant d’allure, de tenue, – d’une élégance sobre et distinguée qui ne court pas les rues, de nos jours surtout. Quand il me croisa, je sentis que son regard m’effleurait. À peine avais-je fait quelques pas qu’une voix dit derrière moi :
– Vous perdez votre livre, mademoiselle.
Je me détournai. L’étranger tenait à la main le volume que je portais sous mon bras et qui venait de glisser à terre sans que je m’en aperçusse.
– Oh ! merci, monsieur !
Je pris le livre, en rougissant très fort. Ce n’est pas que je sois timide, cependant. Faut-il penser que la souriante douceur de ces yeux magnifiques un instant attachés sur moi a été la cause de cette émotion intempestive ?
L’étranger souleva son chapeau, s’inclina légèrement, et s’éloigna, tandis que je reprenais ma route.
Pourquoi cet insignifiant incident m’est-il revenu à l’esprit ? Pourquoi l’ai-je noté sur ce cahier ? Eu vérité, j’ai autre chose à faire que de m’attarder à cela.
Dix heures du soir. – Je viens de remonter dans ma chambre, après avoir fait, comme chaque jour, la lecture du journal à ma tante. Celle-ci somnolait, tandis que je lisais d’une voix molle, car la chaleur est étouffante, ce soir, et l’intérêt du journal, aujourd’hui, assez peu palpitant. J’ai passé rapidement sur les nouvelles politiques, qui n’intéressent pas Mme Holden. Par contre, elle me fait lire toujours le carnet mondain, surtout quand il y est question de personnalités étrangères. J’avoue que pour mon compte tous ces inconnus aux titres sonores et leurs faits et gestes me sont parfaitement indifférents. Mais enfin, il ne faut pas discuter des goûts d’autrui.
Très chargé aujourd’hui, le carnet mondain. Le « Tout-Europe » part en villégiature. À demi endormie par la lourdeur orageuse, j’ai lu ceci : « Les princesses Charlotte et Hilda de Dronstein se sont installées avec leur suite à l’hôtel des Réservoirs, à Versailles, où le prince héritier de Dronstein, notre fidèle hôte parisien, a aussi retenu un appartement. »
J’ai fait remarquer :
– On villégiature beaucoup maintenant à Versailles. Tant mieux, j’aurai plus de chances de trouver des leçons.
Ma tante est restée silencieuse. Elle avait mis sa main devant ses yeux, comme si la lueur de la lampe la gênait tout à coup. J’ai terminé ma lecture sans qu’elle prononçât une parole. Elle m’a dit alors :
– Merci, Odile. Vous pouvez maintenant me laisser, j’ai à écrire.
J’ai regagné ma chambre, allumé ma petite lampe, et je me suis assise près de la fenêtre ouverte, pour écrire encore quelques lignes sur ce cahier. J’aime lui confier les menus, très menus faits de mon existence. Je n’ai pas d’amies. Aucune de mes compagnes de pension ne me plaît assez pour que je lui donne ce nom. Quelques-unes sont de bonnes camarades ; voilà tout. Et c’est mon petit cahier qui reçoit mes confidences.
Ce soir, ma main est un peu lasse, en écrivant. La chaleur d’orage m’engourdit. Et puis, ma pensée s’en va très loin, vers l’Alsace, le pays de mon père et de ma mère, celui de ma tante aussi. Elle s’en va vers ces parents inconnus, dont, sur mon extrait de naissance, j’ai lu les noms : Jean-Henry Herseng, Marguerite-Odile Defrage. Ma tante m’a toujours fort peu parlé d’eux. Elle n’est pas communicative, moins encore sur ce sujet-là que sur d’autres. Ces souvenirs, dit-elle, lui sont pénibles à rappeler, parce qu’elle a beaucoup aimé son frère. Ainsi, j’ignore presque tout de mes parents. Je n’ai même pas un portrait d’eux. Mon père, au dire de Mme Holden, avait négligé de faire faire sa photographie et celle de sa femme, en prétendant que c’était de l’argent gaspillé. Leurs tombes sont à Mulhouse. J’aurais voulu aller y prier ; mais c’est impossible, notre budget est trop restreint.
Un jour, j’ai demandé à ma tante si je ressemblais à ma mère. Elle, m’a répondu :
– Non, à votre père.
Mon enfance a été triste, entre ces deux femmes taciturnes et froides. J’ai heureusement une gaieté naturelle. Puis la religion et l’étude me sont puissamment venues en aide. Ma tante paraît une catholique assez tiède ; mais elle m’a fait instruire chrétiennement. Et à mesure que je me développais au moral, la foi plus vive, la ferveur confiante fortifiaient mon jeune cœur avide d’un peu d’affection, d’un peu de joie. Puis l’étude, que j’aimais, remplissait mes journées, tandis que Mme Holden travaillait seule dans sa chambre, ou bien causait avec Bertha. Ces conversations ont lieu en allemand, la servante parlant difficilement le français. À ce sujet, une chose m’a toujours fort étonnée : c’est que ma tante ne m’ait pas appris l’allemand, et ait même refusé que je m’instruise en cette langue.
– Choisissez l’anglais, m’a-t-elle déclaré. Cela vous sera beaucoup plus utile.
J’objectai :
– Mais il faudra que vous payiez pour ces leçons, tandis que, si vous m’enseigniez l’allemand, cela ne vous coûterait rien.
Elle riposta sèchement :
– Ce que je parle n’est pas de l’allemand, mais du patois alsacien. D’ailleurs, je n’ai pas la vocation de maîtresse d’école.
Je me le tins pour dit. Mais il y avait à ma pension une petite Allemande fort aimable, avec laquelle j’entrepris de causer dans sa langue. À l’aide de mes maigres économies, j’achetai une grammaire d’occasion, que j’appris d’un bout à l’autre. Et, aujourd’hui, je sais l’allemand, – sans que ma tante s’en doute.
Au fond, j’ai quelque remords de cette désobéissance, de cette cachotterie. Elle devait avoir ses raisons pour m’interdire l’étude de cette langue. Mais quelles raisons ? Je les ai cherchées en vain...
Qu’il fait chaud ! Pas un souffle d’air. Des éclairs déchirent la nuit, au loin, et voici que l’orage gronde. Je ferme mon cahier. Il est temps de me mettre au lit, car demain je veux aller à la messe de bonne heure, pour remercier Dieu du bon succès de mon examen.
*
5 juillet, – J’ai été porter mon annonce aux journaux. En revenant de faire une course pour ma tante, au commencement de la rue de la Paroisse, près du parc, j’ai croisé le bel inconnu de l’autre jour, accompagné d’un autre jeune homme blond comme lui, mais beaucoup moins bien, à ce qu’il m’a semblé. Le premier m’a regardée au passage longuement. Et j’ai senti cette maudite rougeur qui me montait aussitôt au visage. Quelle sotte je suis ! Et quel impertinent est ce monsieur ! Cependant, il paraît si distingué ! Et quelle allure ferme, quelle façon fière de porter la tête !
*
6 juillet – Je l’ai revu encore. Cet après-midi, je passais devant le grand Trianon au moment où s’arrêtait la plus superbe automobile que j’aie jamais rencontrée. Je ralentis le pas, pour l’admirer. Un valet de pied, en livrée bleu sombre, ouvrit la portière. J’aperçus le jeune étranger qui sautait à terre, puis se détournant pour enlever dans ses bras une toute jeune fille, vêtue de blanc, dont je distinguai le mince visage, pâli sous la grande capeline qui la coiffait. Je passai vite, ne me souciant pas d’être taxée de curiosité indiscrète. En revenant, je me suis amusée à bâtir des hypothèses sur ces inconnus. Ce sont des gens très riches, évidemment. Et probablement aussi des grands seigneurs. Ils en ont en tout cas les allures. La jeune fille en blanc doit être sa sœur, à lui. Comme elle semble frêle, maladive ! Peut-être, au milieu de son luxe, a-t-elle envié l’inconnue modestement vêtue qui passait, bien portante, d’un pas alerte ?
Oui ! mais si vous êtes entourée d’affection, petite étrangère, vous êtes cependant – en dehors même de votre fortune – infiniment plus riche que moi.
*
8 juillet. – Mon annonce a paru dans les journaux de Versailles. Je souhaite vivement gagner quelque argent, pour dédommager ma tante de ses sacrifices. Je dois dire à sa louange qu’elle ne m’a jamais rien reproché à ce sujet. Mais notre existence mesquine me donne à penser qu’elle a dû se gêner pour m’entretenir et m’élever, et je veux la délivrer au plus tôt de la charge que je représente pour elle.
*
16 juillet. – Je suis encore toute frémissante de la scène que je viens d’avoir avec ma tante. Mais c’est incompréhensible !... incompréhensible !...
Il y a une heure, je travaillais dans la salle à manger, qui occupe avec la cuisine tout l’étroit rez-de-chaussée. On sonne. Le fait est assez rare à cette heure, ma tante n’entretenant aucune relation. Je pense avec un petit battement de cœur : « C’est peut-être pour une leçon ! » Et, bien vite, sans attendre que Bertha, toujours lente, se soit mobilisée, je cours ouvrir...
Fort heureusement ayant déjà les joues empourprées par la chaleur, je ne pouvais rougir davantage. Car je restai toute interloquée, en voyant devant moi le bel inconnu.
Il se découvrit en demandant :
– Est-ce bien ici que demeure Mlle Herseng ?
– C’est ici, Monsieur.
– Vous avez mis une annonce dans le Times, mademoiselle ? je viens à ce sujet.
– Ah ! très bien, monsieur !... Veuillez entrer.
Je l’introduisis dans la salle à manger. Jamais encore je ne m’étais trouvée aussi embarrassée. Dominant ma gêne, j’offris une chaise au visiteur et m’assis en face de lui. Il prit aussitôt la parole, d’une voix harmonieusement timbrée où se discernait un léger accent allemand.
– Accepteriez-vous, mademoiselle, de passer deux ou trois heures chaque après-midi près de ma sœur, pour perfectionner son français, et surtout pour la distraire, car elle est souffrante, et souvent triste ? Vous auriez à lui faire la lecture, à l’accompagner même, dans sa promenade, quand elle le désirerait. En un mot, vous rempliriez près d’elle l’office de demoiselle de compagnie, pendant quelques heures, avec mission de changer un peu ses idées, de l’égayer, – car vous devez être gaie, n’est-ce pas ?
Comment l’a-t-il deviné ? Je ne cherchai pas à me l’expliquer, la surprise et l’émotion mettant mes idées un peu en désarroi. Et je répondis :
– Oui, je suis gaie, monsieur. Et je crois vraiment pouvoir accepter la tâche que vous m’offrez.
Il sourit. Et ce sourire répandit tout à coup un charme incomparable sur le beau visage fier, dans les yeux si profondément expressifs.
– J’en suis très heureux. Je désirais depuis longtemps voir près de ma sœur une compagne jeune et gracieuse, qui put lui devenir sympathique. Je crois que vous réalisez l’idéal, mademoiselle.
C’était un compliment. Le ton de l’étranger, la discrète admiration de son regard ne laissaient pas de doute à ce sujet. Mou embarras s’en accrut. J’objectai :
– Je ne puis accepter sans prendre l’avis de ma tante. Permettez-moi d’aller la chercher.
Et je montai vivement jusqu’au salon où travaillait Mme Holden. Je l’informai de l’événement. Elle demanda :
– Est-ce un Anglais ?
– Je ne pense pas. Il a plutôt un accent allemand, très peu prononcé.
Les sourcils de ma tante se rapprochèrent.
– Ah !... Je n’aime pas les Allemands,
– Moi non plus. Mais, enfin, ce n’est pas une raison pour refuser cette situation.
– Évidemment. Mais encore faut-il savoir quelle sorte de gens... Ce monsieur vous a-t-il dit son nom, et où il habitait ?
– Non, pas encore. Voulez-vous venir, ma tante ? Vous verrez par vous-même.
Elle descendit avec moi. L’étranger se leva à notre entrée, salua Mme Holden et exprima son regret d’être la cause d’un dérangement pour elle – le tout avec une courtoisie légèrement condescendante, un peu hautaine même. Puis il demanda :
– Eh bien ! madame, autorisez-vous mademoiselle votre nièce à accepter la proposition que je lui fais ?
Ma tante le regardait avec une attention qui lui déplut sans doute, car je vis se froncer légèrement les sourcils foncés qui, de même que les cils, formaient un contraste séduisant avec les cheveux blonds.
Mme Holden répondit d’un ton un peu hésitant :
– Je ne sais encore, monsieur... Il faudrait que nous fussions renseignées...
– Sur les gens à qui vous avez affaire ? C’est très naturel. Je suis le prince héritier de Dronstein, de passage à Versailles où ma tante et ma sœur, les princesses Charlotte et Hilda, sont installées à l’hôtel des Réservoirs.
La révélation de cette haute personnalité m’abasourdit un moment – non pas, cependant, au point que je ne fusse frappée du tressaillement qui courut sur le visage de ma tante, et du singulier blêmissement de son teint. Il me parut même qu’elle avait eu comme un mouvement de recul. Et elle balbutia :
– Le prince de Dronstein... Oui, en effet, je sais...
Il dit en souriant :
– Vous voyez donc que vous n’avez pas affaire à des aventuriers. La question des émoluments n’a pas encore été traitée entre nous ; mais je tiens à vous dire que votre chiffre sera le mien.
Il s’adressait à moi. Je répondis timidement :
– J’aimerais mieux que vous... que Votre Altesse le fixât.
– Soit. Vingt francs par jour vous conviendraient-ils ?
– Oh ! certainement !
Vingt francs ! C’était inespéré ! Ma surprise joyeuse dut paraître sur mon visage, car un sourire glissa au coin des lèvres du prince, en soulevant sa moustache blonde.
– Eh bien ! c’est donc convenu ?...
– Pardon, Altesse, rien n’est convenu encore...
C’était ma tante qui intervenait, d’une voix un peu saccadée que je ne lui connaissais pas.
– Il faut que nous réfléchissions... Que Votre Altesse m’excuse... mais je ne suis pas encore décidée à laisser ma nièce courir ainsi le cachet...
Ça, c’était trop fort ! Elle même m’y avait encouragée. Je ne pus réprimer un mouvement de stupéfaction. Le prince la regarda avec surprise, en disant :
– Cependant, madame,vous avez fait mettre l’annonce ?...
– Oui... certainement. Mais je le regrette...
Quelque chose changea sur la physionomie du prince. Une impatience irritée traversa son regard, tandis qu’il ripostait d’un ton hautain :
– Vous auriez dû réfléchir auparavant pour épargner des démarches inutiles... Enfin, veuillez me dire si, oui ou non, je puis compter sur mademoiselle !
– Je... je crois que non, Altesse.
Un mouvement de protestation m’échappa. Le prince s’en aperçut ; car il me dit aussitôt :
– Ce n’est pas votre avis, mademoiselle ?
Ah ! certes non ! Quelle idée nouvelle avait donc surgi dans le cerveau de ma tante ? Mais je ne pouvais entrer en discussion avec elle devant un étranger. Je répondis en essayant de parler avec calme :
– Non, Altesse ! J’étais décidée à accepter. Mais puisque ma tante en juge autrement...
Il dit d’un ton bref, – le ton d’un homme excessivement mécontent, mais qui se contient :
– Vous réfléchirez. J’attendrai votre réponse qu’à demain matin.
Il avait l’air très intimidant en ce moment, – un air de prince irrité qui lui allait fort bien. Je vis ma tante baisser les yeux, en prenant une mine humble que je ne lui connaissais pas...
– Que Votre Altesse me pardonne...
Il ne parut pas l’entendre. Se tournant vers moi, il dit d’un ton plus doux :
– J’espère, mademoiselle, que j’aurai demain le plaisir d’annoncer à ma sœur que vous acceptez.
Il s’inclina légèrement. Je vis alors ma tante esquisser un mouvement comme si elle allait plonger en une révérence. Mais elle se contenta de saluer profondément.
Le prince sorti, je la regardai en disant d’une voix qui tremblait de stupéfaction et de colère :
– Voulez-vous m’expliquer, ma tante, quelles sont les raisons de ce refus ?
Ses yeux se détournaient des miens. Oh ! ce regard de côté, ce regard sans droiture que je n’aime pas, comme elle l’avait en ce moment !
– Cette proposition était inacceptable.
– Inacceptable ! Vingt francs par jour pour trois heures ? En vérité, que vous faut-il ?
~ Je ne parle pas au point de vue pécuniaire. Mais... mais c’est une situation qui ne peut vous convenir. Le prince de Dronstein, que vous verriez naturellement souvent près de sa sœur, est... très peu sérieux.
– Comment le savez-vous, ma tante ?
La question parut un moment l’embarrasser fort. Elle répondit en balbutiant un peu :
– Mais... mais c’est connu.
– Connu, comment ? Vous ne voyez personne et vous ne lisez rien que je sache qui puisse vous renseigner au sujet de ces hauts personnages.
– Tous ces jeunes princes passant une partie de leur existence à Paris ne songent qu’à s’amuser. Et, tenez ! comment expliquez-vous que ce soit lui qui s’occupe, en personne, d’engager une demoiselle de compagnie pour sa sœur, alors qu’il y a la tante et les dames de la suite des princesses, toutes désignées pour des démarches de ce genre ? Comment s’est-il dérangé lui-même pour venir ici, alors qu’on sait combien tiennent à l’étiquette tous ces princes de...
Elle s’interrompit, toussa comme si elle s’étranglait. Puis elle reprit :
– Il a dû vous remarquer dehors et vous a fait suivre pour connaître votre adresse. Puis l’annonce du Times lui est tombée sous les yeux. Il a saisi l’occasion...
Je la considérais avec ébahissement.
– En vérité, ma tante, c’est vous qui imaginez des choses...
– Des choses très vraisemblables. Après le quasi refus que je lui ai fait, un homme comme lui, habitué à voir tout céder devant le moindre de ses désirs, aurait dû nous dire carrément : « C’est bon ! restez chez vous. » Au lieu de cela il attend notre réponse jusqu’à demain, – preuve qu’il tient extrêmement à vous voir accepter sa proposition.
La présence d’esprit me revenait. Je ripostai avec un peu d’ironie :
– Voilà des suppositions absolument gratuites, ma tante. Pourquoi ne pas penser plutôt que le prince, avant de m’introduire près de sa sœur, tenait à me connaître un peu ? Mais, en tout cas, il faut vous dire que, de toutes façons, devant gagner ma vie, je suis exposée à bien des dangers. La grâce de Dieu me soutiendra, si je ne suis pas présomptueuse et sais implorer son secours. Et il me semble que, raisonnablement, je puis toujours accepter cette situation, quitte à me retirer si quelque chose me déplaît de la part du prince de Dronstein ou de son entourage.
Tout en parlant, je remarquais la singulière physionomie de ma tante. Sa bouche avait une sorte de frémissement et son regard, comme gêné, se détournait. Elle dit brusquement :
– Non, je ne veux pas que vous vous exposiez ainsi. Je vais répondre au prince que vous n’irez pas.
Pour comprendre ma surprise devant une décision ainsi motivée, il faut savoir que ma tante ne s’est jamais inquiétée de moi moralement, alors que, fillette et jeune fille, j’allais seule par la ville, libre d’agir à mon idée. Seules, ma très vive piété et mon instinctive horreur du mal m’ont préservée. Il me semblait donc stupéfiant et parfaitement incompréhensible de voir Mme Holden manifester des craintes qui m’eussent paru fort légitimes venant d’une personne plus soucieuse de ma conduite, en temps ordinaire. Et puis, je trouvais bien vagues ses hypothèses au sujet du prince de Dronstein. Pourquoi imaginer ces complications romanesques ? Je ne crois pas du tout qu’un homme bien élevé use de moyens détournés comme ceux dont parle ma tante. Qu’il me trouve jolie, c’est possible, – et même j’en puis sûre. Mais je me tiendrai de telle sorte qu’il n’ait jamais l’idée de me le dire. Une honnête femme doit savoir se faire respecter, fût-ce par un prince. Et, comme je l’ai dit à ma tante, les mêmes dangers m’attendent partout ailleurs, quelque situation que je prenne.
Son refus me paraissait donc extraordinaire. Cédant à un soupçon vague que m’inspiraient sa mine bizarre et ce changement de visage quand le prince avait dit son nom, je m’écriai :
– Vous avez d’autres raisons que celles-là !... Des raisons que vous ne voulez pas me dire !
Elle tressaillit encore, comme tout à l’heure, et parut troublée. D’une voix qui ne me sembla pas très sûre, elle dit vivement :
– Quelles raisons voulez-vous que j’aie ? Je ne connais pas autrement le prince de Dronstein... Je suppose seulement qu’il est comme la plupart des jeunes gens.
– Vous supposez !... On peut aller loin, avec cela, et manquer toutes les situations qui se présentent. Je ne vous comprends pas du tout, ma tante. Vous n’aviez pas coutume d’être si craintive pour moi.
– Eh bien ! j’ai eu tort... En y réfléchissant, vous êtes encore trop jeune pour ce métier d’institutrice ou de demoiselle de compagnie. Attendez, nous verrons plus tard.
Elle essayait de parler avec autorité. Mais son regard se détournait toujours du mien, et je voyais ses lèvres trembler d’impatience – ou de gêne.
Le fond de ma nature n’est pas pacifique. Ces paroles, cette attitude m’exaspérèrent. Je dis avec une ironie frémissante :
– Ainsi, il vous a fallu arriver à aujourd’hui pour décider cela, subitement, alors que depuis mon enfance vous m’avez toujours dit : « Vous devrez gagner votre vie de bonne heure, car vous n’avez rien, et moi je ne suis pas riche ! » Quel effet a donc produit sur vous le prince de Dronstein, pour vous faire ainsi changer d’idée ?
Je vis alors son visage blêmir de nouveau, et – oui, cela, j’en suis certaine – une sorte d’affolement passa dans son regard. Elle abaissa un moment ses paupières. Puis elle dit avec effort :
– Eh bien ! allez-y donc... allez-y, chez votre prince. Il est assez séduisant en effet pour que vous soyez glorieuse qu’il vous fasse la cour. Mais je vous ai prévenue, et je dégage maintenant toute ma responsabilité. Ce qui arrivera sera de votre faute, souvenez-vous-en, Odile.
Elle appuya beaucoup sur ces derniers mots. Puis elle sortit de la pièce.
Alors, je suis montée aussi, je me suis assise près de ma fenêtre, pour mieux réfléchir. Mais je ne pouvais pas d’abord. Trop d’irritation bouillonnait en moi. Elle s’apaisa par degrés. Et je pensai alors que j’avais eu tort de parler ainsi à ma tante. Elle a peut-être raison, après tout. Son âge, son expérience de la vie la rendent plus apte à prévoir bien des choses. Ce prince de Dronstein, si séduisant, peut en effet mener une vie peu exemplaire. Moi-même, je l’ai intérieurement traité d’impertinent, l’autre jour, quand il m’a regardée au passage avec un peu trop d’attention. Il est vrai que beaucoup d’autres font de même, et d’une façon plus hardie, plus insolente. Je me contente de détourner froidement les yeux. C’est une chose que je ne puis éviter – et après tout, en y réfléchissant, le regard du prince de Dronstein était discret, très discret. Je ne sais pourquoi il m’a fait rougir ainsi.
Mais je me suis montrée ingrate, impertinente à l’égard de ma tante, tout à l’heure. Elle agit pour mon bien, certainement.
Je me répète cela – et je ne puis parvenir à le croire. Quelque chose, dans le ton, les paroles, l’attitude de Mme Holden m’a frappée, mise en défiance. Tandis que je me répète : « Elle a raison. Je suis une ingrate », une voix murmure au fond de mon âme : « Elle ment. Il y a autre chose. »
Autre chose ? Mais quoi ? Quelles raisons peut-elle avoir, en dehors de celle-là ?
Et cependant, pourquoi ce nom a-t-il paru produire tant d’effet sur elle ?
Voilà que je bâtis des hypothèses, moi aussi. J’imagine un drame pendant la guerre... Un de ces princes allemands a maltraité, ou fait mettre à mort quelqu’un de notre famille... Mais non, ma tante ne m’aurait pas caché un épisode de ce genre. Elle sait bien qu’en ce cas, le refus à l’offre de l’Allemand aurait jailli spontanément de mes lèvres.
Mon imagination travaille en vain. Je ne connais rien de la vie de ma tante, – pas plus que de celle de mes parents, d’ailleurs. Et cela me semble singulièrement bizarre, en y réfléchissant. Pourquoi, aussi, cette obstination à ne pas me faire apprendre l’allemand ? Cela coïncide avec la répugnance de Mme