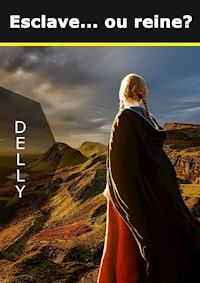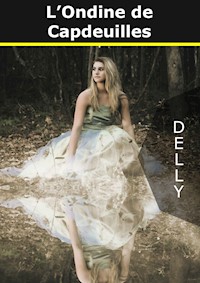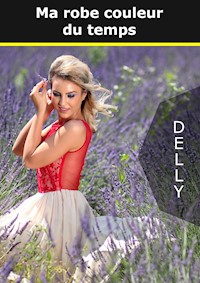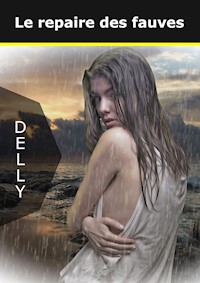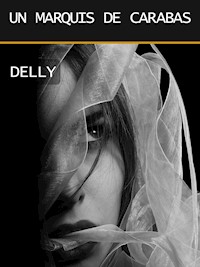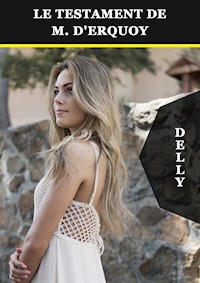2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Deux soeurs, orphelines et pauvres, entrent comme professeurs de jeunes enfants dans un château situé aux environs de Nice. Le manoir et ses habitants leur apparaissent bientôt dans toute leur mystérieuse singularité. Un terrible secret menace leur vie... Tel est l'argument de cette oeuvre qui pose, dans une atmosphère d'étrangeté, une passionnante énigme.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
La rose qui tue
Pages de titreRomanIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIPage de copyrightDelly
La rose qui tue
Roman
Delly est le nom de plume conjoint d’un frère et d’une sœur, Jeanne-Marie Petitjean de La Rosière, née à Avignon en 1875, et Frédéric Petitjean de La Rosière, né à Vannes en 1876, auteurs de romans d’amour populaires.
Les romans de Delly, peu connus des lecteurs actuels et ignorés par le monde universitaire, furent extrêmement populaires entre 1910 et 1950, et comptèrent parmi les plus grands succès de l’édition mondiale à cette époque.
I
La brise, saturée du parfum des orangers, soulevait le journal étendu sur la table. Gemma pencha la tête pour relire l’annonce :
« On demande jeune personne de bonne famille, munie de diplômes, pour instruire deux petites filles. Écrire avec tous renseignements et références à la comtesse de Camparène, Grand-Hôtel, à Cannes. »
De longues coulées de soleil pénétraient jusqu’au milieu du salon vieillot, dont les murs tendus de toile de Jouy fanée s’ornaient de portraits encadrés d’une dorure ternie. Sur la petite terrasse, dans des vases en terre vernissée, de hautes digitales offraient la pourpre vive et le rose tendre de leurs clochettes. Le jardin s’étendait au-delà, abondamment fleuri, bien que négligé depuis la mort de Mme Faublans.
Gemma repoussa le journal et s’accouda à la table. La chaude lumière de mars avivait les reflets moirés des cheveux blonds formant des boucles légères sur la nuque délicate, d’un blanc de nacre. De cette même blancheur nacrée, à peine teintée de rose tendre, était le jeune visage sérieux aux beaux yeux songeurs et soucieux.
Une porte claqua tout à coup, des pas résonnèrent sur le dallage du vestibule. Au seuil du salon parut une jeune fille vêtue de demi-deuil. Elle jeta sur un siège le carton à musique qu’elle tenait à la main, et se laissa tomber sur le petit canapé dont la soie s’élimait.
– Quelle corvée que ces leçons ! Quelles nullités que ces élèves !
La voix était plaintive, comme les yeux couleur d’un beau ciel d’été. Sur ceux-ci battaient de longs cils blonds qui formaient un séduisant contraste avec de bruns cheveux bouclés.
Gemma laissa retomber ses mains sur la table et regarda sa sœur.
– Je viens de voir dans ce journal quelque chose qui pourrait peut-être me convenir...
Elle tendit la feuille à Mahault. Celle-ci lut, et fit la moue.
– Institutrice, avec tous tes diplômes...
– Tu as vu qu’ils ne me servent à rien pour trouver une situation, depuis des mois que je cherche ?
Une note de lassitude passait dans la voix au timbre pur et grave.
– ... Puisque la villa doit être vendue dans trois semaines, il convient de ne plus faire les difficiles.
Mahault eut un sourire un peu amer.
– Tu dis cela pour moi ? Alors, il va falloir me résigner à enseigner toute l’année la musique aux élèves de Mlle Courballon, à vivre comme les sous-maîtresses, dans une petite chambre sous les toits, et cela, pour gagner quoi ? Non, c’est trop odieux !
Elle se leva brusquement, son regard était plein de colère, ses lèvres tremblaient comme celles d’un enfant prêt à pleurer.
Gemma se leva à son tour. Ses yeux, d’une sombre teinte bleue, considéraient pensivement Mahault. Les deux sœurs n’avaient comme trait de ressemblance que le même teint de nacre. Mahault, petite, mince, offrait un singulier mélange de langueur et de vivacité. Celle-ci l’emportait, en ce moment. Mahault de Fonteillan n’avait d’ardeur que pour ce qui l’intéressait personnellement.
Gemma eut un geste d’impatience, aussitôt contenu. Elle dit avec une ferme douceur :
– Il le faut cependant. Je vais écrire à cette dame, et si je m’arrange avec elle, nous déciderons pour toi.
Les doigts de Mahault se crispèrent sur le petit sac élégant qu’ils tenaient.
– Je ne pourrai pas, Gemma !
Sa voix reprenait le ton plaintif.
– ... J’aurais mieux fait, vois-tu, d’épouser M. de Plissan.
– Mahault !... Un homme de cinquante ans, toi qui en as vingt et un ! Et un homme de réputation douteuse, au point de vue moralité.
– Ce sont peut-être des mensonges. Et j’aurais été riche.
– Si cela te suffit...
Il y avait une nuance de mépris dans l’accent de Gemma.
Mahault leva les épaules.
– Eh bien non, je ne regrette pas, malgré tout. Mais je voudrais que quelque chose change dans ma vie !
Gemma songea : « D’autres le souhaitent aussi. »
Elle quitta le salon, monta l’escalier garni d’un tapis usé. Dans sa chambre, envahie par le soleil et les parfums enivrants, elle demeura debout devant la fenêtre, le regard perdu dans la lumière et dans le bleu céleste de l’horizon.
Changer quelque chose à sa vie... Depuis l’enfance, elle le désirait obscurément.
Être aimée. Ne plus être celle qui ne compte qu’à moitié, aussi bien pour la mère au cœur léger que pour le père absorbé par ses travaux d’historien. Tous deux lui préféraient Mahault. La vieille tante Laurence aussi. Mais Gemma, seule, avait soigné celle-ci dans ses derniers jours.
Elle ne sentait pas de rancœur, mais une peine infinie. Son âme noble pardonnait. Mais le pardon n’empêche pas la souffrance.
Une âme secrète. Personne n’avait su l’ouvrir jusqu’ici. Gemma endurait sa peine en silence. Son père, qu’elle avait aidé parfois dans son travail, disait : « Elle est parfaite comme une belle statue. »
Une belle statue frémissante, ainsi qu’en cet instant où elle songeait à son enfance blessée par la mésentente de ses parents, à son adolescence qui avait vu la mère quitter son foyer, ses enfants, rompre avec ses principes religieux par le divorce. Son père avait souffert dans un farouche silence. Cette charmante Yolanda aux clairs yeux bleus – Mahault lui ressemblait – il avait dû l’aimer passionnément. Jamais plus Gemma n’avait surpris un sourire sur cette bouche durcie, dans ce regard qui ne s’adoucissait un peu que pour Mahault. Elle pensait parfois qu’il était peut-être mort de ce chagrin, trop lourd pour son cœur envoûté par l’amour.
Et il avait laissé dans la gêne ses deux filles. Une belle fortune, négligée depuis l’abandon de l’infidèle, se trouvait réduite à peu de chose. Gemma venait de terminer des études brillantes, Mahault s’adonnait à la musique, pour laquelle ses dons étaient remarquables. En attendant qu’elles eussent trouvé une situation, leur grand-tante, Mme Faublans, leur ouvrait sa petite villa de Vallauris. Il y avait dix-huit mois de cela. Un soir de janvier, la vieille dame s’était alitée pour ne plus se relever. Elle vivait en grande partie d’une forte rente viagère. Les deux sœurs héritaient de la villa et d’une cinquantaine de mille francs chacune. La maison devait être vendue pour payer les frais de succession. Avec ce qui leur restait de la fortune paternelle, les jeunes filles se trouveraient nanties chacune d’un revenu de dix mille francs.
Il fallait se faire une situation. Mais les diplômes de Gemma, jusqu’ici, n’avaient pu lui en procurer une. M. de Fonteillan n’ayant eu que peu de relations, ses filles ne savaient à qui s’adresser. Mahault donnait quelques leçons de musique dans une institution de jeunes filles, à Cannes. La directrice offrait de la prendre à demeure. Mais Gemma ne voyait pas dans cette cage cet oiseau trop joli...
Mahault. Une âme légère, comme celle de sa mère. Un visage délicieux. Vers quel troublant destin s’en irait-elle ?
À Paris, le baron de Plisson, qui occupait un appartement dans la même maison que M. de Fonteillan, l’avait demandée en mariage après la mort de son père. Elle avait un peu hésité – très peu. Elle se savait assez jolie pour espérer mieux, la fortune mise à part.
Oui, elle le disait franchement, avec le naïf orgueil qu’on ne songeait pas trop à lui reprocher.
Gemma soupira et quitta la fenêtre pour s’asseoir devant sa table, afin d’écrire à Mme de Camparène.
II
Dans l’après-midi du surlendemain, les deux sœurs prirent l’autobus de Vallauris à Cannes. Gemma était convoquée au Grand-Hôtel pour cinq heures. Mahault avait décidé de l’accompagner. « Cela me distraira, et puis je verrai la tête de cette dame. »
Gemma pensait aussi que le plaisir de se trouver, ne fût-ce que quelques instants, dans un milieu luxueux, entrait pour quelque chose dans cette décision.
Elles longèrent la Croisette, à cette heure fort animée. On les regardait beaucoup. Même dans leurs simples robes de demi-deuil, les deux sœurs n’étaient pas de celles qui passent inaperçues.
Comme elles entraient au Grand-Hôtel, un jeune homme brun, au teint un peu bronzé, les croisa, et Gemma vit de sombres yeux qui la considéraient au passage, discrètement d’ailleurs.
Il monta dans un élégant cabriolet qui démarra aussitôt.
Le portier pria les jeunes filles d’attendre dans le hall, tandis qu’il téléphonait à l’appartement de Mme de Camparène. Puis l’ascenseur les mena au second étage. Une jeune femme de chambre les introduisit dans un salon où se trouvait un homme âgé, qui se leva à leur vue.
Il allait leur adresser la parole, quand, d’une pièce voisine, surgit une femme vêtue de velours noir. Une vieille femme, en dépit du fard savamment appliqué. Un visage dont l’âge avait déformé les lignes, qui devaient être belles naguère. Une allure aristocratique, de la souplesse encore dans ce long corps maigre.
– Mlle Gemma de Fonteillan ?
Des yeux clairs, scrutateurs, regardaient alternativement les deux sœurs.
– C’est moi, madame.
Mme de Camparène s’assit, en désignant un siège aux arrivantes. Le vieux monsieur avait repris son fauteuil, près d’une table où des revues voisinaient avec un nécessaire de fumeur.
– Il s’agirait, mademoiselle, ainsi que je l’ai indiqué dans mon annonce, d’instruire mes deux arrière-petites-filles, sept et neuf ans. Mais peut-être une licenciée en histoire trouvera-t-elle la tâche un peu... simple pour elle ?
– Mais non, madame, j’aime beaucoup les enfants, et je serais heureuse de contribuer à l’éveil de toutes jeunes intelligences.
– Tant mieux ! Car, de mon côté, j’aimerais voir près de Joyce et d’Auberte une personne de bonne éducation et de très bonne famille. Or, mon mari...
Elle tourna la tête vers le vieux monsieur.
– ... qui connaît la généalogie de toute la noblesse du midi de la France, m’a dit que les Fonteillan était une des plus anciennes familles du Dauphiné.
– C’est exact, madame. Mon père en était le dernier descendant mâle. Ma sœur et moi restons seules héritières de ce nom.
Le regard de Mme de Camparène se posa sur Mahault, s’y attarda un moment. Puis la voix un peu brève, au léger accent anglais, reprit :
– Si cette situation vous convient, il sera, je pense, facile de nous entendre... Vous me dites, dans votre lettre, que vous parlez l’anglais et l’italien. Couramment ?
– Oui, mon père possédait parfaitement la première de ces langues, et ma mère est italienne.
M. de Camparène dit avec un accent d’intérêt :
– Cela explique votre prénom. De quelle partie de l’Italie ?
– Du Milanais. Elle est une Pazzini.
– Eh ! très ancienne famille aussi ! Pazzini ? Mais un Pazzini a épousé une Camparène, au siècle dernier ! Giorgio Pazzini...
– C’est possible, mais je suis peu au courant de ma parenté maternelle. Ma mère, très jeune, s’est trouvée orpheline, et elle avait conservé peu de relations avec ses cousins.
Mahault interrompit vivement :
– Je l’ai entendue un jour parler d’un oncle Giorgio qui était très musicien. Elle disait que je tenais ce don de lui.
– Ah ! vous êtes bonne musicienne, mademoiselle ?
Mahault eut pour Mme de Camparène son plus charmant sourire, en répondant :
– C’est l’unique chose qui me plaise, la seule où je sois capable de réussir, du moins mes professeurs me l’assuraient. Mais que faire, seule, sans relations ? Me voilà réduite à donner des leçons dans une institution de jeunes filles.
De ses longs doigts aux ongles brillants, Mme de Camparène tourmentait le face-à-main suspendu à une chaîne de platine ornée de rubis. Ses yeux d’un bleu pâle, un peu saillants, ne quittaient pas Mahault. Elle semblait réfléchir. Son mari considérait Gemma avec un intérêt accru. Il demanda :
– Votre père ne serait-il pas Hector de Fonteillan, qui a écrit quelques très intéressants ouvrages historiques ?
– C’était lui, en effet, monsieur.
– Ah ! très bien, très bien !
De fait, M. de Camparène paraissait enchanté. Il avait une physionomie assez sympathique, de beaux cheveux blancs, un visage ridé, où le menton et la bouche indiquaient une âme faible.
– ... Peut-être vous intéressez-vous aussi à ce genre de travaux ?
– Beaucoup. Du reste, j’aidais parfois mon père pour ses recherches, dans la dernière année de sa vie.
– Mais c’est parfait !... Cynthia, ne pourrions-nous pas arranger quelque chose ?
Détournant son regard de Mahault, Mme de Camparène demanda :
– Quoi donc, mon ami ?
– L’instruction des enfants, à cet âge, ne prendra pas beaucoup de temps à Mlle de Fonteillan. Il serait peut-être possible qu’elle me réservât quelques heures dans la semaine, pour m’aider dans mes travaux... avec un supplément d’émoluments, bien entendu.
– Je n’y vois, pour ma part, aucun inconvénient. À vous de dire, mademoiselle, si cet arrangement vous conviendrait ?
– Je m’occupe d’écrire l’histoire des vieilles familles provençales, expliqua le comte. J’ai bien un secrétaire, mais il ne vaut rien pour les recherches dans les archives, et moi, à mon âge, parfois malade, je puis difficilement les faire maintenant. S’il vous était possible de me suppléer sur ce point, mademoiselle ?
– Mais très volontiers, monsieur, tant qu’il vous plaira !
La satisfaction parut dans les yeux du vieillard.
– Me voilà tout à fait enchanté ! Je vous montrerai les très intéressantes archives du château de Brussols, notre demeure...
Mme de Camparène l’interrompit :
– Et moi, je pensais à un autre arrangement...
La porte du salon fut ouverte à cet instant ; le jeune homme brun, croisé tout à l’heure par les deux sœurs, entra, eut un léger mouvement de surprise, salua, puis s’adressa à Mme de Camparène :
– J’ai oublié votre lettre pour Lætitia, grand-mère.
La comtesse désigna une enveloppe posée sur une table.
– La voici, Salvatore.
Il prit la lettre et sortit. Gemma avait rencontré encore le regard de ces yeux sombres, très beaux dans le visage au net dessin.
Mme de Camparène reprit :
– ... Mes petites filles ont commencé l’étude de la musique avec leur gouvernante anglaise, qui vient de les quitter pour soigner une anémie persistante. Du reste, elle n’aurait pu les mener bien loin. Joyce, l’aînée, paraît très douée. Elle tient cela de son père, mon petit-fils Lionel, musicien remarquable. Or, mademoiselle...
Elle s’adressait à Mahault.
– ... Peut-être envisageriez-vous sans déplaisir de venir, vous aussi, à Brussols et de faire l’éducation musicale de ces enfants, ainsi que de me tenir un peu compagnie, de me faire la lecture ?
La physionomie de Mahault témoigna du plus vif contentement.
– Certes, madame ! Je ne demande pas mieux !
– Eh bien, nous allons convenir de tout cela en prenant le thé.
Mme de Camparène sonna, donna un ordre à la jeune femme de chambre. Celle-ci reparut peu après, apportant un plateau. Mahault et Gemma, sur l’invitation de la comtesse, servirent le thé. Après quoi, Mme de Camparène énonça le chiffre, très large, des émoluments qu’elle offrait aux deux sœurs, et qu’elles acceptèrent aussitôt.
– Nous habitons toute l’année notre château de Brussols, dans la montagne, expliqua-t-elle. Vous déjeunerez avec les enfants, mais dînerez avec nous. Pour ce repas, nous prenons la tenue du soir, selon la coutume anglaise...
– Nous nous y conformerons, dit Gemma.
– Très bien. Nous sommes encore pour toute la semaine ici. Convenons donc que j’enverrai une voiture vous chercher dans quinze jours ?
– Oh ! certainement ! répondit Mahault d’une voix joyeuse. N’est-ce pas, Gemma ?
– Oui, je pense que nous pourrons être prêtes pour ce moment-là.
Le ton réservé de la cadette contrastait avec l’allégresse que l’aînée ne pouvait dissimuler. Mme de Camparène eut un rapide coup d’œil, curieux, scrutateur, vers le visage aux lignes pures, au profond regard.
– Habitez-vous Vallauris depuis longtemps ?
– Seulement depuis la mort de notre père, c’est-à-dire dix-huit mois. Mais la grand-tante chez qui nous vivions est morte, et sa villa va être vendue.
– Oh ! je pensais que vous viviez avec votre mère ?
– Notre mère est remariée, dit brièvement Gemma.
– Ainsi, vous êtes libres, tout à fait libres, toutes les deux ?
– Complètement libres, dit en souriant Mahault ; je suis majeure, et Gemma le sera l’année prochaine.
Il parut à Gemma qu’une lueur de satisfaction passait dans les yeux froids de la vieille dame.
– J’espère que vous vous plairez à Brussols, dit-elle, avec, elle aussi, un sourire sur ses lèvres minces et fardées.
Un bizarre sourire, sans charme, sans douceur.
– ... L’été y est fort plaisant, l’hiver a ses agréments. Avez-vous fait du ski ?
– Non, jamais ! répondit Mahault avec regret. Nous avons voyagé dans le Dauphiné un été, avec notre père, et une autre année dans les Pyrénées. C’est tout.
– Ah ! vous ne connaissez donc pas nos Alpes-Maritimes ? Nos admirables vallées du Yar, de la Tinée, de la Vésubie ? demanda M. de Camparène.
– Hélas ! non.
– Vous en aurez ainsi tout le plaisir ! Brussols se trouve en pleine campagne, proche de la vallée de la Tinée. Ce fut autrefois une demeure féodale. Elle appartenait à une famille seigneuriale de Provence, dont la dernière descendante épousa, vers la fin du XVe siècle, un comte Camparini, venu de Toscane. Plus tard, le nom, francisé, devint Camparène.
– Et vous trouverez chez nous une comtesse Camparini, de la branche demeurée italienne, ajouta Mme de Camparène. C’est une savante, spécialisée en chimie – ce qui ne l’empêche pas, d’ailleurs, d’être une parfaite femme du monde.
Peu après, les deux sœurs quittaient le Grand-Hôtel. Mahault exultait, vantait l’affabilité du vieux comte, la mine de grande dame de la comtesse.
– ... Et ils paraissent nous traiter comme des égales. D’ailleurs, si vraiment un Pazzini a épousé une Camparène, nous leur sommes un peu parents.
– Oh ! c’est bien lointain, dit Gemma.
Elle ne s’associait pas à l’enthousiasme de sa sœur. Cette situation, qui eût dû combler ses vœux, elle l’envisageait avec une singulière appréhension. Pourquoi ? Eh bien, le plus étrange, c’est qu’elle ne pouvait pas se l’expliquer.
Mme de Camparène lui déplaisait, certes. Il y avait dans cette physionomie, dans ce regard, une froideur – plus que cela, parfois, une sorte de dureté assez désagréable. Mais elle n’avait témoigné aucune morgue à l’égard de ces jeunes inconnues qui seraient, bientôt, les institutrices de ses petites-filles. Mahault disait même vrai : elle les avait traitées presque à égalité. Ainsi donc, il n’existait pas de raison pour éprouver cette vague angoisse, au seuil de cette nouvelle existence qui leur était offerte, dans des conditions telles qu’elles n’eussent pu les espérer.
Près d’elle, Mahault continuait de parler avec animation. Elle disait : « Je me demande si le père des petites filles est veuf ? Probablement, puisque c’est leur grand-mère qui paraît s’en occuper... Et c’est un autre petit fils, celui qui est entré tout à l’heure. Il est très bien... »
Des rêves s’ébauchaient déjà, des visions de richesse et de plaisirs surgissaient devant les yeux éblouis de Mahault.
III
La voiture avait quitté la vallée, le torrent, les sauvages défilés. Elle s’engageait sur une route taillée dans le schiste rouge. Un paysage hivernal s’offrait aux regards émerveillés des deux sœurs. Les énormes rocs aux tons de cuivre brasillaient sous le soleil de midi. Une forêt de hêtres et de chênes dressait vers le ciel ses branches encore dénudées. La route s’élargissait un peu, tournait dans un vallon où mugissait un jeune torrent serré dans son lit étroit. Sur sa rive, à droite, un village semblait plaqué contre les hautes roches au sommet déchiqueté comme si le feu du ciel l’eût foudroyé. Le clocher crénelé de la petite église s’enveloppait d’une lumière qui, déjà, s’apprêtait à quitter le vallon resserré. La voiture passait sur un vieux pont du Moyen Âge, continuait sa montée sur la route qui tournait toujours. Elle s’engageait dans un cirque de hautes falaises rouges dégradées par les éboulis qui formaient sur le sol des tas de pierrailles. Paysage aride, magnifique dans sa désolation.
À droite, sur un promontoire, se dressait une construction qui rappelait, par ses ouvertures étroites et ses créneaux, les anciens palais italiens fortifiés en ces temps où l’on se battait de ville à ville. Deux tours carrées, à meurtrières et mâchicoulis, donnaient l’aspect d’une forteresse à cette demeure dont la pierre avait pris le même ton fauve que le roc sur lequel s’appuyait son assise. Un oiseau de proie planait au-dessus, dans la lumière de midi.
– Brussols, sans doute ? dit Mahault.
Sa voix avait un léger frémissement. Gemma comprit que la légère Mahault elle-même était impressionnée par l’allure farouche de cette demeure.
« C’est donc là que nous allons vivre », pensa-t-elle, avec un étrange serrement de cœur. « Là-haut, dans cette solitude, dans ce désert de pierre. »
La route contournait le promontoire, dans un étroit défilé très montueux. Subitement, la voiture se trouva devant une antique muraille, percée d’un porche monumental, qu’elle franchit. Au-delà d’un grand espace nu se dressait le château que les arrivantes avaient aperçu d’en bas.
Un domestique âgé, de mine imposante, parut sur le seuil et vint aider les jeunes filles à descendre. Il les introduisit dans un grand vestibule dallé de marbre rouge et blanc, décoré de très beaux bahuts du XVIe siècle et d’armures damasquinées. La jeune femme de chambre, déjà vue au Grand-Hôtel, s’avança et pria les deux sœurs de la suivre, afin qu’elle les conduisît à leur appartement. Par le grand escalier de marbre blanc, elles gagnèrent le second étage. Comme elles y atteignaient, une porte s’ouvrit, laissant apparaître une singulière créature. Elle avait la taille d’un enfant de huit ans, un maigre visage flétri maladroitement fardé, de longs cheveux noirs réunis en une natte attachée par un ruban écarlate. Sa robe de soie rose à fleurs, un peu élargie aux hanches par une sorte de vertugadin, comme celle des infantes dans les portraits de Velasquez, tombait jusqu’à ses pieds chaussés de souliers en brocart d’argent à hauts talons. Des yeux brillants se levèrent sur les jeunes filles, des yeux où Gemma crut lire une sournoise jubilation. Une voix perçante s’éleva, disant ces mots :
– Encore deux pour la mort !
Puis l’apparition recula, referma la porte sans bruit.
– C’est la naine de Mme la comtesse, dit la femme de chambre. Que ces demoiselles ne fassent pas attention, elle est un peu...
Et, de son index, elle toucha son front.
Puis elle ouvrit une porte et introduisit les deux sœurs dans une grande chambre tendue de vieux Jouy, garnie de meubles anciens d’une noble simplicité. Deux lits s’alignaient côte à côte. Une confortable salle de bains se trouvait à côté. On y avait déposé les malles envoyées la veille de Vallauris, selon les indications de Mme de Camparène.