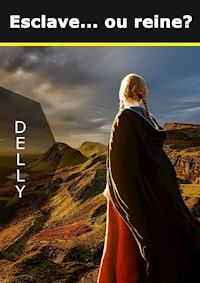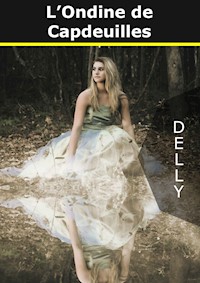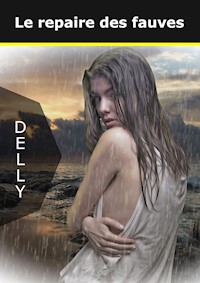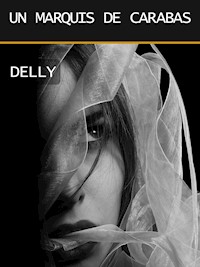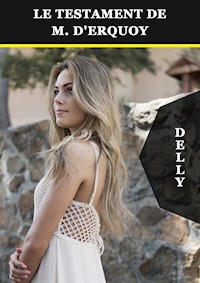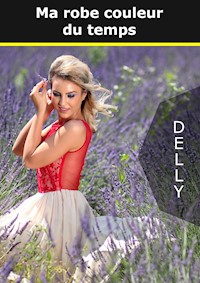
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"- Vous mettez toujours une robe couleur du temps, Gillette ! - Oui, celle-là est grise comme ce ciel d'hiver. Grise comme ma vie..." Ainsi parle Gillette d'Arbiers que la vie, en effet, n'a pas gâtée. Orpheline et soudain ruinée, pour se libérer d'une tutelle odieuse, Gillette se réfugie dans sa métairie délabrée de La Meulière, en Vendée. L'unique bien qui lui reste. L'effondrement de sa fortune a fait fuir un prétendant. Sans argent, que peut attendre désormais Gillette malgré sa jeunesse, sa radieuse beauté? Courageuse, tenace, elle décide de s'installer dans sa vieille maison et de s'initier aux travaux de la campagne. La rencontre d'un homme exceptionnel, Guy de Trézonne, le châtelain du pays, la trouble autant qu'elle la déconcerte. Il a l'air si hautain, si dur?... Pourquoi? Gillette a peur dès qu'il la recherche. Aux ciels gris de l'hiver, les ciels lumineux aux couleurs d'espoir succèderont-ils, pour qu'elle change de robe? Ou, au contraire...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ma robe couleur du temps
Pages de titreIIIIIIVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIPage de copyrightDelly
Ma robe couleur du temps
I
Un matin de juin, Mme Barduzac entra dans ma chambre, où je terminais une des pièces de mon trousseau. Elle s’assit dans mon unique fauteuil, et le pauvre, qui n’était pas neuf, gémit sous le poids respectable de la femme de mon tuteur.
– Il nous arrive une chose ennuyeuse, Gillette.
Je demandai sans m’émouvoir :
– Quoi donc, madame ?
– Les Samponi donnent une matinée dans quinze jours et nous invitent.
– Les Samponi ? En voilà une idée !
Ma voix prenait une intonation de dédain qu’accentua une moue légère.
– Mais c’est une bonne idée ! Ils cherchent à marier leurs filles, ces gens !
Je n’ignorais pas qu’il suffisait qu’une opinion, un goût ou une antipathie fussent exprimés par moi pour que, immédiatement, Mme Barduzac fût d’un avis contraire. Les Samponi, d’origine italienne, bavards, indiscrets et quelque peu excentriques, ne lui plaisaient guère. Mais du moment où je semblais faire fi de leur matinée, ils lui devenaient aussitôt chers.
Je ripostai tranquillement :
– Eh bien, qu’ils les marient ! Je leur souhaite sincèrement cette bonne chance. Mais ils n’ont pas besoin de notre présence pour cela.
Mme Barduzac pinça ses grosses lèvres ombragées d’un duvet foncé.
– Est-ce ainsi que vous accueillez cette gracieuseté ? Nous les avons vus cinq ou six fois, et c’est vraiment fort aimable de leur part d’avoir songé à nous.
– Évidemment. Mais en ces cas-là, on aime toujours avoir son salon plein. Enfin, nous les remercierons avec la même grâce dont ils usent à notre égard, et tout sera dit.
Mme Barduzac leva ses larges épaules.
– Vous croyez que cela peut se passer ainsi ? Il faudrait donner un prétexte plausible, et nous n’en avons pas.
– Eh bien ! Il faut en chercher un, madame.
– Je ne chercherai rien du tout, car je ne vois pas pourquoi vous vous dispenseriez de vous rendre à cette matinée.
Je la regardai avec surprise.
– Comment, pourquoi ? Mais c’est vous-même, madame, qui avez refusé cet hiver toutes les invitations ! Je n’avais que faire, disiez-vous, à ces réunions mondaines, et vous avez su trouver des prétextes, alors.
Les yeux froids, enfoncés dans la bouffissure blafarde du visage, laissèrent voir une irritation que je connaissais bien. La voix se fit plus sèche, plus impérative.
– L’hiver, oui, je n’aime pas ces réunions au sortir desquelles la pleurésie vous guette. Maintenant, c’est autre chose. Je vais répondre que nous acceptons, Gillette.
– Je n’ai pas de robe convenable pour la circonstance, madame.
– Votre blanche de l’année dernière ?
– Elle est trop fanée ; je ferais honte à vos amies Samponi, si élégantes.
Mme Barduzac ne releva pas l’ironie de mon accent. Elle réfléchit un instant, en promenant ses doigts charnus sur son peignoir violet. Puis elle conclut :
– Il faut vous en faire faire une.
– Je ne comptais pas sur cette dépense.
– Il y a des dépenses nécessaires.
Elle ajouta, en jetant un coup d’œil sur la pièce de lingerie à laquelle je travaillais :
– Vous mettrez un peu moins de broderie à votre trousseau, qui pourrait aussi être fait de tissu moins fin. Ce sont des économies bonnes à réaliser quand on a une dot qui, après tout, est médiocre, au temps où nous sommes.
Je ripostai sèchement :
– Que voulez-vous, j’aime mieux me priver d’autre chose, faire mes robes et mes chapeaux moi-même et avoir de joli linge qui me revient moins cher que celui dont vous faites l’acquisition dans vos grands magasins de Paris.
– Naturellement, vous n’avouerez jamais que vous avez tort ! Cela promet de bons moments à l’homme chanceux qui vous choisira pour femme.
Sous une forme variée, ce pronostic m’était lancé à la tête vers la fin de toutes nos discussions, qui étaient fréquentes. Il ne m’impressionnait guère et j’évitais d’y répondre, afin de ne pas éterniser ces entretiens peu agréables pour lesquels Mme Barduzac tenait à avoir le dernier mot.
Aujourd’hui, je ne sais pourquoi, l’impatience me prit si fortement que je répliquai :
– Eh ! oui, l’homme chanceux. Mais ce ne sera pas le premier venu, vous pouvez m’en croire, madame.
– Que voulez-vous dire par là ? Attendez-vous quelque prince, quelque milliardaire ?
Je répondis avec un sourire ironique :
– Qui sait ! Qui sait ! En tout cas, je n’épouserai pas le premier chien coiffé qu’on me présentera, comme l’a fait cette pauvre Élise Duteil qui est si malheureuse aujourd’hui. Je resterais vieille fille plutôt que d’accepter un personnage qui me serait complètement inconnu et que je n’aimerais pas.
Mme Barduzac prit cet air offusqué si amusant sur sa grosse figure boursouflée.
– Vraiment, les jeunes filles d’aujourd’hui sont intolérables ! Aimer !... Aimer !... Ce mot-là n’existait pas dans le vocabulaire de la jeune personne bien élevée, en mon temps.
– Elle ne le prononçait peut-être pas tout haut, mais en cachette, certainement...
Sans paraître m’entendre, Mme Barduzac poursuivit d’un ton doctoral :
– Moi, je me suis mariée après avoir vu deux fois M. Barduzac. Nous avons fait cependant un bon ménage.
– Je n’en doute pas. M. Barduzac ferait bon ménage avec Lucifer en personne.
Les soupçons de sourcils que possédait Mme Barduzac firent mine de vouloir se rapprocher.
– Je désirerais savoir, mademoiselle, ce que vous prétendez insinuer par là ? Oseriez-vous me comparer aux mauvais anges ?
Je pris une mine ingénue.
– Oh ! Madame !... Je voulais dire que mon tuteur s’entendrait avec tout le monde et qu’il faudrait vraiment avoir un caractère plus qu’infernal pour faire mauvais ménage avec lui.
– Il a ses défauts aussi et j’ai besoin de patience – qualité qui ne me manque pas, je dois l’avouer.
Sur ce, elle se leva, non sans effort. Son regard investigateur fit le tour de ma chambre et s’arrêta sur quelques roses trempant dans un vieux Rouen.
– Je vous ai déjà fait remarquer, Gillette, qu’il est mauvais de conserver des fleurs dans une chambre.
– Je les retire pour la nuit, madame.
– Vous avez la manie des complications. À quoi cela sert-il, ces fleurs, sinon à vous faire perdre du temps ? Moi, je n’en mets jamais nulle part.
– Chacun son idée. Ainsi, par exemple, j’ai toujours envie de faire la grimace devant les fleurs artificielles que vous conservez si précieusement dans votre salon.
Elle eut un geste de dédaigneuse supériorité.
– Vous n’avez pas de goût, Gillette... pas le moindre goût. Et des prétentions, avec cela !... des prétentions à revendre !
Elle sortit sur ces mots. Je repris mon ouvrage ; mais un agacement me restait de cette visite et mes points n’avaient plus la finesse nécessaire. Je me levai, en secouant les brins de fil attachés à ma jupe, je fis deux ou trois fois le tour de ma chambre et vins m’accouder à ma fenêtre.
Le jardin des Barduzac s’étendait devant moi – un jardin bien soigné, avec une pelouse au milieu, d’étroites plates-bandes le long du mur, quelques arbustes et un jeune marronnier. Mme Barduzac n’aimait pas les arbres. Comme conséquence de cette antipathie, le jardin restait inaccessible pendant l’été, dès que le soleil se montrait.
Dans une des petites allées couvertes de sable rougeâtre, M. Barduzac se promenait en complet de coutil et panama rabattu sur les yeux. Il traînait un peu sa jambe gauche, à cause d’un rhumatisme, et s’arrêtait à chaque pas pour contempler ses fleurs.
J’apercevais alors un profil lourd, au menton proéminent. C’était un homme faible et pacifique, aussi incapable de bonté que de méchanceté, instrument inerte entre les mains de sa femme. Pour éviter tout motif de discussion, il acquiesçait bassement aux opinions changeantes de Mme Barduzac, et sa pupille savait qu’elle ne trouverait jamais chez lui aucun secours au cas où l’omnipotente dame prétendrait lui imposer quelque exigence inacceptable.
J’avais une nature énergique, peu encline à la mélancolie. Mais j’étais aussi avide d’affection, de confiance. À certains instants, je me sentais bien triste dans cette demeure étrangère, entre ces deux êtres dont l’un restait indifférent, dont l’autre m’était hostile. Car je ne me dissimulais pas que Mme Barduzac me détestait. Pourquoi ? Jalousie d’ex-jolie femme ? Car elle avait été jolie, paraît-il ! Je voulais bien le croire ; mais quelle décadence !... Ou bien mesquine rancune de petite bourgeoise contre la noblesse de ma naissance ? C’était très possible encore. Mais surtout, nos natures se heurtaient sur tous les points. Ma vivacité de repartie, ma franchise, mon esprit d’indépendance l’exaspéraient... Nous vivions vraiment sur un pied de guerre perpétuel, depuis le jour où j’avais quitté mon couvent regretté, à dix-huit ans.
J’étais la fille du capitaine d’Arbiers, tué au Maroc dans une reconnaissance. Ma mère se retira à Tours, où elle avait de vieux amis.
Elle loua un appartement modeste, car bien que ses revenus lui assurassent une certaine aisance, elle voulait économiser pour grossir ma dot. Sur le même palier habitait le ménage Barduzac. M. Barduzac était juge de paix. On les tenait pour des gens honorables, mais on ne les aimait guère dans le quartier, elle surtout, qui était autoritaire, remplie de prétentions, et passait pour une hurluberlue.
Ma pauvre mère, depuis la mort de mon père, restait de santé précaire. Un jour, elle eut une syncope qui effraya notre servante. Celle-ci, au hasard, courut chez la voisine. Mme Barduzac arriva, donna les soins nécessaires, puis revint le lendemain et les jours suivants. Elle manquait de discrétion, elle n’avait rien des idées ni des goûts de ma mère. Cependant la malade se sentait si seule, si faible qu’il lui semblait bon d’avoir à sa portée une personne prête à lui porter secours. Elle accueillit donc les avances de Mme Barduzac. Puis les vieux amis moururent et elle se vit plus isolée encore en cette ville où, claustrée dans le chagrin de son veuvage, elle n’avait pas fait de relations. Sa santé s’affaiblissait chaque jour. En même temps grandissait l’influence de la voisine. J’étais à ce moment une fillette vive et affectueuse et je chérissais maman. Mais déjà Mme Barduzac et moi étions en escarmouches, à la grande désolation de ma mère.
Pauvre maman ! Elle mourut doucement, un jour d’hiver, comme j’atteignais mes quatorze ans. Quand je reporte ma pensée vers ce moment, les heures douloureuses revivent avec une intensité poignante. Elle était ma seule affection. Nous n’avions que des cousins éloignés, inconnus pour moi. Je n’aimais pas les Barduzac. Cependant, c’était à eux que ma mère confiait le soin de ma tutelle. J’accueillis la nouvelle sans enthousiasme et, dans mon malheur, je me trouvai satisfaite d’entrer au couvent, tant j’avais eu peur un moment de demeurer chez eux.
Ils me firent sortir aux vacances, pendant les quatre ans de mon internat. M. Barduzac ayant pris sa retraite, ils avaient acheté une maison à Largillais, petite ville de Touraine où vivaient nombre de rentiers modestes. Comme ils possédaient d’assez jolis revenus, ils jouissaient là d’une certaine considération qui flattait la grosse vanité de Mme Barduzac. Celle-ci, en outre, se servait de moi pour s’exhausser sur son piédestal. « La pupille de mon mari, une orpheline dont nous nous sommes tant occupés, que nous traitons comme notre fille... Mlle Gillette d’Arbiers, notre pupille, la fille de ce pauvre comte d’Arbiers qui fut tué au Maroc... Un héros, chère madame... (ou cher monsieur). »
Et, là-dessus, elle s’embarquait dans une description colorée de l’expédition dont fit partie mon père et qui lui coûta la vie. Ce récit, souvent entendu, me semblait très beau et m’émouvait toujours. Le malheur voulut qu’un jour, en cherchant un volume de Corneille dans la bibliothèque de M. Barduzac, je tombai sur un livre où il était question de nos conquêtes africaines. Il s’ouvrit presque de lui-même à une certaine page, et qu’est-ce que je lus ? Le récit, mot pour mot, si souvent fait par Mme Barduzac. Seulement, ici, le héros ne s’appelait pas le capitaine d’Arbiers.
Je ne soufflai mot de ma découverte. Quelques jours plus tard, à une réunion chez Mme Geolle, la femme du notaire, je fus présentée à une nouvelle venue : « Gillette d’Arbiers, etc. » Et Mme Barduzac commença à raconter. Je la laissai arriver presque à la fin. Puis, profitant d’un moment où elle s’interrompait pour respirer, tandis que se répandait dans la salle un murmure de componction, je dis paisiblement :
– Mais vous vous trompez, madame ? C’est de la mort du capitaine X... que vous parlez là.
Elle rougit et me jeta un coup d’œil en dessous.
– Que dites-vous ? Qu’est-ce que signifie cette réflexion stupide ?
– Mais regardez, madame, dans le volume intitulé Nos conquêtes d’Afrique. À la page 42, vous trouverez ce récit tel que vous venez de le redire. Il n’y manque pas un mot, je crois.
La rougeur s’accentua sur le teint blafard, Mme Barduzac fut un instant sans répliquer. Enfin, elle dit, en évitant de me regarder :
– Il se peut qu’il y ait des coïncidences entre ces deux morts. Mais ce que je raconte, je le tiens de votre mère elle-même.
Depuis lors, elle ne refit plus le récit mensonger. Mais son animosité contre moi s’accrut de toute sa vanité blessée. Peu m’importait. J’étais heureuse de lui avoir montré que sa supercherie se trouvait découverte, car le mensonge m’est odieux et je lui en voulais d’avoir ainsi trompé ma confiance d’enfant.
À dix-huit ans, je sortis du couvent, bien pourvue de brevets et très marrie d’aller vivre chez mon tuteur. La mère supérieure, ma confidente, m’avait dit : « Soyez bonne et patiente, n’indisposez pas contre vous Mme Barduzac par une humeur batailleuse. Il faut faire des concessions dans la vie, ma petite fille. » J’arrivai donc toute pénétrée de bonnes dispositions à la villa des Palmes – ainsi nommée, sans doute, en l’honneur de celles que porte M. Barduzac – et je fis de louables efforts pour les conserver le plus longtemps possible. Je ne crois pas m’adresser des louanges imméritées en déclarant que je fus angélique pendant près d’une année. Mais il advint que Mme Barduzac s’autorisa de ma patience pour me traiter en vaincue. Elle était de ces natures qui ne baissent pavillon que devant plus désagréables qu’elles. Je le compris très vite et sortis bec et ongles. Ce fut l’état de guerre. L’existence était pénible pour moi et j’aspirais à mes vingt et un ans qui me permettraient de remercier les Barduzac en les quittant avec ravissement. Cette date bienheureuse serait atteinte dans huit mois. Jusque-là, il faudrait patienter...
Et où irais-je ?
Je ne savais encore. Probablement, je me retirerais comme dame pensionnaire en quelque couvent jusqu’à mon mariage – en admettant que je trouve un mari à mon goût, car je n’avais rien exagéré en disant à Mme Barduzac que je serais quelque peu difficile.
Alors, s’il le fallait, je resterais vieille fille, je chercherais quelque occupation intéressante, je tâcherais de me rendre utile à mon prochain.
Mais... oui, vraiment, j’aimerais mieux le mariage – pourvu que le mari me plût beaucoup.
II
Dans l’après-midi de ce jour où Mme Barduzac m’avait fait part de l’invitation des Samponi, je sortis pour faire quelques courses. Le temps était orageux ; je m’en allais sans entrain, avec le même air lassé, je pense, que tous les gens coudoyés par moi. Comme je traversais une rue, un homme jeune, bien mis, me salua. Je reconnus le docteur Borday, un jeune médecin que Mme Geolle avait récemment présenté à Mme Barduzac, lors de sa dernière soirée mensuelle.
Tout en continuant ma route, je me remémorais quelques mots aimables prononcés par ce jeune homme, qui avait une figure agréable et des manières distinguées. Il m’avait regardée ce jour-là un peu plus longuement, peut-être, qu’il n’eût dû le faire, et j’avais détourné les yeux en prenant un petit air digne. Parce que j’étais jolie, s’ensuivait-il que l’on pût se permettre de me dévisager ainsi ?
Car j’étais jolie. Dire le contraire eût été de la fausse humilité. La régularité de mes traits laissait peut-être à désirer, mais j’avais un teint délicat, des cheveux châtain doré, qui ondulaient tous seuls, et de grands yeux noirs vifs et doux. D’après ce que m’avait dit un jour Mme Geolle, ma physionomie devait être très expressive. En outre, j’étais mince, bien faite, habillée d’un rien, et mes mains, la finesse de mes attaches, dénotaient mon origine aristocratique, s’il fallait en croire toujours Mme Geolle.
Ces constatations ne me rendaient pas vaniteuse. Jusqu’ici, j’ignorais la coquetterie. Si j’aimais être gentiment mise, ce n’était aucunement dans le but d’attirer l’attention masculine. Celle-ci, je dois le dire, me laissant fort indifférente, aucun des cinq ou six jeunes gens que j’avais pu connaître jusqu’à ce jour, dans le cercle des relations de Mme Barduzac, n’ayant eu l’heur d’attirer ma sympathie.
En songeant ainsi, j’avais atteint le magasin « Aux Rois Mages », but de ma sortie. Près de la poste, je croisai M. Huchard, un ancien commerçant, ami des Barduzac, chez lesquels il venait chaque dimanche dîner et faire sa partie. Il avait très largement dépassé la cinquantaine, portait perruque brune et essayait de me faire la cour, sans se rebuter de ma froideur. Cette fois encore, il m’adressa un grand salut et s’arrêta pour me demander des nouvelles de Mme Barduzac, en bombant son torse sous une jaquette du bon faiseur. Je répondis en quelques mots brefs et le quittai pour pénétrer dans le magasin.
Au rayon de mercerie, je fis mes petites emplettes. Cela réglé, je flânai un instant entre les comptoirs. Des étoffes de tous genres, dépliées, offraient aux yeux des acheteurs l’invite de leurs nuances variées. Il y en avait pour tous les goûts. Mais le mien s’arrêta sans hésitation sur un crêpe bleu pâle – un bleu doux, délicieux, qui rappelait celui d’un ciel d’été, après la pluie.
Je pensai : « Voilà comme je voudrais ma robe, pour la matinée des Samponi. »
Et, aussitôt, un plan s’élabora dans mon esprit. Mme Barduzac allait vouloir me conduire chez sa couturière, qui m’habillait mal. Toutes deux, en outre, m’imposeraient leur goût, lequel n’était jamais conforme au mien. Si j’achetais cette étoffe ? J’étais adroite, je ferais cette robe moi-même... Mme Barduzac serait furieuse, évidemment, mais il faudrait bien qu’elle acceptât le fait accompli, ce magasin ne reprenant pas les marchandises.
Un commis s’approchait. J’indiquai le métrage nécessaire après m’être assuré que j’avais sur moi assez d’argent. Puis, la jolie étoffe enveloppée, je l’emportai, toute satisfaite de mon achat et pas fâchée de jouer un tour à Mme Barduzac.
Elle traversait précisément le vestibule comme j’entrais. Son regard fut aussitôt attiré par mon paquet.
– Qu’apportez-vous là, Gillette ?
– De l’étoffe, madame, du crêpe bleu pâle pour faire ma robe.
– Du crêpe... pour votre robe ? Vous avez choisi sans moi et sans demander conseil à Mlle Boitte ?
– Je n’ai pas besoin de l’avis de Mlle Boitte, car je compte faire cette robe moi-même.
Elle leva un peu les bras en laissant échapper un ricanement.
– Ah ! Ce sera du joli ! Vous serez bien mise ! Mais je n’ai aucunement envie d’attirer les moqueries de tous, en conduisant chez les Samponi une caricature.
Je ripostai :
– Soyez tranquille, je ne vous ferai pas honte. Et j’aurai une toilette complètement à mon idée.
– Elles sont sensées, vos idées !... Montrez-moi cela.
Je défie le paquet et, dans la salle à manger, j’étalai l’étoffe sur la table. Sous le jour ensoleillé qui pénétrait librement ici elle me parut plus jolie encore.
Mme Barduzac leva les épaules et plissa son nez qu’elle avait large et court.
– C’est une étoffe trop légère, qui ne fera pas d’usage. Et ce bleu ! Quand vous aurez porté trois fois votre robe, vous verrez ce qu’elle sera devenue !
Ses gros doigts palpaient le crêpe et elle renifla de dédain.
– ... Cet achat est une sottise ! Aussi avez-vous eu bien soin de le faire sans me consulter...
Je me retins pour ne pas répliquer : « Naturellement ! »
– ... En outre, vous n’ignorez pas que le bleu pâle a toutes mes antipathies. Sans doute est-ce pour cela que vous avez choisi cette nuance ?
– Oh, pas du tout, madame ! C’est simplement parce que je l’aime.
D’un geste méprisant, elle rejeta l’étoffe.
– Vous ne serez jamais une femme sérieuse. Je l’ai toujours prédit à mon mari, et il peut constater aujourd’hui si j’ai vu juste.
Elle sortit là-dessus en levant les épaules, mouvement fréquent chez elle au cours de nos entretiens. Et, bien vite, j’emportai le crêpe azuré qui semblait un léger morceau du ciel.
Je dois dire en toute sincérité que ma robe était une des plus charmantes parmi celles qui embellissaient la réunion des Samponi. Je l’avais ornée de fort belles broderies blanches qui me venaient de ma mère et qui, à elles seules, lui donnaient un aspect d’élégance discrète, car par ailleurs la façon en était très simple. Un coup d’œil sur mon miroir m’avait appris qu’elle m’allait fort bien et que ce bleu pâle seyait admirablement à mon teint. Mme Barduzac, cependant, trouva moyen de me dire aigrement, en m’inspectant de la tête aux pieds avant le départ :
– Cette toilette ne vous va en aucune façon. Votre teint n’est décidément pas fait pour les nuances claires. Mais peu vous importe, pourvu que vous échappiez aux conseils des personnes expérimentées.
Ce jugement ne m’émut pas. Au contraire, il me confirma dans l’idée que ma toilette était fort réussie. Et les compliments plus ou moins bien tournés que me glissèrent mes danseurs achevèrent de m’en convaincre.
L’après-midi était chaud et beau. Aussi quittait-on volontiers les salons pour se répandre en groupes dans le jardin très ombragé où le buffet était dressé. En terminant une danse pour laquelle il avait été mon cavalier, le docteur Borday me demanda si je voulais prendre une coupe de champagne. J’acquiesçai et il m’emmena au-dehors.
– Voyez, me dit-il à mi-voix, en me montrant une échancrure bleue dans le feuillage touffu des vieux hêtres, votre robe est de la couleur du temps.
Il ramena son regard vers moi, et je rougis un peu, car une lueur d’admiration y avait passé.
Nous nous assîmes non loin des tables du buffet et causâmes en vidant lentement nos coupes. Il avait un tour d’esprit, une culture intellectuelle qui le mettaient au-dessus des autres jeunes gens présents à cette réunion. Son regard était agréable, un peu câlin.
Ce docteur Borday m’eût été fort sympathique sans un certain air de fatuité qui le déparait à mes yeux. Car si je détestais quelque chose au monde, c’était la pose.
Je plaisais sans doute beaucoup au jeune médecin, puisqu’il m’invita encore deux fois, ce qui fut très remarqué, à en croire Mme Barduzac.
– Oui, ma chère, déclara-t-elle pendant le trajet du retour, votre coquetterie a attiré ce jeune homme. Tout le monde l’a constaté.
Je répondis tranquillement :
– Il me semble pourtant que ma coquetterie est peu de chose auprès de celle de Carlotta Samponi.
– Carlotta agit plus franchement. Vous, sous vos airs réservés, vous savez tout aussi bien vous faire remarquer. Mais ne vous illusionnez pas trop. Le docteur Borday recherchera certainement une très grosse dot.
– Cela le regarde, madame, je n’en ferai pas une maladie.
Et, comme nous passions devant une maison contenant des logements d’ouvriers, je m’arrêtai quelques secondes pour demander de ses nouvelles à une vieille femme que j’aidais à vivre – ce qui me valut une sèche mercuriale de Mme Barduzac quand je la rejoignis.
III
Après cette journée, le soleil bouda pendant plusieurs semaines. Dans son armoire obscure, ma robe couleur de temps se morfondait. Je la mis deux ou trois fois encore, au cours de cet été. Puis l’automne vint et ce fut pour elle l’emprisonnement définitif, pendant des mois.
La vie restait toujours difficile pour moi, chez les Barduzac. Heureusement, je voyais poindre l’aube de ma majorité. En outre, le mariage apparaissait dans mon horizon.