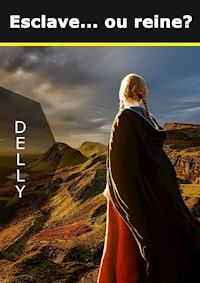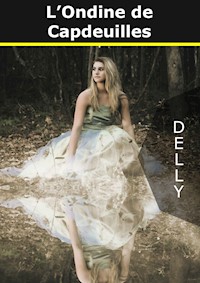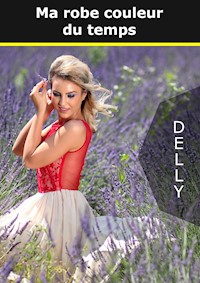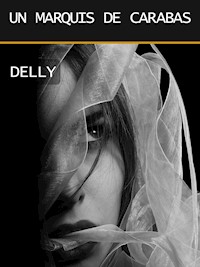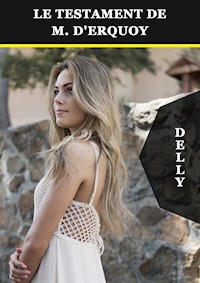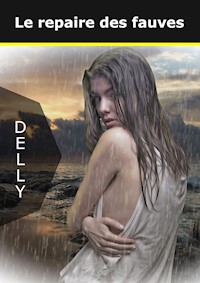
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La belle Suédoise Mme Storven qui s'est remariée avec le duc de Pengdale, lord George Brasleigh, pousse sa fille Hulda, née d'un premier lit, à épouser Charles Brasleigh issu, lui aussi, d'un premier mariage du duc, bien que la jeune fille soit passionnément éprise de lord Harold Treswyll, cousin de Charles. Elle réussit dans son entreprise pendant le séjour que ce dernier fait en Orient. Hulda règne alors en maîtresse à Elsdone Castle. Eric Dorgan, le frère de sir Hector Dorgan, tuteur de lord Harold, a contracté une dette de reconnaissance envers un Français, Jacques Versigny, qui, sur son lit de mort, demande qu'on prenne soin de ses enfants, Yildiz et Hubert. Charles Brasleigh étant décédé dans de mystérieuses circonstances, Hulda pense alors pouvoir conquérir Harold, mais ce dernier épouse la belle Yildiz. Celle-ci sera-t-elle heureuse avec cet homme qui se révèle autoritaire, orgueilleux et n'a jamais pu abandonner les coutumes de l'Orient ? Les autres femmes qu'il a connues avant elle ont souffert d'être délaissées. Qu'en sera-t-il pour Yildiz que Hulda poursuit d'une haine impitoyable ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le repaire de fauves
Pages de titrePremière partieIIIIIIVVVIVIIVII - 1Deuxième partieII - 1III - 1IV - 1V - 1VI - 1VII - 2VIIIIXXTroisième partieII - 2III - 2IV - 2V - 2VI - 2VII - 3VIII - 1IX - 1X - 1XIPage de copyrightLe repaire des fauves
Delly
Première partie
I
En cet après-midi de fin juillet, le duc de Pengdale avait convié toute la jeunesse aristocratique du comté à une réception donnée pour le vingtième anniversaire de son fils unique, lord Charles Brasleigh. Des acteurs mondains occupaient le théâtre dressé dans la galerie de marbre, des couples dansaient dans les salons décorés avec une somptuosité princière, d’autres s’en allaient flirter à travers les magnifiques jardins d’Elsdone Castle dont l’entretien, disait-on, représentait une lourde charge pour le duc actuel, les revenus de celui-ci, probablement par suite d’une mauvaise gestion, étant devenus sensiblement inférieurs à ceux de ses prédécesseurs.
Le maître de céans, grand vieillard au front chauve, à la mine indolente et distinguée, circulait au milieu de ses hôtes avec l’aide d’une canne dont ses jambes rhumatisantes ne lui permettaient plus de se passer. Il adressait un mot à l’un, à l’autre, avec l’air de courtoise indifférence qui lui était habituel dans ses relations mondaines. De fait, lord George Brasleigh, huitième duc de Pengdale, ne s’intéressait guère qu’à lui-même et – dans de moindres proportions – à son entourage familial. Sa nature molle, sans ressort, égoïste et orgueilleuse, n’avait jamais été capable d’une amitié sérieuse. Par contre, elle faisait de lui une proie toute désignée pour la femme habile, souple, ambitieuse, qui, vingt-deux ans auparavant, réussissait à se faire épouser par lui en secondes noces et lui donnait le fils vainement désiré au cours de sa première union.
Elle était suédoise, de bonne famille bourgeoise, fille d’un professeur de musique. Sa voix, très remarquable, lui valait de grands succès dans les concerts où elle se faisait entendre, particulièrement en Russie et en Allemagne. Sans réelle beauté, cette jeune fille aux allures sérieuses et au sourire discret, possédait cependant une séduction enveloppante qui agit aussitôt sur le duc, plus âgé qu’elle de vingt-cinq ans. Bien que ce mariage représentât une mésalliance telle qu’il n’en avait jamais existé chez les Brasleigh, l’une des plus anciennes, des plus illustres familles d’Angleterre. Ebba devint duchesse de Pengdale. Elle ne jouit pas très longtemps de son triomphe, d’ailleurs quelque peu gâté par la froideur que lui témoignait en général l’aristocratie du royaume. Après six années de mariage, elle mourut d’une pleurésie au cours d’un voyage en Italie.
Avant de quitter ce monde, elle avait fait promettre à son mari d’appeler pour la remplacer près de leur fils, enfant malingre et souffreteux, sa sœur cadette que la mort d’un mari dissipateur laissait presque sans ressources, avec une fille de l’âge du petit lord Charles. En conséquence. Mme Storven arriva bientôt de Suède en Angleterre, s’installa chez son noble beau-frère et, peu à peu, prit toute la direction de l’intérieur.
Le duc, tenant avant tout à sa tranquillité, la laissait entièrement libre sous ce rapport, ayant du reste vite reconnu qu’elle y était fort entendue. Elle possédait en outre un caractère très souple, agréable, un esprit assimilateur, un extérieur distingué. Son éducation ne laissait rien à désirer au point de vue mondain. Comme femme de consul, elle avait eu l’occasion de fréquenter quelques salons aristocratiques, de telle sorte qu’elle put aussitôt remplir fort correctement, dans les résidences de son beau-frère, le rôle de maîtresse de maison qui lui était dévolu.
Il se trouvait des gens pour prétendre que Mme Storven avait eu des visées plus hautes. Mais, en admettant que ceux-là vissent clair, le duc n’avait pas réalisé les ambitions de sa belle-sœur. Sans doute jugeait-il suffisante l’introduction, dans son arbre généalogique, d’une descendante des Stôrm, petits bourgeois de Suède.
D’ailleurs, son attitude à l’égard de Mme Storven avait toujours conservé quelque chose de cérémonieux, comme s’il tenait à bien maintenir une certaine distance et à la traiter plutôt en invitée qu’en parente.
Il la cherchait en ce moment et, l’apercevant à l’entrée de la galerie de marbre, alla vers elle en boitant un peu.
– Savez-vous où est Charles, madame ?
– Charles ? Non, voici déjà quelque temps que je ne l’ai vu... Mais je crains que vous ne vous fatiguiez, my lord...
Elle attachait sur le vieillard un regard plein de sollicitude.
– ... Vous circulez beaucoup trop et vous risquez de vous trouver immobilisé demain.
– Je vais me retirer dans la bibliothèque, maintenant. C’est assez pour moi, en effet... Hulda, sauriez-vous me dire où se trouve Charles ?
Il s’adressait à une jeune fille qui passait à ce moment près de lui. Dans le visage d’une blancheur neigeuse, les fines lèvres roses et les yeux bleus aux reflets de turquoise rirent doucement.
– Charles est en train de se morfondre. Regardez par ici, mon oncle.
La jeune fille, de la main, désignait une des larges ouvertures qui faisaient communiquer la galerie avec les salons voisins.
Dans cette embrasure se tenait debout un maigre jeune homme, mal bâti, de physionomie insignifiante et même légèrement niaise. Il portait le smoking avec la plus complète inélégance et ses cheveux blonds s’ébouriffaient comme s’il venait d’y passer les doigts au hasard.
Précisément, à l’instant où Hulda Storven le désignait au duc, une main s’abattait sur l’épaule osseuse du futur maître d’Elsdone Castle, tandis qu’une voix brève et railleuse demandait :
– Vous avez l’air de vous amuser follement, Charlie ?
Lord Charles sursauta et se détourna en jetant sur celui qui l’abordait ainsi un regard craintif.
– Quels doigts de fer vous avez, Harold !... Non, je ne m’amuse pas du tout, comme bien vous pensez. Mon père aurait pu me faire grâce de cette corvée...
– Voyons, il faut bien vous présenter dans le monde ! Vous ne pouvez vous occuper à perpétuité de canotage et de pêche.
Charles eut une moue boudeuse.
– Pourquoi pas ? Rien ne me plaît que cela. Ici, je m’ennuie... et aujourd’hui surtout ! Harold, si je m’esquivais en douceur ?
Il regardait avec quelque perplexité son interlocuteur – un jeune homme qui paraissait plus âgé que lui bien qu’en réalité il eût un an de moins. Grand, souple, parfaitement proportionné, lord Harold Treswyll réalisait un remarquable type masculin. La fermeté des traits nettement dessinés, l’expression altière de la physionomie, le pli froidement ironique des lèvres frappaient aussitôt, en ce jeune visage déjà singulièrement viril, et plus que tout encore le regard dur, railleur, énigmatique des yeux bruns où, comme en ceux des fauves, passaient de troublantes lueurs vertes.
Le duc, qui venait vers son fils, s’était arrêté un moment pour considérer les deux jeunes gens, debout l’un près de l’autre. Le contraste était saisissant. Lord Treswyll écrasait littéralement de son aisance hautaine, de sa vigueur souple, de son élégance patricienne, l’héritier du duché de Pengdale.
Un pli se formait sur le front du vieillard. Celui-ci, entre ses dents, murmura avec un dépit auquel se mêlait une sorte d’orgueilleuse satisfaction :
– Quel homme il sera, cet Harold !
Comme il s’approchait de son fils, lord Treswyll répondait avec un sourire sarcastique à la question de Charles :
– Vous êtes libre de le faire, mon cher. Mais je doute que votre père en soit très satisfait.
Le duc, entendant ces mots, demanda :
– Satisfait de quoi ?
Charles tourna vers lui un regard quelque peu effaré.
– Ah ! mon père, vous voilà ? Je disais à Harold que... que je préférerais à tout ceci une promenade en canot.
Le duc répliqua sur un ton d’impatience :
– Ne faites pas l’enfant, je vous prie. Cette réunion est donnée pour vous et vous allez me faire le plaisir de vous y comporter correctement. Tenez, voici là-bas lady Grace Mingh que sir Julius reconduit à sa place. Voyez à être son cavalier pour la prochaine danse et tâchez de trouver quelque chose d’aimable à lui dire.
La physionomie de Charles laissa voir une véritable consternation.
– Oh ! non, non ! J’ai horreur de la danse, vous le savez... et lady Grace est si... si...
– Si mordante, acheva lord Treswyll. Eh bien, Charlie, tant mieux, cela stimulera votre amour-propre.
Lord Brasleigh répliqua d’un ton pleurnichard :
– Oui, oui, c’est bon à dire ! Vous, Harold, vous êtes un demi-dieu pour ces jeunes personnes qui sont toutes en admiration devant vous. Mais elles voient bien que je déteste le monde, que j’ai peur d’elles, de leurs airs moqueurs, et je suis bien sûr que...
Le duc l’interrompit brusquement :
– Assez, Charles ! Faites ce que je vous dis, en y mettant de la bonne volonté. En outre, votre santé s’améliorant beaucoup, je vous avertis que nous passerons une partie de l’hiver prochain à Londres, car il est grand temps de vous mettre en contact avec la société où, par votre rang, vous êtes appelé à vivre.
Ce dernier coup parut anéantir lord Brasleigh. Il s’éloigna, tête basse, la démarche traînante, tout emprunté dans son vêtement sorti de chez le premier tailleur de Londres.
Son père et son cousin le suivaient des yeux. Lord Treswyll murmura, d’un ton où l’ironie se mêlait au dédain :
– Ce pauvre Charlie se souviendra de cette journée d’anniversaire !
Le duc tourna vers son petit-neveu un regard assombri.
– Il s’habituera... Je l’ai, jusqu’ici, laissé trop libre de mener cette existence de plein air, d’ailleurs nécessaire à sa santé. Mais il n’a que vingt ans et la vie de Londres, les voyages que je lui ferai faire, le changeront vite.
– Cela se peut... bien que j’en doute.
Une lueur d’irritation passa dans les yeux du vieillard.
– On croirait toujours, à vous entendre parler de Charles, que vous avez dix ans de plus que lui ! Cependant, il est votre aîné. En outre, à certains points de vue, il est beaucoup plus sérieux que vous. Sa conduite ne peut donner lieu à aucun reproche... tandis qu’il m’est revenu qu’à Londres, à Paris, vous vous faisiez déjà remarquer dans le monde où l’on s’amuse.
– Avez-vous l’intention de me faire des reproches à ce sujet, mon oncle ?
Le ton était poli, mais bref, et dans le regard hautain passait un éclair qui fit baisser les yeux du vieillard. Celui-ci répliqua, d’un accent plus doux :
– Je sais que ce serait chose inutile avec vous. D’ailleurs, cela ne me regarde pas. Sir Hector est votre tuteur et du moment où il juge parfait...
– Comment, s’il le juge parfait ? Mais c’est lui-même qui m’a initié à la vie de plaisir dans laquelle il est passé maître.
– J’espère du moins que vous ne l’imiterez pas dans sa passion pour les cartes.
– Quant à cela, non ! Je déteste le jeu.
– C’est fort heureux pour vous. Car sir Hector a depuis longtemps laissé à Monte-Carlo et ailleurs sa part de patrimoine. Sans son frère, il serait aujourd’hui dans la misère.
– Pas précisément, puisqu’il aurait son neveu pour l’aider à vivre.
– En effet. Je voulais dire qu’il lui aurait fallu changer d’existence, renoncer à cette vie cosmopolite et indépendante que lui permet la libéralité de M. Dorgan... Avez-vous eu de récentes nouvelles de celui-ci ?
– Non, aucune depuis plus de six mois. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant pour nous qui connaissons l’originalité de mon oncle.
– En tout cas, c’est une originalité qui lui a rapporté l’opulence et une situation quasi royale. Si vous héritez de lui, Harold, vous serez probablement l’homme le plus riche d’Angleterre.
Lord Treswyll dit avec aisance :
– Je le crois, en effet.
Le duc le quitta, se dirigeant vers la bibliothèque où il allait chercher un peu de repos. Harold gagna le salon voisin, suivi par de nombreux et éloquents regards féminins. Hulda Storven, quittant deux jeunes gens avec lesquels elle s’entretenait, vint aussitôt à lui.
– Vous ne partez pas encore, lord Treswyll ?
Elle attachait sur le jeune homme ses yeux bleus dont la douceur câline s’animait d’un éclair de passion.
– Tout à l’heure, quand vous aurez fait avec moi un tour dans les jardins.
Le teint si blanc de la Suédoise devint légèrement rose. Elle dit avec vivacité :
– Allons !
Ils s’éloignèrent, sortirent du salon par une des portes-fenêtres ouvertes sur la grande terrasse qui, de ce côté, longeait la façade du château. Tous les regards suivaient le jeune lord et sa compagne, belle créature mince, à la taille flexible, à la démarche onduleuse. Une vieille dame, qui accompagnait sa petite-fille à cette fête, chuchota, en se penchant à l’oreille de sa voisine, l’Honorable Violet Sempton :
– Ils flirtent beaucoup ensemble, paraît-il. On les a vus plusieurs fois se promener à cheval du côté de Deerden. Mme Storven ferait bien de prendre garde, car lord Treswyll, si jeune soit-il, fait déjà perdre la tête aux femmes.
– Hulda Storven est très sérieuse. Mais il est bien vrai qu’il est terriblement beau !
– Terriblement, c’est le mot. Dans quelques années, avec ce regard où la séduction et la dureté se mêlent si étrangement... eh bien, je plains celles dont il fera ses victimes !
– Et encore plus celle qui deviendra sa femme.
– Il est de fait que... Peut-être – bien qu’elle soit un peu plus âgée que lui – sera-ce miss Storven ?
– Y pensez-vous ? Il n’y a pas plus orgueilleux que les Dorgan, qui se vantent superbement de leur origine royale, de leur arbre généalogique vierge de mésalliance. Jamais sir Hector et lady Treswyll n’ont reçu chez eux la seconde femme du duc de Pengdale, et si vous avez bien remarqué, lady Bruswell...
Ici, Mrs. Sempton baissa encore la voix :
– ... Lord Treswyll semble traiter Mme Storven avec tout juste la politesse qu’un homme bien élevé doit à une femme, lorsqu’il est absolument obligé d’avoir des rapports avec elle. Quant à sa fille, elle est probablement pour lui une distraction, rien de plus. Mais je veux la croire assez intelligente et prudente pour se défier, pour arrêter à temps.
Lady Bruswell hocha la tête.
– Sait-on ! Enfin, cela regarde sa mère et elle. Au fond, Mme Storven est une personne distinguée. On ne peut lui reprocher que son origine roturière.
– Évidemment... Ah ! la voici.
Sortant d’un salon voisin, Mme Storven allait passer près des deux causeuses. Elle semblait chercher quelqu’un. Avisant un jeune homme brun, petit, de physionomie douce et fine, elle lui demanda :
– Sauriez-vous me dire où est ma fille, sir Julius ?
– Je l’ai vue se diriger vers les jardins avec lord Treswyll, madame.
Une ombre passait dans le regard de sir Julius, tandis qu’il répondait ainsi.
Mme Storven eut peine à réprimer un vif mouvement de contrariété. Elle réfléchit un instant, puis dit en souriant aimablement :
– Puis-je vous demander, sir Julius, de la chercher pour l’avertir que j’ai besoin d’elle ?
Le jeune homme hésita avant de répondre :
– Je suis à votre disposition, madame.
Il quitta le salon et s’engagea dans la direction où il avait vu disparaître lord Harold et Hulda. Amoureux de la belle Suédoise, sir Julius Barclay éprouvait une secrète jalousie à l’égard de lord Treswyll qu’il semblait accaparer toute l’attention de Mlle Storven et contre lequel il se sentait incapable de lutter, s’il lui plaisait de prendre le cœur de la jeune étrangère.
Au tournant d’une allée, ceux qu’il cherchait lui apparurent. Lord Treswyll tenait par l’épaule un jeune garçon jardinier, qu’il secouait sans pitié. Celui-ci, blême d’effroi et de douleur, laissait échapper des gémissements sous l’étreinte de cette main dont la finesse cachait une force peu commune. Près d’Harold, Hulda Storven considérait cette scène avec tranquillité. Comme sir Julius approchait, il l’entendait qui disait sur un ton d’admiration câline :
– Il ne fait pas bon d’être corrigé par vous, lord Treswyll !
D’un mouvement souple, sans effort, le jeune lord envoya le jardinier rouler plus loin, sur le gravier de l’allée. En se détournant alors, il aperçut l’arrivant.
– Tiens, vous voilà, Barclay !
Hulda, à la vue de sir Julius, ne put réprimer un léger mouvement d’impatience.
Le jeune homme expliqua :
– Mme Storven vous demande, miss Storven, car elle a besoin de vous.
Les blonds sourcils de la jeune Suédoise se rapprochèrent. Un mot d’irritation était sur ses lèvres. Elle le retint pourtant et se tourna vers Harold :
– Je retourne donc, my lord. Venez-vous aussi ?
– Oui, car je vais partir maintenant.
Tandis qu’ils reprenaient tous trois la direction du château, sir Julius demanda :
– Qu’avait donc fait ce pauvre garçon que vous secouiez si bien, Treswyll ?
– L’imbécile, comme nous passions, avait dirigé sur nous sa lance d’arrosage.
– Exprès ?
Lord Treswyll répliqua, sur un ton d’altière ironie :
– Vous ne supposez pas, je pense, que personne dans la contrée se hasarderait à me causer « exprès » quelque désagrément ?
Hulda approuva vivement :
– Certes, on sait trop bien ce qu’il en coûterait ! Vous auriez brisé les os de ce garçon, si vous l’aviez voulu, avec ces doigts qui n’ont pas l’air d’y toucher.
Elle levait les yeux sur Harold et sir Julius, le cœur serré par la colère jalouse, y revit l’admiration presque idolâtre qu’il avait déjà remarquée tout à l’heure.
À quelques mètres du château, lord Treswyll s’arrêta, en disant à Hulda :
– Je vais prendre congé de vous ici, car il est inutile que je passe par les salons. Mon oncle doit se reposer. Vous lui direz bonsoir de ma part, je vous prie. Donc, au revoir.
Et, presque sans baisser la voix, il ajouta :
– À demain.
Il serra la main de la jeune fille, celle de sir Julius et se dirigea vers l’extrémité du bâtiment principal pour, de là, gagner le hall.
Hulda se mit à la recherche de sa mère. Elle la trouva dans un petit salon où il n’y avait personne d’autre en ce moment. Mme Storven se leva du fauteuil qu’elle occupait et ferma la porte derrière sa fille.
Hulda dit avec une surprise un peu ironique :
– Pourquoi tant de précautions ? S’agit-il de secrets d’État ?
– Non, mais d’une chose plus importante à mes yeux. Hulda, Hulda, tu sais pourtant quel but je me suis proposé, dès le moment où je suis venue chez le duc de Pengdale ! Et tu es en train de tout compromettre par ton fol engouement pour lord Treswyll ! Je sais que tu vois souvent celui-ci... qu’au cours de tes promenades tu le rejoins à des endroits convenus...
La jeune fille interrompit sa mère avec colère :
– Qui donc nous a espionnés ? Ah ! que je le connaisse, celui-là, et lord Treswyll, qui déteste tant les racontars, aura tôt fait de lui ôter l’envie de recommencer !
– Inutile de t’emporter. C’est lui qui l’a dit, paraît-il, au fils de sir John Benley.
Une vive rougeur monta aux joues de Hulda.
– Il l’a dit ? Quelle... quelle idée !
– Tu vois l’agréable position dans laquelle te met ton imprudence ? Lord Treswyll, cet orgueilleux jeune homme, se moque de toi avec ses amis, sans aucun souci de te compromettre. Que cela revienne aux oreilles du duc de Pengdale, et tout mon plan s’écroule...
Hulda l’interrompit avec véhémence :
– Jamais je n’épouserai Charles !... Jamais, jamais ! Cette moitié d’idiot... cet être disgracié ! Ah ! non, non ! C’est lord Treswyll que j’aime, et je veux devenir sa femme.
Mme Storven saisit la main de sa fille.
– Hulda, tu déraisonnes ! Charles est le futur duc, et tout enfant, tu me disais : « Je veux devenir duchesse. »
– Pas avec lui !... Non, non ! D’ailleurs, son cousin sera probablement beaucoup plus riche que lui, car il héritera de l’émir.
– Ce n’est pas absolument certain.
– Mais très probable. Tandis que les affaires du duc sont embarrassées, paraît-il.
– Mais le titre ?
– Le titre ? Qui sait ? Lord Harold le portera peut-être, car Charles n’a pas une brillante santé. Mais, en tout cas, je vous le répète, maman, c’est lui que j’aime... que j’aime au point de...
Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, la poitrine oppressée par une émotion violente, puis elle acheva d’une voix étouffée :
– Au point de tout lui sacrifier.
– Hulda ! Mais vraiment, oui, tu es folle, complètement !... Et si lui ne t’aime pas ?... S’il cherche seulement une distraction ?
Hulda pâlit, sans répondre.
Sa mère insista :
– Crois-tu qu’il t’aime ? Mon enfant, tu as été jusqu’ici une fille sérieuse, tu es intelligente et d’esprit réfléchi. Eh bien ! tu as dû pouvoir discerner quelque peu si les sentiments de lord Treswyll répondent à ceux que tu éprouves pour lui ?
Hulda hésita pendant quelques secondes, avant de répondre brièvement :
– Je crois qu’il n’aimera jamais que lui-même.
– Ce qui veut dire qu’il ne se donne même pas la peine de te cacher que tu es pour lui l’objet dont il daigne s’amuser, pendant quelque temps ? Ah ! tu as beau chercher à t’aveugler, tu sais bien qu’il est trop orgueilleux pour se mésallier, celui-là ! Va, ma chère, crois-moi, renonce à cette chimère, prépare les voies pour épouser Charles, qui fera un mari de tout repos et que tu mèneras à ta guise... tandis que l’autre !...
– L’autre sera un maître. Et s’il me plaît de me soumettre à lui ?... s’il me plaît d’être esclave ?... d’être « son » esclave ?
Hulda se redressait, les joues empourprées, le regard en feu. Soudainement, Mme Storven comprit que – semblable en cela à beaucoup de mères – elle ne connaissait pas sa fille.
Pendant un moment, elle resta stupéfaite devant cette révélation.
Certes, elle avait bien deviné depuis quelque temps que Hulda aimait le petit-neveu du duc de Pengdale ; mais elle s’en inquiétait peu, sachant que lord Treswyll était déjà pour toutes les femmes, selon l’expression de son cousin Charles, une sorte de demi-dieu, et se disant que la sagesse, la pondération, les tendances pratiques de sa fille lui feraient vite comprendre la folie d’un attachement trop vif pour ce très jeune homme de nature fort inquiétante, orgueilleux comme Lucifer lui-même et dont on racontait dans le pays, tout bas – car il était déjà redouté – certains traits de caractère qui promettaient pour l’avenir.
Or, Mme Storven découvrait qu’elle s’était lourdement trompée. Cette tranquille Hulda, qu’elle croyait toujours disposée à un mariage de raison et d’intérêt dès longtemps combiné par sa mère, cette belle créature dont la coquetterie habile se mêlait de gracieuse réserve et qui cachait sous une apparente égalité d’humeur sa volonté impérieuse, son goût de l’autorité, se révélait comme une amoureuse prête à plier humblement sous le joug de son vainqueur.
Mme Storven balbutia :
– Jamais je ne me serais attendue à cela de ta part ! C’est... c’est inouï !... Et il le sait, probablement. Il se joue de toi ! Car jamais, jamais il ne songera à t’épouser ! Ah ! je sens trop bien comme il nous dédaigne, comme il nous regarde de haut, avec toute sa morgue de grand seigneur ! Toi-même, tu dois en avoir l’impression ?
Hulda laissa passer un temps, avant de répondre avec effort :
– Oui. Mais j’espère arriver à me faire aimer... En tout cas...
Ici, l’accent redevint ferme :
– Si, plus tard, j’en devais épouser un autre, je sens bien que je n’aimerai que lui.
– On dit cela... mais heureusement le temps arrange bien des choses. D’ailleurs, le seul parti raisonnable à prendre est de t’éloigner de lui. Tu iras passer quelques mois chez ta tante Stava...
Hulda eut un geste d’ardente protestation.
– Cela, non !... Oh ! certes non ! Je resterai ici, je continuerai de le voir...
Avec un sourire d’ironie forcée, elle ajouta :
– Ne craignez rien, je suis une personne raisonnable et je saurai toujours me tenir dans les limites permises. Mais qu’il ne soit plus question de départ. Vous m’avez élevée dans un complet esprit d’indépendance, vous m’avez dit plus d’une fois : « Ton genre d’éducation te permettra de te garder toi-même. » À quel propos viendriez-vous me retirer ma liberté, maintenant que j’en veux faire usage pour conquérir mon bonheur ?
– Ton bonheur ? Ah ! malheureuse enfant, ce n’est pas avec lord Treswyll que tu le trouverais !
Hulda secoua la tête en murmurant :
– Alors, je ne le trouverai jamais.
II
Celui dont il était ainsi question entre la mère et la fille quittait à ce moment Elsdone Castle dans l’élégant phaéton dont les chevaux très vifs étaient conduits par lui avec maîtrise. L’équipage ayant franchi la grille monumentale, merveille de ferronnerie ancienne, s’engagea dans l’allée de hêtres séculaires qui précédait la résidence des ducs de Pengdale. Aussitôt après, ce fut la campagne, belle et prospère aux alentours immédiats du château, mais qui changeait bientôt d’aspect dès qu’on se dirigeait vers la mer. Des landes apparaissaient entre les bois que le soleil de juillet, à cette heure baissant vers l’horizon, éclairait de chaudes lueurs. Une rivière, qui traversait d’abord le parc d’Elsdone Castle, s’allongeait indolemment entre ses berges rocheuses avant d’aller se perdre plus loin dans l’Océan. Elle était profonde, très navigable, et permettait à lord Charles Brasleigh les parties de canot dont il se montrait si grand amateur.
Un oratoire de style ogival, construit en granit bleu, apparut à l’orée d’un bois. Il avait été bâti en expiation d’un crime commis à cet endroit par un Dorgan d’autrefois. Là commençait le domaine de lord Harold Treswyll.
L’équipage roulait maintenant sur une route forestière bien entretenue, qui débouchait sur une plaine couverte d’une herbe rase que paissaient de nombreux moutons. À gauche, dans un repli de terrain où coulait la rivière, apparaissait une sorte de parc clos d’un mur crénelé au-dessus duquel se dressaient des frondaisons superbes. On ne distinguait là aucune habitation. Lord Harold, d’ailleurs, ne dirigea pas ses chevaux de ce côté. Il continua sa route à travers la plaine ensoleillée, où la senteur de varech et de sel dénonçait l’approche de la mer. Puis le terrain s’éleva, devint plus granitique et, soudainement, à un tournant de la route, un logis apparut, bâti sur un exhaussement du sol. Ce vaste manoir, fait du granit bleu indestructible que, depuis des siècles, on extrayait des carrières de Kitney, présentait un aspect sombre et rébarbatif. Ses ouvertures en plein cintre, la noire patine de ses murs, témoignaient que sa construction remontait à une époque fort lointaine.
Par une route montante, fort bien entretenue, l’équipage gagna cette demeure et s’arrêta devant une voûte romane sous laquelle commençait un large escalier de granit. Sautant à terre, lord Treswyll jeta les guides au domestique assis derrière lui, puis s’engagea dans cet escalier.
Un homme qui descendait se rangea de côté, en s’inclinant profondément. Il était vêtu à la manière des serviteurs arabes et paraissait avoir une vingtaine d’années. Petit, souple, très brun de visage, il présentait dans sa physionomie les traits caractérisant diverses races. Les pommettes saillantes étaient celles du Kalmouk, la mâchoire proéminente rappelait la race noire, les yeux sombres, bien fendus, semblaient attester une origine arabe.
Lord Treswyll, s’arrêtant un instant au passage, demanda brièvement :
– Sir Hector est-il rentré, Abdallah ?
– Oui, my lord, Son Honneur est dans le hall.
Tandis qu’Harold continuait de monter, Abdallah le suivit un instant des yeux. Une fanatique adoration était contenue dans ce regard et en changeait complètement l’expression, douce, indifférente à l’ordinaire.
L’escalier aboutissait à un énorme hall voûté, que de lourds piliers romans divisaient en trois travées. Des tapisseries anciennes cachaient en partie le granit des murs ; sur les dalles étaient jetés des tapis d’Orient, des peaux de tigres, de lions, d’ours blancs. Entre les piliers se dressaient des armures témoignant par leur magnificence des goûts fastueux de ceux qui les avaient portées. De lourdes tables de chêne, des cathèdres sculptées, des escabeaux, des bancs garnis de coussins en précieuses étoffes orientales se trouvaient disséminés dans cette immensité qu’éclairaient, sur toute la longueur du hall faisant face au côté dont l’escalier occupait le milieu, d’admirables verrières colorées, en ce moment éclairées par le soleil couchant. Un orgue occupait l’une des extrémités de cette galerie ; un escalier de granit d’une imposante largeur lui faisait face, conduisant à l’étage supérieur.
Un homme qui fumait, assis près d’une table, tourna vers Harold son visage maigre et ridé, à la bouche sarcastique.
– Ah ! vous voilà, mon cher ? Venez donc que je vous fasse part d’une extraordinaire missive de mon frère. Vous verrez quelle corvée il a l’idée de nous offrir !
Harold s’approcha et prit la lettre qui lui était tendue. Puis il s’assit et commença de lire :
« Voici quelque temps que je ne vous ai donné de mes nouvelles, mon cher Hector. Il faut en accuser l’âge et la fatigue. Je me fais vieux, très vieux, bien qu’ayant un an de moins que vous, car ma santé laisse beaucoup à désirer. Vous n’ignorez pas non plus que je suis l’indolence personnifiée dès qu’il s’agit de correspondre. Puis encore, avouons que nous n’avons jamais été des frères bien affectueux. Tout jeunes gens, nous avons suivi chacun notre voie : vous les courses, le jeu, la grande vie de plaisir, moi l’existence aventureuse du voyageur, de l’explorateur. Ainsi donc, nous nous connaissons en réalité fort peu.
« Néanmoins, les liens de famille sont puissants chez nous. Tout Arabe que je sois devenu, et très attaché à mon pays d’adoption, je n’oublie pas que je suis un Dorgan et j’ai voulu que mon frère, ainsi que le petit-fils de ma sœur, eussent large part des richesses qui me sont échues. C’est pourquoi aussi j’ai résolu de faire d’Harold mon héritier, à charge par lui d’assurer le sort pécuniaire de mes filles, puisque Allah m’a refusé une descendance masculine.
« Toutefois, je voudrais bien le mieux connaître, ce beau neveu qui était déjà un superbe garçon, d’une rare intelligence, quand vous me l’avez amené, il y a six ans. Qu’il vienne donc passer quelque temps près de son oncle l’émir. Je l’initierai à cette vie de grand seigneur oriental qui ne manque pas d’attraits et je lui ferai connaître de charmantes houris, lesquelles ne demanderont pas mieux que de le retenir dans notre paradis.
« Maintenant, passons à autre chose. J’ai un service à vous demander, mon cher Hector.
« Il y a une dizaine d’années, allant de Soumas à Médine, je faillis être victime d’un fanatique, cerveau déséquilibré. Assailli par lui en pleine route, je ne dus la vie qu’à la prompte intervention d’un Français qui me croisait à cheval, au moment où ce fou se jetait sur moi. Je le remerciai de mon mieux et lui demandai son nom. Il s’appelait Jacques de Versigny et habitait généralement Beyrouth avec sa jeune femme, qui appartenait à une très noble, très ancienne famille ottomane tombée dans la pauvreté par suite de la disgrâce dont le sultan avait frappé le grand-père de ladite jeune personne, avec confiscation à la clef et exil forcé sous peine de mort.
« Ce Versigny était lui-même de noble race, et sans fortune. Il exerçait à Beyrouth les fonctions d’ingénieur pour une compagnie française. Je le jugeai aussitôt un homme distingué, intelligent, mais de nature hésitante et faible – en un mot peu fait pour réussir dans la vie.
« Avant de nous séparer, je lui dis que je serais heureux de lui rendre service, au cas où l’occasion s’en présenterait. Après quoi, je ne pensai plus guère à cette aventure, l’un des nombreux incidents dramatiques de mon existence mouvementée.
« Or, voici un mois environ, je reçus une lettre de M. de Versigny.
« Il était très malade, condamné par les médecins, me disait-il. Depuis cinq ans, bien des épreuves l’avaient assailli : la mort de sa femme, la perte de sa situation causée par une féroce jalousie de collègue hautement apparenté, la lutte contre une malchance persistante, la gêne et bientôt la pauvreté. Sa santé, de tout temps délicate, se trouvait maintenant irrémédiablement atteinte. Il se mourait en laissant dans la misère deux enfants, plus une vieille tante incapable de leur être une aide.
« Pas de parenté, ni du côté paternel, ni du côté maternel ; pas d’amis, ceux-ci ayant déserté quand ils avaient craint une demande de secours. Alors, à ses derniers moments, M. de Versigny songeait à moi et venait me prier de procurer le nécessaire à ses enfants, à sa vieille parente, afin qu’après lui tous trois ne mourussent pas de faim.
« Vous le savez, Hector, sans avoir votre parfaite sécheresse de cœur, je ne suis pas une nature sensible, loin de là. Venant de tout autre, pareille requête n’aurait pas été prise en considération. Mais j’avais une dette à l’égard de cet homme. Je résolus de la payer en prenant la tutelle des enfants, en pourvoyant à leurs besoins, à leur éducation, en leur donnant les moyens de gagner plus tard honorablement leur vie.
« Un de mes serviteurs, homme intelligent et débrouillard, fut envoyé à Athènes où se trouvait en dernier lieu Jacques de Versigny. Celui-ci était mourant. Il conservait cependant encore la connaissance nécessaire pour comprendre que je répondais à son désir et, de ce fait, put mourir en paix.
« Sélim lui fit faire des funérailles convenables, paya quelques dettes de boulanger, pharmacien, etc... puis revint me rendre compte de sa mission. La vieille demoiselle de Versigny lui semblait une pauvre cervelle, tout à fait incapable de diriger ses petits-neveux. Ceux-ci, une fille et un garçon, étaient des enfants de neuf et sept ans. Ils paraissaient bien élevés, tranquilles, assez chétifs, ayant sans doute beaucoup pâti par suite des privations.
« Qu’allais-je faire d’eux ? Quelles que fussent mes idées personnelles, je considérais comme sacrée la volonté exprimée par le père au sujet de leur éducation catholique. Or, celle-ci ne pouvait être assurée dans le milieu musulman où je vis.
« Après mûre réflexion, je m’arrêtai à la décision suivante :
« Je vais vous envoyer Mlle de Versigny et les deux orphelins. Vous les logerez très modestement dans une des dépendances de Deerden et je leur ferai une rente suffisante pour leur permettre de vivre avec simplicité. Les enfants, jusqu’à un certain âge, pourront être instruits à l’école de Leigham, après quoi ils seront mis dans un collège où ils travailleront de manière à pouvoir subvenir plus tard à leur existence. Tel est, d’ailleurs, le vœu exprimé par leur père dans la lettre qu’il m’écrivait. J’accomplis ce désir en reconnaissance du service qu’il m’a rendu.
« Je pense que tout cela va déplaire au parfait égoïste que vous êtes, mon cher Hector. Mais vous pourrez confier le soin de ces détails à lady Jane... »
Ici, Harold interrompit sa lecture et rit avec ironie.
– Mon oncle Éric ne connaît pas ma mère, cela se voit. S’il croit qu’elle se dérangerait quelque peu pour ces étrangers !... Mais quelle singulière idée de nous envoyer ceux-ci !
– N’est-ce pas ? Oh ! il en a de drôles, Éric ! Il y avait cent autres combinaisons, s’il tenait absolument à contenter le désir de ce Français. Mais non, il se décharge élégamment sur autrui de la corvée – tout en accusant son frère d’égoïsme !... Enfin, il n’y a pas moyen de lui refuser cela !
– Non, c’est difficile. Mais où les mettrons-nous ?
Pendant un moment, Harold réfléchit, puis il dit sur le ton de décision qui lui était habituel :
– Black-House leur conviendra. Il suffira de donner à Spread les ordres nécessaires pour qu’elle prépare cela convenablement, qu’elle installe ces gens-là et leur fournisse les indications dont ils auront besoin. Nous n’avons pas à nous en occuper autrement.
Sir Hector eut un geste approbateur.
– Très bien, mon cher. Vous arrangez tout en un clin d’œil, là où d’autres hésiteraient, chercheraient... Ah ! quel cerveau est le vôtre, mon bel Harold !
Il considérait orgueilleusement le jeune visage dont un rayon de soleil, descendant des verrières, caressait à ce moment le front mat bien dégagé, les souples cheveux bruns aux chauds reflets fauves.
Harold accueillit l’exclamation de son oncle avec l’indifférence d’un être accoutumé aux adulations. Il posa sur la table près de lui la lettre d’Éric Dorgan, prit un cigare et l’alluma, tandis que sir Hector, après un court silence, demandait :
– Rien de nouveau à Elsdone Castle ?
– Rien du tout. Charles s’est montré sauvage à son ordinaire et son père a dû se fâcher presque pour obtenir qu’il allât inviter lady Grace Mingh.
Sir Hector eut un rire sardonique et ses yeux brillèrent de satisfaction mauvaise.
– Ah ! ah ! il est charmant, le futur duc ! Il fera honneur à la famille. George doit être fameusement mortifié ! Tant mieux ! Il n’avait qu’à ne pas faire ce sot mariage et, alors, il n’aurait pas eu lieu de rougir de son héritier.
À nouveau, le regard orgueilleux de sir Hector enveloppait Harold.
Lord Treswyll se leva et se dirigea vers une très large baie fermée d’une porte de chêne, qui faisait face à l’escalier par où il était venu. Il ouvrit les deux battants, tout en disant :
– La chaleur est supportable, maintenant.
La porte donnait sur une terrasse de granit garnie d’orangers et de lauriers-roses, qui longeait tout l’immense hall. De magnifiques géraniums, dans des vases de vieille faïence, décoraient la balustrade massive, coupée en son milieu par trois escaliers conduisant aux jardins. Ceux-ci formaient une suite de terrasses fleuries garnies de bassins, de vasques en pierre patinée par le temps, de charmilles et de bosquets. Mais le regard était, avant toute chose, attiré, fasciné par la vue qui s’étendait au loin devant lui : l’Océan, houleux, difficile toujours dans ces parages, semé d’écueils et, aujourd’hui, d’une ardente nuance verte sur laquelle le soleil déclinant répandait son lumineux or pâle.
Le terrain, qui descendait du manoir en pente assez rapide, redevenait plan là où finissaient les jardins et continuait ainsi jusqu’à la mer. On distinguait de la terrasse les sombres têtes des pins bordant une partie de la grève et quelques-uns des rochers aux formes fantastiques dont était parsemée toute cette côte sauvage où la furie des flots, aux jours de tempête, offrait un spectacle d’une tragique et terrifiante beauté.
Lord Treswyll demeura un moment immobile, les yeux attachés sur la mer. Il se détourna à peine en entendant son oncle demander :
– Eh bien ! avec la blonde Hulda, cela va toujours ? La sérieuse et irréprochable jeune personne s’emballe de plus en plus pour vous, mon beau faune ?
Harold eut un léger sourire d’ironie.
– Sérieuse, elle l’est en apparence, pour qui ne l’étudie pas attentivement. Là-dessous se cache une nature de coquette, habile, ambitieuse, intéressée, un caractère orgueilleux et autoritaire que je m’amuse beaucoup à mettre sous le joug.
– Parfait ! Voilà ce qu’il faut ! Depuis le commencement du monde, la femme, quand elle sait bien s’y prendre, a mené l’homme et lui a fait commettre plus d’une sottise. Il convient que, de temps à autre, l’un de nous les asservisse, ces astucieuses dames. Or, je crois que vous vous entendez à cela, mon cher.
Harold dit avec calme :
– Je le crois aussi.
Il se tenait debout, le front redressé, face au soleil dont la pâlissante lumière éclairait les yeux où s’allumaient d’ardentes clartés. De tout ce jeune être émanaient l’orgueil indomptable, l’énergie dominatrice, la conviction d’une supériorité qui le mettait fort au-dessus des lois communes, d’un pouvoir dont il avait pu éprouver l’efficacité dès son enfance, alors qu’il se faisait craindre et idolâtrer de sa mère comme de tout son entourage.
Deux chiens de chasse étendus sur la terrasse, dans l’ombre d’un laurier-rose, s’approchèrent en rampant d’Harold avec un regard de soumission craintive. Il les renvoya d’un mot bref et rentra dans le hall où venait de paraître, descendant des appartements qui occupaient l’étage supérieur, lady Jane, sa mère.
Une femme très mince, grande, fort élégante dans sa robe de faille bleu turquoise dont le décolleté en carré s’ornait d’une précieuse dentelle. Le visage aux traits irréguliers conservait une grande fraîcheur et les yeux bleus étaient beaux, sous leurs cils châtains un peu plus clairs que les cheveux savamment ondulés.
Cette physionomie, dont l’expression d’indifférence était mêlée d’ennui, s’éclaira quelque peu à la vue d’Harold. En avançant de quelques pas, lady Treswyll demanda :
– Vous êtes déjà rentré ? Ce ne devait pas être fini, cependant ?
– Non, mais j’en avais assez. Mon oncle m’a exprimé son regret que vous n’ayez pu faire une apparition... et Mme Storven également.
Ces derniers mots tombèrent de la bouche d’Harold avec un tranquille dédain.
Lady Jane eut un petit plissement de lèvres qui témoignait éloquemment du peu d’importance qu’avaient pour elle les regrets de ladite dame.
Sir Hector, qui venait d’allumer un cigare, dit avec le ricanement fréquent chez lui :
– Ma chère, je viens de recevoir une lettre de mon frère. Il nous envoie une famille de trois personnes à héberger, avec l’espoir que vous voudrez bien vous en occuper quelque peu.
– Que dites-vous là, mon oncle ? Quelles personnes ?
– Une vieille demoiselle et deux enfants.
Brièvement, sir Hector résuma la lettre d’Éric Dorgan. En l’entendant, lady Treswyll ne dissimula pas sa surprise et sa contrariété.