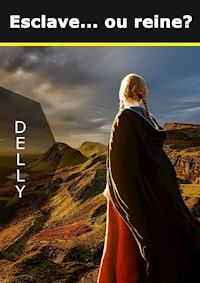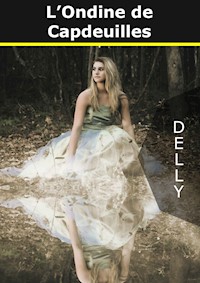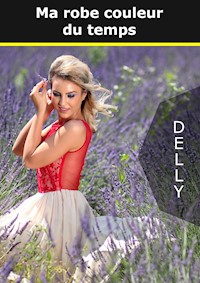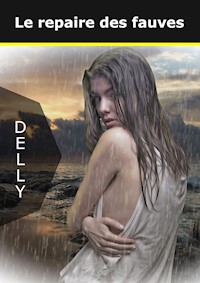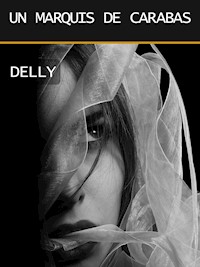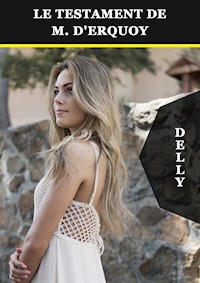2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L'Exilée, c'est Myrtô Elyanni, orpheline riche de sa seule beauté, que recueille en Hongrie sa cousine la comtesse Zolyani. Les détestables filles de celle-ci mènent la vie dure à la fière et belle étrangère. La douceur de Myrtô gagne l'affection de Renat, jeune fils du prince Arpad qui a perdu sa femme et traîne un deuil orgueilleux et glacé. Pendant une dangereuse épidémie, Myrtô sauve l'enfant au péril de sa vie. Triomphera-t-elle de même des drames que la jalousie et l'ambition ont noués autour d'elle ? Verra-t-elle le bonheur lui sourire dans son exil ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
L'exilée
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIPage de copyrightDelly
L’exilée
Delly est le nom de plume conjoint d’un frère et d’une sœur, Jeanne-Marie Petitjean de La Rosière, née à Avignon en 1875, et Frédéric Petitjean de La Rosière, né à Vannes en 1876, auteurs de romans d’amour populaires.
Les romans de Delly, peu connus des lecteurs actuels et ignorés par le monde universitaire, furent extrêmement populaires entre 1910 et 1950, et comptèrent parmi les plus grands succès de l’édition mondiale à cette époque.
I
Les nuages s’étaient un instant écartés, un vif rayon de soleil d’avril frappait le vitrage du bow-window où Myrtô reposait, sa tête délicate retombant sur le dossier du fauteuil, dans l’atmosphère tiède parfumée par les violettes et les muguets précoces qui croissaient dans les caisses, à l’ombre de palmiers et de grandes fougères.
C’était une miniature de petite serre. Tout au plus, entre ces caisses et ces quelques plantes vertes, demeurait-il la place nécessaire pour le fauteuil où s’était glissée la mince personne de Myrtô.
Elle reposait, les yeux clos, ses longs cils dorés frôlant sa joue au teint satiné et nacré, ses petites mains abandonnées sur sa jupe blanche. Ses traits, d’une pureté admirable, évoquaient le souvenir de ces incomparables statues dues au ciseau des sculpteurs de la Grèce. Cependant, ils étaient à peine formés encore, car Myrtô n’avait pas dix-huit ans... Et cette extrême jeunesse rendait plus touchants, plus attendrissants le pli douloureux de la petite bouche au dessin parfait, le cerne bleuâtre qui entourait les yeux de la jeune fille, et les larmes qui glissaient lentement de ses paupières closes.
Sur sa nuque retombait, en une coiffure presque enfantine, une lourde chevelure aux larges ondulations naturelles, une chevelure d’un blond chaud, qui avait à certains instants des colorations presque mauves, et semblait, peu après, dorée et lumineuse. Ses bandeaux encadraient harmonieusement le ravissant visage, doucement éclairé par ce gai rayon de soleil perçant entre deux giboulées.
Myrtô demeurait immobile, et cependant elle ne dormait pas. Quand même sa sollicitude filiale ne l’eût pas tenue éveillée, prête à courir à l’appel de sa mère, la douloureuse angoisse qui la serrait au cœur l’aurait empêchée de goûter un véritable repos.
Bientôt, demain peut-être, elle se trouverait orpheline et seule sur la terre. Aucun parent ne serait là pour l’aider dans ces terribles moments redoutés d’âmes plus mûres et plus expérimentées, aucun foyer n’existait qui pût l’accueillir comme une enfant de plus. Elle avait sa mère, et celle-ci partie, elle était seule, sans ressources, car la pension viagère dont jouissait madame Elyanni disparaissait avec elle.
Myrtô était fille d’un Grec et d’une Hongroise de noble race. La comtesse Hedwige Gisza avait rompu avec toute sa parenté en épousant Christos Elyanni dont la vieille souche hellénique ne pouvait faire oublier, aux yeux des fiers magistrats, que ses parents avaient dérogé en s’occupant de négoce, et que lui-même n’était qu’un artiste besogneux.
Artiste, il l’était dans toute l’acception du terme. Épris d’idéal, il vivait dans un rêve perpétuel où flottaient des visions de beauté surhumaine. La jolie Hongroise, vue un jour à Paris, à une fête de charité où Christos s’était laissé entraîner par un ami, l’avait frappé par sa grâce délicate, un peu éthérée, et la douceur radieuse de ses yeux bleus. Elle, de son côté, avait remarqué cet inconnu dont les longs cheveux noirs encadraient un visage si différent de tous ceux qui l’entouraient – un visage de médaille grecque, où le regard rayonnant d’une continuelle pensée intérieure mettait un charme indéfinissable. Elle se fit présenter l’artiste, obtint de la vieille cousine qui la chaperonnait que Christos fît son portrait, et, un jour, elle offrit elle-même sa main au jeune Grec qui avait jusque-là soupiré en silence, sans oser se déclarer.
Elle était majeure, sans parenté proche, et pourvue d’une fortune peu considérable, mais indépendante. Elle devint madame Elyanni... Et ce fut un ménage à la fois heureux et malheureux.
Heureux, car ils étaient unis par un amour profond et ne voyaient rien au-delà l’un de l’autre... Malheureux, car ils avaient des défauts identiques, des goûts trop semblables. Alors que la nature rêveuse et trop idéaliste de Christos eût demandé, en sa compagne, le contrepoids d’une raison ferme, d’un jugement mûri et d’habitudes pratiques, il ne devait trouver, en Hedwige, qu’un charmant oiseau adorant les fleurs, la lumière, les étoiles claires et chatoyantes, incapable d’une pensée sérieuse et ignorant tout de la conduite d’une maison.
Après avoir vécu pendant deux ans dans la patrie de Christos, ils étaient venus s’établir à Paris. Le peintre aimait cette ville où il était né, où était morte sa mère, une Française. Il espérait surtout arriver à percer enfin, atteindre quelque notoriété, réaliser le rêve de gloire qui chantait en son âme.
Mais il n’avait aucunement le goût de la réclame, et ses œuvres, par leur caractère d’idéalisme très haut, ne s’adaptaient pas aux tendances modernes. La réussite ne vint pas, la fortune d’Hedwige se fondit peu à peu, et le jour où Christos mourut, d’une maladie due au découragement qui s’était lentement infiltré en lui, il ne restait à madame Elyanni qu’une rente viagère, relativement assez considérable, laissée au peintre, et après lui à sa veuve, par un vieux cousin qui s’était éteint quelques années auparavant dans l’île de Chio.
Myrtô avait à cette époque douze ans. C’était une enfant vive et gaie, idolâtrée de ses parents en admiration devant sa beauté et son intelligence. Une piété très ardente et très profonde, la direction d’une vieille institutrice, femme d’élite, l’avaient heureusement préservée des conséquences que pouvait avoir l’éducation donnée par ces deux êtres charmants et bons, mais si peu faits pour élever un enfant... Et à la mort de Christos, on vit cette chose touchante et exquise : la petite Myrtô, dominant la douleur que lui causait la perte d’un père très chéri et la vue du désespoir de sa mère, se révélant tout à coup presqu’une femme déjà par le sérieux et le jugement, organisant, avec l’aide d’un vieil ami de son père, une nouvelle existence, soignant avec un tendre dévouement madame Elyanni dont le chagrin avait abattu la santé toujours frêle.
La mère et la fille s’installèrent à Neuilly, dans un très petit appartement, au quatrième étage d’une maison habitée par de modestes employés. Madame Elyanni, que l’expérience n’avait pas corrigée, fit ajouter à la fenêtre de sa chambre ce bow-window et voulut qu’il fût continuellement garni de fleurs.
– Je me passerais plutôt de manger que de ne pas voir des fleurs autour de moi, avait-elle répondu au tuteur de Myrtô qui avançait discrètement que les revenus ne permettraient peut-être pas...
– Oh ! monsieur, il ne faut pas que maman soit privée de fleurs ! avait dit vivement Myrtô.
Il fallait aussi que madame Elyanni eût une nourriture délicate... Et, comme elle abhorrait les nuances foncées, elle exigeait que sa fille fût toujours vêtue de blanc à l’intérieur, coutume économique, car la fillette, qui remplissait courageusement avec une souriante attention, bien des menus devoirs de ménagère, devait remplacer fréquemment ces costumes que sa mère ne souffrait pas voir tant soit peu défraîchis.
Il en était ainsi de nombreux détails, et malgré les économies que Myrtô, devenue un ménagère accomplie, réussissait à réaliser sur certains points, le budget s’équilibrait parfois difficilement.
Il avait fallu compter aussi avec les frais de son instruction. Grâce à une extrême facilité, aux admirables dispositions dont elle était douée, elle avait pu les réduire au minimum. Elle avait conquis, l’année précédente, son brevet supérieur, et avait réussi à acquérir, en prenant de temps à autre quelques leçons d’un excellent professeur, un remarquable talent de violoniste.
Telle était Myrtô, petite âme exquise, ardente et pure, cœur délicatement bon et dévoué, chrétienne admirable, enfant par sa candide simplicité, femme par l’énergie et la réflexion d’un esprit mûri déjà au souffle de l’épreuve et des responsabilités.
Car tous les soucis retombaient sur elle. Madame Elyanni, languissante d’âme et de corps, se laissait gâter par sa fille et déclarait ne pouvoir s’occuper de rien. Depuis quelques années, elle ne voulait plus sortir et passait ses journées étendue, s’occupant à de merveilleuses broderies ou rêvant, les yeux fixés sur le dernier tableau peint par Christos, et où le peintre s’était représenté entre sa femme et sa fille, dans son petit atelier illuminé de soleil.
Elle s’était étiolée ainsi, hâtant la marche de la maladie qui l’avait terrassée enfin deux jours auparavant. En voyant la physionomie soucieuse du médecin appelé aussitôt, Myrtô avait compris que le danger était grand... Et en entendant, la veille, sa mère demander le prêtre, elle s’était dit que tout était fini, car l’âme insouciante de madame Elyanni était de celles qui attendent les derniers symptômes avant-coureurs de la fin pour oser songer à se mettre en règle avec leur Dieu.
Ce matin, on lui avait apporté le Viatique... Et c’était autant pour la laisser faire en toute tranquillité son action de grâces que pour dérober à son regard les larmes difficilement contenues pendant la cérémonie, que Myrtô s’était réfugiée dans le bow-window.
Elle aimait profondément sa mère, d’une tendresse qui prenait, à son insu, une nuance de protection très explicable par la faiblesse morale de madame Elyanni. Son cœur avait besoin de se donner, de s’épancher en dévouement sur d’autres cœurs souffrants, faibles, ou découragés. Sa mère disparue, ce serait fini de cette sollicitude de tous les instants qu’exigeait, depuis quelques mois surtout, madame Elyanni. Personne n’aurait plus besoin d’elle... À moins qu’elle ne se fît religieuse pour déverser sur ses frères en Jésus-Christ les trésors de tendresse dévouée contenus dans son cœur. Mais, jusqu’ici, la voix divine n’avait pas parlé, Myrtô ignorait si elle avait la vocation religieuse.
Dans le silence qui régnait, à peine troublé de temps à autre par la corne d’un tramway, une voix faible appela :
– Myrtô !
La jeune fille se leva vivement et entra dans la chambre aux tentures claires, aux meubles de laque blanche. Des plantes vertes, des gerbes de fleurs en ornaient les angles, garnissaient les tables et la cheminée... Et sur une petite table couverte d’une nappe blanche, d’autres fleurs encore s’épanouissaient entre les candélabres dorés et le crucifix.
Myrtô s’avança près du lit, elle se pencha vers le pâle visage flétri, entouré de cheveux blonds grisonnants.
– Me voilà, maman chérie. Que voulez-vous de votre Myrtô ? demanda-t-elle en mettant un tendre baiser sur le front de sa mère.
– Je veux te parler, mignonne... Écoute, j’ai compris depuis... depuis que je sens venir la mort...
– Maman ! murmura Myrtô.
Les yeux bleus de la malade enveloppèrent la jeune fille d’un regard navré.
– Il faut bien nous faire à cette pensée, enfant... J’ai donc compris que je n’ai pas été pour toi une bonne mère...
– Maman ! redit encore Myrtô avec un geste de protestation.
– Si, ma chérie, c’est la vérité. Je t’ai beaucoup aimée, c’est vrai, mais autrement, je n’ai rempli aucun des devoirs maternels. J’ai laissé à ta petite âme courageuse toutes les responsabilités, tous les soucis, je n’ai su que m’enfermer dans mon chagrin et dépenser égoïstement tout notre petit revenu, au lieu de songer à économiser pour toi.
– C’était juste, maman, c’était bien ainsi ! Moi je suis jeune, je travaillerai...
– Tu travailleras !... Pauvre mignonne aimée ! que pourrais-tu faire ! La concurrence est énorme... et d’ailleurs tu ne peux vivre seule, Myrtô. Il te faut l’abri d’un foyer, la sécurité au milieu d’une famille sérieuse... j’ai donc songé à ma cousine Gisèle. Tu sais que, seule de toute ma famille, elle a continué à se tenir en rapports avec moi, par quelques mots sur une carte au 1er janvier, par des lettres de faire-part. Elle avait épousé, trois ans avant mon mariage, le prince Sigismond Milcza. Un fils est né de cette union. Elle m’apprit quelques années plus tard son veuvage, puis son second mariage, la naissance de quatre enfants, et enfin un nouveau veuvage. Nous nous aimions beaucoup, et j’ai songé qu’en souvenir de moi elle accepterait peut-être de t’accueillir.
Myrtô se redressa vivement.
– Maman, voulez-vous que j’aille mendier la protection et l’hospitalité de ces parents qui n’ont pas voulu accepter mon cher père ?
– Oh ! les autres, non ! Mais Gisèle n’a jamais cessé de me considérer comme de la famille.
– Cependant, maman, il ne me paraît pas admissible que je sois à la charge de la comtesse Zolanyi ! dit vivement Myrtô.
– Non, mais elle doit avoir des relations étendues et très hautes, car les Gisza, les Zolanyi, les Milcza surtout sont de la première noblesse magyare. Ces derniers sont de race royale, et leur fortune est incalculable. Gisèle pourra donc, mieux que personne, t’aider à trouver une position sûre, elle sera pour toi une protection, un conseil... Et je voudrais que tu lui écrives de ma part, afin que je te confie à elle.
– Ce que vous voudrez, mère chérie ! murmura Myrtô en baisant la jolie main amaigrie posée sur le couvre-pied de soie blanche un peu jaunie.
Sous la dictée de sa mère, elle écrivit un simple et pathétique appel à cette parente inconnue d’elle. À grand-peine, Mme Elyanni parvint à y apposer sa signature... Myrtô demanda :
– Où dois-je adresser cette lettre ?
– Depuis son second veuvage, Gisèle m’a donné son adresse au palais Milcza, à Vienne. Je suppose qu’après la mort du comte Zolanyi, elle a dû aller vivre près de son fils aîné, qui n’est peut-être pas marié encore. Envoie la lettre à cette adresse. Si Gisèle ne s’y trouve pas, on fera suivre.
Myrtô, d’une main qui tremblait un peu, mit la suscription, apposa le timbre, et se leva en disant :
– Je vais la porter chez les dames Millon. L’une ou l’autre aura certainement occasion de sortir ce matin et de la mettre à la poste.
Les dames Million occupaient un logement sur le même palier que Mme Elyanni. La mère était veuve d’un employé de chemin de fer, la fille travaillait en chambre pour un magasin de fleurs artificielles. C’étaient d’honnêtes et bonnes créatures, serviables et discrètes, qui admiraient Myrtô et auraient tout fait pour lui procurer le moindre plaisir. Isolée comme l’était la jeune fille, Mme Elyanni n’ayant jamais voulu nouer de relations, elle avait trouvé plusieurs fois une aide matérielle ou morale près de ses voisines, et elle leur en gardait une reconnaissance qui se traduisait par des mots charmants et de délicates attentions, Myrtô n’étant pas de ces cœurs vaniteux et étroits qui considèrent avant toute chose la situation sociale et le plus ou moins de distinction du prochain.
La porte lui fut ouverte par Mlle Albertine, grande et belle fille brune, au teint pâle et au regard très doux.
– Mlle Myrtô ! Entrez donc, mademoiselle !
Et elle s’effaçait pour la laisser pénétrer dans la salle à manger, où Mme Millon, une petite femme vive et accorte, était en train de morigéner un petit garçon de cinq à six ans, un orphelin que la mort de sa fille aînée et de son gendre avait laissé à sa charge... elle s’avança vivement vers la jeune fille en demandant :
– Eh bien ! mademoiselle Myrtô ?
– Elle est si faible, si faible ! murmura Myrtô.
Et un sanglot s’étouffa dans sa gorge.
– Pauvre chère petite demoiselle ! dit Mme Million en lui saisissant la main, tandis qu’Albertine se détournait pour dissimuler une larme.
– Je suis venue vous demander un service, reprit Myrtô en essayant de dominer le tremblement de sa voix. Quand vous descendrez, voulez-vous mettre cette lettre à la boîte ?
– Mais certainement ! Albertine a justement une course à faire dans cinq minutes, elle ne l’oubliera pas, comptez sur elle.
– Moi aussi, j’irai porter la lettre, dit le petit garçon qui s’était avancé et posait câlinement sa joue fraîche contre la main de Myrtô.
– Oui, c’est cela, Jeannot... et puis tu feras aussi une petite prière pour ma chère maman, dit la jeune fille en caressant sa petite tête rasée.
– Nous lui en faisons dire une tous les soirs, mademoiselle Myrtô... Et vous savez, si vous avez besoin de n’importe quoi, nous sommes là, toutes prêtes à vous rendre service.
– Oui, je connais votre cœur, dit Myrtô en tendant la main aux deux femmes. Merci, merci... Maintenant, je vais vite retrouver ma pauvre maman.
Lorsque la jeune fille eut disparu, madame Millon posa la lettre sur la table, non sans jeter un coup d’œil sur la suscription.
– Comtesse Zolanyi, palais Milcza... Ces dames ne nous ont jamais dit grand-chose sur elles-mêmes, mais j’ai idée, Titine, qu’elles sont d’une grande famille. L’autre jour pendant que j’étais près de madame Elyanni, j’ai remarqué, sur un joli mouchoir fin dont elle se servait, une petite couronne brodée.
– Et mademoiselle Myrtô a des manières de princesse qui lui viennent tout naturellement, cela se voit, si elle pouvait donc avoir des parents qui l’accueillent, qui l’aiment comme elle le mérite !... Car la pauvre dame n’a plus guère à vivre, maman.
– Hélas ! non ! Si elle passe la nuit, ce sera tout... Pauvre petite demoiselle Myrtô ! Ça me fend le cœur, vois-tu, Titine !
Et l’excellente personne sortit son mouchoir, tandis que sa fille, serrant les lèvres pour dominer son émotion, entrait dans la chambre voisine pour mettre son chapeau.
Pendant ce temps, Myrtô, rentrée dans la chambre de sa mère, s’occupait à défaire le petit autel. Elle allait et venait doucement, incomparablement élégante et svelte, avec des mouvements d’une grâce infinie.
– Myrtô !
Elle s’approcha du lit... Madame Elyanni saisit sa main en disant :
– Regarde-moi, Myrtô !
Les yeux bleus de la mère se plongèrent dans les admirables prunelles noires, veloutées, rayonnantes d’une pure clarté intérieure. Toute l’âme énergique, ardente, virginale de Myrtô était là... Et madame Elyanni murmura doucement :
– Que je les voie encore, tes yeux, tes beaux yeux !... Myrtô, ma lumière !
– Maman, ne parlez pas ainsi ! supplia la jeune fille. Il n’y a qu’une vraie lumière, c’est Dieu, et il ne faut pas...
– Oui. Il est la lumière, mais cette lumière incréée se communique aux âmes pures, et celles-ci la répandent autour d’elles... Ne t’étonne pas de m’entendre parler ainsi, mon enfant. Depuis hier, ta pauvre mère a bien réfléchi, elle a compris ce que tu avais été pour elle, ce que Dieu lui avait donné en lui accordant une fille telle que toi, et comment il lui aurait été impossible de vivre sans l’ange qu’elle a sans cesse trouvé à ses côtés. Je te bénis, Myrtô, mon amour, je te bénis de toute la force de mon cœur !
Ses mains se posèrent sur la chevelure blonde. Myrtô, sanglotante, s’était laissé tomber à genoux...
– Ne pleure pas, chérie. Pense que je vais retrouver mon cher Christos. Tous deux, de là-haut nous veillerons sur toi...
Elle s’interrompit, à bout de forces, en laissant retomber ses mains que Myrtô pressa sur ses lèvres... Et elles demeurèrent ainsi, immobiles, savourant la douloureuse jouissance de ces dernières heures.
II
Enveloppée dans ses crêpes, un peu courbée sous son long châle noir, Myrtô marchait comme en un rêve, entre les dames Millon. Elle revenait vers le logis vide d’où était partie tout à l’heure la dépouille mortelle de madame Elyanni.
Elle se sentait anéantie, presque sans pensée. Albertine avait doucement pris sa main pour la passer sous son bras... Et cette marque d’affectueuse attention avait mis un léger baume sur le cœur brisé de Myrtô.
En arrivant sur le palier du quatrième étage, madame Million demanda :
– Vous allez rester à déjeuner et finir la journée chez nous, mademoiselle Myrtô ?... Et même y coucher, si vous le voulez bien, car ce serait trop triste pour vous...
Myrtô lui prit les mains et les pressa avec force.
– Merci, merci, madame ! Mais je préfère rentrer tout de suite, m’habituer à cette solitude, à la pensée de ne plus la voir là...
Sa voix se brisa dans un sanglot.
– ... Demain, si vous le voulez bien, je viendrai partager votre repas... mais aujourd’hui, je ne peux pas... Ne m’en veuillez pas, je vous en prie !
– Oh ! bien sûr que non, ma pauvre demoiselle ! Faites ce qui vous coûtera le moins... Mais je vais aller vous porter un peu de bouillon...
– Non, pas maintenant, je ne pourrais pas. Ce soir, j’essaierai...
Elle leur tendit la main et entra dans l’appartement où la femme de ménage s’occupait à tout remettre en ordre.
Myrtô se réfugia dans sa chambre, une petite pièce meublée avec une extrême simplicité. Elle enleva son chapeau, son châle, et s’assit sur un siège bas, près de la fenêtre.
Tout à l’heure, en se voyant seule derrière le char funèbre, elle avait eu, pour la première fois, la conscience nette du douloureux isolement qui était le sien... Et voici que cette impression lui revenait, plus vive, dans ce logis où elle avait, pendant des années, prodigué son dévouement à la mère dont elle était l’unique affection.
Lorsque le pénible événement s’était trouvé accompli, elle avait aussitôt télégraphié à son tuteur. Celui-ci, vieil artiste célibataire, vivait retiré sur la côte de Provence. Il avait répondu par des condoléances, mettant en avant ses rhumatismes qui lui interdisaient tout déplacement. D’offres de service à sa pupille, pas un mot.
La comtesse Zolanyi n’avait pas répondu. Peut-être ne se trouvait-elle pas à Vienne... Et d’ailleurs, Myrtô comptait si peu sur cette grande dame qui ne souciait sans doute aucunement d’une jeune cousine inconnue et très pauvre ! Lorsqu’elle aurait dominé ce premier anéantissement qui la terrassait, elle envisagerait nettement la situation et chercherait, avec l’aide de dames Millon, un moyen de se tirer d’affaire.
Mais aujourd’hui, non, elle ne pouvait pas ! Elle se sentait faible comme un enfant...
Un coup de sonnette retentit. La femme de ménage alla ouvrir, Myrtô entendit un bruit de voix... Puis on frappa à la porte de sa chambre...
– Mademoiselle, c’est une dame qui demande à vous parler.
Une envie folle lui vint de répondre :
– Pas aujourd’hui !... Oh ! pas aujourd’hui !
Mais elle se domina, et, se levant, elle entra dans la pièce voisine.
Une dame de petite taille, en deuil léger et d’une discrète élégance, se tenait debout au milieu de la salle à manger. Sous la voilette, Myrtô vit un fin visage un peu flétri, des yeux qui lui rappelèrent ceux de sa mère, et qui exprimaient une sorte de surprise admirative en se posant sur la jeune fille...
L’inconnue s’avança vers Myrtô en disant en français, avec un léger accent étranger :
– J’arrive donc trop tard ? Ma pauvre Hedwige ?...
– Oui, c’est fini, dit Myrtô.
Et, pour la première fois, depuis deux jours, les larmes jaillirent enfin des yeux de la jeune fille.
– Ma pauvre enfant ! dit l’étrangère en lui prenant la main et en la regardant avec compassion. Et dire que j’étais à Paris, que j’aurais pu accourir aussitôt près d’Hedwige ! Mais votre lettre m’a été renvoyée de Vienne, je l’ai reçue ce matin seulement.
– Quoi, vous étiez à Paris ! dit Myrtô d’un ton de regret. Oh ! si nous avions pu nous en douter ! Mais asseyez-vous, madame !... Et permettez-moi de vous remercier dès maintenant d’être accourue si vite à l’appel de ma pauvre mère.
– C’était chose toute naturelle, dit la comtesse en prenant place sur le fauteuil que lui avançait Myrtô. Hedwige et moi, bien que cousines assez éloignées, avons été élevées dans une grande intimité. J’en ai toujours conservé le souvenir, malgré... enfin, malgré ce mariage qui avait mécontenté notre parenté.
Le front de Myrtô se rembrunit un peu, tandis que la comtesse continuait d’un ton calme, où passait un peu d’émotion :
– Je n’ai donc pas hésité à venir, espérant bien la trouver encore en vie... Mais la concierge m’a appris que... tout était fini.
– Oui, c’est fini, fini ! dit Myrtô.
Elle s’était assise en face de la comtesse, et le jour un peu terne éclairait d’une lueur grise son délicieux visage fatigué et pâli, sur lequel les larmes glissaient, chaudes et pressées.
La comtesse parut touchée, son regard mobile s’embua un peu... Elle se pencha et prit la main de la jeune fille.
– Voyons, mon enfant, ne vous désolez pas. En souvenir d’Hedwige, je suis prête à vous aider, à vous accorder cette protection que ma pauvre cousine me demandait pour vous... Racontez-moi un peu votre vie, parlez-moi d’elle et de vous.
On ne pouvait nier qu’elle ne se montrât bienveillante, bien qu’avec une nuance de condescendance qui n’échappa pas à Myrtô. Cependant, la jeune fille avait craint de se heurter à la morgue de cette parente inconnue, et elle éprouvait un soulagement en constatant en elle une certaine dose d’amabilité et même de sympathie.
Elle fit donc brièvement le récit de leur existence depuis la mort de M. Elyanni. Parfois, la comtesse lui adressait une question. Entre autres choses, elle s’informa de l’état des finances de l’orpheline. Myrtô lui apprit qu’il ne lui restait rien, sauf un mince capital représentant une rente de quatre cents francs.
– Oui, vous me disiez cela dans votre lettre, mais je pensais que vous possédiez peut-être quelques autres petites ressources. Hedwige avait de fort beaux bijoux, des diamants pour une somme considérable...
– Tout a été vendu au moment de la maladie de mon père, sauf une croix en opales à laquelle ma mère tenait beaucoup.
– Oui, c’est un bijou de famille qui venait d’une aïeule. Ainsi donc, vous ne possédez rien, mon enfant ?... Et vous n’avez aucune parenté du côté paternel ?
– Aucune, madame. La famille de mon père était déjà complètement éteinte à l’époque de son mariage.
La comtesse passa lentement sur son front sa main fine admirablement gantée.
– En ce cas, mon enfant, il me paraît que mon devoir est tout tracé. Vous êtes une Gisza par votre mère – cela, personne de notre parenté ne peut le discuter – vous avez donc droit à l’abri de mon foyer...
– Madame, je ne demande qu’une chose ! interrompit vivement Myrtô. C’est que vous m’aidiez à trouver une situation sérieuse, dans une famille sûre... Car mon seul désir est de gagner ma vie, et je n’accepterais jamais de me trouver à votre charge.
Les sourcils blonds de la comtesse se froncèrent légèrement.
– Une situation, dites-vous ?... Et laquelle donc ? institutrice, demoiselle de compagnie ?... Tout d’abord, je vous répondrai que vous êtes beaucoup trop jeune, et que... enfin, que vous avez un visage... des manières qui rendront difficile pour vous une position de ce genre.
Myrtô rougit et des larmes lui montèrent aux yeux. Elle était si totalement dépourvue de coquetterie que le compliment implicite contenu dans la constatation de son interlocutrice ne lui avait causé qu’une impression pénible, en lui faisant toucher du doigt l’obstacle qui s’élevait devant ses rêves de travail.
– Mais cependant, il faut que je gagne ma vie ! dit-elle en tordant inconsciemment ses petites mains.
– Mon enfant, laissez-moi vous dire qu’il me paraît impossible de vous laisser remplir des fonctions subalternes quelconques, du moment où vous êtes ma parente. Il me déplairait fort, je vous l’avoue, qu’une jeune fille pouvant se dire ma cousine devînt, par exemple, la demoiselle de compagnie d’une de mes connaissances... Non, décidément, il n’y a qu’un moyen, du moins pour le moment : c’est que vous acceptiez mon aide, pour vivre dans une pension de dames, où vous vous trouverez en sécurité...
– Et dans ce cas, en serai-je plus avancée d’ici deux ans, d’ici cinq ans ? s’écria Myrtô. Non, c’est impossible, il faut que je travaille, je ne veux pas tout devoir à votre charité !
La comtesse, surprise, considéra quelques instants la charmante physionomie empreinte d’une fière résolution.
– C’est que me voilà fort embarrassée, alors !... Je ne vois vraiment pas trop... À moins que... Mais oui, cela arrangerait tout ! s’écria-t-elle d’un ton triomphant, en se frappant le front. Vous m’avez dit que vous aviez des diplômes ?
– Oui, mes deux brevets.
– Vous êtes musicienne ?
– Violoniste.
– Oh ! parfait ! Mes filles adorent la musique, et vous enseigneriez le violon à Renat... Vous dessinez peut-être aussi ?
– Mais oui, un peu.
– Tout à fait bien !... Connaissez-vous la langue magyare ?
– Comme le français. Nous parlions indifféremment l’un et l’autre, ma pauvre maman et moi. Je parle également le grec, et un peu l’allemand.
– Allons, mon enfant, je crois que tout va s’arranger ! dit la comtesse d’un ton satisfait, en saisissant la main de la jeune fille. Voici ce que je vous propose : Fraulein Lœnig, l’institutrice bavaroise de mes enfants, doit nous quitter l’année prochaine. Voulez-vous accepter de la remplacer ? Comme son engagement avec moi court pendant un an encore, et que je n’ai aucun motif de lui infliger le déplaisir d’un renvoi avant l’heure, vous demeureriez en attendant avec nous, vous donneriez des leçons de violon à mon petit Renat, vous feriez de la musique avec mes filles aînées... Enfin, vous trouverez à vous occuper, quand ce ne serait qu’à me faire la lecture, mes yeux se fatiguant beaucoup depuis un an.
– De cette manière, oui, j’accepte avec reconnaissance ! dit Myrtô dont la physionomie s’éclairait soudain. Je vous remercie, madame.
– Ne me remerciez pas encore mon enfant, car ceci n’est qu’un projet tout personnel, que je désire fort voir aboutir, mais pour lequel il me faut l’approbation du prince Milcza, mon fils aîné. Je vis chez lui, et je ne puis vous prendre pour ainsi dire sous ma tutelle sans savoir ce qu’il en pensera... Mais ne craignez pas trop, il est fort probable qu’il me répondra que la chose lui importe peu... Quant à la question des appointements, je ferai comme pour Fraulein Lœnig...
Un geste de Myrtô l’interrompit.
– Avant toute chose, il vous faudra juger, madame, si je suis capable de remplacer l’institutrice de vos enfants. Cette question pourra donc s’arranger plus tard, il me semble.
– Oh ! certainement !... Voulez-vous venir dès maintenant avec moi, si vous vous trouvez trop seule ici ?
– J’aimerais à rester encore dans cet appartement, dit Myrtô dont les yeux s’emplirent de larmes.
– Comme vous le voudrez, mon enfant. Je vais donc écrire immédiatement à mon fils, afin que nous soyons fixées le plus tôt possible. Espérez beaucoup. Je lui parlerai de l’obligation pour nous de ne pas laisser à l’abandon une jeune fille qui a dans les veines du sang de Gisza. C’est la seule considération capable de le toucher, car essayer de l’attendrir serait peine perdue... Mais, dites-moi, quel est votre prénom, enfant ?
– Myrtô, madame.
– Myrtô ! répéta la comtesse d’un ton surpris et mécontent. Pourquoi Hedwige ne vous a-t-elle pas donné un nom de notre pays ?... Êtes-vous catholique, au moins ?
– Oh ! oui, madame, comme ma chère maman !... Et je m’appelle Gisèle-Hedwige-Myrtô. C’est mon père qui a voulu que l’on me donnât habituellement ce nom.
– Enfin, cela importe peu, dit la comtesse en se levant. Puisque vous préférez rester ici aujourd’hui, voulez-vous venir déjeuner avec nous demain ?... Nous n’aurons personne, soyez sans crainte, ajouta-t-elle en voyant le regard que la jeune fille jetait sur sa robe de deuil.
Bien que Myrtô eût fort envie de refuser, elle se força raisonnablement à répondre par un acquiescement, et prit l’adresse que lui dictait la comtesse.
– Je vais maintenant me faire conduire au cimetière, dit cette dernière en lui tendant la main. Je veux prier sur la tombe de ma pauvre Hedwige... À demain, mon enfant.
– Oui, madame, et merci de votre sympathie, et de l’espoir que vous m’ouvrez ! dit Myrtô avec émotion.
– Appelez-moi votre cousine, je n’ai pas l’intention de me faire passer pour une étrangère vis-à-vis de vous... Allons, au revoir, Myrtô... Tenez, je vais vous embrasser en souvenir d’Hedwige.
Elle lui mit sur les deux joues un léger baiser et s’éloigna, laissant dans la salle à manger un subtil parfum.
Myrtô rentra dans sa chambre, elle s’assit de nouveau près de la fenêtre et appuya son front sur sa main.
Cette visite venait de soulever légèrement le poids très lourd qui pesait sur son jeune cœur. Elle avait senti chez la comtesse Zolanyi une certaine dose de sympathie, et le désir sincère de l’aider à sortir d’embarras. Comme elle avait craint de se heurter à la morgue patricienne de cette cousine de sa mère, elle ne songeait pas à se dire que la comtesse eût pu montrer envers elle un peu plus de chaleur, insister pour l’enlever à sa solitude, pour lui faire connaître ses filles, ne pas laisser si bien voir, en un mot, qu’elle ne remplissait qu’un devoir strict commandé par ses liens de parenté avec Myrtô, peut-être un peu, aussi, par l’affection conservée pour sa cousine Hedwige.
Non, Myrtô remerciait Dieu qui lui laissait entrevoir une lueur d’espérance dans la douleur où venait de la plonger la perte de sa mère, elle songeait qu’il serait moins dur, après tout, de remplir ce rôle d’institutrice près de parents plutôt qu’envers des étrangers quelconques... Et ce lui fut une pensée consolante de se dire qu’elle allait peut-être connaître le pays de sa mère, la Hongrie toujours aimée d’Hedwige Gisza.
III
Le temps était froid et brumeux, il tombait une pluie fine lorsque Myrtô prit, le lendemain, le train pour Paris. Un peu d’angoisse l’oppressait à la pensée de pénétrer dans ce milieu inconnu, où tous n’auraient peut-être pas pour elle la même bienveillance que la comtesse Gisèle.
Un tramway la déposa dans le faubourg Saint-Germain, non loin de la rue où habitait la comtesse... Bientôt la jeune fille s’arrêta devant un ancien et fort majestueux hôtel qui portait, gravées dans un écusson de pierre, des armoiries compliquées. Un domestique en livrée noire fit traverser à Myrtô le vestibule superbe, puis un immense salon décoré avec une splendeur sévère et artistique, et l’introduisit dans une pièce à peine plus petite, tout aussi magnifiquement ornée, mais qui avait un certain aspect familial grâce à une corbeille à ouvrage, à des livres entrouverts, à un certain désordre dans l’arrangement des sièges, et aussi à la présence d’un petit chien terrier, blotti dans un niche élégante.
Cette pièce était déserte... Le domestique s’éloigna, d’un pas assourdi par les tapis, et Myrtô jeta un coup d’œil autour d’elle.
Son regard fut attiré tout à coup par un tableau placé au milieu du principal panneau. Il représentait un jeune homme de haute taille, très svelte, qui portait avec une incomparable élégance le somptueux costume des magnats hongrois. La tête un peu redressée dans une pose altière, il semblait fixer sur Myrtô ses grands yeux noirs, fiers et charmeurs, qui étincelaient dans un visage au teint mat, orné d’une longue moustache d’un noir d’ébène. Sa main fine et blanche, d’une forme parfaite, était posée sur le kolbach garni d’une aigrette retenue par une agrafe de diamants. Tout, dans son attitude, dans son regard, dans le pli de ses lèvres, décelait une fierté intense, une volonté impérieuse et la tranquille hauteur de l’être qui se sent élevé au-dessus des autres mortels.
Du moins, ce fut l’impression première de Myrtô... Et pourtant, quelque chose dans cette physionomie attirait et charmait. Mais Myrtô ne su pas définir exactement la nature de ce rayonnement que le peintre avait mis dans le regard de son modèle.
Le bruit d’une porte qui s’ouvrait, de pas légers dans le salon voisin, fit retourner Myrtô. Elle vit s’avancer une jeune fille grande et mince, et une fillette à l’aspect fluet. Toutes deux avaient les mêmes cheveux d’un blond argenté, les mêmes yeux gris très grands et un peu mélancoliques, la même coupe longue de visage, et le même teint d’une extrême blancheur.