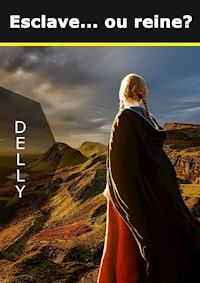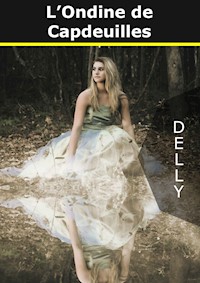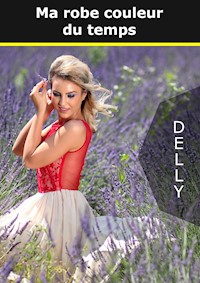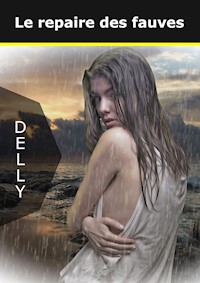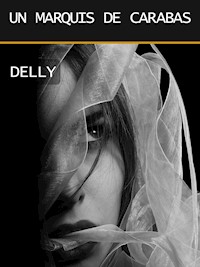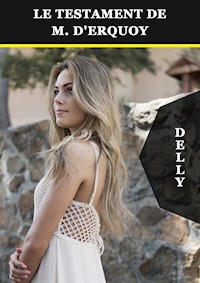2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ce roman fut d'abord publié dans la revue Le Noël, puis dans les Veillées des Chaumières et enfin en volume en 1905. Les éditions ultérieures du roman, avec de nombreuses modifications, sont parues sous le titre « La jeune fille emmurée ». Extrait : De temps à autre, par les portes un instant entrouvertes, arrivaient des éclats de voix joyeuses ou le son du piano supérieurement travaillé par l'un des invités... Mais le blanc visage d'Isabelle restait impassible, et lentement, doucement, elle continuait à passer la serviette de fine toile sur les tasses précieuses, don d'une princesse russe admiratrice passionnée de Valentina. L'aimable grande dame se fût pâmée d'étonnement si elle avait pu apercevoir la besogne à laquelle se livrait la fille du vicomte d'Effranges et de l'élégante Lucienne Norand -- la belle jeune fille qu'un impitoyable système d'éducation reléguait à l'office, parmi les servantes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
L'étincelle
Pages de titreMadame DutfoyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVPage de copyrightDelly
L’étincelle
Delly est le nom de plume conjoint d’un frère et d’une sœur, Jeanne-Marie Petitjean de La Rosière, née à Avignon en 1875, et Frédéric Petitjean de La Rosière, né à Vannes en 1876, auteurs de romans d’amour populaires.
Les romans de Delly, peu connus des lecteurs actuels et ignorés par le monde universitaire, furent extrêmement populaires entre 1910 et 1950, et comptèrent parmi les plus grands succès de l’édition mondiale à cette époque.
Notes : ce roman fut d’abord publié dans la revue Le Noël, puis dans les Veillées des Chaumières et enfin en volume en 1905. Les éditions ultérieures du roman, avec de nombreuses modifications, sont parues sous le titre « La jeune fille emmurée »
Madame Dutfoy
En témoignage de ma respectueuse affection.
I
Un jour terne et mélancolique pénétrait dans la pièce à travers les vitres ruisselantes de la pluie fine, serrée, tenace qui tombait depuis l’aube. Dans cette sorte de pénombre disparaissaient ou s’estompaient à peine les dressoirs de bois sombre, le massif buffet garni de précieuses porcelaines, les quelques tableaux, paysages dus à des pinceaux célèbres, qui ornaient cette très vaste salle à manger. Seule, la partie de la grande table qui se rapprochait des deux fenêtres voyait arriver à elle une clarté à peu près suffisante...
Du moins, la personne qui se trouvait là s’en contentait et travaillait avec une extrême application. Sa tête demeurait penchée sur le linge qu’elle reprisait et l’on n’apercevait d’elle que son buste mince et élégant, un peu grêle, et une épaisse torsade de cheveux soyeux, d’une remarquable finesse et d’une nuance blond argenté rare et charmante. Les mains qui faisaient marcher l’aiguille étaient petites et bien faites, mais brunies, même un peu durcies comme celles d’une ménagère.
Le silence, dans cette rue parisienne un peu retirée, était troublé seulement à de rares intervalles par le passage d’une voiture et de piétons dont les pas claquaient sur le sol mouillé. Dans l’appartement lui-même, rien ne venait le rompre...
Mais un pas énergique résonna soudain derrière une porte, et celle-ci s’ouvrit avec un petit grincement. Dans l’ouverture s’encadra une femme de haute stature et d’apparence vigoureuse. Une épaisse chevelure noire, à peine traversée de quelques fils d’argent, ombrageait son front élevé et volontaire, en faisant ressortir la pâleur de ce visage aux traits accentués. Dès le premier coup d’œil jeté sur cette physionomie énergique et hautaine, en rencontrant ces yeux bruns très pénétrants, froids et tranchants comme une lame, mais animés d’une singulière intelligence, on avait l’intuition de se trouver en face d’une personnalité remarquable – quoique peu sympathique.
– Isabelle !
La voix qui prononçait ce nom résonna, brève et métallique, dans le silence de la grande salle... La tête blonde se leva lentement et deux grands yeux d’un bleu violet se tournèrent vers la porte.
– Isabelle, nous partirons dans deux jours pour Maison-Vieille. Tenez-vous prête.
– Bien, grand-mère, dit une voix calme, presque morne.
Et la tête blonde s’abaissa de nouveau.
La grande dame brune s’éloigna en refermant la porte d’un mouvement plein de décision... Mais une minute plus tard, cette porte se rouvrait, livrant passage à une ombre mince et grise qui se glissa dans la salle et arriva près de la travailleuse.
– Quelle folie, Isabelle !... Est-il vraiment raisonnable de repriser avec un jour pareil ! dit une petite voix grêle. Cela n’a rien de pressé, voyons ?
L’aiguille fut arrêtée dans son mouvement et un jeune visage se tourna vers l’arrivante. Il était impossible de rêver un teint d’une plus parfaite blancheur... non la froide blancheur du marbre, mais celle, exquisement délicate, comme transparente, des pétales de certaines roses... Mais cette figure de jeune fille, fine et charmante, était amaigrie et empreinte d’une morne tristesse.
– Je suis très pressée au contraire, tante Bernardine... maintenant surtout.
– Ah ! tu fais allusion au départ pour Maison-Vieille, sans doute ? Madame Norand t’a dit ?...
La jeune fille inclina affirmativement la tête... Ses mains étaient maintenant croisées sur son ouvrage et elle regardait distraitement les minuscules ruisseaux serpentant le long des vitres, et incessamment alimentés par la pluie persistante.
Son interlocutrice s’assit près d’elle... Cette petite femme maigre et légèrement contrefaite, dont le visage jauni s’encadrait de bandeaux d’un blond terne, semblait n’avoir, au premier abord, aucune ressemblance avec la jolie créature qui l’appelait sa tante. Cependant, en les voyant quelque temps l’une près de l’autre, on réussissait à trouver quelques traits identiques dans la physionomie effacée et insignifiante de la vieille demoiselle et celle, infiniment délicate, mais trop grave de la jeune fille.
– Es-tu contente, Isabelle ?... Tu aimes mieux Astinac que Paris, n’est-ce pas ?
Isabelle demeura un instant sans répondre, le visage tourné vers la fenêtre par laquelle le crépuscule tombant jetait une plus pénétrante mélancolie... Enfin, elle dit lentement :
– Oui, peut-être... J’aime la campagne... et puis...
Elle s’interrompit, et une sorte de lueur traversa son regard triste.
– ... Et puis il y a un peu plus de liberté, du soleil, de l’air, des fleurs, tandis qu’ici...
Elle montrait la rue, la perspective des toits sans fin, des maisons froides et solennelles, et aussi le ciel maussade, l’atmosphère humide et grise de cette soirée de mai.
– Oui, les promenades seront plus agréables là-bas, et moi aussi je suis contente d’y aller, car je n’aime décidément pas Paris, dit mademoiselle Bernardine d’un petit ton allègre. Allons, laisse ton ouvrage, Isabelle. Six heures sont sonné, sais-tu ?
Isabelle se leva lentement, comme à regret... Elle avait une taille élevée, extrêmement mince et svelte – trop mince même, car elle ployait, comme une tige frêle, sous le poids d’une lassitude physique ou morale. Ses mouvements paisibles, presque lents, semblaient témoigner de cette même fatigue.
Elle rangea son ouvrage et gagna un long couloir au bout duquel s’ouvrait la cuisine. Une vieille femme très corpulente allait et venait dans cette vaste pièce, gourmandant à tout instant la fillette maigre et ébouriffée qui épluchait des légumes près d’une table.
Sans prononcer une parole, Isabelle décrocha un large tablier bleu qu’elle noua autour d’elle, et, dans le même silence, se mit à aider la vieille cuisinière. Celle-ci semblait accepter ses services comme une chose habituelle, et, de fait, en voyant la dextérité de cette jeune fille dans la besogne qu’elle accomplissait, il était permis de penser qu’elle avait dû bien souvent remplir cet office.
Mais elle n’avait pas abandonné son attitude lasse, non plus que ses mouvements presque inconscients parfois, semblait-il. Un seul instant, elle éleva un peu la voix pour prendre la défense de la fillette qui servait de laveuse de vaisselle et de petite aide.
– Mademoiselle, c’est une étourdie, une effrontée ! s’écria la cuisinière en roulant des yeux féroces. Croiriez-vous qu’elle est restée près d’une heure pour faire une petite course à côté !... Elle a été jouer je ne sais où, ou bien baguenauder devant les magasins...
– Mais, Rose, sa vie n’est pas si gaie ! On peut l’excuser un peu, cette enfant... Oui, elle a le temps de connaître l’ennui ! dit Isabelle d’un ton bas, plein d’amère mélancolie.
Une ombre semblait s’être étendue sur son front, tandis qu’elle continuait ses allées et venues à travers la cuisine. Elle retourna bientôt dans la salle à manger où une femme de chambre, plus âgée encore que Rose, et un vieux domestique très peu ingambe s’occupaient à dresser le couvert avec une sage lenteur. Là encore, la main habile d’Isabelle fit à peu près toute la besogne.
Au moment où la jeune fille finissait d’allumer les bougies du grand lustre hollandais, le timbre électrique de la porte d’entrée résonna... À cette heure, ce ne pouvait être encore qu’un fournisseur, et, sans se presser, le vieux valet de chambre alla ouvrir.
– Monsieur Marnel ! s’exclama-t-il d’un ton de surprise joyeuse.
– Eh ! oui, mon bon vieux Martin ! répondit un organe sonore et franc.
Isabelle, debout sur un escabeau, se trouvait en pleine lumière, précisément en face de la porte de l’antichambre. Il lui était impossible d’éviter d’être vue, et, d’ailleurs, elle ne semblait pas désireuse de se cacher. Son calme et mélancolique regard se fixa, un court moment et sans beaucoup de curiosité, sur l’arrivant – un homme de haute et forte stature, aux cheveux blanchissants coupés ras, au visage accentué, très coloré, extrêmement ouvert et sympathique...
À peine la femme de chambre l’eût-elle aperçu qu’elle gagna le plus vite possible l’antichambre.
– Monsieur Marnel, vous voilà enfin revenu ! dit une voix chevrotante. Les Turcs et tous ces sauvages de là-bas ne vous ont pas tué, tout de même !
– Eh ! vous le voyez, ma bonne Mélanie ! dit-il gaiement tout en ôtant son pardessus ruisselant. Mais je vous retrouve toujours travaillant... Il me semble que vous avez bien gagné votre retraite.
– Rose, Mélanie et moi sommes toujours les seuls serviteurs de madame Morand, dit fièrement le vieux Martin. Madame veut bien nous garder, et nous ne demandons pas mieux, car ici, c’est à peu près comme chez nous. Monsieur pourra juger que le service ne marche pas mal encore.
– Vraiment !... Rien qu’à vous trois !... C’est extraordinaire !
Il s’interrompit, tandis que son regard extrêmement surpris se dirigeait vers la salle à manger. Là, sous la vive clarté répandue par le lustre, se dressait Isabelle, vêtue de sa modeste robe grise et de son tablier de servante... Mais ces détails vulgaires disparaissaient devant le charme délicat de cette blanche figure, devant la grâce naturelle de cette attitude.
Revenant rapidement de sa surprise, l’étranger rejoignit Martin qui avait été ouvrir la porte du salon. En passant devant la salle à manger, il s’inclina courtoisement. Un bref petit mouvement de tête lui répondit... Lorsqu’il fut passé, Isabelle sauta à terre et se dirigea d’un pas posé vers l’office, emportant l’escabeau qu’elle semblait avoir quelque peine à soulever.
Dans le salon, la voix affaiblie de Martin avait jeté ce nom :
– M. Marnel !
Une légère exclamation lui répondit, et, de la pièce voisine, sortit la grande et forte dame qu’Isabelle avait appelée grand-mère. Une extrême surprise, mêlée d’une satisfaction sincère, se lisait sur ce visage dominateur.
– Marnel !... d’où arrivez-vous donc ? dit-elle en lui tendant la main avec un élan cordial qui devait être rare chez elle.
– Mais tout droit de Smyrne, ma chère amie ! Ce retour était préparé depuis quelques mois, mais je voulais surprendre tous mes amis, selon ma coutume d’autrefois... vous rappelez-vous, Sylvie ?
– Oui, c’était votre plaisir, et je vous en faisais toujours le reproche, Marnel. Mais je n’ai jamais réussi à vous corriger... Enfin, je vous pardonne cette fois en considération du contentement que me cause votre retour. Voici cinq ans, presque jour pour jour, que vous avez quitté Paris, Marnel... Venez par ici, nous serons plus tranquilles pour causer un peu, car mes premiers invités ne vont pas tarder à apparaître.
– En effet, je me suis rappelé que c’était le jour de votre dîner et de votre réception hebdomadaires, dit-il en la suivant dans la pièce voisine, vaste cabinet de travail garni de meubles anciens et de bronzes superbes. Une lampe très puissante était posée sur le bureau, éclairant les papiers épars et les volumes entrouverts.
– Vous travaillez toujours, Sylvie ? continua-t-il en prenant place sur le fauteuil que lui désignait madame Norand. J’ai lu vos dernières œuvres et j’y ai retrouvé les qualités d’analyse, le style à la fois fort et charmeur qui ont fait connaître au monde entier le nom de Valentina... Mais, Sylvie, plus encore qu’autrefois, vos héros m’ont semblé singulièrement désenchantés et leur morale lamentablement triste et... désespérante.
Elle eut un léger mouvement d’épaules.
– Que voulez-vous, Marnel, c’est la vie ! dit-elle froidement. Un peu... très peu de bonheur, beaucoup de souffrances et de désillusions... et, en fin de compte, aucun autre espoir que le repos de la tombe, l’anéantissement final.
– Que dites-vous là, Sylvie ! s’écria-t-il sans pouvoir retenir un geste de protestation. D’où vous viennent ces théories lamentablement amères ?... Vous n’étiez pas ainsi désabusée, jadis.
– Parce que je croyais encore au bonheur, dit-elle d’un ton bas, plein d’amertume. Mais parlons de vous, Marnel, reprit-elle de son accent ordinaire. Ce voyage en Orient ?...
– Absolument superbe ! Je rapporte une moisson de documents et de notes précieuses pour les œuvres qui sont là à l’état d’embryon, dit-il en se frappant le front. Eh ! voilà cinq ans que j’ai quitté la France et que je voyage du Caucase aux Balkans, de Constantinople à Téhéran, sans compter mes petites fugues dans la Mandchourie et un séjour de trois mois au pays des rajahs. Bien des choses ont changé depuis... Mais, à propos, j’ai été stupéfié de retrouver encore vos vieux domestiques. Comment peuvent-ils s’en tirer, Sylvie ?
– Cela marche fort bien, je vous assure. Ces braves gens me sont très attachés.
– Alors vous leur donnez des aides ? dit-il en riant. Car, vraiment, je crois que vous seriez étrangement servie avec ces bons invalides seuls. Mais d’ailleurs, à propos d’aide, je crois en avoir aperçu une... une jeune personne qui m’a semblé – soit dit en passant – d’une apparence peu appropriée à cet état... C’est probablement une demoiselle de compagnie, une surveillante ?
Un pli profond barra soudain le front de madame Norand, tandis qu’une lueur de contrariété traversait son regard.
– C’est ma petite-fille, Isabelle d’Effranges, répondit-elle sèchement.
– La fille de votre jolie Lucienne.
– Oui, la fille de Lucienne, vicomtesse d’Effranges, dit-elle du même ton bref et saccadé.
– Elle ne ressemble pas à sa mère. C’est le type des d’Effranges, absolument... Elle m’a paru une ravissante personne, moins brillante, moins coquette que Lucienne, n’est-ce pas ?... Je doute que l’élégante Lucienne Norand ait jamais consenti à revêtir cette modeste tenue de ménagère.
L’ombre se fit plus épaisse sur le front de son interlocutrice dont les lèvres se pincèrent nerveusement.
– Malheureusement, je ne l’y ai jamais forcée, dit-elle d’un ton où vibrait une émotion puissante. Si j’avais agi envers elle comme je l’ai fait pour Isabelle, elle vivrait encore, ma jolie Lucienne. Mais j’ai été faible... Pendant plusieurs années après mon mariage, uniquement occupée de mes travaux littéraires, de la renommée que j’ambitionnais, du succès, de la célébrité même qui m’arrivait alors que j’étais si jeune encore, je laissais mes enfants aux soins d’une gouvernante... Et cependant, je les aimais, je le compris le jour où mon second fils mourut d’une chute causée par l’imprudence d’une servante. Alors je rapprochai de moi Marcel et Lucienne, je m’occupai d’eux... mais surtout pour les gâter, car je ne pouvais résister au moindre caprice de ces êtres ravissants... Oui, on a vanté bien souvent ma force de caractère, mon invincible énergie, et, de fait, je n’ai jamais plié, excepté devant mes enfants. Aussi qu’est-il advenu ?... Après une vie folle que lui payaient les sommes chaque année plus considérables gagnées par sa mère, Marcel Norand est mort à vingt-deux ans, des suites d’une blessure reçue en duel... et on a dit que c’était un bonheur pour sa mère, et pour lui, car la folie le guettait, et, déjà, avait commencé son œuvre...
Sa voix avait pris un son rauque et elle passa lentement la main sur son front où se formaient de douloureuses rides.
– Comme vous avez souffert, ma pauvre Sylvie ! dit M. Marnel d’un ton ému.
– Si j’ai souffert !... Mais le pire m’attendait encore. J’idolâtrais Lucienne, si radieusement jolie, si vive, tellement charmante qu’on ne pouvait la voir sans l’admirer. Depuis son enfance, elle n’avait jamais eu qu’un objectif : s’amuser... s’amuser toujours, briller, éblouir les autres, et moi je n’avais qu’un désir : l’y aider de tout mon pouvoir. Uniquement par orgueil, elle avait épousé à dix-huit ans le vicomte d’Effranges, riche et frivole gentilhomme qui la laissa veuve deux ans plus tard... À vingt-trois ans, Lucienne mourait, fatiguée, usée par une vie mondaine sans trêve ni répit qui avait brisé son tempérament délicat. Elle quittait la vie en m’accusant de sa mort... parce que je ne lui avais jamais rien refusé... parce que je l’avais trop aimée... Oui, elle a dit ce mot...
Quelque chose d’étrangement douloureux vibrait dans cette voix brève et cet énergique visage se contractait.
– ... Aussi me suis-je juré que ma petite-fille ne pourrait me faire ce reproche. Elle ne sera pas une femme de lettres, une savante ou une artiste, j’ai expérimenté par moi-même le peu de satisfaction que l’on recueille de ces états. Bien moins encore elle ne connaîtra le monde, ses futilités, ses plaisirs... le monde qui m’a enlevé Lucienne... Et puisque j’ai tué ma fille en l’ayant trop aimée, je n’ai pas voulu courir ce risque avec Isabelle. Elle a été élevée dans une institution sévère où son instruction a reçu l’orientation indiquée par moi. L’absolu nécessaire en fait de lettres et de sciences, et, en revanche, beaucoup de travaux manuels, tel a été mon programme, scrupuleusement suivi par la directrice de cet établissement. Quand Isabelle en est sortie, je l’ai prise chez moi, mais ce programme s’y est maintenu. Ma petite-fille ne voit que quelques amies choisies par moi, c’est-à-dire sérieuses, bonnes ménagères et peu cultivées d’esprit ; elle ne connaît rien des plaisirs du monde et est elle-même ignorée de mes relations. C’est elle qui s’occupe de tous les détails du ménage, qui aide mes vieux serviteurs – et, en passant, Marnel, je peux vous apprendre que je les conserve uniquement pour donner de l’occupation à Isabelle – et une occupation telle que je l’entends.
– Mais je ne comprends pas votre but ! observa M. Marnel qui semblait abasourdi... À quoi destinez-vous votre petite-fille ?
– À quoi ?... Mais uniquement à devenir une bonne femme d’intérieur. Je la marierai bientôt à quelque propriétaire campagnard qui trouvera en elle une compagne sérieuse et entendue, entièrement occupée de son mari, de ses enfants et de sa maison. Elle ne sera pas exaltée ou sentimentale, j’y ai veillé... Mon amour – trop fort – pour ma fille ne m’ayant causé qu’amertume et désillusion, je n’ai jamais cherché à rapprocher de moi Isabelle, et j’ai tout fait pour lui persuader qu’une affection quelconque entraîne inévitablement la douleur. Aussi est-elle devenue indifférente à tous et à toutes choses – condition expresse de bonheur.
– Épouvantable égoïsme, voulez-vous dire ! s’écria M. Marnel dans un élan indigné. Oh ! Sylvie, Sylvie, qu’avez-vous fait !... Et cette jeune fille ne s’est pas révoltée contre la vie que vous lui imposiez ?
– Dans son enfance, bien souvent. Elle était vive, enthousiaste, excessivement désireuse d’apprendre... Mais nous avons mis ordre à ces tendances désastreuses,. Isabelle ne sait que ce que j’ai voulu lui faire connaître, et elle a compris depuis longtemps que la révolte était inutile, que rien ne me ferait fléchir, dit madame Norand d’un ton de fermeté implacable. Aujourd’hui, elle est uniquement attachée à ses devoirs de ménagère, et les aspirations inutiles, les rêves sont morts en elle.
– Le croyez-vous ?... Et vous était-il permis de pétrir cette jeune âme à votre fantaisie, de détruire en elle, sous prétexte de rêves, tout idéal, d’étouffer en quelque sorte sa destinée tracée par Dieu pour y substituer une autre conçue par vous ?... Cela me semble excessif, Sylvie.
– La destinée de nos enfants est celle que nous leur faisons, dit-elle sèchement. J’en ai eu la preuve pour Lucienne.
– En partie, Sylvie, et à condition de ne pas contrarier les aspirations légitimes, l’instinct du beau et du bien que Dieu a mis dans l’âme humaine, à des degrés différents, afin de donner un but spécial à chaque vie.
– Vous parlez en chrétien fervent, dit madame Norand avec une légère ironie. L’êtes-vous donc devenu dans vos voyages ?
– Malheureusement non, répondit-il avec gravité. Je voudrais avoir ce bonheur... et, comme beaucoup, je me demande parfois ce qui me retient. L’habitude, sans doute, la lâcheté, que sais-je ?... Mais, pour en revenir à votre petite-fille, je trouve que vous poussez trop loin votre système en refoulant complètement tous les élans de cette intelligence et de ce cœur.
Madame Norand demeura un instant silencieuse, remuant machinalement les feuillets épars devant elle. Enfin, elle leva d’un mouvement énergique sa tête hautaine.
– Tenez, Marnel, j’ai toujours pensé que l’imagination entrait pour une bonne part dans les souffrances humaines. Si cette folle ne venait agiter et troubler le cœur de l’homme, celui-ci connaîtrait plus de jours heureux... Eh bien ! qu’ai-je fait pour Isabelle ? J’ai affaibli son imagination, je l’ai à peu près supprimée en ne lui accordant pas les aliments nécessaires... oui, vraiment, je crois qu’elle n’a plus désormais que des désirs calmes et bornés. Chez elle, tout sera pondéré, réfléchi, plein de modération... En un mot, j’ai dirigé ce cœur de telle sorte qu’il ne reçoive la secousse d’aucune passion. N’est-ce pas l’idéal, le secret du bonheur ?
– Beaucoup appelleraient un crime cet accaparement d’une âme, cette destruction de l’étincelle divine... car, Sylvie, s’il est des passions condamnables, d’autres sont nobles et belles et honorent l’humanité. Indistinctement, vous avez tenté de détruire les unes et les autres, en traçant à ce jeune cœur une voie sévère et monotone, remplie de devoirs et privée de bonheur, puisque vous lui refusez la liberté morale et les rêves les plus légitimes... Mais ne craignez-vous pas que l’étincelle divine si bien refoulée ne jaillisse quelque jour, fulgurante et victorieuse, de cette âme comprimée par vous ?
– Vous croyez à l’étincelle, à l’aveuglant éclair du coup de foudre ? dit ironiquement madame Norand. Pas moi, lorsqu’on sait en prémunir de bonne heure les jeunes imaginations. J’ai agi pour le bien d’Isabelle, et, soyez-en certain, elle sera plus heureuse que les jeunes mondaines ou les petites romanesques que je rencontre sans cesse sur ma route... Mais nos amis sont arrivés, j’entends la voix aiguë de Rouvet et la basse formidable de Cornelius Harbrecht. Venez, Marnel... À propos, je vous prierai de ne pas parler de ma petite-fille. Très peu de mes connaissances savent qu’elle vit près de moi, car je veux qu’elle demeure, même de nom, en dehors du monde qu’elle ne doit pas connaître. Si je vous en ai dit quelques mots, c’est en considération de notre amitié d’enfance continuée sans interruption jusqu’à ce jour, et équivalant ainsi à une parenté.
Il s’inclina en signe d’assentiment et la suivit dans le salon où se trouvaient réunies une vingtaine de personnes. Il y avait là les noms les plus connus du Paris littéraire, romanciers, poètes, écrivains en tous genres, et, au milieu d’eux, quelques femmes que leur talent mettait au rang des célébrités du jour... Parmi celles-là madame Norand – Valentina dans le monde des lettres – occupait une place prépondérante tout autant par son énergie dominatrice et sa vaste intelligence qu’en raison du renom acquis par ses œuvres. L’âge n’avait en rien diminué ses facultés, et les lettrés attendaient toujours avec impatience l’apparition de ces romans charpentés de main de maître, semés de subtiles analyses du cœur humain et teintés – de plus en plus fortement – d’une philosophie amère et douloureuse – œuvres qu’un lecteur non prévenu eût attribuées sans hésitation à une intelligence masculine desséchée par le vent des désillusions et de l’égoïsme, et se réfugiant, lâche et désespérée, dans la négation du relèvement de l’âme après la chute ou la douleur, dans l’affreuse doctrine du néant.
Et cet écrivain était une femme, une mère et une aïeule.
... Isabelle et sa tante achevaient de prendre leur repas dans la chambre de mademoiselle Bernardine, ainsi qu’il en était chaque fois que madame Norand avait des hôtes. Malgré l’invitation qui lui en avait été faite une fois pour toutes, la vieille demoiselle, amie de la tranquillité et peu portée sur les choses de l’esprit, ne s’était jamais souciée de paraître à ces réceptions et préférait de beaucoup son tête à tête avec sa nièce, qui écoutait patiemment ses interminables histoires sur les faits et gestes des habitants d’Ubers, le village berrichon où s’élevait le petit castel de mademoiselle Bernardine d’Effranges. Elle était la sœur cadette du défunt vicomte, père d’Isabelle, et n’avait pas connu sa nièce jusqu’à l’année précédente, où il lui était venu à l’esprit de faire un voyage à Paris. Madame Norand l’avait poliment invitée à demeurer quelque temps près de la jeune fille, car elle s’était vite aperçue que cette petite femme nulle et insignifiante était incapable de déranger ses plans. Cette nouvelle vie plaisait sans doute à mademoiselle Bernardine, puisqu’elle ne parlait pas de départ et s’apprêtait au contraire à suivre madame Norand à sa maison de campagne.