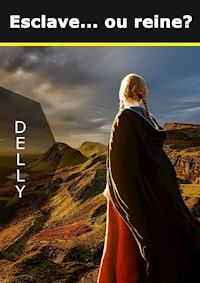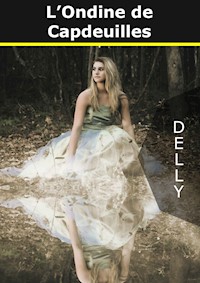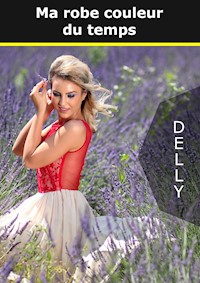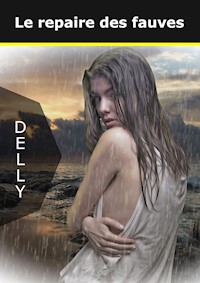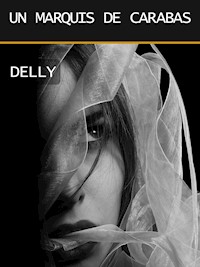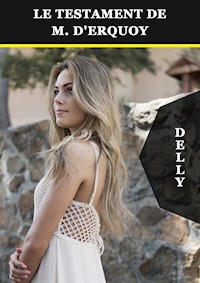2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Fuyant le château de Rosmadec (et surtout le baron Pelveden !), Gaspard de Sorignan, Françoise d'Erbannes et Bérengère trouvent refuge auprès du duc de Rochelyse. Est-ce la beauté de Bérengère qui trouble tant le duc ou bien le mystère qui entoure ses origines ? Avide de lever le voile sur cette, énigme, le duc se heurte au redoutable baron de Pelveden. Lui seul, puisqu'il a recueilli Bérengère alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, connait le secret, mais ne veut pas le révéler ? le temps presse et, dans l'ombre, les ennemis guettent... Bérengère est en danger...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le Sphinx d'émeraude
Pages de titreroman123456789101112131415161718192021222324Page de copyrightDelly
Le sphinx d’émeraude
roman
Delly est le nom de plume conjoint d’un frère et d’une sœur, Jeanne-Marie Petitjean de La Rosière, née à Avignon en 1875, et Frédéric Petitjean de La Rosière, né à Vannes en 1876, auteurs de romans d’amour populaires.
Les romans de Delly, peu connus des lecteurs actuels et ignorés par le monde universitaire, furent extrêmement populaires entre 1910 et 1950, et comptèrent parmi les plus grands succès de l’édition mondiale à cette époque.
1
Dans le jour terne tombant des hautes fenêtres étroites, la grande chambre paraissait infiniment austère et triste, avec ses murs couverts d’une tapisserie usée, ses meubles massifs en bois sombre, le lit à colonnes drapé de lourdes tentures foncées, la cheminée de pierre noircie où brûlait un maigre feu totalement insuffisant pour réchauffer, en cette aigre journée d’octobre, la malade grelottante dans son fauteuil à haut dossier sculpté.
Le baron de Pelveden, de plus en plus dominé par le démon de l’avarice, surveillait jalousement la provision de bois rentrée à l’automne et comptait chaque bûche apportée dans l’appartement de sa femme.
Mme de Pelveden serrait autour d’elle un vieux manteau doublé de fourrure datant de l’époque où, jeune encore, avide d’hommages et de plaisirs, elle était une des beautés en renom de la cour. Un fichu de laine noire couvrait en partie ses cheveux gris, cachait les oreilles et s’attachait sous le menton par une agrafe d’or ornée d’améthystes. Le visage, frais et vermeil qu’avait jadis chanté Pierre de Ronsard, n’était plus qu’un visage de vieille femme malade, blafard, creusé de rides, avec des yeux pleins de sombres pensées qui rêvaient dans l’ombre des paupières mi-baissées.
Aux pieds de la baronne, sur un vieux coussin de velours, se tenait assise une fillette occupée à filer diligemment.
Elle paraissait tout au plus quatorze ans. Sa robe de grossière étoffe flottait autour d’un corps délicat, visiblement amaigri. La petite tête fine semblait se courber sous le poids d’une chevelure d’un chaud brun doré, qui tombait en deux nattes de chaque côté d’un visage menu et charmant, très blanc, trop blanc même, un visage d’enfant qui souffre, qui s’attriste, avec ce pli aux coins de la petite bouche pourprée et cette ombre d’inquiétude dans les yeux d’un ardent bleu violet, sur lesquels frémissaient des cils presque noirs.
Mme de Pelveden, tout à coup, parla :
– Bérengère, y a-t-il encore une bûche dans le coffre ?
– Non, madame, il n’y en a plus.
Une lueur, où la colère et la souffrance se mélangeaient, passa dans le regard de la baronne.
Bérengère ajouta :
– Corentine pourra peut-être m’en donner une. Je vais aller voir...
Mais une main jaunie, ridée, arrêta le mouvement que la fillette esquissait pour se lever.
– Non, c’est inutile. M. de Pelveden va venir et je lui demanderai de m’en faire apporter... Sais-tu, enfant, si M. de Sorigan est revenu ?
– Il n’était pas encore là à midi, madame.
La baronne dit d’un air soucieux :
– Tout cela finira mal. M. de Pelveden et Mme de Kériouët sauront un jour ou l’autre que Gaspard et Françoise se rencontrent ainsi... Mais ce Gaspard, sous ses airs de douceur, est un grand entêté ; quant à Françoise, elle est coquette, adroite... Et, vraiment, ce n’est pas la femme que je voudrais pour mon neveu !
– Elle est très belle, dit pensivement Bérangère.
Une sorte de sourire entrouvrit les lèvres de la baronne. Celle-ci songeait : « Belle, tu le seras bien autrement qu’elle, enfant, et tu auras un charme incomparable qu’elle ne possédera jamais. »
– Oui, on ne peut contester sa beauté. Mais je crois que les qualités de l’âme sont à peu près inexistantes. Françoise d’Erbannes n’a pas de cœur et rendrait fort malheureux ce bon Gaspard, s’il réussissait à l’épouser, en dépit de son oncle et de Mme de Kériouët.
– Vous croyez, madame ?
– J’en suis sûre. Cette jeune fille n’aspire qu’au plaisir, qu’à une existence de luxe et d’orgueil. M. de Sorigan n’a, il est vrai, que peu de fortune ; mais son cousin de Lorgils est l’intime du duc de Joyeuse, le beau-frère de la reine et l’un des favoris du roi. Ainsi, l’ambitieuse fille espère-t-elle probablement arriver de ce côté à la situation désirée... Oh ! oui, oui, j’ai deviné tout cela ! Mon expérience est grande, Bérengère, car ce n’est pas pour rien que j’ai vécu plus de vingt-cinq années dans cet enfer de la cour !
La fillette leva sur son interlocutrice un regard pensif.
– Comme vous semblez en avoir conservé un mauvais souvenir, madame ! C’était donc un lieu bien terrible ?
Un frisson agita les épaules de Mme de Pelveden, une ombre douloureuse couvrit les yeux couleur de noisette, qui avaient été si rieurs, si tendrement provocants.
– Oui, mon enfant, un lieu terrible pour les âmes, qui, à chaque instant, y trouvent la tentation : tentation de l’orgueil, tentation du plaisir, tentation du mensonge, de l’hypocrisie... Car l’on veut plaire aux souvenirs, on veut gagner leur faveur et avoir part aux honneurs ou aux biens dont ils disposent. Oui, vraiment, c’est une triste chose... une triste chose !
Des soupirs gonflaient la poitrine de la baronne ; une larme glissa le long de sa joue flétrie.
Bérengère prit sa main et y appuya ses lèvres.
– Vous en avez bien souffert, madame ?
Mme de Pelveden eut un amer sourire en murmurant :
– J’en ai souffert, oui... plus tard ; j’en souffre toujours, et seule la miséricorde de Dieu pourra me donner le repos de l’âme.
À ce moment, la porte s’ouvrit, livrant passage à un homme d’assez petite taille, maigre, à la tête chauve entourée d’une étroite couronne de cheveux gris. Le visage osseux, jauni, se terminait par une petite barbe en pointe restée presque complètement noire, comme les sourcils broussailleux surmontant des yeux verdâtres au regard dur et méfiant. Ce personnage était vêtu d’un pourpoint râpé, de hauts-de-chausses défraîchis, de chaussures usées ; néanmoins, dans cet accoutrement, il conservait un certain air qui empêchait d’oublier que ce minable gentilhomme avait été un brillant seigneur de la cour d’Henri II et, sous les rois François et Charles, ses fils, une sorte de confident, de favori occulte de la reine Catherine.
Bérengère se leva aussitôt. Emportant sa quenouille, elle quitta la pièce après avoir salué le baron, qui affecta de ne pas s’en apercevoir.
– Comment allez-vous, ma mie ?
M. de Pelveden s’approchait de sa femme en attachant sur elle un regard scrutateur.
Laconiquement, elle répondit :
– Très mal.
– Heu ! c’est vite dit !... Mais enfin, je crois que vous exagérez...
Il attirait un siège, s’asseyait près de la malade. Celle-ci dit du même ton bref :
– Vous seriez aimable de me faire envoyer du bois. Je grelotte avec ce triste feu !
M. de Pelveden jeta vers le foyer un coup d’œil inquisiteur.
– Il me paraît cependant que la température est bonne, ici !
Un sourire d’ironie méprisante vint aux lèvres de sa femme.
– En vérité, monsieur, je n’aurais jamais supposé que votre amour de l’argent aboutît à cette abominable lésinerie ! Autrefois, vous saviez dépenser à propos et la baronne de Pelveden avait dans ses coffres tout le bois nécessaire !
M. de Pelveden eut une grimace de colère.
– La jeunesse est folle, madame... La jeunesse est folle ! J’ai commis des sottises comme les autres ; mais l’âge mûr m’a rendu prudent.
– Et à qui donc profiteront les biens que vous entassez ?... Tenez, je vous conseille de les faire enfouir avec vous dans votre tombeau. De cette façon, au moins, vous serez logique.
Le baron leva les épaules.
– Oui, oui, vous seriez fort aise que je vous permisse de gaspiller cet argent... pour le donner à votre hérétique de neveu par exemple, où gâter ridiculement cette petite Bérengère !
– Gâter Bérengère !... Pauvre enfant !... Si je pouvais seulement lui procurer la nourriture nécessaire à son âge, des vêtements plus conformes à sa position...
– Qu’avez-vous à me parler de sa position ? Vous savez fort bien que j’ai ramassé cette enfant sur une route, à quelques lieues d’ici, et que nous ignorons tout d’elle !
– Moi, oui, je l’ignore... Mais vous, non. Vous, François, vous savez qui est cette petite fille. Vous l’avez ramenée lors de ce voyage à Paris que vous fîtes il y a treize ans, sous un prétexte qui ne me trompa point... Car je suis sûre, moi, que vous avez été appelé par la reine mère.
– Ah ! vraiment, vous êtes sûre, madame ? Eh bien ! je serais désolé de vous enlever cette idée qui doit amuser votre imagination... Or, donc, qui pensez-vous que puisse être la jeune personne ?
L’accent du baron était railleur ; ses lèvres minces, pâles, se plissaient en un rictus sarcastique. Mais dans son regard venait de luire une lueur d’inquiétude.
– Ce qu’elle est, je n’en sais rien. Mais je la soupçonne fille de grande race, car elle porte en toute sa personne la distinction la plus raffinée... Et quand on connaît Madame Catherine... quand on sait de quoi elle est capable, dès qu’il se trouve un être gênant son intérêt, son ambition... ou simplement dès qu’elle souhaite se venger...
M. de Pelveden interrompit sa femme, d’un ton bref et dur :
– Madame Catherine n’a rien à voir là-dedans. Elle ignore l’existence de cette petite fille que j’ai trouvée, comme je vous l’ai dit, sur une route des environs de Nantes. Par pitié, je l’ai recueillie, je l’ai conduite ici dans l’intention qu’elle fût élevée pour en faire une servante. Mais vous vous êtes prise d’engouement pour elle et, si je n’y avais point mis bon ordre, vous auriez donné à cette enfant trouvée une éducation de grande dame...
Mme de Pelveden se redressa en un mouvement d’indignation.
– Je ne lui aurais pas, du moins, mesuré la nourriture de telle sorte que la malheureuse enfant, depuis quelque temps surtout, a juste ce qu’il faut pour ne pas mourir tout à fait de faim !... Si bien que je me demande parfois, monsieur, quelle est votre intention à son sujet ?
Devant le regard accusateur de sa femme, M. de Pelveden ne baissa pas les yeux. Il ricana de nouveau :
– Vous voulez sans doute insinuer que je songe à la tuer peu à peu ?... Décidément, Anne, je le répète, vous avez une riche imagination, devant laquelle reste désarmé un homme aussi peu inventif que je le suis ! Mais rassurez-vous, Bérengère ne me gêne pas du tout et continuera de vivre paisiblement ici, sous votre bonne protection.
M. de Pelveden ne répondit pas. Il dirigeait son regard vers l’âtre et fit observer, en désignant un tison qui s’enflammait :
– Tenez, voilà votre feu qui reprend, ma mie !
Mais Mme de Pelveden se souleva un peu dans son fauteuil et appuya sur la main du baron des doigts tremblants.
– François, écoutez-moi !... Je suis une femme qui va mourir et qui voit son existence passée, ainsi que la vôtre, à la lumière de l’éternité toute proche. Or, c’est une chose terrible à contempler... car nous avons été de grands coupables. Nous avons transgressé la plupart des lois divines... et je sais que vous, François, avez commis des actes qui auraient dû vous faire livrer au bourreau, si vous n’aviez été protégé, puissamment protégé !
M. de Pelveden fit entendre une sorte de gloussement sardonique.
– Charmante appréciation sur votre époux, madame ! Oui, j’étais fort protégé. Vous vous souvenez sans doute que, sous le règne du roi François II, la reine Catherine, mise à l’écart par messieurs de Guise, se trouva impuissante à m’assurer cette protection, si bien que je voyais ma précieuse vie fort en danger quand, sur votre prière, monseigneur François de Guise voulut bien étouffer l’affaire.
Le blême visage devint plus pâle encore. La main crispée se retira, froissa nerveusement le drap du manteau. Un regard douloureux se leva sur la figure ironique et mauvaise, tandis que la voix oppressée disait avec un frémissement de souffrance :
– Vous auriez pu épargner ce souvenir à votre femme mourante, qui s’est repentie, qui expie... oh ! qui expie durement, je vous l’affirme ! Pourtant, qui donc m’a sournoisement poussée à oublier tous mes devoirs, à céder aux attraits du plaisir, de la coquetterie ? Vous, monsieur, vous, mon mari, qui deviez guider, conseiller la toute jeune femme que j’étais, quand nous parûmes à la cour après notre mariage. J’avais été bien élevée, par une mère bonne et vertueuse. J’étais prête à subir l’influence d’un mari que j’aimais, qui, tout d’abord, me parut plein de nobles qualités... Hélas ! cette influence fut ma perte ! Oh ! vous avez agi de façon magistrale ! Graduellement, vous avez introduit en moi le goût du mal, d’abord en m’apprenant à devenir vaine de ma beauté, à prendre plaisir aux compliments, aux hommages qu’elle m’attirait et dont je m’effarouchais au début. Quand la tentation se présenta pour moi, j’étais prête à y succomber... Et dans cette voie, vous avez continué de m’encourager, non ouvertement, – ce n’est pas dans votre manière – mais en dessous, d’après les procédés chers à la reine Catherine, près de qui vous alliez chercher vos directives.
Le baron s’était renversé contre le dossier de son siège et continuait de considérer sa femme avec un air de raillerie mauvaise.
– Quel réquisitoire, madame ! Convenez que je suis un époux bénévole de vous laisser rejeter sur moi vos torts, que je ne vous ai jamais reprochés, d’ailleurs !
Comme si elle ne l’entendait pas, Mme de Pelveden reprenait :
– Depuis dix ans, depuis que je sens les atteintes de la maladie qui va m’emporter, le repentir est venu pour moi, peu à peu. J’ai eu des heures terribles, François, des heures où j’ai désespéré de la miséricorde divine. Puis je me suis humiliée, j’ai imploré le pardon de Celui qui a eu pitié d’autres coupables comme moi. Et ce pardon, je l’ai reçu. Je suis prête à quitter ce monde. Mais vous... Vous ! Oh ! François, dites-le-moi sincèrement : n’éprouvez-vous pas quelquefois des remords ?
M. de Pelveden, les jambes croisées, tenait maintenant son genou entre ses mains sèches. Il fit entendre un petit ricanement avant de riposter :
– Non, pas du tout de remords, ma chère Anne... pas le moindre. C’est une faiblesse qui m’est inconnue.
La malade joignit les mains dans un geste de pathétique indignation.
– Quelle terrible destinée ! Ah ! malheureux, malheureux ! Ainsi, tout ce que vous avez fait... vos crimes, vos mensonges, vos pires fautes contre les lois divines et humaines... vous ne regrettez rien ?
– Rien, madame, je le répète. Ma conscience est fort large et ce que vous appelez mes crimes, mes fautes, s’y trouvent parfaitement à l’aise.
Mme de Pelveden ferma les yeux, en portant les mains à sa poitrine haletante. Ses lèvres remuèrent, comme si elle murmurait une prière. Puis elle releva les paupières et, de nouveau, regarda le visage sardonique.
– Au moins, François, voulez-vous me promettre que, après ma mort, vous confierez Bérengère à ma nièce de Fauchennes qui ne refusera pas de l’accueillir dans le couvent dont elle est prieure ?
– Ne vous occupez pas du sort de Bérengère, Anne ! Cette enfant n’est rien pour vous...
– Rien pour moi ! Mais je l’aime comme une fille ! Elle est si attachante ! On ne peut rêver nature plus charmeuse, si délicate, si aimante, d’une droiture admirable, d’une intelligence vraiment exceptionnelle. Si vous n’aviez pas un cœur insensible, vous-même auriez éprouvé l’attrait de tant de qualités ravissantes... Et cette beauté qui s’annonce en elle... cette beauté qui m’épouvante, pour une enfant isolée, sans famille, sans affection, quand je n’y serai plus ! Ah ! promettez-moi... promettez-moi ce que je vous ai demandé !
Elle joignait les mains en regardant son mari avec supplication.
M. de Pelveden décroisa ses jambes et se leva, avec la lenteur qu’exigeaient ses rhumatismes.
– Vous m’avez rebattu les oreilles avec vos lamentations au sujet de cette petite, madame. Fort heureusement, je suis bon homme et sais qu’il faut passer bien des lubies à une malade. Je pourrais aussi, pour vous contenter, vous faire une promesse que je n’aurais pas l’intention de tenir. Mais je ne le veux point. Si j’ai le déplaisir de vous perdre, Bérengère continuera d’habiter Rosmadec... et maintenant, trêve sur ce sujet. Dites-moi plutôt ce que peut bien faire votre neveu, pendant ces absences qui se multiplient un peu trop depuis quelque temps, à mon avis ?
Mme de Pelveden appuya sa main contre son cœur, comme pour essayer d’en comprimer les battements tumultueux. Une rougeur de fièvre, depuis un instant, montait à ses joues creusées. Elle répondit avec effort :
– Il chasse dans les marais de Saint-Guénolé, vous le savez bien.
– Ouais ! Je sais surtout que Saint-Guénolé est bien près de Kériouët.
Comme Mme de Pelveden gardait le silence, en fermant les paupières avec lassitude, le baron reprit :
– Gaspard est un garçon fort en dessous ; et bien qu’il ait eu l’air d’accepter sans trop de révolte ma décision et celle de Mme de Kériouët, je le soupçonne de chercher à revoir la belle Françoise. Vous êtes d’ailleurs bien capable de l’y encourager, car vous lui avez toujours témoigné une indulgence ridicule.
En soulevant à peine les paupières, la baronne répondit sèchement :
– Je me garderais de le faire, Mlle d’Erbannes, à mon avis, n’étant pas la femme qu’il lui faudrait.
– Heu ! Oui, vous n’avez jamais eu pour elle beaucoup de sympathie... pour Mme de Kériouët non plus. Celle-ci n’est cependant pas mauvaise femme, en dépit de ses cancans... À propos, il faudra que je m’informe si elle a vendu sa terre de la Croix-Noire au duc de Rochelyse, dont l’intendant lui offrait un prix avantageux... Voilà un homme près duquel, dit-on, le roi et les plus riches seigneurs sont pauvres !
M. de Pelveden fit quelques pas à travers la pièce, puis se détourna brusquement :
– Vous souvenez-vous, Anne, d’Alain de Trégunc ?
Mme de Pelveden tressaillit et, de nouveau, un peu de sang monta à son visage.
– Comment ne m’en souviendrais-je pas ? Il était de ceux qui ne peuvent passer inaperçus !
Un sourire de raillerie glissa entre les lèvres du baron.
– Oui, oui, c’était un homme fort agréable... non pas beau, mais mieux que cela. Il aurait pu faire bien des conquêtes et les dédaigna cependant, ce qui fut un tort, du moins pour l’une d’elles.
La baronne se redressa en attachant sur son mari un regard investigateur.
– C’est de la reine que vous voulez parler ?... Oui, j’ai toujours pensé que l’assassinat du marquis de Trégunc était dû à une vengeance de femme, de femme puissante et sans scrupules.
– Eh bien ! madame, peut-être y eut-il autre chose que cela. Mais ce n’est pas mon affaire de vous éclairer là-dessus. Du reste, Alain de Trégunc était un être assez étrange, craint de bien des gens et qu’on soupçonnait de sorcellerie.
Dédaigneusement, la baronne leva les épaules.
– Ce sont là racontars d’envieux. La vérité, c’est que la supériorité morale de Trégunc, la valeur de son intelligence et une trop grande clairvoyance, touchant parfois à la divination, portaient ombrage aux âmes tortueuses, aux âmes fourbes et perverties.
– Eh ! que vous êtes ardente à sa défense, ma mie ! Je vois en effet que vous ne l’avez pas oublié... pas plus que je n’ai oublié comme vous perdîtes connaissance quand, le soir du 24 août 1572, je vins vous dire : « Le marquis de Trégunc a été assassiné dans son hôtel, par erreur, car il était bon catholique. »
La pâleur, de nouveau, s’étendit sur le visage de la malade. Elle riposta d’une voix étouffée :
– Oui, je l’aimais, je l’admirais. Oh ! je ne vous l’ai pas caché ! Mais lui demeurait inaccessible, dans son étrange froideur, dans son dédain presque insultant... Ah ! celui-là n’avait pas une âme de courtisan, une de ces âmes veules, plates, misérables, ou bien cyniques, fourbes, prêtes à toutes les compromissions.
– Comme la mienne ! interrompit sardoniquement M. de Pelveden. Décidément, ce Trégunc était un homme bien dangereux... Et j’ai ouï-dire que son neveu bien-aimé, M. de Rochelyse, l’est encore beaucoup plus. Ah ! madame, je déplore que les infirmités me retiennent éloigné de la cour, car j’aurais plaisir à y faire quelques séjours et à vous en rapporter des nouvelles ! Ici, nous vivons dans un désert où n’arrivent que de lointains échos du monde civilisé.
– Civilisé ! répéta Mme de Pelveden avec un accent d’amère ironie.
Le baron se rapprocha d’elle, prit une main qu’on ne lui offrait pas et l’effleura de ses lèvres.
– Bonsoir, ma chère Anne. Vous serez certainement mieux demain. Tout à l’heure, Corentine vous apportera une bûche ; mais ménagez-la, car le gaspillage est chose infiniment répréhensible et que je ne souffrirai jamais sous mon toit.
Quand il eut quitté la chambre, Mme de Pelveden demeura longuement immobile. De continuels frémissements agitaient son visage, une angoisse profonde troublait les yeux las. Tout à coup, les mains jaunies se tordirent en un geste de détresse, et la malade murmura désespérément :
« Bérengère... pauvre petite Bérengère, que deviendras-tu quand je ne serai plus là ? »
2
Le domaine de Rosmadec, propriété du baron de Pelveden, était situé dans le pays de Cornouaille, à une demi-lieue de la mer sauvage qui battait les côtes granitiques creusées de grottes profondes, de gouffres insondables où, les jours de tempête, se précipitaient avec furie les flots démontés.
Les terres de Kériouët lui faisaient suite, dans la direction des montagnes Noires. Elles étaient de peu d’étendue et assez pauvres. Mais Mme de Kériouët veillait elle-même à leur culture et en tirait un revenu suffisant pour ses besoins, limités à une nourriture frugale, à des vêtements datant de vingt ans et à un train de maison très simplifié.
Elle passait pour une bonne femme, assez serviable. Mais il n’y avait pas de pire langue à dix lieues à la ronde. Elle recueillait avidement tous les racontars et les transformait, les déformait de telle sorte que la meilleure réputation sortait de là déchirée, méconnaissable.
Depuis trois ans, elle avait pris chez elle une nièce devenue orpheline. Françoise d’Erbannes était la filleule du baron de Pelveden, ami de son père où tous deux vivaient à la cour. Élevée en province par une aïeule austère, elle n’avait jamais connu le monde, son luxe et ses plaisirs. Mais depuis l’adolescence, elle aspirait secrètement vers lui avec une ardeur qui devenait fiévreuse, à mesure que les années passaient. Maintenant, elle atteignait vingt ans et se demandait avec désespoir quel époux elle trouverait, dans cette solitude, pour l’enlever à une existence abhorrée et lui donner ce qu’elle rêvait.
Les plus proches logis nobles étaient le château de Rosmadec et celui de Ménez-Run, appartenant au duc de Rochelyse, marquis de Trégunc, qui n’y résidait jamais. À Rosmadec, il y avait bien Gaspard de Sorignan, neveu de la baronne et pupille de son mari. Mais ce jeune homme de dix-neuf ans n’avait qu’une petite fortune et, de plus, semblait peu ambitieux. Néanmoins, Mlle d’Erbannes s’était appliquée à lui tourner la tête, à chaque occasion où ils s’étaient trouvés en présence. Elle y avait bien vite réussi. Gaspard était un excellent garçon, franc et quelque peu naïf encore, et ce n’avait été qu’un jeu pour Françoise de le prendre au piège d’un savant mélange de coquetterie et d’ingénuité.
Mais quand Gaspard, sans vouloir écouter les observations de sa tante, avait avoué à M. de Pelveden son désir d’épouser Mlle d’Erbannes, il s’était heurté à une opposition formelle. Le baron n’entendait pas que son pupille prît pour compagne une fille pauvre qui, en outre, affectait de mépriser les occupations ménagères et ne songeait qu’à s’admirer elle-même... En quoi, d’ailleurs, le tuteur n’avait pas tort. Mais sa manière tranchante et sardonique irrita secrètement le jeune homme et fit germer en son âme la révolte.
De son côté, Mme de Kériouët, avertie par son voisin et ami, avait déclaré à sa nièce que jamais elle n’autoriserait un mariage de ce genre, en premier lieu parce que M. de Sorignan était huguenot et, ensuite, à cause de sa maigre fortune.
Françoise feignit de se ranger aux raisons de sa tante. Il existait en elle un grand pouvoir de dissimulation et un esprit d’intrigue déjà développé. En outre, les scrupules l’embarrassaient peu. Au fond, elle ne tenait pas du tout à épouser Sorignan et n’avait vu dans ce mariage que le moyen d’échapper à ce qu’elle appelait « ce sépulcre de Kériouët »... Mais une autre idée se formait en son esprit et, quand elle l’eut mûrie, elle en fit part à son soupirant, qui l’adopta avec enthousiasme.
Le projet était celui-ci : ils fuiraient tous deux, gagneraient Paris et iraient demander l’hospitalité au comte de Lorgils, cousin de Gaspard. Là, ils ne se marieraient... du moins, Françoise le disait. Mais elle pensait : « Nous verrons, une fois là-bas... Sortons d’abord d’ici. »
Le plan n’était pas sans péril. Si les jeunes gens étaient rattrapés, ils pourraient s’attendre à un sévère traitement. Mais une fois à Paris, le danger, pensaient-ils, serait conjuré, M. de Lorgils devant facilement obtenir la protection du roi au cas où M. de Pelveden chercherait à les poursuivre de sa colère.
Cet après-midi d’octobre, à l’heure même où le baron entrait dans la chambre de sa femme, Mlle d’Erbannes sortait du manoir de Kériouët, d’un pas flâneur qui devait faire supposer à sa tante, au cas où celle-ci l’apercevrait, qu’elle allait faire une simple promenade.
Elle prit la route qui conduisait aux marais de Saint-Guénolé. Mais elle n’alla pas jusque-là Bientôt, elle s’engagea dans un chemin creux et arriva à un menhir que couvraient de leur ombre deux vieux noyers. Un jeune homme était là, assis à terre près d’un cheval qui broutait. Il se leva d’un bond et accourut vers Françoise.
– Enfin !... Comme vous avez tardé !
Une légère moue de dégoût souleva la lèvre fine et rose de la jeune fille.
– Figurez-vous, Gaspard, que ma tante a exigé que j’assistasse à la confection d’un certain pâté de lapin dont, en mourant, elle me fera la très grande faveur de me léguer la recette !... Pouah ! je déteste ces sortes de besognes !
Gaspard jeta un regard de compassion sur la main longue et blanche qu’il venait de baiser avec ferveur.
– Vous n’êtes pas faite pour elles, ma belle Françoise ! Ah ! J’espère que bien vite je pourrai vous donner la position brillante pour laquelle vous êtes née !
– Je l’espère aussi. Mais nous avons des moments difficiles à passer, avant d’en arriver là.
Elle fit quelques pas et s’assit sur un tronc d’arbre couché à terre, en invitant Sorignan à prendre place près d’elle. Le jeune homme obéit avec empressement et lui saisit de nouveau la main, en attachant un regard de tendre admiration sur le visage au teint clair, aux traits irréprochables, dont les yeux d’un gris bleuté lui souriaient câlinement.
– Voyons, Gaspard, qu’avez-vous décidé pour notre départ ? Comment vous procurerez-vous un cheval pour moi ?
– Je le prendrai dans les écuries de Rosmadec. Comme mon oncle a la disposition de mon revenu, il se payera là-dessus, ainsi que je le lui écrirai d’ailleurs, quand je serai à Paris. Il a du reste assez rogné sur mon entretien pour que je n’aie pas de scrupules à agir de cette façon... Quant à l’argent pour le voyage, je le demanderai à ma tante, qui m’a dit un jour : « Si tu te trouvais dans un grand embarras pécuniaire, préviens-moi, car je conserve de côté une petite somme que j’ai pu soustraire à la rapacité du baron. »
– Mais quelle raison donnerez-vous à Mme de Pelveden ?
– Eh bien ! comme je ne puis lui apprendre que je vais m’enfuir avec vous, – car, cela, elle ne l’accepterait pas – je ne lui parlerai que de moi, de ma résolution d’échapper à la tyrannie que fait peser sur moi M. de Pelveden. C’est une chose qu’elle comprendra et approuvera. Depuis longtemps, elle déplore l’inaction que m’impose mon oncle, sous prétexte que, si j’entre à l’armée, ce sera dans le parti protestant, pour combattre le roi. En réalité, ce despote veut continuer de me tenir sous sa férule. En outre, il serait probablement bien fâché d’avoir à me servir les revenus de ma terre de Monterneau.
– Évidemment. Il juge que ses mains crochues n’ont jamais assez raflé... Est-il vrai qu’il a été autrefois en grande faveur près de la reine mère ?
– Je l’ignore. Il ne parle jamais du passé, pas plus que ma tante.
Une lueur mauvaise brilla dans le regard de la jeune fille.
– Oh ! Mme de Pelveden !... Si l’on en croit ma respectable tante, elle n’a pas été précisément un modèle à proposer aux jeunes personnes.
La tête blonde de Gaspard se redressa, en un mouvement d’indignation.
– Quoi ! cette vieille pie au bec empoisonné oserait s’attaquer à la réputation de ma noble, de mon excellente tante ?
– Allons, allons, ne vous emportez pas ! dit Françoise d’un ton conciliant. Vous savez bien qu’il ne faut guère croire aux racontars de Mme de Kériouët.
D’un geste caressant, elle posait sa main gauche sur celle de Sorignan qui tenait toujours la droite. Nulle, comme elle, ne savait allier la réserve à la coquetterie, pour le plus grand malheur du pauvre Gaspard, complètement dominé par cette habile créature.
– ... Dites-moi, maintenant, à quel jour nous fixerons notre départ ?
Gaspard hocha la tête, en prenant une mine embarrassée.
– C’est que... je ne sais trop encore... Ma tante paraît de plus en plus malade et il serait malséant de la quitter en cet état.
Les fins sourcils blonds de la belle Françoise se rapprochèrent, et la voix tout à l’heure caressante prit une intonation sèche pour riposter :
– En ce cas, nous pourrons peut-être attendre longtemps ! Mme de Pelveden est malade depuis des années et il n’est pas impossible qu’elle en vive plusieurs autres...
– Oh ! non. Pauvre tante, elle est très mal, je vous assure... et je ne voudrais pas que mon départ fût pour elle une cause d’émotion ou d’ennuis avec son mari.
– Vous venez de dire tout à l’heure qu’elle approuverait ce départ.
– Oui, mais elle tremblera pour moi, tant qu’elle saura que je n’ai pas échappé à la poursuite des gens que le baron ne manquera pas de lancer contre moi.
Françoise se leva lentement, comme pour mieux faire remarquer la souplesse, l’élégance de sa taille mince et bien prise.
– À votre aise ! Mais prenez garde, monsieur de Sorignan, que vos tergiversations n’aboutissent à faire manquer tout notre plan. Or, vous savez ce que nous risquons : moi, l’internement dans un couvent et, vous, la peine capitale, ou tout au moins de longues années de geôle pour l’enlèvement d’une fille mineure. En outre, je ne vous cache pas que cette attente, cette incertitude ont le plus douloureux effet sur mes nerfs. Je ne mange plus, je perds le sommeil et, en vérité, peut-être n’aurai-je plus dans quelque temps la force d’accomplir un tel voyage !
Le frais visage de Gaspard frémit un peu, ses yeux bleus s’emplirent d’une émotion inquiète.
– Serait-ce possible, ma chère mie ?... En ce cas, il faut en effet partir le plus tôt possible ! Je rentre ce soir à Rosmadec et, dès demain matin, je parlerai à ma tante.
Sans quitter la physionomie dolente qu’elle venait de prendre, Mlle d’Erbannes recommanda :
– Surtout, ayez soin de ne pas lui laisser deviner que je pars avec vous ! Comme vous le disiez tout à l’heure, elle ne voudrait pas entendre parler de cela... d’autant plus que je la soupçonne de ne pas m’avoir en grande sympathie.
Gaspard baissa les yeux d’un air gêné, en répliquant :
– Mais non, vous vous trompez... Je vous assure que...
Françoise l’interrompit, avec un léger haussement d’épaules :
– Allez, je sais à quoi m’en tenir, mon pauvre Gaspard. Je devine qu’elle a essayé de vous détourner de moi. Fort heureusement, elle n’a pas réussi, car vous m’êtes toujours très attaché... n’est-ce pas, mon ami ?
Un caressant regard s’attachait sur Sorignan. Celui-ci mit un genou en terre et couvrit de baisers la main que lui abandonnait la belle Françoise.
– Vous savez bien que je suis à vous ! Que je suis votre dévoué et amoureux serviteur.
Une lueur où l’ironie se mêlait à la satisfaction glissa entre les cils blonds demi-baissés.
– Oui, je le sais, cher Gaspard, dit une voix douce et tendre. Aussi vous ai-je donné toute ma confiance et tout mon cœur. Allons, relevez-vous et convenons des derniers arrangements pour ce départ.
– Il vous suffira de vous tenir prête, à partir de demain, et de venir chaque jour voir ici, dans la cachette du menhir, si j’y ai déposé un mot vous donnant le jour du départ et les indications nécessaires... Car il est plus prudent que nous ne nous revoyions pas. M. de Pelveden est méfiant et pourrait me chercher noise si je faisais encore une absence comme celle-ci.
– Où pensez-vous me donner rendez-vous ?
– J’aimerais que ce fût au bois de Trelgoat, si vous ne trouvez pas la distance trop longue ? Je serais là avec les chevaux, dès minuit, afin que nous ayons déjà fait du chemin quand, au jour, on s’apercevra de notre disparition.
– Très bien... Et maintenant, vous retournez à Rosmadec ?
– Je vais d’abord passer chez le vieux Covarec, pour y prendre les canards que je devrai présenter à mon oncle, comme preuve que j’ai bien fréquenté les marais de Saint-Guénolé. Puis je m’en irai tout droit sur Rosmadec, pour y arriver avant la nuit noire.
– Eh bien ! au revoir, mon ami.
Elle lui tendit de nouveau sa main, puis s’éloigna... Au bout de quelques pas, elle se détourna et envoya un baiser au jeune homme qui la suivait d’un regard extasié.
– À bientôt, ma bien-aimée ! cria Gaspard.
Et il demeura immobile jusqu’à ce que la forme svelte, la tête fine coiffée de cheveux blonds eussent disparu à un tournant du sentier.
Alors, il sauta sur son cheval et s’éloigna dans la direction opposée à celle qu’avait prise Mlle d’Erbannes.
3
Dans la matinée du lendemain, Gaspard, en remontant de la salle où la vieille Corentine venait de lui servir une tasse de lait, croisa Bérengère dans l’escalier.
– Bonjour, petite ! dit-il amicalement, en lui caressant la joue du bout des doigts. Tu vas me donner des nouvelles de ma tante, ma mignonne Bérengère ?
Les beaux yeux couleur de violette se couvrirent d’une ombre d’angoisse, la voix au timbre pur et doux trembla en répondant :
– Mme la baronne n’est pas bien du tout... Et elle a l’air si triste, si préoccupé ! Tout à l’heure, elle m’a dit : « Quand tu verras M. de Sorignan, préviens-le qu’il vienne près de moi, car j’ai à lui parler le plus tôt possible. »
D’une main nerveuse, Gaspard se mit à tirer sa petite barbe blonde, taillée en pointe, selon la mode de l’époque.
– Ma pauvre tante !... Quel malheur ce sera pour nous, Bérengère, quand elle nous aura quittés !
Un frisson agita les épaules amaigries de la fillette. Très bas, elle répéta :
– Oh ! oui, quel malheur !... Pour moi surtout !
– Oui, que deviendras-tu, ma pauvre petite, avec ce grigou de baron qui est toujours si dur pour toi ?
Une sincère compassion apparaissait dans le regard de Gaspard. Le neveu de la baronne s’était toujours montré bon et affectueux pour l’enfant charmante que Mme de Pelveden avait, autant que possible, protégée contre l’inexplicable animosité de son mari. Il la traitait en petite sœur et, plus d’une fois, lui avait procuré un léger supplément de nourriture pris sur sa propre part, cependant peu copieuse elle-même.
Un sanglot s’étouffa dans la gorge de Bérengère.
– Je ne sais pas... Dieu aura pitié de moi et me défendra contre lui... Allez vite, monsieur, près de Mme de Pelveden. J’ai compris qu’elle vous attendait avec impatience.
La baronne reposait dans son grand lit à colonnes drapé de violet foncé. Gaspard, qui ne l’avait pas vue depuis deux jours, fut douloureusement frappé du changement qui s’était fait en ce visage pourtant déjà si altéré auparavant par les lents ravages de la maladie.
– Vous voilà, mon enfant !... Bérengère m’a appris hier que vous étiez rentré à la nuit.
– Oui, madame, en rapportant trois belles paires de canards sauvages.
Le jeune homme s’approchait du lit et baisait respectueusement la main qui se tendait vers lui.
– J’espère que Corentine vous les accommodera mieux que la dernière fois... Asseyez-vous, Gaspard, et causons un peu.
Elle se tut un moment, les yeux mi-clos ; puis, quand le jeune homme eut pris place sur un siège, elle reprit de sa voix toujours haletante :
– La mort est proche pour moi... Non, n’essayez pas de protester. Je la sens prête à me saisir, un jour ou l’autre, soudainement... et j’en remercierais Dieu si, après moi, je ne laissais Bérengère et vous... Parlons de vous d’abord, Gaspard. Vous savez que j’ai toujours souhaité vous voir embrasser l’état militaire, qui convenait à vos goûts et vous aurait préservé de la pénible oisiveté où vous languissez dans ce triste Rosmadec. Mais, pas plus aujourd’hui qu’auparavant, M. de Pelveden n’en veut entendre parler.
– Je le sais bien ! Aussi ai-je résolu de passer outre... et de m’enfuir.
Mme de Pelveden eut un long tressaillement.
– Vous enfuir ! Où ?
– Je gagnerai Paris, j’irai demander l’aide de mon cousin de Lorgils. Par M. de Joyeuse, j’obtiendrai la protection du roi contre M. de Pelveden...
– La protection du roi ? Pensez-vous qu’il l’accordera à un huguenot, mon enfant ?
– Eh bien ! s’il me la refuse, je me réfugierai près du roi de Navarre, avec l’appui de M. d’Aubigné, que connut et estima mon père.