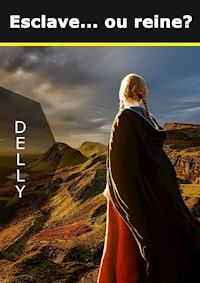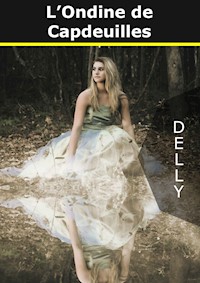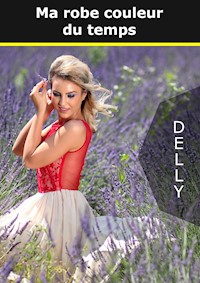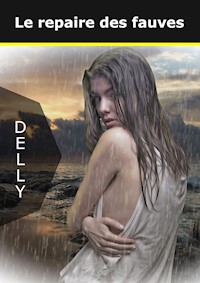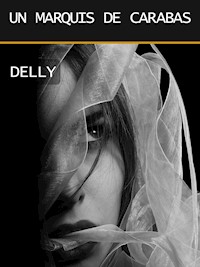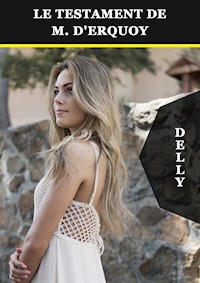2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Oui, puisqu'il l'a promis à son père mourant, Siegbert épousera Myriam de Würmstein. Oui, lui, le fier, l'ombrageux comte de Hornstedt épousera cette inconnue dont il a appris avec horreur qu'elle est la petite-fille d'un usurier... Et lors de ce mariage secret, rapide et glacé, le lourd voile qui couvre le visage de Myriam cache à Siegbert les immenses yeux noirs, les cheveux d'on de cette fiancée haïe. Sitôt la cérémonie achevée, il fuit. Myriam, quant à elle, sera contrainte à une humble retraite provinciale. Un seul sourire éclaire sa vie celui de sa sueur Rachel, une enfant fragile et tendre. Siegbert, brillant diplomate, sillonne l'Europe... jusqu'au jour où le destin met sur sa route une exquise inconnue, aux longs cheveux d'on roux, au sombre et doux regard. Et qui tient pan la main une frêle adolescente...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le candélabre du temple
Pages de titrePremière partieIIIIIIIVVDeuxième partieI - 1II - 1III - 1IV - 1Troisième partieI - 2II - 2III - 2IV - 2V - 1VIVIIVIIIIXXPage de copyrightDelly
Le candélabre du temple
Première partie
I
– Du soleil !... Enfin, enfin !
En parlant ainsi, Carolia d’Eichten se levait et s’approchait d’une fenêtre ouverte. Elle pencha au dehors sa tête blonde et la retira presque aussitôt, une goutte d’eau ayant eu l’indiscrétion de tomber sur le front blanc auréolé de petites boucles savamment disposées.
– ... Il fera bon pour une promenade, Siegbert... pourvu que nous nous chaussions en conséquence, naturellement.
Elle se tournait vers l’intérieur de la pièce – un vaste et beau salon garni de meubles anciens de grande valeur.
Une femme d’une quarantaine d’années, blonde et forte, vêtue de faille noire, travaillait à une broderie, non loin d’un jeune homme qui feuilletait un vieux livre à reliure fanée. Interpellé ainsi par Carolia, ce dernier leva la tête, et ses yeux d’un bleu foncé, au regard volontaire, s’adoucirent légèrement en s’attachant sur le frais visage, sur le regard caressant qui semblait lui adresser une sorte de prière.
– Je suis à votre disposition, Carolia. Mais j’irai auparavant prendre des nouvelles de mon père.
Il posa le livre sur une table voisine et se leva, développant sa haute taille souple et mince, dont un vêtement de coupe parfaite accentuait encore l’élégance.
La laideur proverbiale des comtes de Hornstedt n’existait pas chez lui. Sa mère, une Hongroise, célèbre pour sa beauté, lui avait donné ses traits, son épaisse chevelure brune aux larges ondulations et ses yeux dont les admirateurs enthousiastes de la charmante comtesse disaient : « On ne trouverait pas d’étoiles comparables à eux. » Mais il tenait bien de la race paternelle sa façon altière de porter la tête, et la rare intelligence, l’orgueilleuse volonté qui se discernaient aussitôt sur cette jeune physionomie.
– Je suis vraiment inquiet de sa santé, continua-t-il en se rapprochant de Mlle d’Eichten. Ce voyage à Vienne l’a complètement abattu.
La dame blonde, levant les yeux, fit observer :
– Quelle idée de se déranger ainsi, quand les médecins lui recommandent le repos absolu ! Il semblait, vraiment, que rien au monde n’eût pu l’empêcher de répondre à l’appel de ce comte Würmstein avec lequel il est si singulièrement demeuré en relations – alors que cet homme, par ses excentricités, ses théories révolutionnaires et surtout son mariage avec la fille d’un misérable accapareur, d’un odieux usurier, est devenu un être absolument déconsidéré, digne du mépris de ses pairs !
Tandis que la comtesse Sophie de Hornstedt parlait ainsi, le plus profond dédain s’exprimait sur son large visage au teint clair, que couvrait une légère couche de poudre.
– Évidemment, ma tante, je n’ai pas non plus bien compris comment mon père, si pénétré de nos traditions d’honneur, conservait des rapports, fût-ce lointains, avec cet individu. Celui-ci, paraît-il, lui a rendu autrefois un grand service... Ce doit être bien important, vraiment, pour que ce pauvre père se soit cru tenu de répondre à l’appel d’un tel homme le demandant à son lit de mort – et cela, au risque de compromettre gravement une guérison déjà si lente.
– Ce qui est arrivé... Le docteur Blück semblait vraiment inquiet ce matin, Siegbert.
– Oh ! ce brave Blück est le pessimisme incarné ! dit Carolia, avec un sourire qui découvrit de fort jolies dents. Je suis certaine que si j’allais le consulter, il me découvrirait une ou plusieurs maladies.
Le regard amusé de Siegbert enveloppa la belle jeune fille qui se tenait devant lui, cambrant un peu sa taille souple, bien prise dans une toilette élégante et offrant, avec son teint rosé, ses yeux brillants et animés, une parfaite image de la santé.
– Il faudrait qu’il fût aveugle, en ce cas... L’air de Hoendeck vous a merveilleusement fortifiée, Carolia.
– Oh ! cela, je ne le nie pas ! Hoendeck est un paradis pour moi ! dit-elle avec chaleur.
Une légère rougeur de confusion vint aussitôt à ses joues, et les cils blonds s’abaissèrent un instant sur les yeux dont le regard très doux s’adressait éloquemment à Siegbert.
Un sourire nuancé d’ironie entrouvrit les lèvres du jeune comte.
– Nous en sommes enchantés, croyez-le, Carolia. Notre vieil Hoendeck apprécie à sa valeur la préférence que vous lui accordez. Cependant, vous allez l’abandonner dans quelques jours...
– Oui, puisque mon tuteur veut absolument m’avoir à Marienbad ! Je ne puis vraiment lui refuser cela, me semble-t-il ?
– Évidemment. Mais dans les plaisirs mondains de là-bas, vous oublierez de regretter Hoendeck.
Un reproche ému apparut dans les yeux d’un gris bleuté.
– Oh ! Siegbert, pourrais-je jamais oublier la place que tient Hoendeck dans ma vie ? C’est ici que j’ai été accueillie, pauvre petite orpheline, et avec quelle bonté ! Grâce à vous tous, j’ai connu les joies de la famille... j’ai connu le bonheur... Et vous pouvez penser que j’oublierais ! Siegbert, me connaissez-vous donc si peu ?
Il se mit à rire, sans ironie cette fois, en prenant la main blanche qui sortait d’un volant de dentelle.
– Ne vous désolez pas, car je plaisantais... Quant à vous bien connaître... Connaît-on jamais bien un cœur féminin, d’abord ?
– Oh ! l’affreux sceptique !... L’entendez-vous, marraine ?
– Mais oui, mais oui, j’entends, mignonne !
Avec un sourire satisfait sur ses lèvres épaisses, la comtesse Sophie considérait les deux jeunes gens debout à quelques pas d’elle.
– ... Siegbert plaisante encore, car vraiment, il est si facile de pénétrer votre jeune cœur, limpide comme le plus pur cristal !
Siegbert éclata d’un rire quelque peu moqueur et Mlle d’Eichten lui fit écho.
– Voilà ma tante qui se lance dans les métaphores !... Un cœur de cristal ! C’est délicieux !
– Siegbert, que tu es peu sérieux ! dit Mme de Hornstedt en essayant de prendre un air fâché.
Sur la physionomie de Siegbert, la gaieté s’effaça pour faire place à une gravité un peu railleuse.
– Peu sérieux ? Ce n’est pas ce que disent certains de mes amis, qui me voient refuser de m’associer à leurs folies... Et ne vous en déplaise, ma tante, j’ai déjà un respectable bagage de réflexion, de scepticisme... de désillusions aussi, quelque peu...
– Des désillusions ? Siegbert, qui donc vous les a données ? s’écria Mlle d’Eichten avec vivacité.
Il riposta, mi-sérieux, mi-moqueur :
– Pas vous, Carolia, rassurez-vous. Mais en ces deux hivers, passés en partie à Vienne, dans le milieu de la cour, j’ai beaucoup observé, beaucoup étudié... pour en arriver à conclure qu’il existait dans le monde un nombre considérable de fort vilaines gens.
– Oh ! Siegbert ! s’exclama la comtesse d’un air scandalisé. Je crains fort, mon enfant, que tu te nuises beaucoup, avec cette habitude de juger sans indulgence les plus hautes personnalités.
Il eut un rire légèrement sardonique.
– Vous faites allusion à la prédiction du vieux prince Storm, ce courtisan impeccable, lequel m’a solennellement déclaré que je ne réussirais pas à la cour ?... Eh ! c’est chose possible ! En tout cas, personne ne trouvera en moi un flatteur, vous pouvez en être assurée... Carolia, préparez-vous. Je vais jusque chez mon père et je suis à vous dans dix minutes.
Il se dirigea vers une porte qu’il ouvrit, traversa un salon décoré avec un luxe antique et sévère, et entra dans une galerie dallée de marbre rouge et blanc, éclairée sur l’une de ses faces par de larges fenêtres aux profondes embrasures, tandis que l’autre était occupée par des portraits – les portraits des ancêtres de Siegbert.
Ils se trouvaient tous là, les Hornstedt du temps passé, les hommes roux, comme on les avait surnommés. De fait, il en était peu qui n’eussent cheveux et barbe de cette couleur. Presque tous, également, se tenaient dans une attitude hautaine et semblaient considérer avec orgueil ce jeune homme, leur descendant, qui passait en ce moment devant eux, jeune, élégant, plein de charme, et altier déjà comme un vrai Hornstedt.
Tout au bout de la galerie, et bien que l’on fût au cœur de l’été, un grand feu de bois brûlait dans l’immense cheminée de pierre sculptée.
Près de là se trouvait assis un homme au long visage maigre, creusé par la maladie. Ses jambes étaient enveloppées de couvertures et un incessant tremblement agitait les mains décharnées qui tenaient un journal.
En s’avançant, Siegbert demanda, sur un ton d’affectueux intérêt :
– Comment vous trouvez-vous cet après-midi, mon père ?
– Un peu moins faible peut-être, mon enfant. Mais je ne cesse de grelotter.
Siegbert se pencha pour ramener sur ses genoux la couverture qui en avait un peu glissé. En même temps, il faisait observer :
– Frileux comme vous l’êtes, vous seriez mieux ailleurs que dans cette galerie, me semble-t-il.
– Non, car il me faut de l’air... de l’air !
Et il posa les mains sur sa poitrine qui se soulevait lentement.
– Blück vous a encore grondé ce matin pour votre imprudence, n’est-ce pas, mon père ? dit Siegbert en attirant à lui une chaise pour s’asseoir près du malade.
M. de Hornstedt eut une sorte de vague sourire.
– Il ne me le pardonnera pas, Siegbert ! Pauvre Blück ! il roulait des yeux furieux !... Mais je... je ne pouvais éviter ce voyage.
Il détourna la tête et parut considérer les flammes qui léchaient les bûches amoncelées dans l’âtre énorme.
Les lèvres de Siegbert eurent un plissement de dédain.
– Je ne pourrai jamais admettre que, dans votre état de santé, vous entrepreniez ce voyage pour satisfaire au désir d’un homme tel que ce Würmstein !
– Il était mourant... Je ne pouvais lui refuser cela...
La voix du comte devenait un peu rauque et des frémissements passaient sur son visage.
– ... Il a été mon ami, et m’a rendu autrefois un service... un immense service. Je ne puis oublier... Aussi ai-je cédé à un autre désir de sa part... en acceptant de devenir le tuteur de ses filles.
Siegbert eut un brusque mouvement de stupéfaction indignée :
– Il a osé ?... Et vous avez accepté ?
– Il le fallait... Tu comprends, à un mourant, on ne refuse pas... même les choses qui paraissent inutiles, comme c’est le cas ici... car enfin, mieux valait choisir quelqu’un d’autre plutôt que moi, voué à une mort prochaine...
– Ne dites pas cela ! interrompit Siegbert avec une sorte d’emportement.
Les coins des lèvres du malade s’abaissèrent, un douloureux abattement apparut sur sa physionomie ravagée par la maladie qui le minait depuis de longs mois.
– C’est ainsi, mon enfant. Il faut se résigner courageusement à l’inévitable... Je disais donc que Würmstein m’avait confié la tutelle de ses deux enfants...
Siegbert se leva d’un mouvement si vif que sa chaise tomba à terre.
– Mais c’est inacceptable ! Vous, le tuteur des filles de cet homme rejeté par tous ses pairs !... des petites-filles de cet odieux accapareur qui a nom Eliezer Onbacz !
– Siegbert, tu me fais mal ! murmura une voix éteinte.
Le malade était livide, et son regard témoignait d’une si étrange souffrance que Siegbert en fut effrayé.
– Pardon, mon père ! dit-il d’une voix soudainement adoucie, en prenant la main du comte. Je vous ai dit un peu trop vivement ma pensée, oubliant que vous aviez fait à cet homme le très grand honneur de lui conserver un peu de votre amitié... Mais enfin, n’aurait-il pu confier cette charge à des parents ?
– Les siens l’ont renié ; du côté de sa femme, il n’avait plus que son beau-père, cet Eliezer... Or, si abaissé au point de vue moral que fût devenu ce pauvre Karl, il n’aurait jamais voulu mettre l’éducation de ses filles en de telles mains.
– Les beaux petits monstres que doivent être, moralement, de pareils rejetons ! murmura le jeune homme d’un ton de mépris railleur.
Il fit quelques pas le long de la galerie, tandis que le comte détournait de lui son regard où passait une sorte de désespoir.
– Et qu’allez-vous faire de ces intéressantes pupilles ? demanda Siegbert en revenant à son père.
– Elles seront mises en pension dans un couvent où elles recevront l’enseignement catholique... Car jusqu’ici elles ont été élevées dans la religion juive. Würmstein m’a déclaré qu’il ne tenait pas à celle-ci plus qu’à une autre et qu’il me laissait libre à ce sujet.
– C’est encore fort heureux !... Enfin, la tutelle se bornera pour vous à une lointaine surveillance... Naturellement, ces enfants ont de la fortune ?
– Oui, la dot de leur mère.
Siegbert eut un geste de dégoût.
– Voilà de l’argent honnêtement gagné !... Et elles seront les héritières du vieil Eliezer. Pouah !
M. de Hornstedt laissa retomber sa tête sur le dossier du fauteuil. Son visage apparaissait tellement blême et contracté que Siegbert s’effraya de nouveau.
– Mon père, la conversation vous fatigue. Je vais me retirer pour vous laisser reposer.
– Oui, c’est cela, mon enfant. Dis seulement à Hans qu’il fasse entrer Sulzer dès qu’elle arrivera avec les enfants.
– Quels enfants ?
– Les petites Würmstein, qu’elle a dû aller chercher hier à Vienne, dans l’institution où les avait placées leur père. Elles resteront à la Maison des Abeilles jusqu’à ce que j’aie fait choix pour elles d’un couvent.
– Oh ! le premier venu sera suffisant ! déclara Siegbert avec dédain.
Il ramassa le journal qui avait glissé à terre et le posa sur la couverture.
– Tu vas sortir ? demanda le comte.
– Oui, Carolia m’a demandé de l’accompagner.
Les traits du malade se crispèrent... Sans regarder son fils, M. de Hornstedt dit, avec un accent hésitant et troublé :
– Es-tu encore dans les mêmes idées à son sujet, Siegbert ?
– Mais certainement. Pourquoi me demandez-vous cela, mon père ?
Les doigts du malade caressèrent machinalement, pendant quelques secondes, la soie piquée de la couverture.
– Je crains que sa nature ne s’accorde guère avec la tienne. Elle est un peu superficielle, assez coquette, empressée à saisir toutes les occasions de plaisirs mondains...
– Chose assez naturelle, à son âge, quand on ne dépasse pas les limites permises. Je suis d’ailleurs persuadé qu’elle se laissera facilement guider par moi... et déjà, il me semble qu’elle manifeste des goûts plus sérieux. Ma tante l’a toujours trop gâtée, il ne faut pas nous le dissimuler. Heureusement, le mal est encore réparable, étant donné surtout son affection pour moi, qui la rend très docile à mes conseils.
– Mais au point de vue fortune... Carolia n’a presque rien... et nos affaires sont... très embrouillées.
– Oh ! un embarras momentané, sans doute ! dit négligemment Siegbert. Au reste, cette question d’argent est secondaire. J’aime Carolia, c’est donc elle qui sera ma femme, ainsi qu’il en a été convenu tacitement depuis notre enfance.
M. de Hornstedt courba un peu la tête et saisit son journal entre ses doigts plus tremblants que jamais.
– Vous ne voulez pas que je reste près de vous, mon père ? demanda Siegbert, visiblement inquiet.
– Non, merci, mon enfant. Je vais me reposer un peu avant de recevoir Sulzer et ces petites filles. Va, profite de ce rayon de soleil... profite de tes heures de bonheur. Qui peut savoir ce qu’elles dureront !...
En s’éloignant le long de la galerie, Siegbert songea douloureusement :
« Ce pauvre père doit se sentir bien mal... Il faudra que je sache absolument demain ce qu’en pense Blück. »
II
Dix minutes plus tard, Siegbert et Mlle d’Eichten sortaient du château et se dirigeaient vers le parc. Carolia avait jeté sur ses épaules un élégant burnous de lainage bleu pâle qui faisait ressortir fort avantageusement son teint de blonde. Elle était vraiment une fort jolie personne, en même temps qu’une gracieuse femme du monde... Sans doute était-ce aussi l’opinion du jeune comte de Hornstedt, car il paraissait la considérer avec une évidente complaisance.
Carolia d’Eichten, descendante d’une vieille famille suisse du canton d’Argovie, avait des liens de parenté avec la comtesse Sophie. Celle-ci, veuve d’un frère cadet du comte Chlodwig de Hornstedt, était venue tenir la maison de son beau-frère quand celui-ci avait perdu sa femme, peu après la naissance de Siegbert. Elle amenait avec elle la petite Carolia, orpheline et à peu près sans fortune, que sa mère mourante lui avait confiée.
La plus généreuse hospitalité fut accordée à l’enfant étrangère par M. de Hornstedt. Carolia se vit traitée comme la sœur de Siegbert et, de trois ans seulement moins âgée que celui-ci, elle devint sa compagne de jeux... Bientôt le comte, sur la suggestion de sa belle-sœur, envisagea sans aucun déplaisir l’idée que Carolia d’Eichten deviendrait la femme de l’héritier des Hornstedt.
Les deux enfants avaient été entretenus dans cette pensée par la comtesse Sophie, qui désirait ardemment ce mariage pour sa filleule. Siegbert, de nature très autoritaire, trouvait chez Carolia une parfaite souplesse, une admiration sans bornes et une adhésion empressée à toutes ses volontés. Lui, assez froid d’apparence, et facilement ironique, lui laissait pourtant voir parfois la tendresse un peu dominatrice qu’elle lui inspirait. Néanmoins, il n’y avait pas eu entre eux, jusqu’ici, d’engagement formel. Siegbert, en ces dernières années, avait beaucoup voyagé, puis, entre temps, passé plusieurs mois à Vienne, où son père ne mettait plus les pieds. Les deux jeunes gens s’étaient donc peu vus, depuis quelque temps. Mais les idées du jeune comte n’avaient pas changé, quant à ce projet de mariage, ainsi qu’en témoignait la déclaration fort nette qu’il venait de faire au comte Chlodwig.
Mlle d’Eichten semblait très heureuse d’une telle perspective. Bien que Siegbert n’eût que vingt-trois ans, il était déjà fort recherché, tant pour le charme de sa personne que pour son nom, l’un des plus anciens et des plus illustres du patriciat autrichien. Quant à la fortune, bien que certainement diminuée par la faute du comte Chlodwig, autrefois prodigue et joueur, on la supposait encore considérable.
Mais ces avantages venaient sans doute en seconde ligne dans le cœur de Carolia, profondément éprise de son ami d’enfance, à en juger par son émotion quand elle se trouvait près de lui, et par les tendres regards qu’elle lui adressait.
– Ainsi votre père était plus fatigué tout à l’heure, Siegbert ? demanda-t-elle au bout d’un instant de silence.
– Plus fatigué, oui, et surtout étrangement impressionnable. J’ai cru qu’il allait perdre connaissance, parce que je lui disais avec un peu de vivacité ma façon de penser au sujet de ce Würmstein... Car savez-vous dans quel guêpier ce pauvre père s’est engagé ? Il a accepté la tutelle des deux filles de cet homme !
– Oh ! vraiment ?... C’est inimaginable ! Le comte de Hornstedt, tuteur des petites-filles de cet Onhaez ? À quoi donc a pensé votre père, Siegbert, en acceptant pareille chose ?
Le jeune homme eut un geste qui signifiait : « Je n’y comprends rien ! » Machinalement, il cueillit au passage une feuille de noisetier qu’il pétrit entre ses doigts.
Carolia demanda :
– Savez-vous quel âge ont ces enfants ?
– Je vous avoue que je n’ai pas eu l’idée de m’en informer. Ces petites créatures me sont horriblement antipathiques sans les connaître... Mais si le cœur vous en dit, vous pourrez interroger Sulzer, qui doit les amener à mon père tout à l’heure.
– Au château ?... Et elles y demeureront ?
– Oh ! certes non ! Mon père veut simplement les connaître, je suppose. Elles demeureront chez Sulzer en attendant d’être placées dans un couvent... Car le comte Würmstein, reniant toutes les traditions de sa famille, faisait élever ses filles dans la religion d’Israël.
– Mais pourquoi donc ce Würmstein ne les a-t-il pas confiées à leur estimable aïeul maternel ?
– Un scrupule l’a retenu là, paraît-il... Et après tout, nous ne devons pas le regretter, dans l’intérêt moral de ces enfants, ajouta Siegbert, après un moment de réflexion. Mais enfin, j’aurais voulu voir choisir quelqu’un d’autre que mon père, pour cette charge fort déplaisante... Car il est pénible, pour un homme d’honneur, de gérer une fortune mal acquise.
– C’est vrai, les petites sont riches !
– Mieux vaudrait mille fois qu’elles fussent des mendiantes !... Mais laissons ce peu intéressant sujet, et dites-moi plutôt combien de temps vous pensez rester à Marienbad ?
– Le sais-je ? Cela dépendra du degré d’insistance que mettront M. de Hultz et sa femme à me retenir.
– Et du plus ou moins d’agrément que vous trouverez là-bas, ajouta Siegbert, avec un léger sourire ironique.
Elle leva sur lui un regard de reproche.
– Vous savez bien que cela seulement ne serait pas capable de me retenir loin de Hoendeck ! Si je n’avais craint de mécontenter mon tuteur, avec quelle satisfaction je lui aurais répondu par un refus, pour demeurer ici !
– Vraiment ?
Il plongeait un regard pénétrant dans les beaux yeux gris.
– Fi ! comte de Hornstedt, vous semblez douter de moi ! dit-elle avec un coquet mouvement de tête. Faut-il donc vous avouer que je vais trouver les journées mortellement longues, là-bas, et que je compterai les heures ?
Il riposta, mi-ému, mi-railleur :
– J’espère que non ! Amusez-vous, au contraire, sans arrière-pensée ; mais ayez parfois un souvenir pour Hoendeck.
– Un souvenir !... Oh ! Siegbert, vous savez bien...
Le plus caressant des regards s’attachait sur le jeune comte. Celui-ci, dont une réelle émotion adoucissait la physionomie, prit la main de Carolia qu’il porta à ses lèvres.
Pendant quelques instants, ils avancèrent en silence. Le soleil disparaissait depuis un moment sous l’avancée rapide d’un groupe de nuages sombres et bientôt Siegbert fit observer :
– Je crois qu’il serait prudent de retourner sur nos pas.
– En effet... Voici quelques gouttes de pluie.
Ils rebroussèrent chemin, en se hâtant un peu.
Mais la menace avait disparu quand ils arrivèrent en vue du château, vieux bâtiment d’aspect imposant qui avait conservé une allure très féodale, grâce à ses deux énormes tours sombres et à ses douves pleines d’une eau vive.
– Qui donc arrive là-bas ? demanda Carolia. On dirait Sulzer... avec deux petites filles. Sans doute sont-ce les intéressantes pupilles du comte de Hornstedt ? Il y en a une très petite encore, et qui semble contrefaite, si ma vue ne m’abuse pas.
– En effet... Voyez donc, Carolia, cette pauvre Sulzer n’a pas une tête précisément réjouie !
De fait, la grande femme maigre, correctement vêtue de noir, qui s’avançait avec les deux enfants, montrait une physionomie revêche qu’elle parut avoir peine à modifier quelque peu, en approchant du comte et de sa compagne.
Elle fit une profonde révérence et dit sèchement aux deux enfants :
– Allons, saluez Leurs Seigneuries, petites.
Elles obéirent, et esquissèrent un salut timide.
La cadette, une frêle enfant de cinq à six ans, au maigre visage trop blanc qu’encadraient des cheveux blond pâle, gardait les yeux baissés, mais l’aînée levait les siens, un peu craintifs, sur les deux jeunes gens.
– Merveilleux ! murmura Siegbert.
Ils étaient en effet d’une extraordinaire beauté, ces grands yeux noirs, très veloutés, qui semblaient occuper toute la place dans le pâle petit visage aux traits indécis, autour duquel tombait en larges ondulations naturelles une chevelure d’un admirable roux doré.
Carolia s’écria en riant :
– Eh bien, ma pauvre Sulzer, vous voilà nantie de deux pupilles ?
– Pas pour longtemps, heureusement !... Ce n’est pas qu’elles soient désagréables... non, pour être juste, je dois dire qu’elles sont tout à fait tranquilles et bien élevées. Mais enfin... leur origine... Il faudra pourtant que je les garde un peu de temps, jusqu’à ce que je me sois informée d’un bon couvent, où l’on accepte de donner à celle-ci les soins qu’exige sa santé.
Elle montrait la colonne vertébrale déviée de la plus jeune des petites filles.
– ... On voit qu’elle n’est pas forte du tout ; c’est un souffle. Rien que pour venir de chez moi jusqu’ici, elle n’en peut plus... Levez donc la tête. Rachel, que l’on vous voie un peu.
L’enfant obéit, et deux yeux couleur de pervenche se posèrent timidement sur les jeunes gens.
– Rachel ?... Et l’autre, comment s’appelle-t-elle ? demanda Carolia.
– Myriam, mademoiselle.
– Elle doit avoir une dizaine d’années, il me semble ?
D’un regard dédaigneux, Mlle d’Eichten toisait la petite fille.
– Onze ans, mademoiselle. Celle-là non plus n’est pas forte pour son âge.
– Faites atteler pour emmener ces enfants chez vous, Sulzer, ordonna Siegbert, en jetant un regard de compassion sur le visage altéré de Rachel.
– Votre Seigneurie est trop bonne ! Mais elles marcheront bien encore jusque-là.
– Évidemment. Faire atteler pour des personnages de leur espèce ! s’exclama Carolia d’un ton méprisant.
Siegbert fronça les sourcils.
– Faites ce que je vous dis, Sulzer, ordonna-t-il sèchement.
Il s’éloigna sans remarquer l’éclair de reconnaissance qui avait brillé dans les yeux de Myriam.
Carolia le suivit, et, après quelques pas, voyant qu’il demeurait silencieux, elle mit sa main sur son bras.
– Siegbert, vous ai-je donc contrarié par ma réflexion ? demanda-t-elle avec un accent d’humble douceur.
Il répliqua froidement :
– J’ai été froissé de voir que vous, une femme, ne compreniez pas la pensée d’élémentaire pitié qui me faisait agir.
– Oh ! Siegbert, j’ai cédé là à une impulsion aussitôt regrettée ! En ces enfants, je n’ai vu tout d’abord que les descendantes d’un odieux accapareur, d’un méprisable voleur ! C’est pourquoi j’ai jeté ce cri de protestation. Mais j’approuve de toute mon âme votre bonté, votre générosité... en constatant une fois de plus que vous êtes bien meilleur que moi.
Elle était charmante dans son attitude confuse, avec cet air de repentir et d’humilité sur son joli visage. Aussi la physionomie contrariée de Siegbert s’éclaira-t-elle aussitôt.
– Voilà qui est à voir ! dit-il gaiement. En tout cas, vous savez reconnaître vos torts, ce qui est d’un haut mérite... Quittez donc cette mine de confusion, chère Carolia, et allons demander à ma tante une tasse de thé. Après quoi nous ferons un peu de musique... puisque, hélas ! je vais être privé de mon accompagnatrice pendant des mois peut-être !
– Des mois !... Méchant sceptique ! dit-elle avec un joli rire clair qu’accompagnait le plus tendre des regards.
Peu de temps après, une voiture de Hoendeck déposait les deux petites filles et leur mentor devant une jolie maison de brique rose enfouie dans la verdure, entre le parc du château et le village de Gleitz.
C’était la demeure de Mme Sulzer, ancienne femme de charge du comte de Hornstedt, qui avait pris sa retraite l’année précédente pour soigner des rhumatismes devenus fort gênants. Elle ne s’y était décidée qu’avec beaucoup de peine, étant passionnément attachée au noble logis où elle avait toujours vécu, depuis l’enfance, et surtout à ses maîtres, particulièrement au jeune comte Siegbert qu’elle avait vu naître.
Le comte Chlodwig lui avait donné la jouissance de cette petite maison, que l’on appelait dans le pays « la Maison des Abeilles », à cause des ruches nombreuses établies dans le fond du jardin par le précédent habitant, un vieil intendant de Hoendeck qui avait fini ses jours là. Mme Sulzer y vivait avec une toute jeune servante, faisant elle-même une partie de l’ouvrage dès que ses rhumatismes lui laissaient quelque répit, et travaillant le reste du temps à d’interminables tricots, toujours de la même nuance, qu’elle envoyait chaque année, au moment de Noël, à une œuvre de bienfaisance.
De l’avis général, Martha Sulzer était une femme de la plus haute probité, d’une discrétion absolue pour tout ce qui concernait ses maîtres ; mais son caractère sec, peu avenant, ne lui attirait pas les sympathies.
À l’égard des deux enfants confiées à ses soins, elle n’était pas mauvaise, et même, elle leur témoignait une certaine sollicitude. Toutefois, les orphelines ne trouvaient chez elle aucune douceur, aucune de ces attentions si bonnes aux cœurs souffrants ou craintifs. M. de Hornstedt lui avait dit de bien soigner ces étrangères, elle remplissait strictement sa mission, voilà tout.
Les petites filles, en rentrant, montèrent dans la chambre qui leur était attribuée, pour ôter leurs vêtements de sortie. Myriam enleva le chapeau de paille noire qui coiffait trop lourdement la tête délicate de sa sœur, elle lissa avec un tendre soin la pâle chevelure, puis, approchant un fauteuil de la fenêtre ouverte, elle y fit asseoir Rachel.
– Là, tu seras très bien, ma chérie. Justement, le soleil revient un peu... Comme c’est heureux que nous ayons rencontré ce monsieur ! Sans lui, nous revenions à pied et tu en aurais été malade, ma Rachel.
– Oui, car j’étais bien fatiguée ! murmura l’enfant en appuyant sa tête contre la poitrine de sa sœur. Mais on est bien, ici... Toutes ces fleurs sentent bon...
Ses narines aspirèrent avec délices les parfums qui montaient du jardin.
– ... Crois-tu, Myriam, que nous resterons longtemps avec Mme Sulzer ?
– Je ne sais pas ! murmura Myriam. Je ne sais rien.
Ses beaux yeux se couvraient d’ombre, sa bouche frémissait... Car l’enfant sérieuse et aimante se demandait anxieusement ce qu’on allait faire de Rachel et d’elle, pauvres petits oiseaux sans nid... et surtout, surtout, si on ne les séparerait pas !
À cette pensée, Myriam frissonnait de détresse. Rachel, sa petite bien-aimée, qui avait tellement besoin de soins et de tendresse !...
Elles étaient tout l’une pour l’autre. À la naissance de Rachel, Myriam était demeurée toute la journée près du berceau, dans une muette contemplation et, dès ce moment, elle avait voué à sa cadette la plus ardente affection. Après la mort de sa femme, le comte Würmstein avait placé les deux enfants dans une institution tenue par des Israélites. Il se désintéressait complètement d’elles, se contentant de régler ponctuellement leur pension. Les deux sœurs avaient grandi ainsi, bien soignées physiquement, recevant une bonne éducation morale, mais privées des affections familiales. La petite Rachel, à la suite d’une chute, devenait contrefaite. On ne s’inquiéta pas assez tôt de la faire soigner, si bien que les médecins, enfin consultés, déclarèrent que la complexion délicate de l’enfant ne permettait pas le dur traitement maintenant nécessaire.
Attirant à elle un tabouret, Myriam prit place aux pieds de sa sœur, en levant les yeux sur le maigre petit visage, et toutes deux restèrent ainsi, en se considérant avec une ardente tendresse.
III
Un subit rafraîchissement de température s’étant produit, quelques jours plus tard, la petite Rachel prit froid et dut demeurer à la chambre. Sa seule distraction consistait dans la vue du jardin et des hautes cimes de la forêt, qui couvrait une partie du domaine de Hoendeck. Mais elle ne s’ennuyait pas. Son âme, déjà résignée, savait souffrir en silence et s’intéressait à un rien. Puis elle avait près d’elle Myriam, garde-malade accomplie, toujours douce, toujours souriante et s’ingéniant à distraire sa sœur chérie du mieux possible.
Rachel l’en récompensait par une affection passionnée, un peu exigeante parfois, car l’aînée, pour lui complaire, ne sortait guère de la chambre où la petite malade voulait la voir sans cesse.
Mme Sulzer avait trouvé un couvent pour les petites orphelines. Mais il ne pouvait être question de les y envoyer tant que Rachel n’irait pas mieux... En grommelant dans son for intérieur, l’ancienne femme de charge soignait l’enfant avec un certain dévouement. Rachel était attachante, même pour un cœur peu sensible. Puis le comte de Hornstedt, en apprenant sa maladie, avait recommandé : « Surtout, faites ce qu’il faut pour cette petite et pour sa sœur, Sulzer. Qu’elles ne manquent de rien, qu’elles se trouvent bien chez vous, je vous le recommande. »
Un matin, le docteur Blück constata une réelle amélioration dans l’état de Rachel. Il le déclara à Mme Sulzer d’un ton de vive satisfaction, puis ajouta, en regardant Myriam, debout près du lit de sa sœur :
– En voilà une autre qui n’a pas une fameuse mine... Je suis sûr que vous vous fatiguez auprès de votre petite sœur, ma mignonne ?
Il prenait dans sa main le menton de la petite fille et attachait un regard de bienveillant intérêt sur le mince visage altéré. Bien que célibataire endurci, le docteur Blück aimait beaucoup les enfants, et ces petites étrangères, en particulier, le charmaient vivement.
Myriam protesta :
– Oh ! non, Rachel ne me fatigue pas du tout !
– Hum !... Et puis, je suis sûr que vous ne sortez pas ?... Voilà de la bonne hygiène ! Madame Sulzer, il faut m’envoyer cette petite fille-là dans le jardin, et même lui faire faire quelques bonnes promenades.
– Ah ! pour cela, monsieur le docteur, je voudrais bien que vous me disiez comment m’y prendre ? J’ai mon travail ici, avec la petite à soigner en plus ; ainsi donc il ne me reste pas de temps pour aller courir les routes.