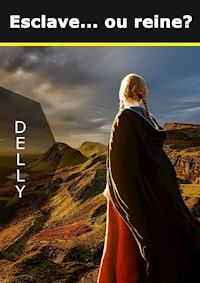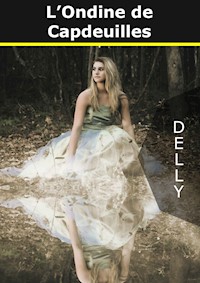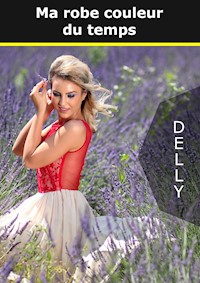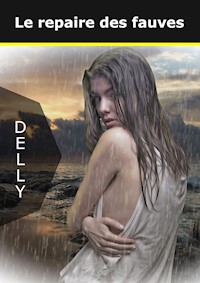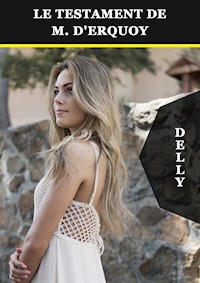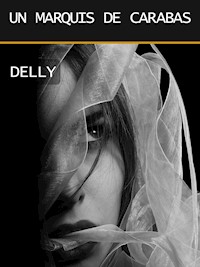
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un inconnu au visage bronzé, à l'air hautain contrastant avec ses vêtements élimés, descend du train à la gare de Treilhac. C'est Lorenzo. Il revient dans le Bordelais après une longue absence. Chacun l'évite : il ne semble pas avoir fait fortune, en Afrique ! Pour sa belle-mère, Mme Damplesmes, qui vit dans la maison de Lorenzo, ce retour est une catastrophe. Cet aventurier, ce raté est bien capable de la chasser, elle et ses enfants ! Seule, Hélène une orpheline recueillie par Mme Damplesmes, accueille le jeune homme avec chaleur. Elle-même est malheureuse, traitée comme une domestique... Dans les salons de Treilhac, on ne parle que d'un mystérieux étranger qui vient d'acheter un superbe château et les terres qui l'entourent. Les jeunes filles rêvent de ce riche parti, surnommé "le marquis de Carabas". Lorenzo a su se faire aimer de la douce Hélène. Il songe à l'épouser. Mais avant, il prépare sa revanche, qu'il veut éclatante...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Un marquis de Carabas
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVPage de copyrightDelly
Un marquis de Carabas
I
Le thé dansant que donnait aujourd’hui Mme Leduc, la femme du plus jeune médecin de Treilhac, réunissait à peu près toute la meilleure société de la petite ville. L’hôtesse allait de l’un à l’autre, vive, aimable, un peu maniérée, bonne personne, d’ailleurs, comme le disait une vieille dame au profil de chèvre à Mme Damplesmes, avec qui elle s’entretenait en regardant les évolutions des danseurs.
L’autre – une blonde entre deux âges, au visage fané – approuva du bout des lèvres. Puis elle ajouta avec une moue de dédain :
– Mais elle est bien peu intelligente, soit dit entre nous.
– Oh ! pas moins que beaucoup d’autres ! Seigneur ! que ces danses sont inélégantes ! Quand je pense à celles de mon temps ! Tout cela est bien loin, hélas !
Mme Damplesmes dit sentencieusement :
– Il faut être de son époque, madame. Voyez ma fille. Elle est très sérieuse, en dépit de ses allures plus libres que celles ayant cours autrefois.
La vieille dame jeta un coup d’œil vers une petite blonde qui causait depuis un long moment dans une embrasure de fenêtre avec un jeune homme à mine de fat, vêtu avec une élégance trop appuyée.
– Elle paraît trouver Jean-Paul Morin à son goût, votre Janine, ma chère amie.
Mme Damplesmes soupira légèrement.
– Il serait tout à fait le mari de nos rêves ! Mais on le dit très intéressé.
– C’est de famille. Le père Morin a épousé le sac, en prenant par-dessus le marché la plus laide femme du monde.
Mme Leduc, qui s’approchait des causeuses, demanda en souriant :
– De qui parlez-vous ? Quelle est la plus laide femme du monde ?
– Vous ne l’avez pas connue, chère madame. C’était la mère de Jean-Paul Morin – lequel fait rêver Janine, paraît-il.
Mme Leduc se mit à rire.
– Les jeunes filles ne rêvent plus aujourd’hui. C’était bon autrefois, ma bonne madame Clémentier !
– Dommage... grand dommage ! Elles n’en valaient pas moins, allez ! Rêver, je l’ai fait aussi quelquefois, à vingt ans : cela ne m’a pas empêchée d’aider mon mari à la direction de notre fabrique, quand la maladie l’a obligé à se ménager, ni d’élever mes cinq enfants, qui se sont bien et honnêtement débrouillés dans la vie.
– Oh ! vous êtes une femme si intelligente ! dit Mme Damplesmes sur un ton de flatterie. Mais il n’empêche que cette éducation de votre époque, et même de la mienne, avait bien des inconvénients.
– Où n’en trouve-t-on pas, dans ce pauvre monde ? Toutefois, je reconnais que nous avons encore quelques jeunes filles charmantes – comme votre petite cousine Hélène, par exemple.
La vieille dame glissait vers son interlocutrice un coup d’œil malicieux. Mme Damplesmes eut un rire pincé, en ripostant ironiquement :
– Hélène ? Mais c’est une jeune fille du temps jadis, élevée dans les jupes d’une mère ridiculement vieille France qui en a fait une petite nigaude, s’effarouchant de tout, ignorant la vie... et avec cela sensible, très sottement.
– Cela n’est pas un défaut, à mon avis. Quant à son genre d’éducation... évidemment, la pauvre Mme Surbères a eu tort de ne pas mieux l’armer pour l’existence. Mais sans doute ne pensait-elle pas être enlevée si tôt de ce monde.
Mme Damplesmes dit dédaigneusement :
– Je ne l’ai pas connue, mais je me la figure aussi insignifiante, aussi nulle que sa fille.
Mme Clémentier hocha la tête.
– Insignifiante ? Eh ! je ne trouve pas que la petite Hélène le soit tant que ça ! Bien jolie, en tout cas, fine, distinguée. Espérons qu’il se trouvera un homme intelligent pour la choisir entre cent autres.
– Sans dot ? Comptez-y, chère amie !
– Bah ! qui sait ? dit Mme Leduc. Mais en attendant de généreux prétendants, pourquoi ne l’amenez-vous pas quelquefois à nos petites réunions ? Elle se distrairait, en s’habituant un peu au monde et à la vie, que vous lui reprochez d’ignorer.
– Vous oubliez qu’elle est en grand deuil.
Mme Clémentier déclara :
– Voilà dix-huit mois que sa mère est morte.
– Mais elle ne veut pas encore le quitter. En outre, comme elle est destinée à gagner sa vie, il est beaucoup plus raisonnable qu’elle ne s’accoutume pas aux distractions mondaines.
Mme Leduc demanda :
– Et que fera-t-elle, cette pauvre petite ?
– Elle est bonne musicienne et pourra donner des leçons de piano, de solfège.
– Où cela ? Pas ici ?... Nous avons déjà Mme Bruard, Mlle Gersier, Mlle Clair... et cette dernière meurt de faim, dit-on.
– Le cas est embarrassant, je le sais bien ; pourtant, elle n’est pas capable de faire autre chose. Croyez-vous que sa mère, n’ayant pas de fortune, n’aurait pas dû la diriger vers une carrière un peu rémunératrice ? Au lieu de cela, elle l’a élevée comme une rentière... et maintenant, c’est moi qui en ai toute la charge.
Sur ces mots, Mme Damplesmes soupira, en levant au plafond des yeux de martyre résignée.
– Mais elle a une pension, cette petite, dit Mme Clémentier.
– Oui, mais si peu de chose ! Et je lui prends naturellement le moins possible là-dessus. Il faut savoir faire quelques sacrifices pour sa famille...
Elle s’interrompit. Un couple entrait, venant de la pièce voisine où l’on servait le goûter. Elle, une grande belle fille légèrement rousse, aux yeux hardis, portant avec une désinvolture provocante une toilette du genre le plus nouveau ; lui, un gros garçon d’une trentaine d’années, vulgaire, poseur et visiblement plein de suffisance. La jeune fille riait, parlait haut, montrant de belles dents entre les lèvres savamment carminées. Tous deux traversèrent le salon pour regagner le jardin qui s’étendait jusqu’à la rivière.
Mme Clémentier joignit sur ses genoux ses vieilles mains ridées en murmurant :
– Cette Camille Trémont !... Peut-on se compromettre ainsi avec ce gros Chervet !
Un rictus moqueur plissa la bouche molle de Mme Damplesmes.
– Eh ! elle cherche le mariage riche !... Théodore Chervet paraît ensorcelé, au dire de ses amis. Avec ses goûts de dépense et sa maigre dot, la belle Camille ne ferait pas si mal en épousant l’un des gros propriétaires du pays.
– Et le fils d’un usurier, d’un être taré, méprisé de tous durant sa vie. Lui-même n’est que sottise, prétention, vulgarité physique et morale. Je veux espérer que Mlle Trémont n’a pas l’âme assez basse pour accepter un pareil mari !
– Elle y arrivera, croyez-moi. Attirés par sa beauté, les épouseurs s’éloignent en apprenant que cette élégante personne a pour dot trente mille francs – sans espérances, puisque la rente assez ronde dont jouit sa mère n’existera plus à la mort de celle-ci. Camille, fille pratique, se lassera vite d’attendre le mari de ses rêves et se contentera du gros Chervet.
– Grand bien lui fasse ! Un triste ménage de plus sur la terre... Allons, je vous laisse maintenant. Pour contenter Mme Leduc, ma bonne voisine, j’ai fait cette petite apparition ; mais je retourne à mon tricot.
Mme Leduc accompagna la vieille dame jusqu’au vestibule, tout en essayant aimablement de la retenir. Mais Mme Clémentier dit en riant :
– Non, non, ma figure du temps jadis n’a que faire parmi toute cette jeunesse un peu... évaporée. Vous viendrez demain pour que je vous montre mon nouveau point de crochet. Hier, j’ai donné une leçon à Hélène Surbères qui fait, comme vous, tout ce qu’elle veut de ses jolis doigts. Ah ! la charmante créature, physiquement et moralement !
– On prétend qu’elle ne doit pas être fort heureuse chez ses cousines Damplesmes ?
– J’ai tout lieu de le penser. Mais elle ne se plaint jamais, car c’est une fière et délicate nature. Janine en est très jalouse, je m’en suis aperçue, et Mme Damplesmes ne lui pardonne pas d’être infiniment mieux que sa fille.
– Voyons, est-il exact que ces dames n’aient qu’une fortune très médiocre ?
– Parfaitement exact, Autrefois, ces Damplesmes, grands propriétaires, tenaient le haut du pavé à Treilhac et aux alentours. Mais André Damplesmes, dissipateur et insouciant, laissa péricliter si bien ses affaires qu’il dut vendre peu à peu ses terres, les plus belles de la contrée, pour venir vivre enfin des débris de sa fortune dans sa maison de Treilhac.
– J’avais entendu dire que sa femme, très dépensière, avait largement contribué à cette ruine ?
– Oui, oui, c’est vrai. Elle a sa grande part de responsabilité là-dedans – comme aussi dans l’exil de son beau-fils.
– Elle ne s’entendait pas du tout avec lui ?
– Certes non ! Lorenzo, nature ardente, un peu violente même, difficile à diriger, mais intelligent et loyal, détestait sa belle-mère qui a toujours aimé louvoyer, ruser, et dont il devinait l’influence néfaste sur la trop faible volonté de son père. Il y eut, paraît-il, de nombreux conflits entre eux – si bien qu’à dix-huit ans il s’engagea et partit pour le Maroc. Au moment de la mort de son père, il se trouvait à l’hôpital, ayant été blessé gravement dans la défense d’un poste. Un échange de lettres eut lieu entre le notaire et lui pour le règlement des affaires. Mais on ne le revit jamais par ici. Mlle Ambert, à laquelle il témoignait beaucoup d’affection, a reçu il y a quatre ans un mot de lui l’informant de son départ pour l’Afrique du Sud, où il allait chercher fortune. Depuis lors, plus de nouvelles. Est-il encore vivant ? Nul ne le sait. Mme Damplesmes continue d’habiter la maison qui appartient à son beau-fils. Des valeurs qui lui ont été attribuées à la mort de son mari, je crois qu’il ne doit plus rien rester. Elle vit sur le maigre revenu de ses enfants mineurs. Cependant, on fait bonne chère chez elle et ces dames se payent des toilettes neuves à chaque saison.
– On prétend qu’elle a beaucoup de dettes.
– Je m’en doute !... Mais à force d’expédients, on finit par faire la culbute.
– Si le jeune homme n’est pas mort, il peut, d’un jour à l’autre, venir réclamer son bien.
– Naturellement !... Ah ! elles lui feraient beau visage ! Ce serait à voir, vraiment !
Et la vieille dame rit silencieusement.
– ... Mme Damplesmes ne pouvait pas le souffrir... Maintenant encore, quand elle en parle, elle ne l’appelle que « l’aventurier ». Toujours, elle a déclaré bien haut qu’il n’était qu’un cerveau brûlé, incapable d’arriver à quelque chose.
– Était-ce votre avis ?
– Pas du tout. Évidemment, il avait un caractère difficile, une volonté peu maniable ; il travaillait par caprice, se fiant beaucoup à son intelligence, à sa mémoire remarquable, et se plaisant surtout aux exercices du corps. Personne, dans le pays, ne montait à cheval comme lui. Mais je le soupçonnais de cacher beaucoup de cœur sous ses airs frondeurs, et une grande énergie morale. Bien dirigé, ce garçon-là serait peut-être devenu un homme supérieur. Vraiment, j’aurais aimé le revoir, ce beau Lorenzo. Car c’était un superbe garçon, qui avait les yeux de sa mère, une Italienne, orpheline pauvre et de grande famille qu’André Damplesmes avait épousée par amour. Et, tenez, cette origine aristocratique de Lorenzo entrait pour beaucoup dans l’animosité de sa belle-mère à son égard. Cette pauvre Mme Damplesmes collectionne toutes les mesquineries !... Mais, chut ! n’offensons pas davantage la charité !... D’ailleurs, j’aperçois Mme Loriot qui vous cherche. Sans doute a-t-elle en réserve quelque petite critique sur votre réunion. Mais ne vous laissez pas mettre en laisse, chère madame !
II
Ce même jour, une heure plus tard, descendait d’un wagon de troisième classe, à la gare de Treilhac, un jeune homme dont la stature souple et vigoureuse, bien proportionnée, amena cette réflexion, faite avec le plus pur accent de Saintonge, sur les lèvres d’un cultivateur des environs qui regardait l’étranger au passage :
– Bonnes gens, ce n’est pas un mal bâti, celui-là !
Le voyageur, qui tenait à la main une valise usée, de teinte indéfinissable, se dirigea vers la sortie. Son allure ferme, décidée, le pli autoritaire de sa bouche, une certaine froideur hautaine sur le maigre visage bronzé, dans les profonds yeux noirs, dénotaient une nature volontaire et semblaient indiquer l’homme sûr de lui, habitué à diriger, à commander.
Sans paraître remarquer les quelques regards curieux qui le dévisageaient, il gagna le lieu de réception des bagages et donna son bulletin, en désignant une très vieille malle d’aspect minable.
– Pourra-t-on me la porter à la maison Damplesmes ?
L’employé appela :
– Clémart ! On a besoin de vous, ici.
Un vieil homme s’avança, jeta un coup d’œil sur le voyageur et balbutia, les yeux écarquillés par la surprise :
– Eh ! bon sang, est-ce que j’ai la berlue ? On dirait M. Lorenzo !
Aux lèvres du jeune homme vint un sourire qui adoucit tout à coup sa physionomie.
– Oui, vous ne vous trompez pas, Clémart, je suis bien M. Lorenzo Damplesmes. On me croyait mort, n’est-ce pas ?
– Dame, on se le demandait, monsieur Lorenzo ! Depuis le temps, songez donc ! Et dans ces pays-là... Ça fait plaisir de vous revoir. Je vous ai bien reconnu tout de suite, à vos yeux. Autrement, c’est que vous avez changé, depuis des années qu’on ne vous voyait plus... et bruni, donc !
– C’est le soleil d’Afrique, Clémart. Pouvez-vous m’emporter cette malle ?
– Bien sûr, monsieur Lorenzo. L’omnibus va partir tout de suite. Voulez-vous aussi me donner votre valise ?
– Non, merci, je la garde... Ma belle-mère habite toujours la maison, n’est-ce pas ?
– Toujours, monsieur, avec Mlle Janine, M. Félix et une cousine orpheline, Mlle Surbères.
– Surbères ?
Lorenzo cherchait dans sa mémoire.
– ... Ah ! oui, je m’en souviens. Mme Surbères était une cousine de mon père qui habitait la Bretagne. Bon, merci, Clémart. À tout à l’heure. Si vous arrivez avant moi, attendez un moment pour que je vous règle la course.
Il s’éloigna d’un pas sans hâte. Autour de lui, en ces lieux familiers où s’étaient écoulées son enfance et son adolescence, il découvrait peu de changements. Quelques maisons de plus, petites villas prétentieuses, à droite de l’allée de platanes menant de la gare vers la ville. Une cheminée de fabrique un peu plus loin, avec son entourage de bâtiments couverts de tuiles neuves. Mais, à gauche, la lente, paresseuse rivière glissait toujours sur son lit garni de longues herbes ondulantes. Le vieux pont de pierre l’enjambait encore, pittoresque et vénérable sous sa toison de lierre. Plus loin, dans la rue de la Font-Perdue, Lorenzo retrouvait à peu près toutes les mêmes boutiques, quelques-unes inchangées, d’autres modernisées. Au passage, on regardait, avec l’habituelle curiosité provinciale, cet inconnu qui avait grand air, en dépit de ses vêtements usés et fanés, du vieux feutre gris couvrant en partie ses cheveux bruns légèrement frisés. Le jeune homme reconnaissait quelques visages d’autrefois. À un vieux chaudronnier debout au seuil de sa porte, il dit gaiement :
– Bonjour, père Pinsonneau.
Et, souriant de l’ébahissement du bon homme, il continua sa route après lui avoir adressé un amical signe de tête.
Une tourelle du XIIIe siècle, à l’angle d’une maison, un linteau sculpté au-dessus d’une porte, rappelaient l’ancienneté de la petite ville. Vers l’extrémité de la rue se dressait, à droite, une demeure d’assez belle apparence, bâtie en pierre et brique. Comme Lorenzo y atteignait, la porte s’ouvrit et un petit homme maigre, grisonnant, à la figure bilieuse, commença à descendre les trois marches conduisant au trottoir. Lorenzo s’arrêta devant lui en disant avec une nuance d’ironie dans la voix :
– Bonjour, mon cousin.
M. Adrien Barbelier, ex-avocat au barreau de Bordeaux, s’immobilisa en attachant sur le jeune homme des yeux quelque peu ahuris.
Lorenzo eut un rire légèrement railleur.
– Eh bien ! vous ne me reconnaissez pas ?
– Vraiment... oui... on dirait Lorenzo !
– Lui-même, mon cousin.
M. Barbelier, reprenant ses esprits, se mit à le considérer des pieds à la tête.
– Oui, oui... Mais que te prend-il d’arriver ainsi sans crier gare, alors que depuis des années personne n’a reçu de tes nouvelles ?
– Oh ! des nouvelles de moi, cela n’aurait pas intéressé grand monde, par ici. Quant à prévenir, non ; j’aime les arrivées impromptu.
M. Barbelier riposta, d’un ton aigre-doux :
– Moi, je déteste cela... et je crois que ta belle-mère sera de mon avis.
L’expression sarcastique s’accentua sur la physionomie de Lorenzo.
– Je n’en doute guère ! Évidemment, je vais la gêner en revendiquant mon bien. Convenez cependant que j’ai été bon prince en lui en laissant bénévolement la jouissance jusqu’ici ?
– Tu n’as fait au contraire que ton devoir, car, étant la femme de ton père, elle a droit aussi...
Lorenzo fronça les sourcils et sa physionomie prit une expression dure qui s’associait à l’accent un peu âpre de sa voix tandis qu’il ripostait :
– Des droits ?... Elle n’en a aucun sur cette demeure qui m’appartient de par la volonté de mon père. Ses enfants et elle ont reçu ce qui restait d’argent et, moi, j’ai eu la maison pour ma part.
– Eh ! je ne dis pas le contraire. Mais je parlais d’un droit moral.
– Un droit moral ? Lequel donc ? Elle a aidé mon père à précipiter sa ruine ; elle est arrivée à me séparer de lui après m’avoir montré en toute occasion son antipathie. Non, je ne lui dois rien, absolument rien. Quant à mon frère et à ma sœur, c’est différent. Au cas où ils auraient besoin de mon aide, je ne la leur refuserais pas, car, là, c’est mon devoir.
Tandis que parlait ainsi Lorenzo, M. Barbelier continuait de l’examiner. Son regard s’attachait sur la vieille valise, sur les chaussures qui, visiblement, avaient fait un long usage. Sa bouche mince se plissa en un rictus de dédain, tandis qu’il demandait narquoisement :
– Quelle sorte d’aide ? Pas une aide pécuniaire, si j’en crois les apparences ? Tu ne rapportes pas la fortune d’Afrique, hein, Lorenzo ?
– Vous m’avez assez prédit que je n’arriverais jamais à rien, mon cousin ! Et vous voilà ravi d’avoir deviné si juste ?
– Ravi, non pas... Mais je te connaissais trop bien pour ne pas prévoir une non-réussite. Les faits sont venus me donner raison, puisque te voilà de retour... guère plus riche qu’en partant, j’imagine ?
Lorenzo saisit au passage le coup d’œil méprisant qui s’attachait à ses vieux vêtements. Il eut un rire moqueur en répliquant :
– Vous trouvez que je n’ai pas l’apparence d’un homme ayant fait fortune ?... Bah ! je m’en console, cher cousin ! L’argent est une chimère et je prétends le traiter comme tel.
– Ta, ta, ta ! Tu crânes, mon bel ami, mais je ne suis pas dupe de tant de résignation. L’argent, tu l’aimes, tout comme les autres ; malheureusement pour toi, il a dédaigné de venir en ton escarcelle... Et que vas-tu faire maintenant ? Ici, tu ne peux trouver à gagner ta vie.
– Je chercherai sans doute une situation à Bordeaux.
– À Bordeaux... oui. Mais pourquoi pas à Paris ?
Une lueur narquoise brilla dans les yeux de Lorenzo.
– Évidemment, Paris est plus loin de Treilhac... Mais j’ai le temps de réfléchir, car je veux faire un petit séjour ici, dans mon vieux logis.
La maigre figure de M. Barbelier s’allongea.
– Ah ! Qu’est-ce que tu vas y faire ? Avec quoi vivras-tu ?
– Je possède quelques petites économies, suffisantes pour payer ma nourriture. Comme distraction, j’aurai la pêche. Oh ! je ne m’ennuierai pas !
La lueur de gaieté railleuse se faisait plus vive dans les yeux noirs.
– ... Montiez-vous en ville, mon cousin ? Nous pourrions, en ce cas, faire route ensemble jusqu’à la place ?
M. Barbelier dit précipitamment :
– Non, je vais à la gare, où j’ai affaire... Bonsoir, mon garçon.
Il tendit deux doigts à Lorenzo, d’un geste protecteur.
– Bonsoir, mon cousin. Mes hommages à mes cousines. Clémentine et Andrée doivent être des jeunes filles, maintenant ?
– Clémentine est mariée à un médecin de Périgueux. Très joli mariage. Un garçon fort capable... Bonsoir, bonsoir !
Il s’en alla, en frappant le sol de sa canne à pomme d’or.
Lorenzo continua son chemin. Ses dents mordaient légèrement les lèvres très rouges ; un vif amusement luisait dans le noir velouté de ses yeux, tandis qu’il songeait : « Eh ! cet excellent Barbelier n’est guère désireux de se montrer à travers Treilhac en compagnie d’un cousin aussi minable ! Il ne m’a même pas offert de venir voir sa femme et ses filles. Délicieux parent ! Bordeaux est beaucoup trop près d’ici, à son avis, car je pourrais m’aviser de lui demander « les recommandations... ou même un prêt, qui sait ? »
Lorenzo s’engagea dans la rue aux Bœufs, qui montait assez fortement. Un jour, en la descendant à toute vitesse avec des camarades, il était tombé et s’était ouvert le front. Sa belle-mère, en guise de réconfort, l’avait appelé chenapan. Jamais il n’avait trouvé chez elle un peu de bonté, ni même de justice. Et il savait que son père, trop faible, avait souffert par elle.
En haut de la rue apparaissait une silhouette féminine vêtue de noir. En dépit des années écoulées, le jeune homme la reconnut aussitôt. C’était Mme Loriot, vaguement parente des Damplesmes, imposante dame qui avait tenu Lorenzo sur les fonts du baptême. Le lien spirituel ne l’avait d’ailleurs pas rendue plus indulgente pour lui, à l’époque de ses démêlés avec sa belle-mère. Lorenzo se souvenait même d’une certaine scène qui s’était passée chez elle et au cours de laquelle il avait reçu de blessants reproches. Peu après, il était parti pour le régiment sans la revoir.
De loin, elle regardait le jeune homme qui continuait d’avancer tranquillement. Il ne la trouvait pas changée. Elle gardait la même allure assurée, la même façon de redresser la tête, de pointer son long nez avec un air de dire : « C’est moi, Mme Loriot, présidente de dames de charité, présidente du vestiaire des pauvres, du comité pour la diffusion des bonnes lectures... et candidate à toutes les présidences éventuelles. »
Quand Lorenzo fut à sa hauteur, il alla carrément à elle et ôta son vieux feutre en disant avec une courtoisie teintée d’ironie :
– Permettez-moi de vous saluer, madame. Reconnaissez-vous l’enfant prodigue, qui revient au bercail ?
Mme Loriot prétendait ne jamais s’étonner de rien. Cette fois, pourtant, elle eut grand-peine à réprimer un haut-le-corps. Ses yeux aigus dévisagèrent le jeune homme. Puis elle dit, en affectant un grand calme :
– Ah ! c’est vous, Lorenzo ? On finissait par croire à votre mort, ici. Vous n’avez prévenu personne de votre retour ?
– Personne. C’est une surprise que je fais à tous.
– Une grande surprise, en effet... Qu’êtes-vous devenu, pendant tout ce temps-là ?
Elle parlait du bout des lèvres, en toisant le jeune homme avec une pitié dédaigneuse.
– Mais j’ai travaillé pour gagner ma vie.
– Et vous revenez aussi peu nanti qu’au départ, naturellement ? Votre cousin Barbelier l’avait assez dit. Et les Monceau donc !... Ceux-là vous connaissaient et savaient que vous n’êtes pas de ceux qui deviennent millionnaires, ou même simplement arrivent à faire de sérieuses économies.
– Admirable perspicacité de ma famille et de mes concitoyens ! Oui, j’ai peut-être eu tort de ne pas les écouter. Mais la jeunesse est aventureuse, que voulez-vous ! Quoi qu’il en soit, je ne regrette pas les années passées là-bas.
– Cela, c’est votre affaire. Mais si vous revenez sans argent... hum ! mon ami, il ne faut pas compter en trouver chez votre belle-mère.
– Je ne demanderai rien à Mme Damplesmes, rassurez-vous – rien que ce qui m’est dû, c’est-à-dire l’abri du toit qui m’appartient. Pour le reste, je saurai me suffire par mon travail.
– Allons, tant mieux... Bonne chance ! Bonsoir !
Elle lui adressa un petit signe protecteur et continua sa route.
Lorenzo dit entre ses dents :
– Voilà un filleul qui ne fait pas honneur. À laisser de côté ! Et de deux ! Maintenant, à ma chère belle-mère !